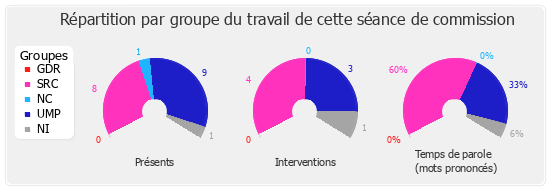Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Séance du 13 mai 2008 à 16h45
La séance
Le Président Didier Migaud : Nous accueillons, pour nous éclairer sur la crise financière et ses répercussions sur l'économie réelle : M. Christian de Boissieu, président délégué du Conseil d'analyse économique, professeur à l'université Paris I ; M. Jean-Hervé Lorenzi, qui est membre du Conseil d'analyse économique, conseiller du directoire de la Compagnie financière de Rothschild, professeur à l'université de Paris Dauphine et président du Cercle des économistes ; M. Xavier Timbeau, membre de l'Observatoire français des conjonctures économiques et M. Marc Touati, directeur général des études économiques à Global Equity.
Cette audition se situe dans le prolongement de celles que nous avons consacrées depuis plusieurs mois à la crise financière et à ses effets, qui ne sont pas limités à la sphère financière, mais ont affecté et continuent d'affecter l'économie réelle.
Les fondamentaux de l'économie mondiale, les systèmes d'échanges sont en profonde et rapide mutation, sous l'effet de la hausse des cours des matières premières et de l'énergie, et de la faiblesse du dollar. La situation nouvelle reste à interpréter afin de mieux appréhender les options qui s'offrent en matière économique et financière, notamment aux pays de la zone euro.
Je vous propose d'entrer dès à présent dans le vif du sujet en laissant chacun de nos invités nous faire part de ce qui lui paraît le mieux caractériser la situation actuelle, de son appréciation des réponses adoptées par les différents pays et, éventuellement, de celles qu'il faudrait adopter.
Même si mon optimisme me pousse à penser que le plus dur est derrière nous, la crise financière n'est pas finie, pour au moins trois raisons. Premièrement, les prix des logements aux États-Unis vont continuer de baisser en 2008. La seule incertitude, c'est de combien – sans doute entre 5 % et 10 %. Or cette chute a été le détonateur de la crise des subprimes, qui s'est ensuite diffusée via la titrisation. Le surendettement des ménages américains et la situation des prêteurs vont donc encore s'aggraver. Deuxièmement, la crise de confiance entre les banques persiste. Les banques centrales ont fait leur travail en injectant massivement des liquidités, mais elles n'ont pas ramené la confiance qui demanderait davantage de transparence sur les positions de chacun. Le G7 a eu raison, à Washington, de donner un délai pour accélérer l'apurement des comptes. Troisièmement, il y a forcément un décalage entre la crise et sa transcription comptable. Les banques et les compagnies d'assurances vont continuer dans les mois qui viennent à révéler des dépréciations d'actifs, voire des pertes pour les établissements les plus touchés.
Cette crise américaine est susceptible de se diffuser à travers trois canaux. S'agissant, premièrement, de l'activité, je ne crois pas au découplage entre l'Europe et les États-Unis. Nous sommes dans la crise, plus ou moins, selon les pays. Le scénario américain conditionnera la capacité de résistance des grands pays émergents. Ce sont eux qui, depuis trois ans, expliquent la résistance – ou la résilience – impressionnante de la croissance aux multiples chocs : choc pétrolier, crise alimentaire, chocs financiers et géopolitiques. Il y a cinq ou dix ans, la conjoncture américaine aurait immanquablement affecté l'Amérique latine. Or, aujourd'hui, la croissance résiste. En Chine, elle sera comprise entre 9 % et 10 % cette année, au lieu de 11,5 % l'année dernière ; en Inde, elle sera autour de 7 %, contre 7 % à 8 %, idem en Russie. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de récession importante et durable aux États-Unis. Et il ne devrait pas y en avoir, parce que les États-Unis ont joué sur trois leviers que l'Europe n'a pas pu ou voulu utiliser : la politique monétaire avec la baisse des taux – le taux directeur de la Fed est aujourd'hui de 2 % –, le taux de change, et la politique budgétaire avec le paquet fiscal « bipartisan » décidé il y a quelques semaines. Bien sûr, la croissance européenne est touchée. L'année dernière, la France a connu une croissance nettement inférieure à celle de la zone euro – 1,9 % contre 2,6 % – mais, avec le ralentissement allemand, cette année, elle devrait se situer autour de la moyenne. Deuxièmement, le canal bancaire : les banques françaises sont affectées, certes, mais plutôt moins que les banques suisses, allemandes ou britanniques. Les banques françaises vont sans doute devenir plus sélectives. Je ne parle pas de credit crunch parce que, d'après les derniers chiffres connus, le crédit au secteur privé augmente encore à un rythme de plus de 10 % dans la zone euro et en France. Cependant, le problème du financement des PME, qui est structurel, se posera de manière plus aiguë car la sélectivité ne pèsera pas également sur les particuliers et les entreprises. Enfin, le troisième canal est le taux de change. Le dollar, déjà faible, est encore affaibli par la crise, c'est-à-dire par le ralentissement de l'économie couplé à la dynamique des taux courts : face à une Fed très réactive, la BCE n'a pas touché à son taux directeur depuis juin 2007. Depuis une semaine, le dollar remonte un peu. Il est un peu tôt pour se réjouir car la Fed n'a peut-être pas dit son dernier mot, tandis que la BCE, pour baisser son taux directeur, attendra que l'inflation soit retombée dans la zone euro.
Que faire ? Le dollar va rester faible, il risque même de rechuter compte tenu de l'ampleur des déficits américains. Dans un contexte où la BCE ne modifiera pas son taux directeur, la question d'une action coordonnée des banques centrales n'est pas absurde à condition que les Américains soient avec nous. Il faudrait que la baisse de leur monnaie ait atteint un niveau tel qu'ils aient intérêt à agir. Ce n'est sans doute pas encore le cas et l'acharnement de M. Paulson et d'autres à répéter qu'ils sont pour un dollar fort est suspect. Le problème de la zone euro n'est pas tant la parité bilatérale euro-dollar que la baisse de toutes les autres monnaies – yen ou livre sterling. En termes de taux de change effectif, l'euro est pratiquement la seule monnaie qui monte. Le G7-G8 du mois de juillet à Hokkaido devrait se demander s'il faut continuer à inciter la Chine à faire évoluer son taux de change et à quelles conditions elle pourrait l'accepter.
Quant au policy mix, j'espérais une politique monétaire européenne un peu plus pragmatique, sans changer les textes. Il n'est pas question de mettre en cause l'indépendance de la BCE. Le ralentissement de la croissance ne nous aide pas beaucoup, nous Français, à cause de son impact sur notre déficit public. La France aura beaucoup de mal à faire passer ses thèses quand elle présidera l'Union européenne si, dans le même temps, elle affiche des comptes publics encore dégradés. Elle est prise dans la quadrature du cercle : comment rallier ses partenaires qui ne lui feront pas de cadeaux, à commencer par l'Allemagne, qui a déjà fait des concessions sur l'Union de la Méditerranée, et qui a connu, en matière budgétaire, une réduction très rapide et très importante de son déficit ? Les recettes étant sous contrainte, le débat se reporte sur la dépense. Je salue les nouvelles procédures telles que la LOLF ou la RGPP, mais ce ne sera pas en trois ou quatre mois qu'elles porteront leurs fruits.
Un dernier mot sur les politiques structurelles. D'une part, nous avons fait au Premier ministre plusieurs recommandations en matière de régulation bancaire et financière. D'autre part, la commission Attali, dont j'étais membre, a fait des propositions pour gagner un point de croissance. Dans le contexte actuel, il ne faut pas ralentir le rythme des réformes car l'objectif visé est le défi français des deux ou trois prochaines années. Le peu de marge de manoeuvre budgétaire doit être utilisé à faciliter la croissance des petites entreprises, à améliorer la qualité de nos universités. Malgré la question du pouvoir d'achat qui est importante à moyen terme, la priorité va à la consolidation du sentier de croissance.
Même si je partage beaucoup des analyses de Christian de Boissieu, ma position diffère un peu de la sienne en ce qu'elle est plus interrogative et plus pessimiste.
Nous assistons à une course de vitesse entre une crise classique, celle de l'immobilier, et une crise systémique, extrêmement grave et inquiétante à laquelle les économistes n'ont pas beaucoup de réponses à apporter. Le risque existe de voir la crise bancaire dégénérer en crise financière majeure, mais le pire n'est pas sûr. Il faut déjà dresser un état des lieux précis, car nous sommes dans le brouillard.
Le rôle des subprimes est connu ; ce qui l'est moins, c'est la façon dont la crise s'est diffusée, à partir de quelques milliers de Special Investment Vehicles, de Collateralised Debt Obligations, selon une mécanique financière complexe, sécrétant sa propre logique. Il n'est pas sûr que l'on sache aujourd'hui déterminer l'ampleur de ce qui est en jeu : à l'heure qu'il est, nous en sommes, hors AIG, à 310 milliards de dollars de dépréciations d'actifs, tandis que le FMI parle, lui, à juste titre à mon avis, de 1 000 milliards. La création d'instruments bancaires parallèles, non contrôlés, a permis aux trente ou quarante premières banques mondiales de sortir des créances de leur bilan via la titrisation, mais elles restent au coeur de la tourmente. Il n'est pas sérieux de dire que la crise financière est derrière nous – si tant est que la fourchette donnée soit la bonne –, ne serait-ce que parce qu'AIG ne sera pas la seule compagnie d'assurance à être touchée dans de telles proportions. L'incertitude subsiste donc quant à l'ampleur du phénomène. Le seul point commun avec 1929, ce sont les annonces en décalage avec la réalité. À la veille du Jeudi noir, Irving Fisher déclarait que le problème était sous contrôle, ce qui incite à la modestie. Comment en sortir ? Par une meilleure régulation, comme le prônera le prochain rapport de Patrick Artus, Jean-Paul Betbèze et Christian de Boissieu.
La titrisation, nous sommes tous d'accord, est une bonne chose pour aller chercher l'épargne là où elle existe. Le déficit commercial américain a permis de créer de l'activité au niveau mondial, sur la base d'un accord entre les pays émergents, qui produisaient, et les pays occidentaux qui achetaient, les États-Unis se finançant auprès des banques centrales des premiers, ou bien grâce à la titrisation. L'équilibre a été rompu à cause d'un phénomène historique : jamais, depuis un siècle, le système bancaire n'a connu un tel taux moyen de rentabilité. Les grandes banques d'investissement américaines, et derrière elles, tout le système bancaire, ont été entraînées dans une double dérive : aller chercher des clients insolvables – c'est la crise des subprimes – et transformer la mécanique bien connue de la titrisation en une machine infernale. Nous sommes d'accord aussi pour souligner à quel point les normes comptables et la nouvelle réglementation prudentielle sont pro-cycliques. Le principe du mark to market accélère l'enregistrement des dépréciations d'actifs. Le système qui s'est créé autour de la titrisation crée par ailleurs des conflits d'intérêts entre les emprunteurs, les cédants, les arrangeurs, les sociétés de gestion, les réhausseurs de crédit, les agences de notation, les autorités de tutelle et les investisseurs. On ne peut pas en sortir en quelques mois.
J'ai la conviction que la priorité des priorités, c'est de tout faire pour éviter un nouvel incident, ou accident. Nous n'en sommes pas à l'abri. La réorganisation du système financier mondial ne se fera pas sans la moitié de l'économie mondiale, c'est-à-dire sans les pays émergents. Je souscris donc à la proposition de réunir autour d'une même table les ministres des finances, les banquiers centraux, les banquiers, les agences de notation qui sont le danger public n° 1, en intégrant non seulement la Chine et l'Inde, mais aussi, notamment, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Les agences de notation se sont révélées incapables d'évaluer les produits complexes. Six mois avant que la crise n'éclate, aucune ne mentionnait les risques potentiels, même les plus évidents. Il faudrait donc, comme le suggèrent Patrick Artus et Jean-Paul Betbèze, que la Commission européenne puisse donner son label à d'autres agences que les deux et demie qui ont reçu l'aval de la SEC. À propos de la régulation, et plus particulièrement des réformes Bâle II et Solvency II, je souligne que, dès avant la crise, 70 % des produits de titrisation avaient été rachetés par des hedge funds, qui sont en dehors du champ. Difficile de réguler quoi que ce soit dans ces conditions. Pour éviter la combinaison des deux crises, il faut, d'une part, autoriser le système bancaire à amortir les dépréciations d'actifs sur cinq, dix, quinze ou vingt ans, pour éviter qu'un credit crunch ne contribue à propager la crise financière à l'économie réelle. Sinon, les banques vont devoir se procurer des fonds propres car ce qui était en hors bilan va devoir remonter dans leur bilan. D'autre part, en début d'année, de grandes banques ont envisagé de créer un grand fonds, rassemblant tous les produits titrisés difficiles pour un montant de l'ordre de 300 à 500 milliards de dollars. Seuls les pouvoirs publics mondiaux pourraient mettre en oeuvre un tel instrument, conforme à ce qui s'est fait, toutes proportions gardées, en France pour le Crédit Lyonnais. Le Gouvernement français devrait réfléchir avec ses partenaires européens à la manière de protéger le système bancaire d'un deuxième choc, dont il aurait beaucoup de mal à se remettre.
Il s'est produit aux États-Unis un choc spécifique, comparable à l'éclatement de la bulle Internet, qui conduira à un ralentissement, voire à une récession, et auquel se superpose la crise financière. Les chiffres annoncés – entre 300 milliards et 1 000 milliards de dollars – ne sont pas si considérables rapportés à la capitalisation boursière mondiale des banques, qui est mille fois supérieure. Le système financier capitaliste est destiné à réaliser du profit, et à encaisser des pertes. Il s'agit donc d'un accident notable, mais pas insurmontable. En revanche, les faillites de banque sont des événements potentiellement très graves, avec des conséquences en chaîne. Les banques centrales doivent à tout prix éviter la faillite, soit en prêtant directement à ceux qui sont menacés, soit en baissant les taux, soit encore en organisant très rapidement leur reprise, comme pour Bear Stearns, dont les actionnaires ont été proprement déshabillés, y compris les employés et les retraités. C'est le jeu du capitalisme – on ne peut pas toujours gagner – et aller contre la loi de la jungle capitaliste reviendrait à privilégier certains prédateurs par rapport à d'autres. On sait ce qu'il en coûte de bouleverser un écosystème ! Il est tout de même paradoxal d'entendre les tenants du capitalisme n'avoir à la bouche que le mot magique de « régulation » et prôner de passer d'un système où chacun était libre de faire à peu près ce qu'il y voulait – y compris des montages financiers complexes, que l'on trouve, surtout a posteriori, aberrants – à un autre, où les règles éviteraient de perdre trop. Si l'on régule, il faut agir de façon extrêmement approfondie, avec des objectifs de bien-être social, au lieu de se borner à écouter ceux qui crient le plus fort et qui sont les mieux organisés. Or, aujourd'hui, les banques usent de l'impérieuse nécessité qu'aucune d'elles ne fasse faillite, pour obtenir des règles qui protègent leurs positions acquises. La mise en commun des titres difficiles relève d'une démarche oligopolistique. Tolérer des comportements de ce type en période de crise, c'est s'exposer à instaurer en faveur de quelques-uns une rente qui ira grandissant et finira par étouffer les autres. On aura dans un premier temps l'impression de sauver le système, mais on finira par se rendre compte qu'on aura enrichi ceux qui ne le méritaient pas, au détriment des contribuables, des salariés, des PME… Empêcher les faillites de banque, c'est un impératif, réguler la finance mondiale, c'est un tout autre chantier !
En tout état de cause, il est indispensable, quelle que soit la perte réelle, que le système puisse absorber des pertes de capitalisation boursière de cet ordre de grandeur, sans remettre en cause le fonctionnement de l'économie mondiale. Si le secteur des fruits et légumes, confronté à une mauvaise récolte, menaçait l'économie d'une récession mondiale, cela ferait sourire. Quand ce sont les banquiers qui sont en difficulté, ils font peur et on leur donne raison. Si le niveau de concurrence entre banques est suffisant, elles ne pourront pas prétexter les subprimes pour renchérir le coût du crédit. Après tout, quand votre garagiste commet une bévue, il ne double pas pour autant le prix de la vidange et, si jamais l'envie l'en prenait, il ne vous reverrait plus. Il n'y a pas de raison de se comporter autrement avec son banquier. Si l'organisation du marché du crédit n'est pas oligopolistique, ce sont les banques et leurs actionnaires qui perdront de l'argent. Le capitalisme moderne se développe par une alternance de cycles de croissance accélérée et de phases de digestion, une succession de bulles qui se forment avant d'éclater, et il est important que les mécanismes de régulation préservent la symétrie du processus en ne garantissant pas à certains opérateurs de ne pas perdre alors que rien n'a été prévu en phase ascendante pour limiter leurs gains.
L'inflation constituerait un nouveau choc, en accentuant la crise financière, ce qui nous ramènerait à la stagflation des années soixante-dix. Cette analyse expliquerait l'extrême prudence de la BCE, à l'opposé de l'attitude de la Réserve fédérale qui a laissé se développer les tensions inflationnistes qui apparaissent un peu partout, à commencer par les marchés du pétrole et des denrées alimentaires. Certes, la hausse des prix est un signal de tension pour réguler la pénurie. Elle est caractéristique d'une croissance globalisée et, dans ce schéma, l'inflation va de pair avec une croissance très forte. En cas de ralentissement mondial, cette composante de l'inflation disparaîtra spontanément. L'inflation peut également être alimentée par la globalisation et les inégalités : les marchés locaux, s'approvisionnant localement avec des importations à la marge, se sont ouverts à un marché mondial parfaitement globalisé, si bien que l'appétit et les moyens d'un Africain sont désormais en concurrence avec ceux d'un cochon chinois, lequel se tend à se multiplier au fur et à mesure que les Chinois mangent de plus en plus de porc, ou même d'un cochon européen. Les prix montent avec des conséquences variables au Nord, où les produits les moins chers augmentent mais où l'impact est limité, et au Sud qui est le théâtre d'émeutes de la faim parce que les habitants n'arrivent plus à se nourrir décemment. On a coutume de dire que les effets de l'économie de marché doivent être atténués par des mécanismes de solidarité entre les plus riches et les plus pauvres parce que le marché peut être extrêmement inégalitaire. Nos pays admettent des mécanismes de redistribution ; il en faut aussi si l'on veut des marchés globalisés, en particulier pour les denrées alimentaires. C'est une mauvaise nouvelle car cela coûtera cher, à moins que l'on ne décide de recloisonner les biens fondamentaux pour ne plus les soumettre à la loi du marché. En tout état de cause, il ne s'agit pas du processus inflationniste tel qu'on pouvait l'observer dans les années soixante-dix.
L'inflation, proprement dite, menacerait dans les pays développés à cause de la perte de pouvoir d'achat, qui est réelle quoique limitée, et qui réveillerait les revendications salariales, lesquelles susciteraient à leur tour la crainte chez les banquiers centraux. C'est aller un peu vite en besogne. Pour qu'il y ait processus inflationniste, il faudrait, d'une part, que les entreprises acceptent les augmentations de salaire, d'autre part, qu'elles les répercutent sur leur prix de vente. L'augmentation des salaires en économie de marché n'est pas nécessairement un drame irrémédiable. Dans les faits, la spirale inflationniste est loin d'être enclenchée : les hausses de prix sont circonscrites à l'énergie et aux produits alimentaires, les augmentations de salaire sont limitées pour le moment et elles n'engendrent pas de hausse des prix. Le rythme de progression des coûts salariaux unitaires dans l'ensemble des pays développés est au plus bas. On observe paradoxalement des hausses de prix sans hausse des coûts. On est loin d'une situation inflationniste. Quant aux revendications salariales, elles peuvent être en partie légitimes. On constate, en effet, que, dans la plupart des pays, le partage de la valeur ajoutée est défavorable aux salariés, de façon caricaturale aux États-Unis ou en Allemagne, un peu moins au Royaume-Uni et en France. Et si l'on se fie à la rentabilité du capital, c'est-à-dire les revenus du capital immobilisé, et qui est un indicateur plus pertinent, on observe, au plan macroéconomique, que le niveau de rentabilité réelle est au plus haut, grâce en partie à la globalisation financière. Il est difficile d'avoir une approche normative dans ce domaine mais, comme la rentabilité est historiquement élevée, elle est plus proche de son point culminant que de son niveau le plus bas. En France, elle est supérieure à 8 %, taux qu'il faut comparer à ceux proposés aux clients des banques. Sans considérer qu'une telle rémunération soit illégitime, on peut penser que les propriétaires d'une entreprise pourraient se satisfaire d'un niveau un peu moindre. Dans cette optique, les hausses de salaire tant redoutées pourraient se traduire non pas par une hausse des prix, mais par une baisse de la rentabilité du capital. Les revendications des salariés, mal formulées, ne cacheraient-elles pas, au fond, une aspiration à un partage du gâteau plus favorable, plutôt qu'à la simple conservation du pouvoir d'achat ?
La crise financière est une fable morale qui prouve que, quand un banquier ou un professionnel de la finance proposait un rendement de 15 % sans risque, c'était un mensonge, même si, avec la complicité de certains, dont les agences de notation, il donnait l'impression du contraire. Mais, et le lien avec la crise financière est là, dans le même temps, les prêteurs exigeaient de la PME du coin qu'elle lui serve les mêmes rendements, sous peine de mort. Laisser se purger cette folle illusion du 15 % de rendement sans risque aura pour bénéfice immédiat que les PME pourront se financer moins cher. Et avec 7 % de rendement, la pression retombe, on vit plus confortablement, y compris en payant mieux ses salariés.
Aujourd'hui, le risque inflationniste serait plus de mettre en place des régulations pour maintenir le système financier dans l'illusion qu'il peut continuer à servir 15 %, ce qui obligerait les entreprises à répercuter dans leurs prix les hausses de salaire qu'elles subiraient. En revanche, si la crise financière conduisait à abaisser l'exigence de rentabilité, il y aurait la possibilité de résorber d'autres déséquilibres, notamment salariaux, sans pour autant être pris dans une spirale inflationniste. La mécanique est complexe car le niveau de rentabilité ne se décrète pas, surtout dans une économie globale. Mais, en tout état de cause, le marché ne parvient à l'équilibre que s'il fonctionne librement et perturber les équilibres ne profite pas toujours à ceux que l'on voudrait. En revanche, le sort des pauvres Africains en concurrence avec les cochons chinois ou bretons est beaucoup plus dramatique et cela plaide beaucoup plus en faveur d'une régulation que de la libre concurrence, dont le fonctionnement pourrait avoir des conséquences tout à fait détestables.
Les crises sont inévitables. La spéculation fait partie des marchés. Il serait illusoire d'imaginer la supprimer. Sans spéculation, il n'y a pas de liquidités sur les marchés, pas de prise de risque ni de couverture de risque. Les produits aujourd'hui incriminés, les produits optionnels et complexes, permettent, à la base, de couvrir le risque. Et ceux qui prennent des risques, ce sont les spéculateurs. Ils ont donc un rôle à jouer.
Cela dit, laisse-t-on une crise financière devenir une récession économique ? Ce fut le cas en 1929, où, à la différence d'aujourd'hui, on était en période de déflation et où la Réserve fédérale américaine a refusé de baisser les taux d'intérêt sous prétexte que ce n'était pas à elle de faire plaisir aux méchants spéculateurs. Elle avait considéré qu'il fallait laisser faire le marché et avait maintenu des taux d'intérêt très élevés. Je vous rassure, Jean-Claude Trichet n'était pas à la FED à l'époque…
L'économie est une science humaine, non une science exacte. Cela signifie qu'elle peut être influencée par les hommes et les femmes, en fonction de leur réactivité.
Le monde est confronté à une crise financière grave, qui aurait pu devenir une récession grave d'un point de vue économique, mais qui ne le deviendra pas grâce à la réactivité de la Réserve fédérale américaine, qui a en fait agi comme si l'on était en récession.
C'est pourquoi j'exclus le scénario d'un écroulement de la croissance américaine, qui devrait redémarrer progressivement, après un deuxième trimestre encore mauvais, pour atteindre 1,8 % en moyenne annuelle.
J'ai d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi le FMI a annoncé 0,5 % de croissance pour cette année, alors que l'acquis de croissance était déjà de 1,1 % à la fin du premier trimestre. Cette prévision pessimiste repose sur l'hypothèse que le PIB baisse sans remonter ensuite, alors que l'on peut faire jouer les trois armes dont on dispose – budgétaire, monétaire, et du change.
Les Américains sont en train de vivre la période la plus dure, même si, d'un point de vue bancaire, il y aura certainement encore des mauvaises surprises. La Réserve fédérale a joué son rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle n'a pas laissé les banques faire faillite, selon le principe too big to fail. Les banques ne sont pas des marchands de légumes : lorsqu'un grand établissement fait faillite, on peut craindre un effet domino.
Il y a toutefois des aléas moraux. Les banques sachant qu'elles sont soutenues quoi qu'il advienne, elles peuvent se laisser aller à faire un peu n'importe quoi. Mais, au-delà de ces petites tempêtes à moyen terme, je pense que l'économie américaine va redémarrer assez rapidement à partir du troisième trimestre et qu'elle retrouvera son niveau de croissance structurelle de 3 % à partir de l'année prochaine.
Je suis en revanche beaucoup moins optimiste et même inquiet pour l'économie européenne. En économie, comme partout, on n'a que ce que l'on mérite. En Europe, comme on n'a rien fait, on n'aura rien… On n'a aucune marge de manoeuvre de relance budgétaire. La politique monétaire est excessivement restrictive et l'euro est trop fort. Nous revivons aujourd'hui ce que nous avons connu en 2002. On tenait d'ailleurs alors le même discours : pour les États-Unis, c'est fini, pour l'Europe, tout va bien. Or, les Américains ont redémarré dès 2002-2003 et la zone euro uniquement en 2006 – grâce notamment à la baisse de l'euro en 2005. En 2001-2002, l'euro valait un dollar. Aujourd'hui, il est monté à 1,60. Si l'on intègre la hausse de l'euro dans l'évolution des taux d'intérêt – c'est-à-dire, si l'on calcule l'indicateur des conditions monétaires, composé du taux d'intérêt de la BCE augmenté du change –, c'est comme si nous avions aujourd'hui des taux d'intérêt de 5,25 %. La situation est donc même pire qu'en 2002.
La crise n'est pas finie, en particulier en Europe. Les banques européennes risquent de se trouver en difficultés et les mauvaises nouvelles de s'accumuler. Tout l'enjeu aujourd'hui est là. Alors que l'activité américaine va permettre aux États-Unis d'avoir une croissance plus forte, en Europe, elle sera très molle.
J'en tirerai deux conclusions et deux perspectives.
Premièrement, dans la zone euro, la BCE finira par baisser les taux. Mais elle le fera trop tard. Toute inflexion de politique monétaire n'agit sur l'activité qu'au bout de six à neuf mois. C'est le délai qu'il faudrait pour qu'une baisse des taux produise ses effets. Il est donc trop tard pour 2008 : dans le meilleur des cas, on aura une croissance de 1,6 % dans la zone euro, et d'environ 1,4 % en France. Et le déficit public de cette dernière atteindra environ 3 % du PIB cette année.
L'autre conséquence – que je vis au quotidien –, c'est que les clients demandent aujourd'hui à avoir des produits financiers qu'ils puissent comprendre. Il faut reconnaître qu'ils sont de plus en plus complexes, réalisés uniquement via des modèles mathématiques indépendants des fondamentaux économiques. On fait miroiter des gains de 6, 10, voire 15 %, ce qui est, par définition, faux, car plus le rendement est élevé, plus le risque l'est également. C'est la loi de base de la finance.
La crise est salutaire, puisqu'elle conduit à retrouver le sens des réalités. C'est une sorte de revanche de l'économie réelle sur l'économie financière. Or la réalité de la première aujourd'hui, c'est l'investissement des entreprises. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'investissement des entreprises en équipement croît de 6 % par an. En période de récession, il diminuerait de 10 %. Les indicateurs avancés de l'investissement, c'est-à-dire les carnets de commande des biens d'équipement, annoncent que cette augmentation va se poursuivre. Quand on a l'investissement, on entre dans ce qu'on appelle le cercle vertueux, résumé par la formule : l'investissement génère de l'emploi, donc du revenu, donc de la consommation.
En résumé, nous sommes confrontés à une crise grave. Les États-Unis sont réactifs, pas l'Europe. Cette dernière va revivre ce qu'elle a connu en 2002 : son économie va s'enliser dans la croissance molle tandis que celle des États-Unis va redémarrer.

En réponse à une remarque de M. de Boissieu vis-à-vis des Allemands, je rappelle que la France est aujourd'hui complètement « déshabillée » en aéronautique à leur profit.
M. Touati a répondu en partie à la question que je voulais poser. Si la France n'a pas l'arme du change, elle a encore celle des taux. Or, elle ne l'utilise pas, sous prétexte qu'il y a de l'inflation – même si on peut discuter de sa nature structurelle. Faut-il demander à M. Trichet de revenir devant la Commission et l'empêcher de sortir jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose…

Ma première question porte sur la vitesse de propagation de la crise, qui est beaucoup plus grande que par le passé. Un certain nombre de facteurs et d'instruments – la titrisation, les nouvelles normes comptables IFRS – contribuent à faire ressortir plus rapidement les éléments de dépréciation. Est-ce un désavantage ou cela permet-il de réagir plus rapidement et plus efficacement ?
Ma seconde question concerne l'euro et le dollar. Les politiques des autorités monétaires américaines et européennes ont chacune leur logique. Mais, l'important, ce sont les arbitrages que font les tiers, c'est-à-dire les détenteurs de devises. Pensez-vous que la préférence pour le dollar sera éternelle ? N'assistons-nous pas aujourd'hui à un certain basculement en direction de l'euro ? C'est peut-être là que se fera un jour l'arbitrage.

M. Marc Touati a raison de voir dans les crises une revanche de l'économie réelle sur l'économie financière. D'une certaine façon, la première ramène à des taux de rentabilité issus du monde réel et non à ceux qui sont anticipés par les spéculateurs.
Pour M. Xavier Timbeau, des sommes comme 300 milliards ou mille milliards d'euros ne sont pas considérables par rapport à la capitalisation. C'est vrai. Le problème de la crise, qui fait qu'on a du mal à en cerner les conséquences, est qu'on ne sait pas où sont les risques. Dans les crises traditionnelles, on arrive à peu près à les localiser et à les évaluer. Dans le cas présent, personne ne peut le faire. Avec la titrisation, les risques ont été dispersés. Il y a des périodes d'accalmie, comme actuellement, mais, dès qu'une banque annonce que des crédits ne sont pas évalués à leur vraie valeur, la crise rebondit. J'ai le sentiment que les économistes sont un peu désarmés. Autant on connaît bien la façon dont une récession aux États-Unis se transfère vers d'autres pays – à ce sujet, il me semble trop tôt pour dire que l'Amérique latine est épargnée –, autant on ne sait pas grand-chose sur les crises touchant le crédit. Je me souviens qu'à la fin des années 1980, tous les instituts de conjoncture et tous les économistes vantaient le système financier japonais. Or la crise financière, qui a des points communs avec celle que l'on connaît aujourd'hui à l'échelle mondiale, a plongé le Japon dans une grande crise pendant dix ans. Nous ne sommes peut-être pas à l'abri d'un tel risque, la confiance étant un facteur clé du fonctionnement d'une économie de marché.
Ma question porte sur la régulation. Un rapport ancien du Conseil d'analyse économique a mis en évidence qu'on trouve toujours à l'origine des crises des établissements de crédit qui ne sont pas des banques et qui ne sont pas soumis à la régulation bancaire. La première chose à faire ne serait-elle pas d'étendre les principes de régulation bancaire à tous les établissements de crédit ?
J'ai compris que Bâle 2 permettait de mieux prendre en compte la titrisation dans les bilans des banques, le problème actuel venant, en grande partie, de ce que les banques ont été poussées à améliorer leur situation financière apparente en recourant à ces instruments de titrisation. Y a-t-il des solutions pour mieux les maîtriser ?
J'ai apprécié que M. Timbeau nous explique qu'une partie de l'inflation est due à l'inégalité et à la mondialisation. Le fait que les prix alimentaires aient fortement augmenté a-t-il un lien avec la crise financière ou les deux phénomènes sont-ils complètement découplés ? Après tout, le mécanisme décrit par M. Timbeau s'est développé depuis une dizaine d'années, mais c'est dans la période récente, du fait sans doute de facteurs spéculatifs, qu'on a vu s'envoler les prix mondiaux des produits agricoles.
Enfin, nous sommes confrontés à la fois à une crise bancaire mondiale dont on ne connaît pas bien les conséquences sur l'économie réelle et à un choc pétrolier presque aussi important que les deux précédents. À cela s'ajoute, en Europe, une montée sans précédent de l'euro. Tout cela ne crée-t-il pas une situation dont on ne maîtrise pas toutes les conséquences réelles ?

Ma première question porte sur la dualité des objectifs de la politique monétaire– politique de taux de change, lutte contre l'inflation – et l'unicité de l'instrument régulateur qu'est la Banque centrale européenne. Ce problème fondamental, que l'on a bien connu lorsque la Banque centrale française maniait les taux d'intérêt, n'est-il pas en train de ressurgir au niveau européen ? Comment l'éviter ? Cette question est au coeur de la problématique de la croissance économique aujourd'hui.
Que pensez-vous par ailleurs de la situation actuelle, et surtout à venir, de la « courbe des taux », que l'on ferait sans doute mieux d'appeler la « pente des taux », ou mieux la « plateforme des taux » ? Peut-on espérer, sans impulsion de la Banque centrale européenne, un abaissement des taux à court terme ? Ou faut-il redouter, compte tenu de l'ampleur des déficits et de leur pérennité, un redressement des taux à long terme ?
Ma troisième question est liée à la précédente. À partir du moment où l'on a des taux relativement plats, en des temps d'incertitudes pour les investisseurs – les investissements en France ne sont pas aussi dynamiques qu'aux États-Unis alors que l'évolution de la FBCF est aussi un des moteurs de la croissance économique – et d'interrogations sur le pouvoir d'achat entraînant un affaiblissement de la consommation, pouvons-nous nous attendre à une nouvelle dynamisation de l'investissement, comme le Gouvernement semble l'espérer ?

Lors d'un débat auquel participait M. Touati, deux conceptions se sont opposées. Le contradicteur de M. Touati estimait que la crise devait être purgée par la punition de ceux qui avaient fauté, c'est-à-dire en les laissant mourir sans qu'intervienne d'une quelconque manière la puissance publique. Un certain esprit moral était privilégié. M. Touati, pour sa part – je parle sous son contrôle – considérait qu'ils étaient trop gros pour faillir et que privilégier l'aspect moral faisait courir un risque, y compris à ceux qui n'avaient rigoureusement aucune responsabilité – même morale – dans la crise. Par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, estimez-vous qu'on a fait le choix d'une certaine efficacité au détriment de la morale ou plutôt de la morale au détriment d'un certain avenir économique ?
Deuxièmement, selon M. Touati, si la crise n'est pas terminée aux États-Unis, l'investissement des entreprises, qui est un très bon indicateur, laisse présager qu'elle est voie de l'être. Comment les entreprises font-elles pour investir avec une telle croissance ? Si les banques n'osent plus se prêter entre elles, on imagine mal qu'elles osent prêter à des entreprises ? D'où sort la matière à cet investissement aux États-Unis ?
En France, on imagine mal un tel chiffre, au moins à brève échéance ? Au demeurant, quel est-il cette année ? Comment voyez-vous la sortie de la crise, étant entendu que les marges des entreprises sont à un niveau tel qu'on les voit mal investir et que les banques hésitent à prêter, quelles que soient les garanties que les entreprises semblent vouloir apporter ? Si les choses sont jouées pour 2008, en raison de la position de la BCE, quelle sera la situation en 2009 et 2010 si, tout au long de cette année, les entreprises n'investissent pas ?

Deux questions se posent. Comment éviter un certain nombre d'effets pervers mis en avant par la crise ? Quelles sont les perspectives de sortie de cette crise ?
S'agissant des effets pervers, on a évoqué le problème des agences de notation. J'ai bien entendu la proposition qui a été faite de s'orienter vers une européanisation du système. Cet avis est-il partagé par tous les économistes ici présents ? Quelles sont les chances de voir aboutir un tel dispositif ? Quelle est la possibilité de trouver des alliés à cette fin parmi les pays émergents ou au Japon ?
La diffusion de la crise a été assez rapide, avec un effet systémique. Faut-il aller vers un encadrement des produits complexes, voire jusqu'à une interdiction de certains de ces produits, ou faut-il continuer à laisser libre court à l'imagination des banques ? Un renforcement de l'information peut-il être suffisant par rapport à la montée en volume des produits complexes ?
S'agissant de la seconde question, vos avis divergent concernant les États-Unis mais personne n'est totalement pessimiste. En revanche, la sortie de crise en Europe prend du temps. Quels moyens réels avons-nous de faire évoluer la position de la BCE, dont on considère qu'elle est un problème central ? Quel est l'impact réel du credit crunch en Europe, et plus particulièrement en France ? Pensez-vous que Bâle 2 permettra de mieux garantir les banques ou peut-il être un facteur aggravant en cas de crise ?

Je vous demanderai, messieurs les économistes, de vous transformer d'analystes, en prévisionnistes.
Après les junk-bonds, la bulle Internet, les subprimes, quel sera, selon vous, le prochain événement ? On peut toujours faire des incantations sur les mécanismes de régulation, rêver que la BRI devienne une instance fantastique – qui en viendrait à s'auto-émasculer puisque ce sont les dirigeants des banques centrales qui seront pilotes de Bâle 2 –, mais on ne saurait oublier que le métier de la banque, c'est de gagner de l'argent. On sait que la fixation de règles créera systématiquement des contournements. La titrisation est un contournement des ratios prudentiels. Quel sera, selon vous, le prochain véhicule ?
J'ai bien entendu l'analyse de M. Lorenzi sur les agences de notation. Qui est la demi-agence de notation ?

Dans le cadre des excellentes auditions organisées par le Président de la commission des Finances, Fitch, justement, est venu parler des subprimes. Il a expliqué qu'il avait fait son premier warning en décembre et qu'il était inaudible ce mois-là. Or M. Lorenzi a dit que les agences de notation sont incapables de prévoir six mois à l'avance ce qui va se produire. Pouvez-vous, monsieur Lorenzi, approfondir cet aspect ? Fitch n'a-t-il pas dit toute la vérité ?
Par ailleurs, il est tout à fait exact que tous ces acteurs, d'une façon ou d'une autre, se parlent, se contactent et s'entendent. En même temps, depuis plusieurs années, on essaie de séparer les genres. Existe-t-il une solution idéale permettant de garantir cette séparation et de faire en sorte qu'on puisse au moins garantir le petit épargnant et l'informer des risques qu'il prend – ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent s'agissant des subprimes ?
Le Président Didier Migaud : J'ajouterai deux questions.
Certains sont allés jusqu'à prôner une nouvelle séparation entre les activités de banque de dépôt et de banque d'affaires, estimant que la confusion entre les deux peut être à l'origine de crises. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, comment expliquez-vous ce qu'on peut appeler, en des termes diplomatiques, cette absence de pragmatisme qu'on observe au niveau européen ? Avons-nous vocation à subir les crises et à être moins bons que les Américains pour amorcer la reprise ? Tous les économistes conviennent, en dehors de ceux de la BCE, que l'euro est trop fort et que nous avons tous les inconvénients de la monnaie forte sans en avoir les avantages. Que faudrait-il faire pour en avoir aussi quelques avantages ? Que faudrait-il faire pour amorcer la reprise ?
Deux philosophies totalement différentes s'opposent chez les économistes. Les deux sont tout à fait sympathiques et respectables.
La première est celle de MM. Timbeau et Touati. Ils considèrent que la crise présente est comme celles qui apparaissent de manière régulière et cyclique, qui sont une revanche du réel sur le financier et qui ont, de ce fait, un côté positif. Je ne pense pas ainsi. Pour moi, 2008 sera, non pas l'année du millénaire, mais quand même une année très exceptionnelle. C'est la même crise en Afrique, sur les marchés financiers et sur le pétrole. Nous assistons à un changement complet du fonctionnement de l'économie mondiale.
Je me permets d'élargir un peu la discussion car il faut savoir ce dont on parle au fond. On peut en déduire ensuite des tas de propositions, y compris sur ce que doit faire M. Trichet.
Au moment de la chute du mur de Berlin, on s'est dit que tout le monde fonctionnait désormais de la même manière et on a vécu sur l'illusion que cela se traduisait par une généralisation du marché et que le modèle générique de l'économie de marché était le capitalisme anglo-saxon. Or ce dernier est une mécanique datée, précise, qui ne va pas connaître dans les prochaines années des jours aussi heureux que d'aucuns le prétendent. C'est une économie financière totalement désintermédiée, dans laquelle le système bancaire ne joue pas le même rôle que dans les autres pays européens. Je suis surpris quand j'entends dire qu'il n'y a pas de découplage. Ces économies sont tellement différentes qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles soient liées de manière aussi évidente qu'on le dit. Le dispositif a, au fond, fonctionné de manière assez efficace et assez idéologique, sur la base de processus de régulation et de normes comptables liés au capitalisme anglo-saxon. Mais le capitalisme continental, celui de la France, ce n'est pas celui-là. Il a des règles de rentabilité et des modes de fonctionnement du marché, économique et financier, différents. On a considéré qu'il fallait conserver les mêmes mécanismes : le Fonds monétaire, le G7 puis le G8. On a juste introduit l'OMC. En réalité, aucun de ces organismes de régulation n'est capable de gérer l'économie mondiale telle qu'elle est.
Ce qui est en train de se passer n'est pas une crise comme les autres, ni un simple accident historique, selon un cycle. C'est une crise financière majeure dont on n'est pas sorti. On est face à une dérive de 1 000 milliards de dollars. Le montant de la titrisation est de 40 000 milliards de dollars. Peut-être 300 milliards seulement sont-ils concernés. Ce n'est pas ma conviction mais l'avantage en économie est qu'on peut vérifier les choses par la suite. On a laissé l'endettement dériver totalement, tout le monde étant au courant depuis des années, en pensant que l'équilibre totalement branquignolesque des déficits majeurs des comptes américains pouvait perdurer. Tout cela s'écroule et, faute de mécanismes de régulation, le pétrole augmente. Je me permets de rappeler que nous avions écrit, il y a deux ans, « Un monde de ressources rares ». On n'aura pas de quoi nourrir 9 milliards de personnes avec ce dont on dispose aujourd'hui.
La crise actuelle résulte de ce que, à l'illusion fondée sur un système de régulation, un capitalisme anglo-saxon et une économie de marché, se substituent des capitalismes qui sont en compétition majeure : les hausses des prix du pétrole et de l'agroalimentaire sont dues à la compétition entre grands groupes de pays. Je pense que nous sommes entrés, en 2008, dans une guerre économique, dont on voit les premiers effets.
La crise financière est extrêmement dangereuse. Je comprends qu'on veuille faire payer ceux qui n'ont pas bien agi et que l'on retrouve les accents moraux de notre jeunesse mais si, d'aventure – qu'à Dieu ne plaise – se produisait un nouveau choc majeur, sans qu'on puisse réguler quoi que ce soit, cela renverrait certes à l'économie réelle – même si j'aimerais savoir ce qu'est exactement l'économie réelle des pays développés – et l'on verrait le secteur industriel américain reprendre de la vitalité, …
Je le concède. Mais je ne crois pas du tout à l'idée que nous soyons dans une simple version cyclique, traditionnelle, de crise. Du coup, je ne crois ni au rebond américain, aussi agréablement présenté soit-il par mes collègues, ni à la faiblesse européenne, ni au couplage systématique des destinées de l'Europe et des États-Unis. Je crois, en revanche, à une certaine force de l'économie européenne dans un monde beaucoup plus conflictuel, où on verra la prochaine présidence américaine faire réapparaître le protectionnisme. Les bagarres vont porter sur les ressources rares, sur les biens et services, sur le protectionnisme et sur les marchés financiers, donc sur la propriété du capital. Je ne suis pas convaincu que l'Europe soit si mal placée qu'on le dit. On verra bien ce qui se passera en 2009-2010. L'élément politique essentiel, qu'il faut essayer de faire réapparaître, est la régulation.
Tout ce que je viens d'exposer correspond au diagnostic de Dominique Strauss-Kahn, dont j'apprécie la manière de poser le sujet.
Je répondrai sur la courbe des taux.
La crise actuelle est-elle aussi grave que cela ? Qu'elle soit d'importance et qu'elle ne soit pas terminée, c'est indéniable, mais on ne peut pas dire qu'elle soit plus grave que la crise de la dette mexicaine ou la bulle Internet. On peut tenir des discours catastrophistes quand on fréquente des banquiers tous les jours, mais la réalité n'est pas aussi simple que « Ça va mal ».
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste indiqué qu'il n'existe pas de régulation correspondant à une situation géo-économique nouvelle.
La régulation semble le mot magique, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? M. Lorenzi avance que l'emballement du prix du pétrole provient d'un conflit d'intérêts entre les pays et qu'il faut donc réguler. Va-t-on fixer des quotas de pétrole par pays, nationaliser les ressources ?
Aujourd'hui, 30 % du prix du pétrole est lié à des interventions d'acteurs qu'il faut réguler !
Cela pourrait éventuellement jouer sur la partie du pétrole liée à la spéculation, laquelle est un phénomène qui s'installe quand le prix monte et a tendance à amplifier sa hausse, mais n'est pas une explication fondamentale de cette dernière. On ne peut interdire la spéculation sur le pétrole à moins d'avoir un gouvernement mondial dont l'ordre et la loi s'appliquent partout. Les États-Unis tolèrent des paradis fiscaux à côté de chez eux, parce que c'est un moyen d'exemption fiscale pour leurs citoyens. L'Europe tolère des paradis fiscaux à l'intérieur de son territoire – et construit des lignes de TGV pour s'y rendre, sur fonds publics ! Pourquoi interdirait-on les îles Caïmans si on n'est pas capable de réguler les pratiques bancaires au Luxembourg ?
Si je décide avec Marc Touati de jouer sur le pétrole à terme, nous allons nous envoyer des e-mails, jouer dans une monnaie qui n'existe pas, sans le dire à personne. Qu'est-ce qui nous empêchera, au bout du compte, d'acheter ou non du pétrole ? À moins d'entrer dans un système compartimenté dans lequel on contrôle tous les mouvements d'information, ce qui est un rêve que même les communistes n'ont plus, on ne peut pas réguler l'économie mondiale.
Si Dominique Strauss-Kahn propose une réforme du FMI, il ne dit pas que le monde va devenir angélique. Il veut simplement modifier la régulation.
Quand on parle de régulation, on ouvre une boîte qui est terriblement complexe. Il faut précisément dire ce qu'on fait, avec quel objectif et quel impact. Ce n'est vraiment pas simple. Prêter aux banques qui ont des difficultés de trésorerie au motif qu'elles sont un maillon indispensable peut paraître une évidence dans une situation de crise mais il faut se demander ce que cela change à la rentabilité de la banque et pourquoi on donne une facilité à un agent économique et pas à un autre. Comment fait-on pour contrebalancer cet avantage ? Toute régulation nécessite d'être contrôlée, ce qui est horriblement difficile, d'autant plus aujourd'hui que ceux qui sont les plus actifs promoteurs de cette régulation sont précisément ceux qui viennent de perdre. Sont-ils véritablement crédibles pour expliquer et décrire la régulation qu'il est nécessaire de mettre en place ? Je n'ai pas toute la réponse mais j'ai une petite idée.
Les régulations avancées aujourd'hui n'en ont que le nom, et sont en fait le produit de comportements de lobbying, tout à fait nets, légitimes et logiques, qui utilisent une capacité et un pouvoir à un moment donné. Il ne faut pas être naïf. La régulation est une utopie. Le travail et la bonne volonté nécessaires pour la réaliser rendent la route longue, difficile et semée de bien des déceptions.
Regardons l'évolution des profits des banques en Europe et aux États-Unis. Dans ce dernier pays, le taux de profit est comparable à celui des entreprises des autres secteurs. Le monde des banques est assez ouvert et concurrentiel. Dernièrement, le profit des banques est devenu négatif. Elles affichent des pertes. En Europe, depuis une dizaine d'années, en particulier depuis l'euro, le secteur des banques est relativement peu ouvert et ses progressions de profits sont hors de la normale. La capitalisation boursière des banques dans la zone euro connaît une bulle comparable à celle des entreprises de télécom il y a à peine dix ans. Comment se fait-il que les banques arrivent à extraire autant de rentes en Europe ? Alors que la crise des subprimes provoque un ralentissement de la croissance de leurs profits, elles parviennent à les maintenir des niveaux largement supérieurs à ceux des banques américaines ? C'est parce qu'on a mis en place, en Europe, une régulation qui est à l'avantage des banques. Les directives de concurrence ne s'appliquent pas à elles. Elles sont sous l'autorité d'un régulateur central bienveillant, la Banque centrale européenne. Le système européen des banques centrales agit nationalement, sans logique d'ensemble. Les banques sont exemptes de toutes les contraintes qui ont été imposées aux entreprises européennes. Elles tirent des rentes phénoménales de cette situation de non-régulation concurrentielle. Voilà ce qui se passe avec une régulation mal comprise, mal digérée et mal mise en place. On privilégie certains acteurs par rapport à d'autres.
Je suis fondamentalement favorable à la régulation. Une économie non régulée est instable. Mais il faut faire particulièrement attention aux pièges de la régulation, d'autant plus qu'il s'agit de régulations partielles, très difficiles à mettre en place car réclamant des moyens coercitifs adaptés. Il est facile, pour la Réserve fédérale, au moment de la crise des Caisses d'épargne, de les nationaliser. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de réaliser la même chose à l'échelon de la finance mondiale, parce que des hedge funds sont la propriété de banques européennes ou américaines et que tout ce qui s'y passe est caché et échappe aux régulations. Que signifie, dans ce cadre, réguler ? Si l'on veut interdire les paradis fiscaux, pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui ?
La courbe des taux actuelle montre que cette question est loin d'être résolue. Les banques centrales américaine et européenne ont agi de façon à résoudre les problèmes de financement à très court terme, c'est-à-dire entre une semaine et un mois, mais, au-delà, sur le marché interbancaire, on ne voit pas fonctionner correctement les choses. Des primes de risque sont payées par les établissements bancaires. En particulier, ils se refinancent à long terme et n'utilisent plus le marché interbancaire. Cela leur pose des problèmes de gestion insupportables parce qu'ils ont une structure de financement complètement bouleversée. Je pense que cela pèse surtout sur les banques et assez peu sur les entreprises, qui se financent plutôt à long terme, c'est-à-dire au-delà d'un an. On s'aperçoit que les marchés d'obligations à un an sont beaucoup moins perturbés, et probablement moins risqués que les marchés interbancaires, parce que les procédures de défaut sont incluses dans ce type de marchés. Le marché bancaire repose sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de défaut des acteurs. Aujourd'hui, le marché interbancaire à trois mois continue à ne pas fonctionner.
La crise continue. Elle n'est pas résolue malgré l'intervention des banques centrales, la baisse des taux américains et les facilités de financement accordées. On reste dans une situation entièrement ouverte.
Tout excès, par définition, est inefficace en économie. Le problème aujourd'hui, c'est que, si l'on crée trop de barrières, les banquiers, les ingénieurs réussiront à les contourner. On l'a vu avec Bâle 2 et, en particulier, les ratios prudentiels.
Seul un tiers de l'investissement des entreprises est financé par les banques. Donc il peut y avoir des banques américaines qui sont en difficulté mais, globalement, on a un investissement qui résiste grâce notamment à des taux d'auto-financement élevés et, parallèlement, à l'investissement massif de fonds d'investissement.
L'attitude de la BCE pose problème, car elle revient à faire passer le dogmatisme avant le pragmatisme. Si la Commission reçoit de nouveau M. Jean-Claude Trichet, je vous suggère de lui présenter l'article 105 du traité de Maastricht, dans lequel il est mentionné, noir sur blanc, que l'objectif principal, mais pas unique, de la BCE est la stabilité des prix. Il n'est nulle part écrit que c'est 2 % d'inflation, encore moins en tenant compte des prix de l'énergie sur lesquels la BCE n'a aucun pouvoir. Il est également précisé, au même article, que la BCE peut soutenir les objectifs de l'article 2, lesquels sont justement la croissance, le bien-être, la qualité de vie et l'emploi. Il n'est pas besoin de changer de traité. L'objectif de croissance est implicitement compris dans l'action de la BCE, telle que définie par ses statuts. Mais on lit mal ces statuts ou, par dogmatisme, on ne veut pas regarder la réalité en face.
Quant à la nouvelle bulle, c'est celle des matières premières. Il y a un mobile objectif : une éventuelle pénurie, une demande grandissante des pays émergents, une offre qui ne suit pas. Mais, aujourd'hui, l'explication n'est pas suffisante. Les mouvements sont dus, pour une partie – pour moitié ou davantage – à la spéculation, et c'est inévitable. Quand un baril qui coûte 10 dollars en Arabie Saoudite est vendu 120 dollars, cela pose quand même un problème.
La pire des bulles est celle des matières premières. Après la bulle Internet, il reste des sociétés. Après une bulle immobilière, il reste les immeubles. Après une bulle des matières premières, il ne reste rien.
Tout est lié. Si, demain, la BCE baisse les taux, ce que j'espère – elle devrait le faire à partir de septembre –, l'euro normalement baissera, le dollar se réappréciera et, du coup, le prix du baril diminuera et tout se débloquera. Se féliciter aujourd'hui d'un euro cher en croyant qu'il nous protège contre un baril cher est une erreur. Quand la Réserve fédérale américaine a baissé les taux d'intérêt moins que ce qu'avaient anticipé les marchés, ceux-ci ont eu le sentiment qu'il y avait un pilote dans l'avion, c'est-à-dire le président de la Réserve fédérale, qui contrôle ce qu'il fait : il veut bien baisser les taux pour éviter la récession, mais il ne fait plus n'importe quoi, il ne va plus trop loin.
On attend maintenant un co-pilote. On attend que la BCE fasse le même mouvement. Comme elle tarde à le faire, on le paiera, malheureusement. L'histoire se répète.
Quant au problème de la morale, on peut dire, en voyant que les banques françaises ont fait 11 milliards de perte sur les subprimes, que la facture est en partie payée, l'enjeu étant que cela ne fasse pas tâche d'huile sur l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, on y est.
Je pense que l'euro baissera mais on n'en sentira l'impact qu'en 2009. On peut s'attendre, en 2008, à une croissance très molle, en 2009, à un rebond dans la zone euro mais toujours sous les 2 %. Ce n'est qu'en 2010 que, si tout va bien, elle dépassera les 2 % dans la zone euro. Encore une fois, l'histoire se répète.
Le Président Didier Migaud : Comment expliquer que les Allemands, qui semblent également souffrir d'un euro fort, soient aussi fébriles dès qu'on met tant soit peu en cause le dogmatisme de la BCE ?
Le premier problème est que ce sont, nous, Français, qui faisons la remarque. Or, nous sommes l'illustration du seul argument valable de la BCE, à savoir que, pour contrecarrer le laxisme budgétaire des gouvernements, elle doit faire de l'orthodoxie monétaire. Il faudrait que la remarque vienne des Allemands, mais ceux-ci ont un problème culturel avec l'inflation. Les choses sont toutefois en train de changer du fait d'un début de ralentissement économique.
La question principale se situe au niveau de la direction de la BCE, qui doit penser « zone euro ». Or, dans la zone euro, il n'y a pas que la France qui va mal. L'Italie aura 0,5 % de croissance. D'autres pays, qui allaient très bien jusqu'à présent, commencent à souffrir : l'Irlande et, surtout, l'Espagne. Le nombre de chômeurs a augmenté de 15 % en un an, de 40 % dans le secteur de la construction. Il est dommage qu'il y ait un manque d'anticipation et que l'on n'utilise pas les indicateurs avancés qui montrent la gravité de la situation.
La crainte de l'inflation est l'argument le plus fort pour que la BCE maintienne sa position. Elle trouve sur ce terrain l'accord implicite, non seulement des Allemands, mais également de toute une communauté d'économistes. Il me semble maladroit de la qualifier de dogmatique car je ne pense pas qu'elle le soit. Elle a fait preuve d'un certain pragmatisme quand elle est intervenue sur les marchés interbancaires et elle a été plus active et plus réactive que ne l'a été la Réserve fédérale. Si, en matière de change, elle ne fait pas grand-chose, cela est dû davantage à une erreur d'analyse sur la menace inflationniste qu'à un dogmatisme.
Outre la mondialisation, une série de mauvaises récoltes dans certains pays ont beaucoup joué sur les prix alimentaires.
Globalement, il y a eu de mauvaises récoltes. Or, nous vivons dans un univers globalisé, dans lequel on met en commun toutes les mauvaises récoltes face à une demande forte et croissante. Il y a eu baisse des stocks. Ceux de maïs et de céréales sont au plus bas. Cela contribue plus à la formation des prix que la spéculation, qui est un phénomène additionnel. Les indicateurs de produits financiers basés sur les matières premières montrent que le moment où les encours grimpent est bien postérieur à l'explosion de leurs prix. Les mouvements spéculatifs sur les céréales étaient quasiment nul avant le début de cette année.
C'est principalement l'état des stocks qui explique la flambée des prix : il y a eu de mauvaises nouvelles sur les récoltes dans une situation tendue. Si l'on croit aux marches aléatoires, les prochaines récoltes devraient être moins mauvaises et les tensions disparaître rapidement.
Un dernier mot sur la courbe des taux, puisque c'est la grande différence entre les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, elle est redevenue normale aux États-Unis, c'est-à-dire que les taux courts sont redevenus inférieurs aux taux longs, ce qui permet aux banques de refaire leur métier de base, qui est un métier de transformation. En Europe, les taux d'intérêt à trois mois sont à 4,80 % et ceux à dix ans à 4 %, ce qui inverse la courbe des taux. Cela fait peser un risque sur la transformation, qui consiste à se financer à court terme pour prêter à long terme, le différentiel des taux d'intérêt permettant de gagner de l'argent.
Outre la faiblesse de la croissance, la BCE a un problème à court terme avec les banques européennes, qui risquent de souffrir quelque peu.
Le Président Didier Migaud : Merci à tous.
Informations relatives à la Commission