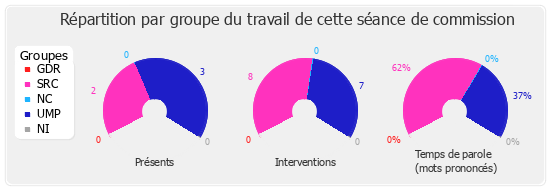Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 8 juin 2011 à 16h15
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 8 juin 2011
La séance est ouverte à seize heures vingt.
(Présidence de M. Serge Blisko, député, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies entend M. Bernard Leroy, avocat général près la Cour d'appel de Versailles.

Monsieur Bernard Leroy, vous nous avez fait part de votre disponibilité pour partager avec nous votre expérience dans le domaine de la lutte contre les toxicomanies – vous avez notamment travaillé pour l'Organisation des Nations Unies sur le sujet. Soyez le bienvenu.
Quels enseignements avez-vous tirés de cette expérience, en tant que juriste et tout au long de votre parcours international ? La réponse qu'apporte la France au phénomène des toxicomanies vous paraît-elle adaptée, sachant qu'un récent rapport élaboré par une commission internationale a conclu à la nécessité de procéder à certains infléchissements ?
Pendant trente-deux ans, je me suis consacré à la lutte contre les toxicomanies. J'ai d'abord été juge d'instruction spécialisé dans les affaires de drogue, à Évry, avant de m'intéresser aux usagers et aux grandes filières du trafic, et de réfléchir à la mise en place d'une alternance thérapeutique. Devenu expert pour la Commission européenne, j'ai mené en 1990 la première étude comparative de toutes les lois européennes en la matière.
J'ai été recruté par l'Organisation des Nations Unies pour mettre en place un service d'assistance juridique destiné à aider les États à transcrire dans leur législation la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 et à réfléchir sur la stratégie à adopter face à la drogue. En vingt ans, j'ai travaillé avec une centaine d'entre eux et j'ai eu l'honneur de rédiger des projets de législation ad hoc pour l'Afghanistan, la Russie et les quinze républiques nées de l'ex-Union soviétique. Je me suis également beaucoup intéressé à la question de la légalisation de l'usage de drogues.
Mon sentiment est que nous allons dans le mur, aussi bien au niveau international que français : la dynamique ontologique du phénomène est de plus en plus inquiétante et des carences sont à déplorer non seulement dans l'interprétation de ce dernier, mais aussi dans les stratégies propres à le contenir.
La dynamique s'emballe. Aujourd'hui, dans le monde, 200 millions de personnes se droguent : 50 millions prennent des amphétamines, 23 millions des drogues de synthèse, 20 millions de la cocaïne, et 140 à 190 millions du cannabis. En France, la consommation se concentre autour du cannabis et de l'héroïne, la cocaïne progressant malgré tout de façon spectaculaire. Ces données, très impressionnantes, sont appelées, selon moi, à augmenter.
La commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a classé 249 substances dans des tableaux, suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises. Pour autant, nous avons calculé qu'en changeant une seule molécule de chacune de ces substances, on obtiendrait 10 000 combinaisons possibles de nouvelles drogues de synthèse, qui sont les drogues de l'avenir. En effet, celles-ci peuvent être fabriquées et distribuées sur place et ne nécessitent que de petits investissements. Par ailleurs, les trafiquants disposent de trois ans avant qu'elles ne soient classées dans des tableaux de substances interdites, que ce soit au niveau national ou international.
Les statistiques concernant l'offre sont tout aussi impressionnantes. Ainsi, au niveau mondial, on dénombre 400 000 hectares de cannabis, pour 110 000 tonnes de produit ; 167 000 hectares de coca, pour 845 tonnes de cocaïne ; 235 000 hectares de pavot, pour 8 900 tonnes d'opium et 735 tonnes d'héroïne. Le chiffre d'affaires de la drogue tourne autour de 325 milliards de dollars, dont 74 milliards pour la cocaïne et 65 milliards pour l'opium et l'héroïne.
Nous allons dans le mur parce que des facteurs culturels et sociétaux favorisent la demande de drogue : culture du produit « réponse à tout » ; « chimisation » de l'existence ; perte des points de repère ; banalisation de la consommation comme réponse aux problèmes de la vie. D'autres facteurs favorisent l'offre de drogue : mondialisation, crise, ou encore professionnalisation du crime organisé.
L'action menée au niveau tant national qu'international n'est pas à la hauteur. Ceux qui se disent experts ont une façon d'approcher le phénomène qui s'apparente à celle du café du commerce. Des réflexions qui n'en sont pas sous-tendent une action qui n'est pas structurée. Enfin, les moyens consacrés à la lutte contre la drogue ne sont pas adaptés à ce qu'exige la situation.
Nous allons dans le mur parce que la dépénalisation existe déjà de facto et que le recours aux médicaments licites s'est formidablement développé dans notre pays. Des personnes de plus en plus nombreuses traitent les problèmes de la vie courante avec des médicaments prescrits de manière excessive par le médecin – par exemple huit médicaments différents, dont deux pour dormir, pour une seule patiente dépressive !
Enfin, les conventions internationales sont appliquées de façon erratique et la prohibition est contournée par des moyens licites.
Trois conventions internationales ont été conclues en 1961, 1971 et 1988. À l'heure actuelle, elles ont été ratifiées par cent quatre-vingt trois États, ce qui est un niveau de ratification sans égal. Elles précisent quelles sont les substances prises en compte et les classent en quatre catégories qui déterminent leur régime : les drogues dont on considère qu'elles n'ont pas d'intérêt médical et qu'elles doivent être prohibées ; les substances qui ont un très grand intérêt médical – morphine ou grands analgésiques –, mais qui sont très dangereuses et donc interdites en dehors de l'usage médical ; les tranquillisants, interdits pour un usage non médical, mais prescrits de façon plus souple ; enfin, les précurseurs chimiques, qui sont indispensables pour fabriquer les drogues, mais qui n'en sont pas. Sur ce dernier point, la France n'a pas encore mis sa législation en conformité avec la convention du 19 décembre 1988. Cela supposerait d'identifier toutes les entreprises qui utilisent, pour des raisons légitimes, des précurseurs chimiques et de détecter les dispositifs de diversion.
Le rôle moteur de la demande est très inquiétant. De retour en France après vingt ans, j'ai ainsi appris que l'on trouvait de la drogue dans nos villages les plus reculés. Les médias comme les intellectuels sont fascinés par la drogue et l'impression de toute puissance qu'elle procure. N'importe qui peut dire n'importe quelle stupidité sur la légalisation mais il est écouté alors qu'il n'apporte aucun argument valable. Les hommes politiques sont hésitants. Ils n'osent plus prendre fermement position contre la légalisation. Or, on peut fort bien se prononcer en faveur de la prohibition, avec des arguments solides, sans être un réactionnaire.
Les conséquences sont désastreuses. Toutes les semaines, je requiers à la Cour d'appel pour des affaires de drogue dans les cités des Mureaux, de Nanterre ou du Val d'Oise. Nous mettons à jour des systèmes pyramidaux mis en place par des individus qui terrorisent les jeunes qui travaillent pour eux. La drogue peut même menacer directement l'État de droit.
Au Cambodge, où j'ai eu l'honneur de travailler, un général, arrêté avec 100 kilogrammes d'héroïne, est reparti libre deux heures plus tard avec la marchandise, après que le canon d'un char d'assaut eut été pointé vers la porte du commissariat où il avait été emmené !
Au Maroc, où j'ai aussi travaillé, treize hauts magistrats ont été emprisonnés, car le crime organisé ayant acheté, avec l'argent du cannabis vendu en France, tout l'immobilier disponible dans la région, tenait les juges et les procureurs qui, pour se loger, étaient bien obligés de s'adresser à lui...
Au Mexique, la situation est devenue quasiment hors contrôle. On a par exemple trouvé 215 millions de dollars dans une maison, une somme que, vraisemblablement, les mafias s'apprêtaient à donner au gouvernement pour les prochaines campagnes électorales.
Dans ce contexte, il est urgent de procéder à une réflexion et de se demander d'où vient le phénomène. Jusqu'à présent, on s'est contenté de poncifs. C'est pour cela que l'action ne donne pas de bons résultats et que les tenants de la légalisation peuvent prospérer.
Pourquoi la drogue, qui existe depuis que l'homme existe, a-t-elle proliféré dans les années 1960 ?
Avec la Seconde guerre mondiale, nous avons assisté au développement du « chimique bénéfique » : le pétrole qui faisait avancer les chars pour la liberté ; l'atome qui mettait fin à la guerre ; le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) qui sauvait les récoltes ; les plastiques que l'on retrouvait dans de multiples produits ; les antibiotiques, etc. Dans les années 1950 cependant, les gens ont commencé à s'interroger : l'atome risquait de provoquer une guerre nucléaire ; le pétrole, le DDT et les plastiques polluaient ; les antibiotiques étaient à l'origine de résistances, etc. Dans les années 1960, avec la société de consommation, la publicité s'est développée qui laissait croire que tous les problèmes pouvaient être résolus – si un enfant vous empêche de dormir la nuit, utilisez les couches Pampers ; si votre linge est gris, achetez la lessive Persil ; si vous avez des problèmes de libido, transcendez-les en roulant en BMW : à chaque problème, un produit. Enfin, alors que jusque-là l'enfant devenait directement un adulte, avec le baby-boom sont apparus les adolescents qui, justement, ne savent pas qui ils sont – ni des enfants, pas encore des adultes. Aussi se mettent-ils à fonctionner sur le mode éthologique, comme les oiseaux, tant ils ont besoin des signes d'appartenance à un groupe auquel ils peuvent s'identifier : des cheveux verts, des jeans, éventuellement la drogue, et mille autres choses.
La résultante de tous ces éléments a été que les enfants d'après guerre, pour dire leur opposition à leurs parents, utilisèrent de manière métaphorique des substances que leurs parents considéraient comme du « mauvais chimique », par rapport au « bon chimique » qu'ils utilisaient eux-mêmes. À partir de là, toute une dialectique s'est créée autour de ce que Freud appellerait l'oralité. Nous pourrions parler d'un « syndrome du Titanic » : des facteurs puissants qui stimulent la demande et qui font un trou dans la coque. L'offre de drogue s'est alors mise à exploser. Les années 1960 ont été celles du cannabis, du diéthylamide de l'acide lysergique (LSD) et des hippies qui voulaient voir le monde autrement. Les années 1970 ont été celles de l'héroïne, des junkies et de la guerre du Vietnam. Les années 1980 ont été les « années fric », avec la cocaïne. À partir des années 1990, se sont développées les drogues de synthèse.
Penser la drogue comme quelque chose qui vous tombe sur la tête est une grave erreur : prendre de la drogue est une stratégie, un aménagement de son rapport à soi, aux autres et à la réalité. On a eu le tort de développer des théories déresponsabilisantes et de jouer sur la victimisation : le drogué est le seul qui puisse se sortir de la drogue. Cela ne nous dispense pas de l'y aider, et j'ai moi-même fondé un centre de soins, « Essonne Accueil », qui joue un grand rôle dans le département. Mais n'oubliez pas que si on considère le drogué comme une victime, il en jouera. Car dans son rapport aux autres, il est très souvent dans la toute-puissance.
Pour illustrer les méfaits de la drogue, les Britanniques avaient ainsi montré des drogués dans leur cercueil. L'effet de leur campagne a été désastreux. En effet, ils avaient en fait fourni un argument aux toxicomanes qui pouvaient ainsi dire à leurs parents : si vous ne vous intéressez pas à moi, voilà ce qui va m'arriver !
Il serait temps qu'au bout de cinquante ans, nous soyons capables d'analyser le phénomène pour ce qu'il est, et non pas pour ce que cela nous arrange de croire qu'il est. Car c'est cette erreur d'analyse qui explique, selon moi, que nous ayons eu jusqu'à présent du mal à réagir.
À cet égard, je suis consterné par tout ce que j'entends concernant la légalisation. Depuis cent ans, d'innombrables expériences ont été menées en la matière. Elles ont toutes échoué. Mais cela n'empêche pas certains de la défendre.
Que se passerait-il si on légalisait le cannabis ? Nous pouvons nous appuyer sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
En 2004, quand M. Tony Blair a changé la classification du cannabis pour réduire la gravité de sa consommation, les trafiquants en ont immédiatement relevé la teneur en principe actif pour s'assurer un avantage commercial : aujourd'hui, si le gouvernement français légalisait le cannabis, il autoriserait une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 5 % ; immédiatement, arriverait sur le marché une drogue dont cette teneur serait de 25 % ou 50 %. Le résultat a été le même aux Pays Bas avec le cannabis de type « nederwiet ou « skunk » – qui est un cannabis de synthèse. Et la France serait autosuffisante dans les cinq ans.
Le cannabis thérapeutique – le dronabinol – est bien autorisé par l'Organisation des Nations Unies depuis 1989, mais en prendre n'a rien de chic : les drogués préfèrent avoir leur pot de cannabis sur la fenêtre. Cela fait partie de la provocation et incite à la légalisation.
Si nous légalisons la distribution et l'usage du cannabis, nous perdrons le contrôle de la situation – sachant qu'alors nous nous orienterions vers la légalisation d'autres drogues. Pourtant, cela n'empêche pas une potentielle candidate à la présidentielle de dire qu'elle commencerait par là !
Lorsque j'assiste à des conférences sur le sujet, j'ai l'habitude de demander si les mineurs pourraient « bénéficier » de la légalisation. La main sur le coeur, on me répond que non. Mais la discussion est sans objet : la légalisation s'accompagnerait d'un trafic gigantesque en direction des mineurs, à partir de l'approvisionnement licite des majeurs. Les trafiquants de Nanterre, au lieu de se donner le mal de faire venir le cannabis du Maroc, le feraient venir de Saint-Denis. Les prix feraient la culbute. L'extrême droite, dans ces conditions, ne tardera pas à arriver au pouvoir avec des parents confrontés à cette situation.
Je voudrais que l'on réfléchisse au problème de la fin de l'interdit. L'interdit, ce n'est pas la loi. C'est bien plus fondamental. La nature nous a donné cinq sens pour communiquer avec l'extérieur. Le drogué s'en procure un sixième, qui relève de la toute puissance. Prendre de la drogue, c'est vouloir être Dieu.
Imaginez qu'un gouvernement décide de légaliser. Qu'on le veuille ou non, cela aura un caractère incitatif. L'enfant pourra créer un rapport de force avec ses parents. Qu'en sera-t-il de la prévention et de l'éducation ?
Il faudrait par ailleurs être conscients que les drogués ont souvent de sérieux problèmes que la drogue ne saurait résoudre. Légaliser celle-ci ne pourrait donc leur fournir les vraies réponses. Et dans cinq ou dix ans, la situation risquerait d'être comparable à celle de l'affaire du sang contaminé avec des parents et des responsables qui demanderaient pourquoi les jeunes meurent de surdose.
La légalisation signifierait en outre que la France renierait des conventions internationales, dont elle a pourtant été le promoteur. Alors que nous avons incité des pays – qui croient encore à certaines valeurs et qui estiment qu'interdire la drogue a du sens – à ratifier ces conventions, voilà que nous nous libérerions de cette contrainte ?
Quant à prétendre que la légalisation ruinerait la mafia, c'est une imposture absolue. Le traité de Westphalie est toujours d'actualité, en ce sens que les États font ce qu'ils veulent sur leur territoire. Pour ruiner la mafia, il faudrait donc que tous légalisent toutes les drogues le même jour. Sachant que pour des sujets plus anodins comme la standardisation des prises électriques au niveau mondial, cinquante conférences sont nécessaires pour établir trois protocoles et dégager dix-huit solutions, il est illusoire de penser que l'on puisse jamais universellement légaliser les drogues.
La légalisation transformera au contraire le monde en « peau de léopard ». Elle facilitera le travail des trafiquants qui ne feront plus venir la drogue d'Afghanistan, mais du Luxembourg, où ils l'achèteront à un prix ridicule pour la revendre au prix fort. La mafia deviendra ultra-puissante.
L'argument des prix est tout aussi stupide. Actuellement, la morphine médicale coûte 6 euros la plaquette. Les trafiquants la vendent 1 000 euros, mais ils peuvent baisser son prix à 5 euros sans aucun problème : ils n'ont pas de charges sociales, pas d'impôts et ils paient à peine leurs ouvriers. Si on élargit l'assiette des utilisateurs, il leur sera possible de faire des profits gigantesques tout en contractant les prix. Et la concurrence sera impitoyable au sein de la mafia qui inondera le marché de drogues de plus en plus violentes, puissantes et originales.
Enfin, dans notre société, le nombre de gens qui ont besoin d'une « béquille chimique » est incomparablement supérieur à celui de ceux qui prennent de la drogue. La loi permet, entre autres, de maintenir l'immense majorité des gens qui n'en prennent pas « en dehors » de la drogue. Si on la légalise, ceux qui n'y auraient jamais pensé préféreront, le jour où ils auront besoin d'un tranquillisant, s'adresser à un revendeur en bas de la rue plutôt que d'entrer dans un parcours de soins impliquant médecin, pharmacien et Sécurité sociale. Le réservoir potentiel d'usagers serait ainsi gigantesque.
La prohibition a eu de l'effet. Malgré les terribles problèmes que nous rencontrons, le phénomène a été contenu. Va-t-on choisir de perdre en rase campagne la bataille de la drogue, après avoir perdu celle du tabac et de l'alcool ?

Compte tenu la consommation de masse, êtes-vous partisan d'une contraventionnalisation de l'usage ?
Je l'ai été longtemps, mais je ne sais plus trop quoi penser maintenant. Aujourd'hui, la peine requise pour usage de stupéfiants est d'un an de prison, mais elle n'est quasiment jamais appliquée. Donc, on ne met pas les drogués en prison. Envoyé par l'Organisation des Nations Unies en Italie en 1993, année où ce pays s'était prononcé par référendum pour la dépénalisation, j'ai demandé au directeur de l'administration pénitentiaire combien de détenus étaient emprisonnés pour usage de drogue : 201 sur environ 50 000 détenus !
De nombreux États ont adopté des systèmes d'amendes. Cela pourrait se justifier en France, dans la mesure où la loi n'est pas appliquée, ce qui ne fait que la décrédibiliser, et où son application effective ne serait pas gérable.
L'intérêt de la contraventionnalisation est double : une sanction moins violente que la prison – plus adaptée à l'infraction –, et une faisabilité accrue pour traiter de la délinquance de masse. Néanmoins, le risque est que le changement soit perçu comme une reculade et comme un feu vert à l'usage de drogues, et l'amende assimilée à une formalité pour pouvoir se droguer. Les tribunaux, quant à eux, déjà écrasés de travail, ne pourraient pas gérer la situation.
Cela me conduit à vous parler des alternatives thérapeutiques. Le Subutex, malgré ses inconvénients – risques de chronicisation de sa consommation et d'alcoolisation – a permis d'enregistrer des progrès dans la prise en charge des héroïnomanes. J'ai moi-même envoyé des centaines de drogués se faire soigner, avec quelques résultats. Mais maintenant il n'y a plus ni injonction ni prise en charge thérapeutique. Cela dit, je ne considère pas que le recours à la drogue procède de la maladie. C'est bien plutôt un mode de fonctionnement – le professeur canadien Dollard Cormier a écrit un livre remarquable à ce sujet – qui a, j'en conviens, des conséquences sanitaires graves.
Mais revenons-en à la contraventionnalisation : le 2 de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 oblige les États signataires à faire de l'usage de stupéfiants une infraction pénale. En faire une contravention passible d'une amende administrative irait à l'encontre de cette convention.
Le dispositif permet au drogué d'être dans la toute puissance. Il lui permet de faire ce que vous ne voudriez pas qu'il fasse, et à le normaliser. Je reconnais qu'il peut parfois avoir du sens, notamment pour les héroïnomanes. Mais allez-vous superviser la consommation de cocaïne, de cannabis, ou d'ecstasy ? Il faut raison garder.
Les problématiques liées à la consommation d'héroïne – syndrome d'immunodéficience acquise, partages de seringues – ont par ailleurs perdu de leur acuité. En la matière, on peut dire que la situation est sous contrôle. De fait, depuis trente ans, le nombre d'affaires concernant des héroïnomanes a bien baissé. Il convient donc de faire preuve de souplesse et d'intervenir dans certains cas, sans se prêter à la manipulation.
Une vraie réflexion sur le sens du phénomène devrait être engagée dans notre pays. Mais attention de ne pas réitérer l'erreur commise en 1970, année où M. Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre, avait fait adopter la loi du 31 décembre relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses.
À l'époque, il aurait fallu d'abord cerner le phénomène, puis se pencher sur les solutions à y apporter. Or les pouvoirs publics français se sont contentés de plaquer sur le phénomène des solutions déjà existantes : le recours au juge et au médecin, alors qu'ils auraient dû aussi impliquer la société civile.
Quand votre bébé pleure la nuit, vous vous sentez concernés et vous réglez le problème, car il n'y a pas de ministère des bébés qui pleurent dans le noir. Quand votre enfant se drogue, vous prenez l'annuaire téléphonique pour savoir qui est en charge du problème. Voilà ce qu'a généré l'approche qui a été développée dans tous les pays développés, à partir des années 1970.
Le travail est gigantesque, d'autant que les écologistes, qui ont pourtant un autre rapport au chimique, sont favorables à la légalisation. Toujours est-il que les Français sont capables de mener une réflexion véritable sur le phénomène, en mettant dans la balance tous ces paramètres. Responsabiliser la société civile, en lui fournissant d'autres éléments que ceux qui sont avancés dans le débat sur la légalisation, permettrait d'avancer.

Merci pour vos propos, que je partage en grande partie. Je pense moi aussi que nous allons dans le mur et qu'il faut adopter une approche du phénomène qui soit sociale, et non plus seulement médicale.
Comme vous l'avez dit, depuis dix ans, il n'y a plus d'affaires de drogues, en tout cas d'affaires impliquant les consommateurs. J'ai bien peur que la contraventionnalisation ne change rien, si les textes ne sont pas davantage appliqués. Mais pour que le système fonctionne mieux, que faudrait-il mettre en place ?
Avec le médecin et le juge, nous sommes allés au bout de la spécialisation. Il faut maintenant s'adresser à tous les corps intermédiaires. Je me souviens que dans les années 1980, à Évry, une association du contrôle judiciaire avait été chargée de suivre les drogués. Nous pourrions faire de même, en utilisant les mêmes méthodes que celles des juridictions interrégionales spécialisées, pour étudier tous les aspects de la vie des usagers. Mais cela ne relève pas de la responsabilité du procureur général. Ce dernier pourrait néanmoins contribuer à un dispositif impulsé à un niveau plus général. Je pense, par exemple, à la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
J'ai créé des instances équivalentes à cette mission interministérielle dans de nombreux pays dans le monde, en essayant de faire en sorte qu'elles soient compétentes pour l'offre et la demande, pour la réflexion et pour l'international. Mais chez nous, on a voulu cantonner la mission interministérielle à certains domaines. Il faudrait se demander qui est en charge de quoi, et comment on pourrait cerner les différents aspects du problème.
Le recours à la drogue est une réalité protéiforme. Il faut être capable de s'y adapter. Vous connaissez tous des gamins qui ont fumé du haschich. Ils ne vous paraissent pas pour autant de grands malades et vous ne les voyez pas en prison. Envoyer dans un centre de soins celui qui a fumé un joint est inadapté. Mais qui charger de cette réalité protéiforme, pour que son action soit crédible et efficace ?

Pensez-vous que les actions menées par l'Éducation nationale au collège ou au lycée sont suffisantes ? Connaissez-vous des pays où les actions de sensibilisation obtiennent de bons résultats ?
J'ai été impressionné par la façon avec laquelle les Slovaques ont procédé. Ils ont voulu que nous les aidions à rédiger une loi-cadre pour cerner le problème et définir une stratégie nationale, avant de décider du contenu du code pénal ou encore du code de la santé publique. Ils ont consacré un volet à la prise en charge du problème par l'Éducation nationale. Même la Russie mène une réflexion au niveau scolaire.
Je m'en méfie beaucoup. Je fais partie de la section internationale de l'Association des juges jamaïcains des Drug courts. Je me rends tous les deux ans à leur congrès, aux États-Unis, et j'ai pu constater que les fabricants d'appareils destinés à analyser les urines, dont l'industrie est en plein développement, avaient tendance à pousser les juges à y recourir.
En France, l'Éducation nationale est obsédée par la mauvaise image qu'elle pourrait avoir si elle reconnaissait des problèmes de drogue au sein de ses établissements. Elle est donc dans le déni de la réalité.
J'ai été pendant dix ans responsable de la formation des magistrats sur la drogue et j'ai mené de nombreuses actions avec l'Éducation nationale, notamment avec toutes les écoles normales d'instituteurs de la région parisienne. Le travail était très intéressant, car les étudiants étaient motivés. À un moindre niveau, il faudrait que l'encadrement administratif abandonne cette peur de la stigmatisation et intègre la lutte contre les stupéfiants dans le projet éducatif des établissements Ce serait tout à fait concevable, en raison de la qualité des personnels. Mais nous en sommes encore loin.
Je suis entièrement d'accord avec vous sur la nécessité d'une approche sociétale du phénomène. Mais je remarque que l'Éducation nationale n'est pas le seul secteur susceptible de susciter une prise de conscience par rapport à la drogue. Le cinéma pourrait y contribuer. Or, je suis allée voir LOL avec ma fille : dans ce film, les parents fument du cannabis avec leurs enfants ! Il faudrait bien plutôt que les cinéastes participent à la « ringardisation » du phénomène.
Je remarque que ce n'est pas le fait de nombreux politiques qui considèrent comme assez moderne la dépénalisation, ou tout au moins la contraventionnalisation de l'usage des drogues. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser à l'Éducation nationale le soin de faire ce que les politiques ou les parents ne font pas.
Un pays a-t-il donné une image un peu « ringarde » du phénomène de la drogue ?
Les Américains s'y essaient. Ils utilisent malheureusement des méthodes behavioristes ou comportementales qui n'auraient pas de succès dans notre pays. En revanche, ils mènent des actions intéressantes auprès des jeunes enfants.
Les Asiatiques font de même. Mais il faut savoir qu'ils ne fonctionnent pas comme les Occidentaux. Chez eux, les enfants sont très encadrés.
Plus généralement, la prise de drogues a un rapport avec la culture locale. Il existe trois sortes de drogues : à effet sédatif, pour être « down »; à effet stimulant, pour être « high »; et à effet hallucinogène. Les Américains, qui sont d'abord dans la performance, préfèrent la cocaïne, qui est un stimulant ; quand ils lèvent le pied, ils sont dans la folie du LSD. Les Japonais, qui sont dans la performance, consomment des amphétamines ; mais ils n'utilisent pas d'héroïne, car cela les ferait mal voir et, pour eux, le regard de l'autre est très important. Les Français, qui sont dans la dépression, préfèrent les drogues à effet sédatif.
Je terminerai sur un phénomène inquiétant : les nouvelles stratégies des trafiquants.
L'héroïne est un gros problème, mais le nombre de ses consommateurs stagne : en France, il est de 160 000 depuis cinquante ans. De ce fait, les trafiquants ne peuvent espérer qu'une augmentation limitée de la masse de leurs clients héroïnomanes. Ils développent donc en Europe leur trafic de cocaïne, maintenant que le marché des États-Unis est arrivé à saturation. En même temps, ils conseillent aux cocaïnomanes de prendre un peu d'héroïne pour pallier le côté désagréable de « l'atterrissage » qui suit la prise de cocaïne.
Par ailleurs, l'héroïne se conserve cent ans sans altération. On peut donc prendre son temps pour l'envoyer à 1 000 kilomètres. Ce n'est pas le cas de la cocaïne, dont la date de péremption est très rapide. Donc, ils la distribuent localement.
Avant de quitter l'Organisation des Nations Unies, j'ai rencontré le ministre chargé du commerce extérieur du Maroc. Je lui ai demandé quelle quantité de permanganate de potassium, produit utilisé pour la production de cuir, était importée de Chine. En un an, elle était passée de 200 à 400 tonnes ! Car les trafiquants envoient maintenant de la « pasta » de cocaïne au Maroc et utilisent le permanganate de potassium pour effectuer le lissage et la transformer localement en cocaïne.
Au Kosovo, qui est en train de devenir le point central d'arrivée de la cocaïne en Europe, les trafiquants ont envisagé de faire pousser localement de la coca.
J'ai également découvert de nouvelles stratégies en Afghanistan, où je me suis rendu plusieurs fois. Pour approvisionner la Russie, les trafiquants passaient par le Tadjikistan. Mais ils se sont aperçus que la police tadjik, lorsqu'elle arrêtait l'un d'eux, l'éliminait pour revendre sa drogue. Voilà pourquoi ils passent maintenant par l'Ukraine et la Roumanie en adoptant une nouvelle méthode : ils achètent la route – par exemple, les policiers, les douaniers, les juges en place sur 500 kilomètres, et cela tous les six mois.
Ainsi le phénomène de la drogue présente-t-il toute une série d'aspects qui nécessiteraient, de la part de la France, des ajustements. Cela nous permettrait d'adopter des conduites mieux adaptées face aux trafiquants.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et Mme Christine Bronnec, chef du bureau des prises en charge post aiguës, des pathologies chroniques et de la santé mentale.

Madame Annie Podeur, je vous souhaite la bienvenue.
Nous avons pu constater, au fil de nos auditions, que l'offre de soins aux toxicomanes était très diverse et son organisation complexe. Les intervenants sont nombreux : médecine de ville, secteur médico-social et hôpital, réseaux ville-hôpital. Il n'en reste pas moins que certains départements ne possèdent pas encore de dispositif d'addictologie.
Votre direction générale est compétente sur les questions de médecine de ville, d'hôpital et de traitement des toxicomanes en milieu pénitentiaire.
Pourriez-vous nous exposer les orientations de la politique d'offre de soins dans les secteurs qui relèvent de votre compétence ? Des évolutions sont-elles envisagées en vue du prochain plan gouvernemental de lutte contre les addictions ?
Quel est le rôle de la direction générale de l'offre de soins dans la mise en oeuvre des plans de prise en charge et de prévention des addictions ?
Il faut être conscient qu'en ce domaine, le chef de file est la direction générale de la santé. J'avais d'ailleurs suggéré une audition commune avec son directeur général, M. Jean-Yves Grall. La direction générale de la santé est en effet chargée de faire le lien, dans la mise en oeuvre du plan de santé publique, entre la direction générale de l'offre de soins qui s'occupe de l'organisation des soins – y compris, maintenant, dans le champ ambulatoire – et les structures médico-sociales.
Dans ces conditions, la vision de la direction générale de l'offre de soins est nécessairement un peu tronquée, d'autant que les premiers plans relatifs aux addictions concernaient plutôt le secteur médico-social. Ce n'est qu'à la faveur du dernier plan 2007-2011 que le secteur sanitaire est devenu un acteur à part entière du dispositif. Ma direction générale a ainsi été conduite à mettre en place une organisation hospitalière graduée – parce qu'on ne peut pas tout faire partout – en trois niveaux.
Il n'y a pas de structures d'addictologie dans tous les établissements. Le secteur hospitalier public – où se sont développées la plupart de ces structures – compte environ 1 000 établissements, dont 350 hôpitaux locaux. Chaque hôpital local possède en moyenne cinq à dix lits de médecine et, dans le meilleur des cas, une trentaine de lits de soins de suite et de réadaptation. Il ne serait pas sérieux de leur adjoindre des structures d'addictologie.
Le maillage territorial repose d'abord sur les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui constituent le premier élément – médico-social – du dispositif et sont essentiellement financés par la direction générale de la santé ; ensuite, sur des structures hospitalières qui assurent des soins requérant des compétences médicales et paramédicales spécialisées. Aujourd'hui, nous avons fait le pari d'assurer un niveau I dans toutes les structures d'urgence – plus de 600 sites à l'échelon national.
Plus précisément, selon la circulaire du 16 mai, puis celle du 26 septembre 2007, les établissements de niveau 1 d'offre de soins doivent avoir une consultation d'addictologie, une équipe de liaison et de soins en addictologie et des lits dédiés à l'addictologie, pour des sevrages simples. Ainsi, dans un centre hospitalier de proximité, qui n'est pas forcément un hôpital pivot, la prise en charge de niveau 1 est assurée. C'est déjà considérable, d'autant que le décret relatif aux structures d'urgence oblige chacune d'elles à avoir, à côté, une équipe d'addictologie. En effet, c'est souvent via les urgences qu'arrivent les patients en prise avec de fortes addictions.
Le niveau 2, qui est le niveau de recours, suppose les mêmes structures que le niveau 1, mais avec des lits d'hospitalisation en addictologie pour des soins complexes, un hôpital de jour et des lits de soins de suite et de réadaptation. L'objectif du plan était d'assurer un niveau de recours pour 500 000 habitants. Cela correspond à un département moyen. Voilà pourquoi, sur un petit département, il n'y a pas nécessairement de structure de recours.
Le niveau 3 est le niveau de référence, avec les centres hospitaliers universitaires. Il suppose toutes les structures des niveaux 1 et 2, et celles du niveau 3, qui est consacré à l'enseignement et à la recherche en addictologie. En ce domaine, nous avons des progrès à faire.
Quel bilan peut-on établir aujourd'hui ? Il ne peut s'agir que d'un bilan à mi-parcours, puisque les dernières données dont nous disposons concernent l'année 2009 et que le plan court jusqu'en 2011.
Il faut savoir que ce plan a été mis en oeuvre au moment de la transformation des agences régionales de l'hospitalisation en agences régionales de santé. Pour le premier niveau, l'identification et la contractualisation avec les établissements n'ont pas posé de difficultés. Mais pour les niveaux 2 et 3, les avenants aux contrats n'ont pas nécessairement été conclus, et le suivi n'a pas été de même qualité parce que les équipes des agences régionales de l'hospitalisation commençaient à s'étioler, tandis que celles des agences régionales de santé n'étaient pas encore en place. Je ne peux pas vous assurer qu'en 2011, les objectifs du plan auront été atteints.
Sur les 620 établissements qui déclaraient une activité d'addictologie, on dénombrait 271 équipes de liaison et de soins en addictologie, 441 consultations d'addictologie hospitalière et 261 établissements dotés de lits de sevrage simple ; 150 établissements de proximité étaient globalement bien dotés et correspondaient au niveau 1. Cela signifie que les autres avaient mis en place ou l'équipe de liaison, ou la consultation, ou les lits, mais pas l'ensemble des prestations requises, telles qu'elles ont été définies dans le plan. Nous sommes donc loin du compte.
S'agissant des niveaux de recours, on comptait 55 établissements dotés d'un hôpital de jour avec une activité d'addictologie, et 51 unités de soins complexes reconnues, plus une vingtaine d'établissements de recours non dorés de lits de soins de suite et de réadaptation et une soixantaine d'établissements en étant pourvus.
Près de 25 % des établissements disposant d'une unité pour sevrage complexe reconnue sont des établissements autorisés en psychiatrie, et plus de la moitié des hôpitaux de jour se trouvent dans des établissements autorisés en psychiatrie. Cela illustre la forte implication des établissements psychiatriques. Mais ce ne sont pas des sites de structure d'urgence, même s'ils font le lien avec les urgences.
À mi-étape, nous avions atteint la moitié de l'objectif d'un niveau 2 pour 500 000 habitants : on compte 50 ou 60 établissements au lieu des 110 prévus.
C'est sur les niveaux de référence régionaux, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, que notre retard est le plus important. En effet, un tiers des régions seraient couvertes. Mais il ne s'agit là que d'un bilan de mi-étape.
Sur ces sujets d'importance, il convient d'être modestes. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Une structuration, qui n'est d'ailleurs pas si complexe que cela, s'est mise en place. Je précise que la graduation en trois niveaux correspond à celle de l'ensemble des activités hospitalières : la proximité, le recours et la référence.
J'en viens à nos relations avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui sont beaucoup moins fréquentes et beaucoup moins suivies que celles qu'elle entretient avec la direction générale de la santé. J'essaie néanmoins de travailler en complémentarité avec la mission et de l'appuyer dans la mise en oeuvre de certaines de ses orientations.
Premièrement, nous intervenons dans la formation des professionnels de santé, qui relève de la compétence de la direction générale de l'offre de soins. Par exemple, en 2008, dès la deuxième année du plan, nous avons retenu l'addictologie comme l'une des cinq orientations prioritaires dans les directives que nous adressons à l'ensemble des établissements pour la formation des professionnels de santé de la fonction publique hospitalière. Trois cent cinquante professionnels ont déjà été formés à l'addictologie entre 2008 et 2010. Ils sont employés par des établissements sanitaires, médico-sociaux ou sociaux – car la fonction publique hospitalière couvre toutes les structures.
Deuxièmement, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et la mise en place du développement professionnel continu nous ont amenés à penser différemment la formation des professionnels de santé. Nous avons décidé de décloisonner le champ ambulatoire et le champ hospitalier, ainsi que la formation médicale et la formation paramédicale. En addictologie, il serait en effet particulièrement intéressant de développer des actions communes. C'est une des ambitions que nous nourrissons, mais les décrets n'étant pas encore parus, nous devrons attendre.
Dans les plans de formation, nous nous attachons malgré tout à prendre en compte les comorbidités des personnes sujettes à des comportements addictifs. Les comorbidités psychiatriques sont fréquentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour le niveau 2, les structures psychiatriques se sont fortement engagées. Mais nous nous intéressons aussi aux comorbidités liées à des maladies infectieuses – les hépatites, notamment – et à certains cancers – mais cela concerne plutôt le tabac.
Troisièmement, nous menons des actions de prévention et de prise en charge liées à la consommation de substances psychoactives pendant la grossesse. Ces actions-là sont conduites essentiellement par les équipes de liaison et de soins en addictologie, souvent à la demande des professionnels des maternités. Elles prolongent les actions préventives conduites par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Vis-à-vis de la population détenue, qui fait l'objet d'attentions particulières, nous avons engagé des actions d'information sur les maladies infectieuses. Cette information fait partie de la consultation médicale d'accueil du détenu. Elle est d'ailleurs reprise dans un guide méthodologique qui concerne la prise en charge des soins des détenus au soin des établissements pénitentiaires.
Il est en cours d'élaboration. Il existait déjà un guide méthodologique, mais celui-ci était très incomplet. Je peux vous l'adresser, mais je ne suis pas sûre que cela vous aide et je ne m'engagerai pas sur les développements concernant la prise en charge des addictions.
Enfin, toujours à la demande de la mission interministérielle, nous allons mettre en place une expérimentation qui vise à améliorer l'accès au fibroscan des détenus dans cinq unités de consultation et de soins ambulatoires, situées dans les établissements pénitentiaires.
Je souhaite maintenant aborder la question des réseaux ville-hôpital, dont l'objectif est de faire le lien entre la ville et l'hôpital. Pendant longtemps, l'initiative s'est développée dans chaque région, sous l'égide des unions régionales des caisses d'assurance maladie, puis des agences régionales de l'hospitalisation. Maintenant, ces réseaux relèvent des agences régionales de santé et sont financés par le Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville.
En ce domaine, les addictions ne sont pas un thème prioritaire. Sur 742 réseaux, 45 seulement ont pour thème les addictions. La répartition de ces derniers est très hétérogène sur le territoire : certaines régions n'en ont pas un seul – la Basse-Normandie, la Corse, la Guyane, le Languedoc-Roussillon, la Martinique, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie – alors que les Pays-de-la-Loire en ont sept et la Franche-Comté six, sans aucun rapport avec l'importance du phénomène des addictions dans ces régions.
La qualité de 41 réseaux a été évaluée, et les résultats ont été corrects. Cela dit, je n'ai pas beaucoup d'informations, et j'aurais maintenant beaucoup de difficulté à en obtenir. Malgré tout, on peut s'interroger sur la raison du développement de ces réseaux.
Le recours aux réseaux a été le moyen de contourner l'insuffisance des fonds mis à la disposition de l'action de prévention et de l'action médico-sociale sur le budget de l'État. Les moyens de groupements régionaux de santé publique étant limités, on a ponctionné l'enveloppe dévolue aux réseaux parce qu'on savait qu'elle permettrait de financer, précisément, des structures en ambulatoire qui assureraient la liaison avec les dispositifs hospitaliers. Cela dit, il faut être honnête : ces initiatives étaient antérieures à l'implication du secteur sanitaire, et notamment à la structuration hospitalière, dans le domaine de l'addictologie. Aujourd'hui, il faut vraiment se demander quelle est la valeur ajoutée d'un réseau dédié à l'addictologie.
Je terminerai par trois points sur lesquels il conviendrait à mon sens d'insister, pour améliorer le dispositif existant.
D'abord, il faut renforcer l'articulation entre les structures hospitalières, le secteur médico social – les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie – et le champ ambulatoire. Aujourd'hui, le médecin généraliste est le point d'entrée dans le système, mais je ne suis pas sûre qu'il dispose de toutes les clés nécessaires, ne serait-ce que pour orienter le patient. Or c'est fondamental. Voilà pourquoi j'insiste sur le développement professionnel continu. Mais il faudra peut-être aussi, à l'échelon des territoires de santé, structurer des actions de formation simples, pour identifier le rôle des uns et des autres, les bonnes pratiques et les instruments qui permettent d'aller de la prévention primaire au dépistage précoce, à la prise en charge des soins et à l'accompagnement des patients – car on ne se débarrasse pas si facilement d'une pratique addictive.
Ensuite, il convient d'améliorer l'articulation avec les structures d'hébergement social, notamment pour les personnes en état de désocialisation. Car l'addiction est liée à la misère sociale.
Cela m'amène à vous parler de la prise en charge dans les prisons. Celle-ci est aujourd'hui correcte, grâce à notre structuration en unités de consultation et de soins ambulatoires et en services médico-psychologiques régionaux. Ce n'est pas en ce domaine que nous avons le plus d'efforts à faire.
Enfin, il faut développer la complémentarité de la prise en charge par les addictologues et par les psychiatres. Nous touchons là à des questions d'écoles. Reste que l'on dépense du temps et de l'énergie à se demander « qui fait quoi » aux dépens des patients qui ont besoin de cette prise en charge. Heureusement, comme je vous l'ai dit, des structures d'addictologie – notamment de niveau 2 – ont été créées dans un certain nombre d'établissements psychiatriques. Mais la discussion n'est pas close.
Tels sont, résumés, en termes aussi généraux que possibles, les enjeux majeurs de notre action en faveur de la prise en charge des toxicomanies.

Je vous remercie pour cette évaluation des outils mis à la disposition de l'addictologie, mais, pour les toxicomanes usagers réguliers de drogues qui souhaiteraient engager une démarche d'abstinence, peu de communautés thérapeutiques pourraient les aider : les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les services hospitaliers sont en effet tournés vers l'offre de soins et, surtout, l'offre de traitements de substitution. Certes, des expériences portées par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie existent, mais elles sont peu nombreuses. Est-il envisagé de mettre en place des structures équivalentes à ces communautés dites thérapeutiques et qui répondent à un souci d'accompagnement, d'hébergement et de réinsertion sociale ?
Votre préoccupation de prise en charge globale du patient est légitime. Pour autant, je ne peux empiéter sur les domaines de compétences de mes collègues, dont le chef de file est le directeur général de la santé.
En tout état de cause, il n'a jamais été dit que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie n'offriraient qu'une proposition de substitution : d'autres modes de prise en charge et d'accompagnement existent.
S'agissant des soins, les réponses peuvent être apportées soit par l'hôpital de jour – avec une prise en charge un peu plus au long cours plutôt qu'une cure de sevrage –, soit par les soins de suite et de réadaptation. Ce qui peut manquer, c'est peut-être le développement de l'éducation thérapeutique. Mais on bute là sur le rôle des professionnels de santé et des associations accompagnantes dont le rôle, en matière d'addictions, notamment l'alcoologie, n'est pas neutre. Vous ne pourrez jamais demander à des structures hospitalières d'aller au-delà du lien – sur lequel j'ai d'ailleurs insisté – entre les soins de premier recours, les structures hospitalières et le champ médico-social.
Vous parlez pour votre part de prise en charge au long cours. Ce que je peux proposer lors d'un épisode aigu, ce sont des soins de suite et de réadaptation sur une durée qui ne peut aller au-delà d'un ou deux mois. S'il y a besoin d'un accompagnement ultérieur, c'est à nouveau le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qui intervient, avec peut-être l'appui du secteur associatif – mais je dépasse là mon champ de compétences.

Dans votre excellent exposé du problème de la toxicomanie au sein du champ de compétences qui est le vôtre, le soin, vous avez évoqué le développement professionnel continu. S'il existe aujourd'hui une controverse sur les traitements de substitution, notamment la buprénorphine haut dosage, c'est peut-être parce que ce fameux Subutex a été mis en urgence sur le marché, en particulier pour faire face à l'épidémie de syndrome d'immunodéficience acquise, sans formation des médecins et des pharmaciens. Avez-vous autorité, si une substitution est trouvée par exemple à la cocaïne, pour demander qu'un tel médicament ne soit pas mis sur le marché sans formation des professionnels de santé ?
Je n'ai pas de pouvoir décisionnel en la matière. Je peux tirer la sonnette d'alarme – mais encore faut-il que je sois moi-même alertée. Cela pourrait cependant faire partie des orientations nationales prioritaires définies chaque année concernant le développement professionnel continu, sachant que ces orientations demandent toutefois deux ou trois ans pour être mises en oeuvre.
En tout cas, toute prise en charge pluriprofessionnelle de grands problèmes de santé publique implique une mise en oeuvre de formations également pluriprofessionnelles intéressant aussi bien les médecins hospitaliers et les médecins généralistes que les personnels paramédicaux et les pharmaciens. Une telle vision territorialisée vaut d'ailleurs pour la toxicomanie, voire pour les grands plans de santé publique – lutte contre la douleur, soins palliatifs – qui constituent des mutations culturelles conduisant à des changements de pratique des professionnels de santé. À cet égard, le vecteur du développement professionnel continu est très prometteur.

Il m'a semblé percevoir à la fin de votre exposé liminaire une petite difficulté à propos de la psychiatrie. À cet égard, est-il vraiment pertinent de faire suivre des personnes ayant un problème d'addiction dans des hôpitaux psychiatriques ?
Par ailleurs, si l'addictologie passionne certains psychiatres, la plupart estime que ce n'est pas vraiment de la psychiatrie, encore que chacun sente bien que l'on est là dans un problème de santé mentale. L'accueil n'est donc pas toujours à la hauteur des espérances ni des pouvoirs publics, ni de ceux qui adressent les patients. Comment résoudre cette difficulté ?
Enfin, ne devrait-on pas être plus actif concernant l'addiction médicamenteuse et la polyaddiction, d'autant que se développe une addiction aux produits dits de synthèse ?
Concernant le premier point, je ne faisais qu'un constat. Le plan prévoyait d'ailleurs la création de postes d'addictologues professeurs des universités - praticiens hospitaliers. L'avis du président de l'intersection d'addictologie au Conseil national des universités pourrait en tout cas être intéressant. Pour autant, en qualité de directrice générale de l'offre de soins et sans me défausser de mes responsabilités, je peux simplement témoigner qu'avec le plan, les psychiatres se sont sentis un peu « dépossédés » en voyant dans la création d'une nouvelle spécialité, l'addictologie, et dans l'arrivée de professeurs des universités-praticiens hospitaliers reconnus, un déni de leur vocation.
En tout cas, je serai plus nuancée que vous concernant les résultats atteints. Les unités d'addictologie sont une affaire de communauté humaine et d'engagement de professionnels de santé. La spécialité n'est sans doute pas le critère premier à retenir dans les résultats atteints, mais beaucoup plus l'accompagnement, les équipes, la bonne structuration du service ou encore la capacité à développer des interactions avec d'autres professionnels, soit dans le secteur médico-social, soit en ambulatoire avec les généralistes.
Pour ce qui est enfin des polyaddictions, notre démarche tient compte des substances licites. Selon les trois niveaux de prise en charge dont j'ai fait état, les manifestations de l'addiction peuvent d'ailleurs être extrêmement différentes. Nous avons même mis en place des structures pour les addictions aux jeux en ligne : quand on « décroche » d'une addiction, on court un fort risque de céder à une autre pratique addictive.
Je laisse en tout cas la controverse ouverte : il y a là un sujet de souffrance psychique et de mal-être que l'on peut ranger, à défaut effectivement de faire partie des catégories de la psychiatrie, sous le grand vocable de la santé mentale.
La direction générale de l'offre de soins est compétente en matière de formation des professionnels de santé. La dangerosité des substances actives ne relève pas de mes compétences, mais de celles de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de sa direction de tutelle, la direction générale de la santé.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Pierre Fender, directeur du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et Mme Véronica Levendof, responsable de la mission de veille législative.

Nous accueillons M. Pierre Fender, directeur du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Nos auditions nous ont permis de constater que la question des toxicomanies était, pour partie, liée à celle des mésusages de médicaments ou de détournement de traitements, en particulier des produits de substitution aux opiacés. Pouvez-nous indiquer l'ampleur de ces phénomènes et les mesures que la caisse nationale a prises ou envisage de prendre pour les juguler ?
Afin de montrer en quoi l'assurance maladie est concernée en matière de traitements de substitution aux opiacés, je traiterai successivement du contexte, de l'analyse des bases de remboursement de l'assurance maladie et des programmes de contrôle.
En matière de substitution, deux principaux produits existent, la méthadone et la buprénorphine, avec pour chacune un encadrement législatif et réglementaire, particulièrement pour la méthadone avec une délivrance fractionnée de sept jours, une prescription limitée à quatorze jours et l'instauration d'un relais de la prescription en cabinet de ville. En revanche, si l'encadrement de la buprénorphine est bien supérieur à celui prévu pour un médicament ordinaire, il est bien moins contraignant que pour la méthadone avec une prescription limitée à vingt-huit jours et une délivrance sur sept jours.
Nos programmes de contrôle ont été lancés dans les années 2000, lorsque nous nous sommes aperçus d'une vraie dérive – un mésusage et des fraudes – qui impactait très fortement la prescription et la délivrance de ces produits. Si les montants remboursés en 2002 atteignaient près de 80 millions d'euros pour le Subutex et près de 6 millions d'euros pour la méthadone, nous savions qu'il y avait un détournement d'usage du premier – avec nomadisme et surconsommation – dû à sa facilité d'accès, et une prise en charge de qualité inégale des personnes traitées.
Le dispositif législatif s'est renforcé en 2007 dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale qui a introduit un article L. 162-4-2 dans le code de la sécurité sociale tendant, pour qu'il y ait prise en charge par l'assurance maladie, d'une part à obliger le prescripteur à indiquer sur chaque prescription le nom du pharmacien chez lequel l'assuré se fera délivrer le produit, d'autre part à élaborer un protocole de soins entre l'assurance maladie, le médecin traitant et l'assuré. Ce protocole concerne soit tous ceux qui consomment de la méthadone sous forme de gélules, soit, en cas de suspicion d'un usage détourné ou abusif, tous ceux qui consomment les autres produits de substitution. Une fois encore, deux réglementations s'appliquent : l'une très stricte pour la méthadone sous forme de gélules, l'autre moins sévère pour la buprénorphine. Le renforcement du dispositif législatif oblige également à prescrire ces médicaments à l'aide d'une ordonnance sécurisée.
J'en viens aux bases de remboursement de l'assurance maladie. S'agissant de la buprénorphine haut dosage, les montants remboursés ont diminué entre 2004 et 2009, passant de 81 à 72 millions d'euros environ, tandis que le nombre de boîtes passait de 8,5 à 9,7 millions. Cette baisse des remboursements s'explique par le développement des génériques du Subutex et par la baisse des tarifs de la buprénorphine haut dosage. Pour ce qui est de la méthadone, les montants remboursés ont fortement augmenté, de même que le nombre de boîtes, qui a plus que doublé entre les deux périodes du fait de la mise à disposition d'une nouvelle présentation galénique sous forme de gélules et de la possibilité d'un relais de la prescription en cabinet de ville.
Depuis l'apparition de la méthadone sous forme de gélules en 2008, le nombre de ses consommateurs a atteint au premier semestre 2010 un nombre supérieur à 11 000, soit un quart du total des bénéficiaires des remboursements de méthadone. Cette croissance existe également concernant la méthadone sous forme de sirop : le nombre des bénéficiaires des remboursements est en effet passé de 11 000 en 2004 à près de 30 000 au premier semestre 2010, avec une évolution semestrielle moyenne de + 7,3 %.
La consommation hebdomadaire de Subutex en comprimés de 8 milligrammes et de ses génériques s'est accrue entre 2006 et 2008, avec un creux fin 2007 lié principalement à une affaire pénale relative à une bande organisée de médecins, de pharmaciens et d'assurés d'Île-de-France. Entre janvier 2008 et février 2010, on note cependant une stagnation du nombre de comprimés autour de 460 000 – la petite croissance qui a suivi fera l'objet d'un plan de l'assurance maladie.
Pour ce qui est du nombre de consommateurs de buphrénorphine haut dosage, on en comptait 80 000 au premier semestre 2004 contre 103 000 aujourd'hui. L'évolution semestrielle, qui était de + 2,5 % entre 2004 et 2007, est passée depuis à + 0,9 %, résultat dû à l'ensemble des plans mis en place par l'assurance maladie, ainsi que la majorité des acteurs le reconnaît. Nous avons en effet insisté sur le ciblage d'assurés, particulièrement ceux ayant des posologies de buphrénorphine haut dosage supérieures à 32 milligrammes par jour dont le nombre est passé de près de 2 000 en 2004 à 1 530 au premier semestre 2010.
La répartition des bénéficiaires de buphrénorphine haut dosage à des dosages supérieurs à 32 milligrammes varie beaucoup selon les régions – nous avons mis la barre à cette hauteur parce que, si l'on ne peut normalement dépasser 16 milligrammes, nous avons pris en compte le fait que certains professionnels estiment que cette dose peut être dépassée, sachant qu'une dose de 32 milligrammes correspond en tout état de cause soit à du mésusage soit à de la fraude.
L'Île-de-France comprend le plus grand nombre de consommateurs de buphrénorphine haut dosage, bien qu'elle représente 23 % des Français, ce qui indique une surconsommation en mésusage. Cette région, qui pose un problème majeur, est suivie en deuxième position par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur – dont le résultat est plus conforme à son poids démographique – puis par la région Rhône-Alpes. Les régions qui nous interpellent sont l'Alsace, l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, la Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire les régions frontalières – comme Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes qui cumulent ainsi deux handicaps.
Tout à fait. Cette région apparaît d'ailleurs, dans la répartition des bénéficiaires par région, avant la Haute-Normandie ou d'autres régions de même taille.
Quant à l'évolution du pourcentage de bénéficiaires au sein de l'ensemble des consommateurs de chaque région, on note, s'agissant des posologies quotidiennes moyennes supérieures ou égales à 32 milligrammes par jour, une diminution en Île-de-France, en Alsace et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au-delà de ces régions qui ont réduit le nombre de consommateurs mésusant le produit, les autres régions se situent autour de 1 % de consommateurs en mésusage. C'est ainsi qu'en France entière, le pourcentage était de 1,5 % au premier semestre 2010 contre 2,3 % au deuxième semestre 2006.
Si l'on s'intéresse maintenant au taux de substitution du Subutex par des génériques, la comparaison entre toutes les molécules – y compris la buphrénorphine haut dosage – et la seule buphrénorphine haut dosage, fait apparaître une différence : alors que le taux de substitution pour toutes les molécules est de 82,5 %, il n'est que de 8,8 % pour la seule buphrénorphine haut dosage. Cette moindre substitution du Subutex s'explique par le fait que les fraudeurs revendent bien mieux ce produit que la buprénorphine haut dosage sous forme de générique qui n'a pas la même connotation. Cette « génériquation » est même différenciée selon le dosage du produit : alors que le taux de substitution n'est que de 16 % pour le Subutex en comprimés de 8 milligrammes, il atteint près de 50 % pour le Subutex en comprimés de 0,4 milligramme.
Au sein des programmes nationaux de contrôle de l'assurance maladie tendant à réprimer les fraudes, les fautes et les abus, deux programmes concernent plus spécifiquement les traitements de substitution aux opiacés : le contrôle-contentieux relatif aux professionnels de santé et celui portant sur les assurés. D'une manière générale, le programme national de contrôle tend à lutter contre les fraudes, à préserver des soins de qualité et à aider les professionnels dans leur démarche thérapeutique, sachant que nous collaborons depuis 2006 avec la justice, la gendarmerie et la police. Nous avons en particulier un lien très fort avec la brigade des stupéfiants parisienne : d'une part, c'est à elle, lorsque nous déposons plainte, que les procureurs ou les juges d'instruction confient l'investigation ; d'autre part, c'est elle qui nous alerte sur les changements de mode opératoire des fraudeurs. C'est ainsi qu'à partir du moment où l'on a travaillé sur les usagers consommant plus de 32 milligrammes de buphrénorphine haut dosage par jour, certains fraudeurs se sont mis à utiliser des droits à l'assurance maladie en achetant ou en volant des attestations – des professionnels les leur donnant parfois –, ce qui leur permettait de se faire délivrer sous un autre nom les produits. Ce ne sont donc plus eux qui apparaissent, mais des quidams dont les relevés d'assurance maladie ne mentionnent d'ailleurs pas « Subutex » mais « pharmacie ». C'est ce travail avec la brigade des stupéfiants qui nous permet d'ajouter de nouvelles méthodes à notre mode opératoire de repérage de fraudes.
Concernant le programme de contrôle des assurés sous traitements de substitution aux opiacées, les actions menées entre 2004 et 2010 ont eu pour résultat 400 procédures pénales engagées à l'encontre des assurés, 4 359 suspensions de prise en charge des traitements par l'assurance maladie et près de 10 000 protocoles de soins contractualisant la prise en charge entre le patient, le médecin traitant et l'assurance maladie. Ce dernier nombre est bien supérieur aux 1 530 consommateurs ayant des posologies de buphrénorphine haut dosage supérieures à 32 milligrammes par jour, car les protocoles sont signés dès qu'une alerte est déclenchée.
Quant au programme de contrôle des professionnels de santé, le premier plan de contrôle national 2005-2006 a conduit à trente-six procédures ordinales et à vingt lettres de mises en garde, tandis que le deuxième a abouti, entre 2006 et 2007, à deux procédures pénales, à neuf procédures ordinales et à neuf lettres de mise en garde, et que le troisième, dont le bilan est en cours, a eu pour résultat vingt-deux procédures pénales et une procédure ordinale. Le prochain plan sera lancé à l'automne 2011 afin de poursuivre la lutte contre le mésusage et la fraude en matière de traitements substitutifs aux opiacés.

Le facteur déclenchant le contrôle est donc une posologie de buphrénorphine haut dosage supérieures à 32 milligrammes par jour ?
Ce n'est pas le seul critère. Si le mode opératoire change, nos modes de détection changent également : aujourd'hui, on vérifie par exemple si, au sein des patientèles de pharmaciens ou de médecins, n'existent pas des patients venant de très loin pour obtenir du Subutex. Pour prendre un exemple récent, la patientèle d'un médecin du Val-de-Marne non seulement vivait éloignée de ce département, mais se faisait délivrer les médicaments prescrits dans le 19e arrondissement de Paris. La posologie de 32 milligrammes nous sert d'indicateur : on continue de surveiller les bénéficiaires de posologies supérieures, mais d'autres modalités de repérage existent. Pour citer un autre exemple, en repérant quatre-vingt douze assurés sous Subutex pour un seul prescripteur, nous nous sommes aperçus que soixante et un d'entre eux étaient communs avec le prescripteur exerçant dans le même cabinet, et que trente-neuf l'étaient avec une pharmacie.
Il ne faut pas oublier non plus le travail effectué par les médecins conseils, qu'il s'agisse de rechercher si des chevauchements existent, si le patient ne se rend pas chez un autre médecin, ou si la prescription a bien donné lieu à facturation de la consultation, sachant que le professionnel peut ne pas être impliqué, car un réseau a pu lui subtiliser ses ordonnances et se faire ainsi délivrer des produits.
C'est parce que l'on croise énormément de nombreuses variables que l'on arrive à ce nombre de procédures pénales ou ordinales qui ont conduit l'Ordre des médecins à décider de plus d'une centaine de condamnations à des interdictions temporaires d'exercer.
Si, comme on l'a vu, la courbe de l'évolution semestrielle moyenne des bénéficiaires de remboursements de méthadone sous forme de sirop et gélules monte de façon très importante, le retour du terrain ne donne pas l'impression d'une dérive comme pour le Subutex. Mais nous allons vérifier.

L'évolution des montants remboursés semble due essentiellement à l'augmentation du nombre de personnes sous méthadone, soit 150 000 me semble-t-il.
C'est ce que nous vérifierons.

Concernant le risque sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – qui confirmait ainsi des données fournies par un toxicologue – nous a indiqué que la méthadone était impliquée dans 38 % des cas de surdose, contre 45 % pour l'héroïne, soit une différence peu importante entre les deux. Le résultat du financement de la méthadone par la puissance publique est donc mitigé puisque la toxicité de ce produit conduit à des surdoses – même si elles peuvent être dues à une polyconsommation. Avec près de cent morts chaque année, ne peut-on s'inquiéter de voir la méthadone être le Mediator de demain ?
Autant je peux répondre s'agissant de la question du mésusage et de la fraude, autant je n'ai pas compétence pour évaluer les risques sanitaires. Mais, encore une fois, nos vérifications porteront cette année non seulement sur le Subutex, mais aussi sur la méthadone. Nos bases de données sont suffisamment puissantes pour savoir par qui ce produit est prescrit et quel patient le consomme et à quelle dose.
Reprenons le nombre de 10 millions de boîtes vendues de Subutex ou de ses génériques : pour 100 000 personnes, cela représente 100 boîtes pour chacune d'entre elles, soit, avec sept comprimés par boîte, la consommation moyenne d'une année. Pour la méthadone, le résultat est de 337 boîtes vendues par an et par personne. Sachant que pour la majorité, il s'agit d'unidoses, on devrait avoir comme résultat 365 boîtes.
Tel est le travail que nous allons effectuer : savoir, pour la méthadone en sirop unidose, si les données correspondent bien, et combien de boîtes sont délivrées par consommateur et par an. C'est ainsi que l'on pourra vérifier s'il y a fraude ou mésusage concernant la méthadone.
C'est grâce à ce travail effectué en amont que l'on pourra, en cas de clientèle ciblée importante dans un cabinet, s'interroger sur le médecin – sachant qu'un vol d'ordonnancier a pu avoir lieu – ou encore sur le pharmacien.

Pour revenir au nombre de 150 000 personnes cité par Mme la rapporteure, peut-être convient-il de préciser qu'il s'agit du nombre d'usagers « problématiques » d'opiacés, sachant qu'entre la moitié et les deux tiers d'entre eux reçoivent une prescription de traitement de substitution aux opiacées, dont 40 000 sous méthadone.
Pour être exact, le nombre de 40 000 qui ressort de nos statistiques correspond à des personnes non pas sous méthadone, mais bénéficiant de remboursements de méthadone, ce qui est différent.
Les statistiques de l'assurance maladie ne portent que sur les remboursements et les personnes qui les sollicitent.
S'agissant de la méthadone, les unidoses, quel que soit le dosage – 5 ou 10 milligrammes,... – coûtent entre 1,14 et 1,61 euro ; en gélules, (boîtes de sept comprimés), le prix varie en fonction du dosage : pour 1 milligramme, le prix public toutes taxes comprises d'une boîte est de 3,17 euros contre 8,03 euros à 40 milligrammes.
Sachant que si l'on prescrit 17 milligrammes, il faut ajouter les prix publics d'une boîte de comprimés de 10 milligrammes, soit 5,89 euros, de 5 milligrammes, soit 5,14 euros et de deux boîtes de comprimés de 1 milligramme, soit deux fois 3,17 euros.
Quant au Subutex, le prix public toutes taxes comprises des boîtes de comprimés de 8 milligrammes est de 20,01 euros contre 16,52 euros pour la buprénorphine générique.

Pour revenir à la question des surdoses, je précise que la méthadone est un produit agoniste, c'est-à-dire qu'elle occupe tous les récepteurs aux opiacés. C'est ce qui explique que, lorsqu'une personne prend une dose supplémentaire ou un autre produit alors que ses récepteurs sont saturés, la surdose survienne, ce qui n'arrive pas avec le Subutex qui est un agoniste partiel. C'est la raison pour laquelle la méthadone est prescrite dans les réseaux en faveur de personnes sur la voie de la resociabilisation, et dont on pense qu'elles ne prendront pas forcément autre chose.

J'ai vu pourtant à la salle d'injection de Genève un jeune sous méthadone prendre de la cocaïne car il avait peur de le faire ailleurs à cause des risques encourus.

Il n'y a pas de marge de manoeuvre. Il aurait d'ailleurs été intéressant d'avoir l'évolution par dosage de la méthadone remboursée. En effet, quand on initie un traitement, on a un flacon à 60 milligrammes par jour, mais ensuite lorsque le dosage baisse, par exemple à 55 milligrammes, le patient doit repartir avec un flacon à 40 milligrammes, un flacon à 10 milligrammes et un flacon à 5 milligrammes, c'est-à-dire que les unités augmentent en même temps que le dosage baisse. La réussite du traitement – avec un dosage que l'on baisse – pourrait en effet expliquer l'augmentation détectée tant pour le sirop que pour les gélules.
J'essaierai de vous fournir une évolution de la méthadone par dosage, sachant que la base de données ne permet un recul que sur deux ans. Il est vrai que la mise sur le marché des gélules est assez récente.

Pour ce qui est du traitement de substitution en générique, plus le dosage est élevé, plus la personne est « border line » et plus il est difficile de lui faire accepter le générique, au contraire des personnes dont le dosage est à 0,4 ou 0,8 milligramme, qui sont resociabilisées.
Il faut également savoir que le laboratoire Schering-Plough a été malin : lorsque le Subutex a été « génériqué », son goût a été amélioré afin de masquer son amertume. C'est ainsi que le Subutex a continué à être préféré aux génériques qui, eux étaient amers.
Je reviens par ailleurs sur l'expérience de Midi-Pyrénées où un système tripartite – sécurité sociale, médecins, pharmaciens – avait été mis en place en Haute-Garonne. Nous avons dû y mettre fin, en dépit de résultats extraordinairement bons, car il était à la limite de la légalité. Une adaptation réglementaire ne serait-elle pas possible ? En effet, lorsqu'un « méga-consommateur » – et uniquement dans ce cas – était repéré, une lettre était envoyée à tous les médecins et les pharmaciens du département indiquant que cet assuré ne les avait pas choisis comme médecin ou pharmacien référent pour une liste donnée de médicaments. Certes, on a pu voir là une violation du secret professionnel, puisque personne n'était censé savoir, alors que le patient en question venait juste pour un antibiotique ou un antidiarrhéique, qu'il prenait également du Subutex. Sauf que cela a permis un bon encadrement. En effet, avec le système actuel, le temps que la sécurité sociale réagisse, un « méga-consommateur » se sera rendu pendant des semaines et des mois chez plusieurs médecins. C'est ce qui arrive en Haute-Garonne depuis l'arrêt du système mis en place : la courbe des « méga-consommateurs » remonte.
Le directeur général et moi-même n'avons jamais arrêté, par nous-mêmes, cette expérimentation menée à Toulouse. C'est à la suite du rapport de la Cour des comptes nous incitant à la généraliser dans la France entière que nous avons dû nous retourner vers ses promoteurs pour leur demander au contraire d'y mettre un terme, car elle se situait en dehors de la légalité.
Le problème de fond tenait au fait – ce qui pose tout de même problème par rapport au secret médical – que tous les professionnels étaient informés, tous sachant très bien, même s'il ne s'agissait que d'une liste, quels médicaments cela concernait véritablement et qui était le professionnel qui prescrivait ou qui délivrait.

On ne donnait pas de nom. On disait simplement aux autres professionnels que ce n'étaient pas eux les référents.
Mais tous savaient ce qui était prescrit. Imaginons le fils ou la fille d'un pharmacien qui, pour ne pas dépendre de la pharmacie familiale, entre dans le circuit : son père ou sa mère saura qu'il est dans un circuit de traitement de substitution aux opiacés.
Cette méthode informe chaque professionnel du cas d'un patient qui peut être un proche. Pour l'assurance maladie, un tel système ne peut être mis en place sur le plan national ou en dehors d'une expérimentation bien encadrée. Nous avons fermé les yeux, mais ce que vous avez expérimenté était totalement interdit.
Je suis garant de l'application des lois et règlements au nom de l'assurance maladie. La fin ne pouvait en l'occurrence justifier, sur le plan national, les moyens.

Pour lutter contre les mésusages, peut-on améliorer les ordonnances sécurisées ? L'Ordre des pharmaciens a fait allusion à des prescriptions électroniques. Est-ce envisageable ?
À partir du moment où le système est très ouvert, puisqu'il offre la capacité à tout professionnel de prescrire et à tout pharmacien de délivrer, il n'y a pas de limite à l'imagination des fraudeurs. Certains ont ainsi mis en place une plateforme téléphonique, parallèlement à l'utilisation de fausses ordonnances comprenant de vrais noms de médecins mais un faux numéro de téléphone : le pharmacien qui avait un doute tombait ainsi, en composant ce numéro, sur un complice.
Autant le dispositif est très encadré pour la méthadone – ce qui n'a pas donné lieu à dérive, encore qu'à la suite de la remarque de Mme Catherine Lemorton, il nous faudra vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie –, autant le dispositif général est ouvert : si toute amélioration du contrôle se traduit dans un premier temps par la réduction de la fraude, des contre-parades apparaissent très rapidement, d'autant que le produit n'étant pas classé dans la catégorie des stupéfiants, les condamnations à des peines de prison sont bien inférieures à celles encourues en cas de trafic de stupéfiants. Un trafiquant mis en prison pour deux ou trois semaines recommencera dès sa sortie après avoir inventé un nouveau processus – nous en parlons souvent avec la brigade des stupéfiants d'Île-de-France et son chef, M. Patrick Nguyen.
En outre, pour les pharmaciens, il est parfois très difficile de ne pas délivrer un produit même quand ils savent qu'il y a fraude. Ils ont en effet affaire à des gens très agressifs.

La présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, elle-même pharmacienne dans le 18earrondissement de Paris, nous a dit combien, venant de Corbigny dans le Morvan, elle s'était retrouvée dans un monde nouveau.

Nous avons aussi le cas du médecin qui a prescrit sous la menace et qui nous appelle pour que l'on ne délivre pas son ordonnance !

Pour en revenir à notre expérimentation, cela signifie-t-il que l'on ne pourra pas faire évoluer le système actuel ?
Je ne suis pas juriste, mais en touchant au secret médical et à la couverture du secret de la pathologie de patients, cette expérimentation me semble contraire à notre droit.
Je la comprends parfaitement.

Il n'y aurait donc pas d'adaptation réglementaire possible pour mieux encadrer ces patients ? Plus il y aura de méga consommateurs, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas que se soigner, plus on risque de décrédibiliser le système.
Votre mission pourrait être justement de faire la balance entre le bénéfice et le risque du dispositif encadrant le Subutex, afin de savoir s'il a eu un effet majeur en termes de santé publique et pourquoi. En tout cas, le fait qu'il soit d'accès facile implique, par définition, des dérives. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis en oeuvre des programmes de contrôle. Mais quels que soient les verrous mis en place, des failles seront trouvées car cela rapporte trop. Une grande partie de ceux qui sont dans la logique de la toxicomanie est asociale et la légalité n'est pas son sujet.

En liaison avec le développement professionnel continu, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne pourrait-elle pas mettre en place un guide de la prescription et de la délivrance ?
Un tel guide est même une recommandation de la direction générale de la santé, sachant cependant que la caisse ne pourra en être que le vecteur faute de pouvoir élaborer elle-même les référentiels. Il faut vous retourner vers la direction générale de la santé ou la Haute Autorité de santé – d'autres institutions que la nôtre en tout cas.
Non.
Au-delà des dérives que Mme Catherine Lemorton et moi-même avons pu décrire, existent d'ailleurs de mauvaises prescriptions de la part de médecins qui ne maîtrisent pas très bien le dispositif faute d'être bien formé. C'est le défaut d'un système très ouvert : les patients n'ont pas toujours affaire au bon médecin, bien formé, qui maîtrise le système.
D'autant qu'il s'agit avec ces patients d'une prise en charge psychologique particulière.

Avez-vous des statistiques concernant la consommation et surtout le mésusage de produits comme le Rohypnol ou les benzodiazépines ?
S'agissant des benzodiazépines, il faut s'entendre sur la signification du mésusage : les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sont exposées, lorsqu'elles leur sont prescrites, à un risque majeur de chutes et donc de handicap voire de décès. C'est donc plutôt un problème de santé publique qui fait d'ailleurs l'objet de campagnes de la part de l'assurance maladie.
Le sujet du bon usage du médicament en général que vous abordez est très vaste, voire trop pour que j'engage un travail sur ce point. Il est en tout cas très éloigné du sujet très précis de santé publique et de fraude que nous avons abordé aujourd'hui.
La séance est levée à dix-neuf heures vingt.