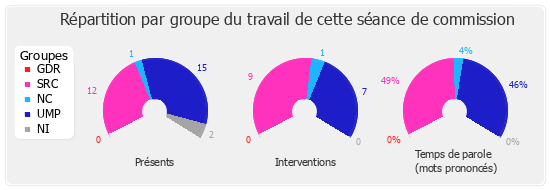Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
Séance du 15 février 2011 à 18h00
La séance
La séance est ouverte à 18 heures 15.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission procède à l'audition, ouverte à la presse, de M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés sur les carences des décisions de justice pénale :

Monsieur le ministre, vous êtes venu nous présenter les deux rapports d'inspection qui vous ont été remis hier et qui révèlent, nous semble-t-il, des carences en matière d'organisation administrative, qui se sont traduites par la non-affectation de certains dossiers à un conseiller d'insertion et de probation et la définition de priorités. Ces rapports révèlent également un défaut de suivi en sortie de prison ayant entraîné une rupture de la continuité des soins psychiatriques, une absence de coordination entre les milieux fermé et ouvert et une sous-utilisation de l'application informatique APPI.
Monsieur le ministre, cette audition doit être également l'occasion d'échanger sur l'exécution des décisions de justice. Nous avons créé en juillet 2007 une mission d'information, où sont représentés tous les groupes parlementaires : elle a adopté aujourd'hui à l'unanimité le rapport de M. Étienne Blanc.
La Commission des lois est convaincue de la nécessité de renforcer dans notre pays la prévention de la lutte contre la récidive, qui passe d'abord par l'exécution des décisions de justice pénale. Lorsqu'une décision de justice n'est pas appliquée ou lorsqu'elle est appliquée trop tardivement, elle perd son sens à la fois pour le condamné et pour la victime, quand elle ne met pas en danger la société.
La loi du 9 mars 2004 a introduit dans le code de procédure pénale l'article 707 qui prévoit la mise à exécution « de façon effective et dans les meilleurs délais » des décisions de justice.
Dans cette perspective, nous avions travaillé sur l'exécution des peines de prison, notamment en matière correctionnelle. En cas de comparution immédiate – quelque 25 000 jugements –, le prononcé d'une peine prison ferme entraîne l'incarcération : il y a donc continuité entre la décision du tribunal et son exécution, contrairement aux décisions prises dans le cadre d'une convocation par un officier de police judiciaire – 200 000 affaires en 2008 – ou d'une citation directe. En 2004, nous avons voté une disposition visant à mettre fin à la discontinuité entre le prononcé de la peine et son exécution : l'article 474 du code de procédure pénale prévoit la mise à exécution d'une peine de prison prononcée en correctionnelle dans un délai de trente jours. La loi prévoit également que, lorsque le condamné est présent, la convocation lui est remise en main propre à l'audience afin que rendez-vous soit pris aussitôt pour définir les conditions de la mise à exécution.
Or, la loi n'est pas appliquée : 50,7 % des peines d'emprisonnement ferme prononcées dans les sept juridictions d'Île-de-France ont été mises à exécution la première année en 2005, 53,7 % en 2006, 58,7 % en 2007, mais seulement 35,1 % en 2008 et 42,6 % en 2009 : on ne peut pas continuer ainsi ! La difficulté de faire baisser la délinquance est liée, en partie, aux carences dans la mise à exécution des peines prononcées.
Dès 2003 et 2004, nous avons également travaillé sur les sorties « sèches ». Si un prisonnier sort de prison de manière abrupte et est renvoyé vers le milieu dans lequel il a commis son infraction, le risque de récidive est très élevé. Le nombre de sorties sèches est passé de 43 696 en 2000 à 62 853 en 2009, soit une augmentation de 44 %, qui n'est pas sans poser un grave problème pour le pays – voyez l'affaire de Nantes –, en termes de coordination de tous les intervenants, juge de l'application des peines, service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), milieu ouvert, milieu fermé, suivi informatique.
Il convient également d'évoquer le suivi effectif à la sortie de prison, notamment le suivi socio-judiciaire, introduit dans les années 1990 et que nous avons étendu de la délinquance sexuelle aux infractions les plus violentes. Il fait entrer en action le juge d'application des peines, qui décide du suivi, le médecin coordonnateur, qui définit le type de soins, et le médecin traitant, qui les prodigue. Le choix du législateur était le bon. Or, à ce jour, il n'y a pas de médecins coordonnateurs dans 34 tribunaux de grande instance et 16 départements n'en disposent pas. De plus 70 médecins coordonnateurs interviennent sur plusieurs départements, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur disponibilité. On peut donc affirmer que, dans près de la moitié des juridictions françaises, le suivi socio-judiciaire et la coordination médicale ne sont pas réellement assurés, ce qui préoccupe vivement la Commission des lois.
Monsieur le ministre, la terrible affaire de Nantes doit être l'occasion de prendre des mesures urgentes pour que les lois que nous avons votées, certaines à l'unanimité, soient correctement appliquées. Il existe, outre des problèmes d'organisation et de cohérence informatique, des problèmes de moyens. Personne n'ignore la pénurie budgétaire actuelle : toutefois la Commission des lois est unanime à réclamer la mise en place rapide d'un plan d'urgence en faveur de l'exécution des décisions de justice pénale, doté de moyens à la hauteur des enjeux.
Comme le taux de perception des amendes contentieuses s'est amélioré d'un point par an depuis 2002 – un point représente 40 millions d'euros –, je suggère de faire de l'exécution des décisions de justice pénale la priorité de la fin de la législature et d'y consacrer les sommes ainsi dégagées. On peut espérer améliorer le taux de recouvrement des amendes contentieuses de trois points d'ici au 31 décembre 2012, ce qui permettrait de dégager près de 120 millions d'euros pour financer ce plan exceptionnel en faveur de l'exécution des peines.
Un tel financement, à coût constant pour les finances publiques, permettrait à chaque tribunal, à chaque service d'exécution des peines ou à chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation de mieux fonctionner. C'est en redoublant de volonté que nous réussirons à renforcer la lutte contre la récidive et donc à améliorer la sécurité.
Le rapport de l'inspection des services judiciaires ainsi que celui de l'inspection des services pénitentiaires, diligentés à la suite de l'affaire de Nantes, révèlent de nombreux dysfonctionnements qui sont, de toute évidence, la manifestation des problèmes que vous avez évoqués.
Il s'agit là d'un meurtre particulièrement atroce : s'il n'est toujours pas possible de célébrer les obsèques de la jeune fille, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé toutes les parties de son corps. L'émotion publique était donc légitime et on doit à la mémoire de la victime et à ses proches une analyse loyale des dysfonctionnements, en vue d'y remédier. Je pense également au jeune enfant de Tony Meilhon. C'est du reste en raison de son attitude lors d'une audience relative à la garde de son petit garçon, qu'il avait été condamné, en 2009, pour la dernière fois, pour outrage à magistrat avec mise à l'épreuve.
Le premier rapport porte sur le fonctionnement du tribunal de grande instance de Nantes et ses rapports avec la Cour d'appel et le second sur le fonctionnement du service pénitentiaire. Ces deux rapports ont une vocation plus large que l'étude du seul cas Meilhon.
Du reste, ce cas n'apporte aucun éclairage particulier sur le fonctionnement du TGI de Nantes, tribunal important doté d'un effectif théorique de 48 juges du siège. Le rapport montre que, de 2008 à 2011, ce chiffre a toujours été atteint, voire dépassé, sauf pendant deux mois. En revanche, sur la même période, le nombre des juges de l'application des peines a été inférieur d'un à deux à l'effectif théorique, qui est de quatre. Or, de 2008 à 2011, les discussions budgétaires entre le tribunal, la Cour et la chancellerie ne font jamais ressortir la moindre demande du tribunal en faveur du service de l'application des peines. Les seules demandes visaient à combler des temps partiels au profit du tribunal civil.
Durant la même période, non seulement une seule demande de juge placé du TGI de Nantes au Premier président de la Cour d'appel de Rennes a concerné le service de l'application des peines, mais, de plus, le juge a été affecté non pas à ce service mais à la rédaction des jugements. Le tribunal a donc toujours favorisé le civil au détriment du pénal.
Par ailleurs, dès sa nomination, le président du TGI de Nantes, aujourd'hui décédé, a délégué toutes ses fonctions relatives à l'organisation de sa juridiction à la première vice-présidente. Il n'a exercé que des fonctions juridictionnelles. C'est la première vice-présidente qui dialoguait avec les magistrats référents des services du TGI et avec la secrétaire générale de la Cour d'appel de Rennes. J'ai l'intention d'interroger le Conseil supérieur de la magistrature sur ce point, non pas dans un objectif disciplinaire mais au titre de l'article 65 de la Constitution, qui permet au ministre de la justice d'interroger le CSM sur la déontologie et le fonctionnement des juridictions. Le dernier Conseil supérieur de la magistrature a publié un livret sur la déontologie : une des dispositions interdit à un juge de déléguer la totalité de ses fonctions à un de ses collègues. Or, c'est ce qui s'est passé à Nantes.
Je tiens à ce que le CSM, lorsqu'il nommera des premiers présidents et des présidents de juridiction, ait bien à l'esprit qu'il s'agit d'une tâche spécifique : il leur incombe non seulement d'être capables de bien juger, mais également de diriger un tribunal ou une Cour d'appel. Comme la nomination des présidents de tribunaux ou des premiers présidents de Cour d'appel appartient au CSM – le pouvoir exécutif ne fait que signer les nominations sans aucun droit de regard –, et que les procédures disciplinaires relèvent également du CSM, je tiens à me placer uniquement sur le plan de l'organisation. Un président de juridiction doit exécuter correctement toutes ses tâches.
Pourquoi le CSM ne procéderait-il pas à des évaluations ? C'est ce qui a manqué au TGI de Nantes. Nous pouvons également nous demander pourquoi le premier président de la Cour d'appel de Rennes, qui siège actuellement à la Cour de cassation et est sur le point de partir à la retraite, n'a pas davantage porté attention à la situation du TGI de Nantes : un premier président de Cour d'appel est également chargé du fonctionnement de toutes les juridictions de son ressort. Qu'on me comprenne bien : je ne cherche pas à désigner des coupables mais à comprendre l'origine des dysfonctionnements.
Je tiens à préciser que les juges de l'application des peines de Nantes ont fait correctement leur travail. Le rapport n'émet aucune critique à leur encontre. S'agissant de Meilhon, dont la sortie était prévue le 24 février 2010, le juge de l'application des peines a coté son dossier dès le mois de septembre 2009, et y a inscrit à la main « Urgent – Avertir le SPIP pour la prise en charge ». Ce dossier papier a été transmis en octobre au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nantes. Je tiens également à préciser le point technique suivant, car il me paraît essentiel : dans le dossier figurait l'extrait de casier B 1, qui recense toutes les condamnations du prisonnier. Or, très souvent, cet extrait ne figure pas dans les dossiers transmis au SPIP. J'ai l'intention de le rendre obligatoire. Il suffisait donc de lire le dossier avec attention pour savoir que Tony Meilhon était un multirécidiviste condamné quinze fois, une fois pour viol et agression sexuelle et plusieurs fois pour violences. Les dysfonctionnements éventuels du TGI de Nantes ne concernent donc pas l'affaire Meilhon.
Tony Meilhon a passé 11 ans, en prison, soit une grande partie de sa vie. Condamné d'abord pour violences par le tribunal pour enfants, il a été incarcéré dans la cellule d'un délinquant sexuel – un « pointeur ». Condamné ensuite par la Cour d'assises pour mineurs de Loire-Atlantique pour agression sexuelle et viol sur ce dernier, il a alterné séjours en prison et sorties de quelques semaines, mais, lorsqu'il est sorti, le 24 février 2010, le SPIP ne l'a pas soumis au sursis.
En prison, Meilhon a fait l'objet d'un excellent suivi de la part du SPIP et du service médical – notamment sur le plan psychiatrique. En septembre et novembre 2009, le dossier de saisine parvient, au sein du même du SPIP, au milieu ouvert. Cependant, à la sortie de Meilhon, le lien entre les deux milieux ne se fait pas : le suivi en milieu fermé cesse, le rapport y afférent ne parvient au milieu ouvert que 43 jours plus tard et le suivi en milieu ouvert ne sera pas mis en oeuvre.
Pourquoi ? La circulaire de 2008 relative aux SPIP prévoit expressément que les directeurs de ceux-ci déterminent les moyens d'action de leurs services et l'ordre de priorité du traitement des dossiers, en fonction de la situation des personnes concernées et des moyens du service. À Nantes, une note du directeur du SPIP place les sursis avec mises à l'épreuve au dernier rang des priorités du service – ce qui revient à dire qu'il ne s'agit pas de priorités –, sauf pour certains délinquants, notamment sexuels. Or, on n'ouvre pas le dossier de Meilhon et, faute d'avoir pris connaissance du casier B1, on ne retient que l'outrage à magistrat : le dossier rejoint alors le tas de ceux qui ne sont pas considérés comme prioritaires.
On n'a trouvé aucune trace d'un suivi médical à partir de la sortie de Meilhon. On sait aussi, comme je viens de l'expliquer, qu'aucun suivi n'a été assuré par un conseiller d'insertion et de probation.
Il est probable que le SPIP de Loire-Atlantique n'était pas doté de moyens suffisants pour assurer ce suivi – ce qui explique sans doute la décision du directeur quant à l'ordre de priorité des dossiers. Sur la période 2009-2010, l'effectif cible du SPIP de Loire-Atlantique était de 31 personnes, dont 10 pour le milieu fermé et 21 pour le milieu ouvert – l'effectif réel étant plutôt, pour ce dernier, de l'ordre de 16,5. En 2009, la Chancellerie a attribué à ce SPIP quatre postes pour combler le déficit du milieu ouvert. Sur ces quatre postes, trois seulement sont pourvus, faute de candidats. Le directeur du SPIP affecte ces trois postes au milieu fermé et sort de ce dernier deux personnes – l'une travaillant à 80 % du temps, l'autre bénéficiant d'une décharge syndicale de 70 %, pour les affecter au milieu ouvert. Au bout du compte, le milieu ouvert ne reçoit que 0,8 emploi en équivalent temps plein. Il apparaît ainsi que la culture du SPIP est une culture du milieu fermé et que la culture du milieu ouvert reste à construire.
Le SPIP de Loire-Atlantique a connu de nombreux problèmes, à commencer par un fort absentéisme – 31 % de l'effectif cible, et donc un taux plus élevé par rapport à l'effectif réel. Il a en outre connu, pour la période qui nous intéresse, trois directeurs : au départ du premier, l'intérim a été confié à une dame certainement pleine de bonne volonté, mais qui n'était visiblement pas à la hauteur du poste, puis a été nommé, fin 2009, un directeur qui, après quelques semaines, a demandé un audit méthodologique et organisationnel, transmis à la Chancellerie par l'intermédiaire du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes.
Ce rapport, qui a reçu l'aval de la direction de l'administration pénitentiaire et a été réalisé par l'inspection générale des services pénitentiaires, formule 77 recommandations, dont un grand nombre n'ont pas été mises en oeuvre, comme celle qui demande expressément l'affectation de tous les dossiers. Malgré la demande du directeur de l'administration pénitentiaire, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ne prend aucune mesure d'appui en faveur du SPIP de Nantes, lequel doit se débrouiller – ce qu'il fait en laissant tout simplement les dossiers s'entasser. Le nombre de ces dossiers est du reste difficile à chiffrer : d'une centaine au départ du premier directeur, leur nombre augmente dans une proportion inconnue durant l'intérim, puis la mission d'inspection en compte manuellement 690 non attribués, parmi lesquels celui de Meilhon.
On constate également que l'informatique est très peu utilisé. Ainsi, les responsables de la direction interrégionale de Rennes déclarent ne pas utiliser le logiciel API, qui permet aux magistrats du suivi des peines et aux services de probation, qui l'alimentent les uns et les autres, de partager les informations relatives aux personnes sortant du milieu carcéral. À Nantes, on n'utilise guère davantage ce logiciel. Le dossier Meilhon y figure cependant et les magistrats constatent à la fin de 2009 qu'un conseiller est désigné pour suivre ce dossier. Il s'agit cependant d'une affectation virtuelle et le sursis n'a en réalité jamais été mis en oeuvre. Du reste, le logiciel sera ensuite nettoyé de ces affectations virtuelles par la mission d'inspection.
Les analyses qui se dégagent du rapport d'inspection suscitent évidemment des interrogations quant à l'action individuelle de certains agents. Ainsi, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes n'a pas donné suite à l'instruction claire qu'il avait reçue du directeur de l'administration pénitentiaire, et les préconisations du rapport d'audit demandé n'ont pas été mises en oeuvre. De même, le classement des dossiers était contraire aux dispositions de la circulaire de 2008 instituant les services pénitentiaires de probation et d'insertion, qui prévoyait expressément que le degré de priorité des dossiers ne pouvait être fixé qu'après une analyse de la personnalité des probationnaires, fondée sur des critères sociologiques et criminologiques, et que les dossiers ne pouvaient en aucun cas être classés selon la nature de l'infraction commise. De fait, dans le dossier Meilhon, le B1 permettait de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire d'outrage à magistrat.
Au demeurant, un suivi de Meilhon n'aurait pas forcément empêché qu'il commette son crime. Il ne s'agissait ici, je le rappelle, que de relever des dysfonctionnements.

Monsieur le garde des sceaux, souhaitez-vous vous exprimer sur le problème général de l'exécution des peines ?
L'exécution des peines est la première urgence de ce ministère. Les personnes condamnées à des peines de prison et qui n'effectuent pas ces peines sont aujourd'hui plus nombreuses que celles qui se trouvent en prison – 62 000 contre 105 à 110 000.

Le nombre de personnes qui n'effectuent pas leur peine de prison n'est-il pas plutôt de 82 000 ?
Ce chiffre n'intègre pas les calculs de la Cour d'appel de Paris, qui ont été communiqués plus tard. En tout état de cause, c'est beaucoup trop et il faut absolument faire exécuter les peines.
Les magistrats ne sont pas du tout laxistes. Ils appliquent la loi telle que vous l'avez votée. Cependant, le fait qu'une personne notoirement condamnée pour une infraction soit toujours présente dans le voisinage est très mal perçu par la population. Cette situation crée un vrai fossé entre les citoyens et la justice, et il faut y remédier.
Il existe plusieurs façons d'exécuter une peine et nous n'allons certes pas créer 170 000 places de prison. Il faut relancer les travaux d'intérêt général pour les courtes peines – et je rencontrerai à ce propos les associations d'élus. Il faut également s'intéresser aux bracelets et à la surveillance électronique extérieure. En effet, on compte aujourd'hui 5 000 bracelets statiques et 43 bracelets mobiles seulement – voici quelques jours, j'ai constaté qu'il n'y avait à Corbas, qui est pourtant un centre important, que deux bracelets de ce type. J'ai donné instruction d'atteindre le chiffre de 12 000 bracelets d'ici à la fin de l'année, ce qui est à la fois beaucoup et fort peu. Les bracelets n'ont jusqu'à présent donné lieu à aucun incident, mais nous devons nous préparer à ce qu'il s'en produise, ce qui est inévitable lorsque 30 000 bracelets auront été installés. Un incident ne justifiera pas cependant que nous renoncions à ce dispositif – nous n'en aurons d'ailleurs pas les moyens.
J'ai entrepris de visiter pratiquement toutes les prisons existantes et je suis surpris de constater que des établissements qui avaient été déclarés insalubres et que nous nous apprêtions à raser sont devenus d'un coup beaux et agréables. Il est amusant d'observer que les détenus que je rencontre ne veulent à aucun prix les quitter. C'est par exemple le cas de la prison d'Aurillac, qui ne dispose pourtant pas même d'un parloir. Cet établissement accueille de nombreux détenus venus d'Ardèche – département au sud duquel la culture d'herbes aromatiques fournit en abondance les prisons – et qui n'ont pas trouvé de place à Privas. La prison d'Aurillac a même été jugée favorablement par les commissions qui s'y sont rendues. La prison de Lure, quant à elle, est devenue si belle qu'elle a obtenu le label européen. À Agen, les détenus ne voulaient pas partir non plus – et, de fait, les évasions sont rares … Nous allons définir d'ici juin le nombre de places de prison dont nous voulons disposer, en conservant certains établissements qu'il était prévu de détruire.
Le fait de conserver toutes les prisons que nous pourrons a bien évidemment des conséquences en termes de moyens. En effet, celles qui devaient fermer représentaient 1 400 postes que nous sommes tenus de conserver, en créant donc de nouveaux postes pour les prisons en cours de construction. Nous ne dépasserons cependant pas un total de 70 000 à 75 000 places – ce qui est déjà beaucoup – et il faudra donc trouver d'autres moyens d'exécuter les peines.
Je vais prendre des mesures d'urgence en dotant 14 juridictions, avec des contrats d'objectifs, de moyens supplémentaires pour résorber le nombre des condamnations non exécutées. Il est cependant vraisemblable que ce qui sera résorbé d'un côté se traduira ailleurs par d'autres peines non exécutées.
Je me réjouis que l'Assemblée nationale travaille sur cette question. En effet, tout en découvrant avec enthousiasme ce ministère passionnant, j'en découvre aussi la sous-administration chronique et le manque de moyens. Ce dernier est du reste historique et, malgré les efforts du gouvernement actuel en termes de construction de prisons, de dotations budgétaires et de créations de postes, nous restons loin du compte. J'ai entendu avec intérêt votre proposition de trouver des crédits et j'espère que cette procédure est parfaitement légale dans le cadre de la LOLF.

Elle l'est. Un amendement adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2006 a permis de réaffecter 29,5 millions d'euros pour l'exécution des peines.

Pour la troisième étape de ses travaux, la mission d'information sur l'exécution des peines a défini deux nouveaux axes de travail : réaliser un bilan statistique de l'exécution des décisions de justice pénale et évaluer le déploiement de l'application Cassiopée et, plus largement, la dématérialisation de la chaîne pénale. Je voudrais aujourd'hui rendre compte de mes travaux sur ces deux aspects.
Pour ce qui est du bilan de l'exécution des décisions de justice pénale, je partage pleinement le constat sans appel du président de notre Commission. Cette situation est d'autant moins acceptable que les lois existent – nous les avons évaluées dans le cadre de notre mission d'information – mais ne sont toujours pas appliquées. Les multiples carences de l'exécution des décisions de justice pénale minent plus que jamais notre volonté de lutter contre la récidive.
L'exécution des peines doit rester la priorité absolue de la justice dans les années à venir. Cela suppose une impulsion décisive et des moyens à la hauteur des enjeux. Je m'associe donc pleinement à la proposition de lancer un plan exceptionnel de 120 millions d'euros qui pourrait être alimenté par un meilleur recouvrement des amendes pénales.
Si les statistiques disponibles font apparaître une dégradation sensible de l'exécution des peines ces dernières années, elles n'offrent en réalité qu'une vision très imparfaite de la situation. L'équation à résoudre peut se résumer en ces termes : comment prétendre améliorer l'exécution des peines sans une connaissance précise et chiffrées de ce phénomène ? À l'heure actuelle, faute d'outils statistiques performants, l'exécution des peines reste un maillon mal connu de la chaîne pénale, alors même qu'elle revêt une importance majeure. En effet, dans ce domaine, la fiabilité des statistiques reste conditionnée au déploiement effectif de Cassiopée – une application informatique permettant d'enregistrer une affaire ab initio, dès la présence d'une personne soupçonnée ou coupable d'une infraction devant l'officier ou l'agent de police, et jusqu'à la fin de la chaîne pénale, c'est-à-dire jusqu'à la justification de la peine prononcée par une juridiction.
Ce projet, que certains jugent ambitieux, a suscité beaucoup d'espoirs, mais aussi de nombreuses déceptions. Cassiopée ne mérite pas d'être vouée aux gémonies, comme ses débuts catastrophiques ont pu le laisser croire, mais plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer les difficultés rencontrées.
En premier lieu, il est rapidement apparu que la conception de cette nouvelle application, engagée à partir de 2001, porte en elle ses difficultés présentes et à venir. En effet, Cassiopée avait vocation à remédier à l'obsolescence des applications informatiques de la justice pénale, que nous avions déjà stigmatisée dans notre premier rapport, en 2007, mais le projet s'est révélé trop ambitieux, du fait notamment de sa complexité technique. Le calendrier a dû être revu à plusieurs reprises et le projet a pris un retard considérable – de 43 à 48 mois pour un programme prévisionnel de 41 mois.
Ce retard tient d'abord à l'insuffisante prise en compte des besoins opérationnels des magistrats et des greffiers : 80 % des juridictions que nous avons interrogées nous ont indiqué ne pas avoir été associées à la conception de l'application Cassiopée.
Il tient ensuite à une sous-estimation chronique de l'importance que revêt le pilotage d'un tel projet, du côté tant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'oeuvre. Les équipes de projet sont restées sous-dimensionnées jusqu'en 2005. Un audit réalisé dans le cadre de la RGPP a bien mis en évidence que la sous-direction de l'informatique et des télécommunications du ministère de la justice n'avait pas les moyens suffisants pour porter un projet de cette ampleur.
Le retard tient enfin aux relations difficiles entre le ministère de la justice et ses prestataires, en particulier la société Atos Origin. Du début 2007 à la fin 2008, alors que le ministère de la justice se réorganisait et que le projet Cassiopée entrait en phase de recette, la société Atos Origin se trouvait régulièrement en retard sur le calendrier qui lui avait été fixé par le ministère.
Après la conception, la phase de déploiement s'est également heurtée à de sérieuses difficultés. Le déploiement a été sous-estimé et insuffisamment préparé. Si l'information des magistrats et des greffiers sur l'avancement du projet et son implantation a été menée de manière relativement satisfaisante – 86 % des juridictions que j'ai interrogées estiment avoir été régulièrement informées de l'état d'avancement du projet –, le déploiement de Cassiopée a, hélas, été sous-estimé à deux égards : la formation des utilisateurs finaux aurait gagné à être renforcée et la question de la reprise des données n'a pas été correctement anticipée au départ ; les moyens accordés ponctuellement pour la reprise des données n'ont pas assez été pris en compte.
De ce fait, le déploiement de Cassiopée a considérablement accru le stock des procédures à enregistrer au bureau d'ordre et des jugements à dactylographier au greffe correctionnel. À titre d'exemple, au début du mois de novembre 2010, malgré le renfort des personnels placés et des vacataires, le bureau d'ordre du tribunal de grande instance d'Avignon accusait un stock de 12 632 procédures non enregistrées, dont 4 086 procédures nouvelles et 3 510 classements sans suite.
Insuffisamment préparé, le déploiement de Cassiopée s'est caractérisé par de nombreuses lacunes et faiblesses à tous les stades de la chaîne pénale.
En premier lieu, le temps de saisie des dossiers s'est parfois accru au bureau d'ordre et à l'audiencement. Au service de l'audiencement du tribunal de grande instance de Nancy, par exemple, un fonctionnaire pouvait enregistrer chaque jour, en moyenne, vingt convocations par officier de police judiciaire (COPJ) ou comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), quand Cassiopée ne permet d'en enregistrer que quinze.
En second lieu, l'application s'est révélée partiellement inadaptée à l'instruction et à la justice pénale des mineurs, Cassiopée n'offrant pas d'historique des parcours et n'intégrant pas le volet civil des décisions prises par les tribunaux pour enfants, telles que les mesures d'assistance éducative, qui sont pourtant un aspect essentiel pour la bonne compréhension de la situation d'un mineur. Nous avons, par ailleurs, constaté que seuls 30 cabinets d'instruction sur 110 utilisaient complètement Cassiopée.
En troisième lieu, il est apparu que des ruptures et des ralentissements d'accès pouvaient compromettre le traitement des procédures en temps réel, notamment les CRPC : entre novembre 2009 et septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, où nous nous sommes rendus le 4 octobre dernier, a subi près de soixante heures de dysfonctionnements divers.
En quatrième lieu, nous avons constaté que la plupart des trames des actes susceptibles d'être édités étaient rédigées dans un style approximatif et parfois juridiquement inexact, avec des références aux textes de loi souvent insuffisantes, voire erronées, tout cela pouvant compromettre la validité des actes.
En cinquième lieu, le suivi de l'exécution des peines demeure lacunaire : près des trois quarts des juridictions interrogées considèrent que Cassiopée n'a pas permis de réaliser de progrès sur ce plan. L'application constitue un réel progrès pour les services de l'exécution des peines qui n'étaient pas informatisés, mais ce n'est pas le cas pour ceux qui utilisaient le système EPWin : il n'est plus possible, avec Cassiopée, de visualiser l'ensemble des affaires concernant un individu par la simple saisine de son nom, ni d'obtenir une information claire sur l'état d'exécution de chaque jugement.
Nous avons observé, en dernier lieu, que les défaillances de l'infocentre ne permettaient pas de disposer de statistiques fiables.
Toutes ces difficultés auraient pu compromettre gravement le déploiement de Cassiopée sans les efforts salutaires déployés par la chancellerie et sans le dévouement des magistrats et des greffiers, qui se sont mobilisés pour la mise en oeuvre de l'application. Après l'échec relatif de l'implantation de Cassiopée à Bordeaux, qui a suscité de très vives inquiétudes et donné lieu à un large mouvement de protestation au sein des tribunaux, le ministère a fait le choix de poursuivre le déploiement de l'application, mais en répondant très énergiquement aux préoccupations qui avaient vu le jour.
Dès 2009, la chancellerie a mis en place un observatoire sur le déploiement de Cassiopée, composé de représentants des organisations syndicales des magistrats et des fonctionnaires et de plusieurs juridictions pilotes. Le ministère a, en outre, procédé à de très nombreux ajustements budgétaires et matériels : la sous-direction de l'informatique et des télécommunications, qui assure la maîtrise d'oeuvre du projet, a bénéficié d'une augmentation importante de ses crédits et de ses effectifs pour la période 2011-2013 ; du côté de la maîtrise d'ouvrage, l'équipe en charge du projet a été renforcée, et des sites « pilotes » ont été désignés pour résoudre certaines difficultés, tel le TGI de Lille pour les dossiers complexes impliquant plusieurs auteurs, victimes ou infractions.
Le déploiement de Cassiopée étant quasiment achevé – 138 tribunaux de grande instance ont été équipés au 14 février 2011 –, un premier bilan peut être dressé. Au terme des travaux que nous avons menés, il me semble difficile de porter une appréciation tranchée et définitive. Nombreux sont ceux qui ont porté des critiques très sévères et parfois justifiées sur Cassiopée ; d'autres se sont montrés plutôt satisfaits de cette application qui, sans être parfaite, permet d'améliorer le service public de la justice et le fonctionnement des juridictions. Loin de rejeter unanimement Cassiopée, ses utilisateurs portent sur elle une appréciation plutôt positive, mais nuancée.
Si la satisfaction des juridictions n'est ni franche ni massive, c'est que les promesses dont Cassiopée est porteuse ne se sont pas encore concrétisées. Il convient en particulier de réaliser au plus vite une interconnexion avec les applications utilisées par l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, suivant notre proposition 14. Il faudrait également poursuivre la réorganisation des services de la chaîne pénale en favorisant la verticalisation des procédures et la revalorisation des tâches induites par Cassiopée – c'est notre 15e proposition.
Au-delà de Cassiopée, toute la chaîne pénale – contraventionnelle, correctionnelle et criminelle – a besoin de nouveaux efforts de dématérialisation suivant le modèle offert par nos partenaires européens.
Il convient, tout d'abord, de dématérialiser les échanges entre la justice, les forces de sécurité et l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, notamment les avocats et les huissiers. De nombreuses initiatives ont déjà été prises, mais elles doivent être développées – je pense en particulier à la communication électronique pénale : instaurée en 2008 entre la gendarmerie nationale et le ministère de la justice, elle ne concerne pas la police nationale, ce qui est fort regrettable. Nous avons, en effet, constaté que la communication entre la gendarmerie et la justice avait apporté des améliorations considérables au fonctionnement de la chaîne pénale.
La poursuite de la dématérialisation exige, en outre, que l'on s'inspire des succès enregistrés dans le domaine contraventionnel avec la mise en place des programmes « radars », encore appelés « contrôle automatisé », qui permettent de délivrer une amende à domicile en 48 heures. Une expérimentation de signature électronique à valeur probante devant les tribunaux de police a, par ailleurs, été engagée.
Cette démarche ambitieuse de dématérialisation laisse entrevoir de nombreuses opportunités. Nous devons relever ce défi, qui n'est autre que celui d'une justice moderne, rapide et efficace.

Je ne reviendrai pas sur ce travail remarquable, qui a été adopté à l'unanimité par la mission d'information. Delphine Batho, qui a beaucoup contribué au rapport, l'évoquera sans doute plus tard. Pour ma part, je voudrais remercier le garde des Sceaux d'être venu présenter devant la Commission des lois ces deux rapports d'inspection, conformément à notre souhait. Je vous remercie également, monsieur le président, d'avoir accédé à cette demande de notre groupe.
Je m'efforcerai d'être aussi prudent que possible – cette audition étant publique, la famille et les proches de la victime nous entendent peut-être. Nous devons donc faire attention aux mots que nous utilisons et éviter de sombrer dans la solution de facilité qui consisterait à pointer du doigt ce qu'il aurait convenu de faire : on peut certes déplorer le manque de moyens dans ce drame abominable, mais on ne peut pas affirmer que des moyens plus nombreux auraient suffi à éviter ce qui s'est passé. J'ajoute que si M. Meilhon est aujourd'hui mis en examen pour meurtre, le corps de la victime n'a pas encore été retrouvé, ce qui nous oblige à une certaine prudence.
Un premier enseignement de ces deux rapports est que le travail des magistrats n'est pas contesté, alors qu'ils ont été victimes d'un lynchage médiatique : on les accusait d'avoir libéré un assassin récidiviste sans veiller à ce qu'il soit suivi. Ils sont hors de cause, et c'est tant mieux : notre justice a fonctionné.
Un deuxième enseignement concerne le manque de moyens. Les conseillers d'insertion et de probation de Nantes avaient, chacun, entre 120 et 170 dossiers à suivre. Or, selon un récent rapport de Jean-René Lecerf, sénateur UMP, un conseiller d'insertion et de probation ne doit pas être en charge de plus de 70 dossiers pour faire son travail dans de bonnes conditions.
Il va de soi que notre justice ne fonctionnera pas bien tant qu'on ne dégagera pas des moyens pour créer des postes supplémentaires de magistrats et de conseillers d'insertion et de probation. Peut-on accepter qu'il y ait moins de magistrats par habitant en France qu'en Azerbaïdjan ? Peut-on accepter que notre pays soit au 37e rang des pays européens ? C'est d'autant plus inadmissible que le nombre d'infractions ne cesse d'augmenter. Qui peut donc prétendre objectivement qu'on fait le nécessaire pour la justice ? Son budget n'a rien de colossal parmi les dépenses de la République, puisqu'il ne dépasse pas 7 milliards d'euros.
Il me semble, en dernier lieu, que nous devrions regarder de près comment M. Meilhon a été traité lorsqu'il n'était qu'un mineur délinquant. On l'a placé dans une cellule de quatre personnes, dont un « pointeur ». Je rappelle que le viol dont M. Meilhon a été accusé s'est produit dans cette cellule.
Ce n'est pas exactement un viol, mais un rapport sexuel obligé.

Comme je l'indiquais d'emblée, je n'entrerai pas dans le détail par respect pour les familles. Mais on ne peut pas passer sous silence les conditions dans lesquelles ce garçon de 17 ou 18 ans, condamné pour des faits de violence, a été traité : je répète qu'il a été placé dans une cellule comptant trois autres détenus, dont un « pointeur ». Or, chacun sait comment cette catégorie de détenus est traitée : ils sont considérés par 80 % du reste de la population carcérale comme des êtres asociaux, qu'il faudrait détruire. Nous devons réfléchir sur le sens de la peine, sur le sens de la prison et sur les conditions dans lesquelles on incarcère et on punit. Évitons de faire que la prison devienne l'« école du vice ».
Il y a des rapports parlementaires à foison sur ce sujet. L'un d'entre eux, présenté par Jacques Floch et adopté à l'unanimité il y a quelques années, portait sur les expériences étrangères en matière pénitentiaire. Il contenait une remarque qui m'a beaucoup frappé : quand un détenu entre en prison au Québec, il est considéré comme un citoyen appelé à sortir de détention six mois, un an ou vingt ans plus tard, peu importe ; lorsqu'un détenu entre en prison dans notre pays, il est d'abord considéré comme faisant l'objet d'une privation de liberté. Les moyens consacrés à en refaire, à terme, un citoyen sont trois fois, voire dix fois inférieurs à ceux qu'ils sont dans d'autres démocraties. C'est un aspect qu'il ne faudrait pas négliger dans notre réflexion sur le sens de la prison et sur les moyens de la justice en France.

Je voudrais tout d'abord remercier le président de notre Commission et le garde des Sceaux pour cette réunion, qui est un moment de vérité.
Il était bon de rappeler, à un moment où la magistrature et l'ensemble de la chaîne pénale ont besoin d'être confortés par la représentation nationale, que les magistrats ne sont pas laxistes. Je salue donc vos propos, monsieur le garde des Sceaux. Cela étant, les chiffres cités par notre président ne manquent pas de nous interpeller. Nous devons aux victimes d'améliorer l'exécution des peines. Il y va de la crédibilité de la justice. Tel était le sens de la question au Gouvernement que j'ai posée cet après-midi.
Sous le contrôle de Philippe Houillon et d'André Vallini, qui étaient respectivement président et rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, je rappelle que nous avions proposé d'améliorer la connaissance des personnes condamnées en renforçant l'informatisation du ministère de la justice. On peut penser que les carences de l'exécution des décisions de justice résultent en partie de cette méconnaissance. C'est une piste sur laquelle nous pourrions travailler ensemble, toutes tendances politiques confondues, afin d'améliorer la situation.
S'agissant des moyens consacrés à la justice, nous sommes classés au 37e rang par le Conseil de l'Europe, ce qui est un mauvais résultat. Toutefois, si la justice doit constituer une priorité, il n'y a pas que la question des moyens : il faut aussi améliorer les capacités de jugement et l'exécution des peines. Sur ce point, la loi pénitentiaire permet à une personne condamnée à deux ans d'emprisonnement d'exécuter sa peine à l'extérieur, ce qui peut être difficile à comprendre pour les victimes et leurs familles. Que l'on n'aille pas en prison au-delà d'une peine de deux ans le serait plus encore.
Je le répète, nous sommes à un moment de vérité. Il faudra apporter des réponses aux constats dressés aujourd'hui et à nos questions.

Je voudrais, à mon tour, féliciter notre collègue Etienne Blanc pour son travail remarquable et utile – c'est un document qui nous servira par la suite. Je veux également remercier le garde des Sceaux pour ses explications : nous disposons maintenant d'une photographie précise de l'affaire, qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Je le remercie d'avoir autorisé la distribution de ces deux rapports dont nous allons maintenant prendre connaissance plus en détail.
Chaque « affaire » relance le débat sur les moyens de la justice. Tous ses acteurs, les magistrats, les services pénitentiaires, mais aussi les avocats, refusent à juste titre d'être mis en cause, car on ne leur donne pas les moyens d'effectuer correctement leur travail dans un certain nombre de cas. Quand on dispose d'une photographie précise d'une juridiction, comme celle que vous venez de nous fournir, on s'aperçoit que la situation n'est pas toujours simple. Or, j'ai eu le sentiment que vous découvriez, vous aussi, cette photographie du fonctionnement du tribunal de grande instance de Nantes et que, sauf erreur de ma part, le Premier président de la Cour d'appel de Rennes n'avait pas non plus une connaissance exacte de la situation de ce tribunal, pourtant situé dans son ressort.
À la suite de la réunion que vous avez organisée hier, monsieur le garde des Sceaux, j'ai reçu – comme d'autres sans doute – un communiqué de syndicats de magistrats, d'avocats et de personnels pénitentiaires nous invitant, nous parlementaires, mais aussi les simples citoyens, à nous rendre dans les juridictions pour constater le fonctionnement des services – selon des modalités fixées par les services eux-mêmes, mais c'est une restriction qu'on peut comprendre.
Pourquoi la question des moyens se pose-t-elle depuis si longtemps ? J'ai compris que vous étiez favorable à la réalisation d'une évaluation, mais cela signifie que rien de tel n'existe encore. Le rapport d'Etienne Blanc constitue un premier travail, relatif à l'exécution des peines. Pourquoi n'organise-t-on pas, sous une forme à déterminer, une évaluation de la justice ? Cela n'aurait rien de contraire au principe d'indépendance de la justice. Toutes les institutions et toutes les activités sont évaluées.
On ne pourra dire s'il manque des moyens ici ou là que sur la foi d'une évaluation de la situation, tribunal par tribunal, y compris au plan de la gestion des ressources humaines. Si les moyens ne sont pas déployés dans un second temps, il ne faudra pas se plaindre que l'activité ne soit pas à la hauteur. Mais on pourrait aussi constater que la situation n'est pas aussi dramatique qu'on le dit – je n'en sais rien : il ne faut pas préjuger.

Je voudrais remercier le garde des Sceaux pour ses explications, et saluer le rapport d'Etienne Blanc, dont les chiffres sont accablants : nous savons maintenant que les délais de traitement d'une affaire devant les tribunaux correctionnels ont augmenté en moyenne de 11 % là où la « nouvelle chaîne pénale » (NCP) existe, et que le délai de réponse a augmenté de 18 % devant les tribunaux correctionnels entre 2000 et 2008. Les poursuites n'ayant augmenté que de 3 % dans le même temps, on ne peut pas expliquer la thrombose croissante du système par le simple accroissement des affaires à traiter.
Ce constat est accablant pour la politique menée par le Gouvernement au cours des dernières années : le rapport montre que le dysfonctionnement est aujourd'hui la norme. Des cas semblables à celui de Tony Meilhon se produisent quotidiennement. Même s'ils ne sont pas aussi dramatiques par leurs suites, il y a tous les jours des dysfonctionnements dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice.
La proposition de notre collègue Philippe Houillon de réaliser un état des lieux est excellente. La question des moyens se pose, à l'évidence, en particulier pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, où les difficultés sont incontestables. Compte tenu du nombre de dossiers à suivre par agent, il est manifeste que la situation n'est pas gérable. La proposition d'affecter 120 millions d'euros supplémentaires est, elle aussi, intelligente, mais je crains fort qu'elle ne suffise pas.
Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement d'une question de moyens, mais aussi de structure et d'organisation. Comme Bernard Roman, je suis frappé de ce qui s'est passé quand Tony Meilhon était mineur, au début de son parcours judiciaire. Notre système fonctionne à l'envers : on met le « paquet » sur les peines les plus lourdes et sur les individus les plus dangereux au lieu d'intervenir en amont, de façon précoce, pour apporter des sanctions appropriées aux primo-délinquants. Nous devons empêcher ce qui s'est passé dans le cas de Tony Meilhon : par ses réponses, notre système judiciaire a contribué à fabriquer un monstre.
S'agissant du milieu ouvert, le rapport de Michèle Tabarot sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs délinquants soulignait déjà, il y a deux ans, l'existence de carences. On ne se focalise pas assez sur cette question.
J'observe que vos propos, monsieur le ministre sont très éloignés de ce que le Président de la République a pu dire, et de ce que vous avez indiqué, vous-même, dans un communiqué commun avec M. Hortefeux. Alors que vous faisiez référence à des sanctions disciplinaires, vous dites maintenant qu'il ne s'agit pas de chercher des coupables.
J'en viens à une récente note de l'administration pénitentiaire qui prévoit l'affectation nominative des mesures en cours. Ressentie comme une façon, pour la chancellerie, de se défausser de ses responsabilités, cette note était un des sujets de mobilisation. Allez-vous revenir sur ce point, monsieur le ministre ?
Ma dernière question s'adresse au président de notre Commission : aurons-nous communication des rapports de l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale ? Ces documents n'ont pas été rendus publics pour le moment.

Je n'ai pas eu connaissance de ces rapports, mais nous aurons le plaisir d'accueillir, demain matin, le ministre de l'intérieur. Nous pourrons l'interroger sur ce sujet.
La question des moyens doit être posée, mais pas dans n'importe quels termes. Il existe, en effet, un problème d'organisation et de méthode sur lequel nous devons absolument travailler pour mettre un terme aux dysfonctionnements actuels. On peut penser que les moyens sont insuffisants – je le crois, en effet–, mais cela ne dispense pas de suivre de bonnes méthodes.
La note évoquée par Mme Batho ne vise qu'à rappeler un élément figurant déjà dans la circulaire de 2008 : il faut examiner les dossiers de manière personnelle, au lieu de ne prendre en considération que les catégories de peines. Je ne reviendrai pas sur cette note, car elle correspond tout à fait à la philosophie actuelle du suivi.

Nous savons qu'il y a aujourd'hui entre 80 000 et 90 000 peines d'emprisonnement ferme non exécutées. Mais ce n'est pas le seul aspect du problème : il faut certes que les peines soient exécutées, mais aussi qu'elles le soient rapidement, faute de quoi elles risquent d'être déphasées et d'entraîner certaines « complications ».
De grands progrès ont été réalisés en matière d'individualisation du suivi des délinquants, notamment dans l'examen de leur dangerosité et du risque de récidive, qui doit avoir lieu au cas par cas, mais on peut aller plus loin.
Un autre sujet auquel nous devons réfléchir concerne les rapports entre les juges de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Leur coordination est nécessaire, mais elle se heurte aujourd'hui à un certain nombre de difficultés.
J'en viens à la question des moyens. Nous savons tous qu'ils sont insuffisants. Le budget de la justice a certes augmenté de 40 % en huit ans, mais l'essentiel de cet effort a bénéficié à l'administration pénitentiaire. Peut-être conviendrait-il, comme certains le suggèrent, de réorienter les efforts vers les juridictions, qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour certains postes de dépenses qui empoisonnent leur vie quotidienne.
J'ajoute que l'augmentation des moyens consentie en faveur de l'administration pénitentiaire concernait en particulier les SPIP. Leurs moyens, notamment humains, ont considérablement augmenté. On ne peut donc pas seulement raisonner en termes de moyens, même si c'est la rengaine habituelle. Certains SPIP fonctionnent très bien. C'est le cas, par exemple, de celui de Bordeaux, dont l'organisation et les méthodes de travail diffèrent des services comparables : au risque de schématiser, on peut dire que son mode de gestion n'est pas « administratif ». Un rapport remis au ministre de la justice par Isabelle Gorce et Charlotte Trabut avait d'ailleurs conduit à une sorte d'expérimentation sur les conditions de prise en charge de la récidive, assortie d'un plan et d'une évaluation, qu'il me semblerait très intéressant de généraliser.
J'aimerais maintenant revenir sur l'importance des éléments de personnalité et du passé pénal : ces informations doivent être portées à la connaissance de l'autorité judiciaire. Sur ce point, il a été question du casier judiciaire, dont nous savons tous qu'il n'est pas suffisamment renseigné, mais il y a aussi le RDCPJ, le Répertoire des données personnelles collectées dans le cadre des procédures judiciaires, créé par la loi du 10 mars 2010 pour renforcer les éléments portés à la connaissance de l'autorité judiciaire et pour améliorer le suivi des personnes.
J'en terminerai par la question de l'interdisciplinarité : il est essentiel que les travailleurs sociaux, les conseillers d'insertion et de probation, les magistrats, les experts et les psychiatres travaillent davantage en commun afin d'améliorer l'individualisation du suivi. Tous les moyens légaux existent, les moyens matériels ont été renforcés, mais il faudrait aussi procéder à certaines remises en cause. Elles me paraissent absolument nécessaires.

Comme l'a indiqué Etienne Blanc dans son rapport, le délai d'enregistrement des décisions au casier judiciaire est, en moyenne, de presque cinq mois. En cas de récidive commise dans ce délai, le magistrat ne sait pas qu'une condamnation a déjà été prononcée. Or, ce dysfonctionnement est connu depuis des années. On pourra adopter autant de lois qu'on voudra en matière de récidive, on n'avancera pas tant que les magistrats n'auront pas les informations nécessaires.

L'inscription des décisions au casier judiciaire, réalisée par les services de Nantes, est de plus en plus rapide. En revanche, le délai entre la condamnation et la transmission de la décision s'allonge. Ce sont deux éléments distincts.

Je voudrais saluer, à nouveau, l'important travail qui a été réalisé par le rapporteur. Il me semble toutefois nécessaire d'aller plus loin, notamment en faisant le lien avec la question des moyens humains.
Ma première observation concerne le délai d'audiencement. S'il est inconnu pour l'ensemble des juridictions françaises, il semble qu'il y ait un décalage important entre l'enclenchement des poursuites et la première audience de jugement. Le délai de traitement des affaires correctionnelles a, en outre, augmenté de plus de 11,5 % entre 2005 et 2010. Pour la suite de nos travaux, il serait intéressant de réaliser un travail supplémentaire sur cette question : j'aimerais savoir, en particulier, quel est le délai médian. Le rapport indique clairement que, faute de pouvoir recueillir des informations fiables pour l'ensemble des peines prononcées au plan national, les outils statistiques n'offrent qu'une vision lacunaire et imparfaite de l'exécution des peines. J'observe, au demeurant, que les données disponibles proviennent de la « nouvelle chaîne pénale » (NCP), qui ne concerne que les sept juridictions situées en Île-de-France.
Malgré le travail important réalisé par le rapporteur, je trouve qu'il manque aussi une analyse causale des difficultés rencontrées en matière d'exécution des peines. Il n'y a pas que la question des moyens : l'organisation et les méthodes de travail comptent aussi. A l'image du système de santé et de l'éducation nationale, la justice est une « entreprise de personnel ». Or, sur les 47 pays du Conseil de l'Europe, nous sommes classés au 37e rang. La question des moyens humains mérite donc toute notre attention. Pour la petite histoire, le mot « emploi » ne figure que deux fois dans le rapport, et ce dans les expressions suivantes : « mode d'emploi » et « introduction de l'emploi du paiement par mode électronique ».

Cette séance est un moment fort pour notre Commission. L'objectivité, le calme et la pondération des différentes interventions ne font que renforcer la solennité de cette réunion. J'espère qu'un tel état d'esprit perdurera, et que nous ferons tous l'effort intellectuel nécessaire pour sortir des « rails » habituels : la question des moyens importe, mais il ne faut pas se limiter à cette problématique.
Le respect du juge et de l'institution judiciaire en tant que telle me semble un élément essentiel, tant pour l'opinion publique que pour le justiciable. Je ne devrais pas avoir besoin de le rappeler, mais quand on entend dire que les juges sont des moins-que-rien et qu'ils sont trop laxistes, quand on voit qu'ils ne sont pas respectés au plus haut niveau de l'État, on ne peut qu'avoir du mal à accepter les sanctions. J'ajoute que le respect des juges et celui de l'institution elle-même sont intimement liés : quand l'institution n'est pas respectée, ce sont les juges qui ne le sont pas ; quand un juge n'est pas respectable, c'est l'institution qui en pâtit. Je ne crois pas utile d'en dire davantage, car vous voyez à quoi je fais allusion.
Si l'on veut assurer l'efficacité des décisions de justice, il faut aller vite : la sanction n'a d'efficacité que si elle est prononcée très rapidement après les faits. Ce qu'a dit Etienne Blanc sur la transcription des éléments d'information au casier judiciaire me paraît également très important.
Même si cela peut heurter certaines consciences, je pense que nous devons aller plus loin dans la modernisation de notre système répressif en développant des peines véritablement alternatives à l'emprisonnement. Ce dernier reste nécessaire pour les cas les plus difficiles – je ne suis pas laxiste –, mais il faut adopter une culture du milieu ouvert dans la majorité des cas, afin de permettre une réinsertion aussi rapide que possible. Celui qui a dévié à un moment donné doit pouvoir être ramené dans le droit chemin.

Je m'associe aux félicitations adressées à Étienne Blanc, et je fais miens les propos tenus sur la question des moyens, mais je voudrais aussi rappeler que la tâche de la justice s'est considérablement accrue en matière civile – avec la création du JEX, le juge de l'exécution, avec les dispositions applicables au surendettement, avec la modification du régime des tutelles et bientôt avec le contrôle des hospitalisations d'office –, mais aussi en matière pénale. On a, en effet, juridictionnalisé l'application des peines. Cette évolution est positive, mais elle a considérablement alourdi la charge de travail. Il est exact que les gouvernements successifs ont augmenté les moyens alloués à la justice – de 30 % de 1997 à 2002, selon l'opposition, et de 40 % depuis 2002, nous dit la majorité –, mais ces efforts ne se sont traduits que par la création d'un peu moins de 400 postes de greffiers, soit deux greffiers de plus par tribunal, tandis que les effectifs des magistrats étaient réduits de 176 postes. Les efforts ne sont donc pas à la hauteur de l'accroissement des besoins.
En matière de contrôle, un premier dysfonctionnement résulte de l'absence de lien entre les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) et les SPIP : les psychiatres intervenant en prison ne communiquent que très peu avec les conseillers d'insertion et de probation. Un second dysfonctionnement est qu'il n'existe pas de véritable contrôle du suivi psychiatrique réalisé à la sortie de prison. Dans l'affaire en cause, le SMPR ne s'est pas préoccupé de la transmission du dossier à un centre de consultation médico-psychologique, alors que la fin de la détention avait été très profitable pour l'intéressé, qui s'était montré plus facile que par le passé, intéressé par sa prise en charge psychiatrique et soucieux de rembourser les victimes de ses précédentes infractions.
Il existe aujourd'hui trois types de contrôle : le sursis avec mise à l'épreuve (SME), qui n'a pas été mis en oeuvre pour les raisons que nous connaissons ; l'inscription au Fichier national des délinquants sexuels, le FIJAIS, qui se limite en réalité à un contrôle d'adresse – on pourrait d'ailleurs s'interroger sur une coordination avec le SPIP ; et l'enregistrement des plaintes éventuelles, qui ne fait pas l'objet d'une coordination avec le suivi. Dans cette tragique affaire, la multiplication des plaintes aurait permis de comprendre que l'intéressé était entré, en l'absence de soins, dans un cycle inquiétant de montée de la violence, alors que son profil n'avait pas attiré l'attention dans un premier temps.
J'en viens à la question des peines non exécutées. Il est précisé, à la page 23 du rapport, qu'elles sont au nombre de 82 000, dont 70 % sont des peines de moins de six mois, et 90 % des peines de moins d'un an. Faisons attention au maniement de ces chiffres : il s'agit de peines aménageables, et il ne faudrait pas désespérer complètement nos concitoyens en leur laissant croire que les peines de prison ne sont jamais exécutées. Nous aurions besoin d'une évaluation plus fine, faisant ressortir les peines qui ne sont pas exécutées du tout.

Le problème de l'exécution ne concerne pas tant les peines longues, qui sont exécutées, que les condamnations infligées en réponse à la « délinquance quotidienne ». Le drame est que cette délinquance nécessite une exécution immédiate : il s'agit de donner des repères à ceux qui n'en ont pas. Par ailleurs, cette situation ne facilite pas la tâche des services de police et de gendarmerie qui se heurtent, dans certains secteurs, à de graves difficultés pour lutter contre ce type de délinquance. Il y a donc un intérêt général très fort à ce que ces peines soient exécutées rapidement.

Le rapport de M. Étienne Blanc et les circonstances dans lesquelles nous l'examinons nous conduisent à aborder ces questions avec une grande humilité, mais également l'exigence de ne pas conclure à la fatalité. Entre l'attitude démagogique, qui affirmerait qu'il est possible de trouver un système permettant d'éviter toute récidive, et la nécessité d'en éviter le maximum, il existe une marge, qui est celle de la responsabilité du politique.
Personne ne peut affirmer que la réponse dépende uniquement des moyens dont dispose la justice, ce qui ne signifie pas qu'ils soient indifférents. M. Philippe Houillon s'est placé sur le plan méthodologique : nous ne sommes pas opposés à un bilan juridiction par juridiction, qui permettrait de mobiliser toute la société. Il n'en reste pas moins que les chiffres relatifs à la justice ont un caractère effarant : quatre ans pour obtenir un jugement devant les prud'hommes, qui peut s'en satisfaire ? Certaines juridictions sont totalement sinistrées, d'où un déficit de confiance dans la justice.
Il faut également savoir que les dernières promotions de l'École de la magistrature sont en forte diminution : ne faudrait-il pas prévoir des recrutements exceptionnels de magistrats, comme on en a connu dans le passé, afin de prévenir les problèmes ? Comme l'a rappelé le président Warsmann, plusieurs rapports du Sénat ou de l'Assemblée nationale ont également mis l'accent sur le nombre moyen de dossiers traités par conseiller : de 80 à 130.
Il convient de tirer des enseignements de la dramatique affaire de Nantes en termes d'organisation. Peut-on reprocher aux conseillers de ne pas s'être aperçu de la présence de l'extrait B 1 puisqu'un tel extrait ne se trouve pas habituellement dans le dossier transmis au SPIP ? Il faut effectivement, monsieur le ministre, rendre obligatoire sa transmission dans le dossier car il contient des informations indispensables à une bonne appréhension de la personnalité du prisonnier. Le dossier était arrivé au SPIP dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve pour outrage à magistrat, et non pour violence sexuelle. Si l'extrait du casier B 1 devait éveiller l'attention du conseiller, il n'en reste pas moins que le dossier contenait deux appréciations successives fort différentes : selon la première, Tony Meilhon était dangereux et nécessitait un suivi, alors que la seconde, rédigée par celui qui a rempli le dossier de sortie, affirmait que le prisonnier ne présentait aucun caractère particulier de dangerosité, ce qui ne pouvait que rassurer ceux qui étaient chargés de mettre en oeuvre les mesures de suivi.
La lecture détaillée du rapport invite donc à prendre des initiatives, parfois complexes, notamment en matière de secret médical : les constatations effectuées par les médecins ne figurent pas de manière précise dans le dossier parce que ceux qui sont destinés à le lire ne sont pas médecins. Or, cette difficulté a déjà été relevée : les rapporteurs, page 18, précisent en effet que « la mission a constaté l'absence de partage d'informations opérationnelles entre les acteurs pénitentiaires et les acteurs de santé intervenant au centre pénitentiaire de Nantes ». C'est ainsi que Mme X observe que « le service médical ne donne aucun renseignement sur les détenus qui sont suivis. Il n'y a aucun échange possible dans ce domaine. Je n'en connais que ce que Meilhon m'a dit ».
Ce défaut d'échange n'est pas spécifique au cas Meilhon : il est la norme. Il s'agit là d'une situation à risque, à laquelle il est d'autant plus urgent de répondre que les rapporteurs renvoient à un précédent rapport, remontant à 2006, dans lequel l'inspection générale des services judiciaires avait noté que « les deux administrations concernées (Justice et Santé) devraient approfondir les réflexions déjà engagées pour définir un protocole de secret partagé au terme duquel le praticien devrait à tout le moins communiquer au travailleur social l'information selon laquelle un condamné suit ou non les soins qui lui sont imposés, à l'exclusion de tout autre renseignement de nature médicale. » Il s'agit là d'éléments objectifs que le politique doit traiter rapidement. La situation est grave. M. Garraud affirme que la nouvelle organisation, expérimentée au SPIP de Bordeaux, est une réussite. C'est possible. Il est toutefois peu rassurant que les services travaillent en autogestion avec pour seule règle la personnalité du chef de service, en dehors de toute harmonisation avec la direction centrale.
Cette affaire dramatique doit nous inciter à trouver des réponses en termes non seulement de moyens, mais également de circuit de l'information pénale.

S'agissant du fonctionnement des services, les rapports ont pointé des erreurs dans les choix, tant du TGI de Nantes que de la Cour d'appel de Rennes, puisque les moyens auraient dû être affectés au service de l'application des peines. Les rapports démontrent donc que la réponse ne dépend pas uniquement de la quantité des moyens affectés, même si l'effort entrepris depuis 2002 doit être poursuivi, mais également de leur bonne affectation, ce qui implique de revoir l'organisation des ressources humaines, notamment au TGI de Nantes.
Monsieur le ministre, vous avez lancé le 2 février un plan national d'exécution des peines : prendrez-vous, comme je le suppose, ces deux rapports en compte pour améliorer l'efficacité de ce plan ?

Le budget de la justice a augmenté non pas depuis 2002 mais depuis 1997 : de 30 % de 1997 à 2002 et de 40 % depuis 2007. Ne retombons pas dans l'ornière de clivages stupides.
Si les citoyens assistaient à notre commission, ils auraient de quoi désespérer : au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les rapports se succèdent sur l'insuffisance des moyens et sur l'inexécution des peines, problèmes que Julien Dray et Delphine Batho, qui s'occupaient des questions de sécurité au PS, avaient déjà relevés en 2002, pour la campagne présidentielle de Lionel Jospin. Voilà neuf ans ! Et on continue d'empiler les rapports sur le sujet, alors que chacun sait que le mauvais fonctionnement de la chaîne pénale, provoquant un sentiment d'impunité, incite à la récidive.
Philippe Houillon a raison de proposer une évaluation : il se rappellera que la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau avait conclu à l'organisation dans chaque tribunal d'états généraux sur la justice. Mes chers collègues, qu'attendons-nous pour les organiser nous-mêmes ? C'est notre travail. Le Gouvernement a autre chose à faire ! Faisons moins de lois mais procédons à un plus grand nombre d'évaluations et de contrôles. Décidons ce soir d'évaluer les moyens dont dispose, ou ne dispose pas, chaque tribunal.
Enfin, Bernard Roman a évoqué la mission parlementaire au Québec. J'y suis allé avec Jacques Floch : lorsque les Québécois ont décidé de consacrer beaucoup d'argent à leur système pénitentiaire ainsi qu'à l'insertion et à la probation, l'opinion publique n'y fut pas favorable. Or, la récidive a diminué, ce dont tous les Québécois se félicitent aujourd'hui.
L'affaire Laëtitia nous invite, pour une fois, à parler des SPIP. Toutefois, monsieur le ministre, je vous suggère également de doter de moyens supplémentaires la protection judiciaire de la jeunesse, dont on ne parle jamais, non plus. Or, plus la PJJ disposera de moyens, moins les SPIP en auront besoin.
Enfin, monsieur le ministre, j'ai visité, moi aussi, lors de la commission d'enquête sur les prisons de 2000, quelques vieilles prisons, notamment celle d'Aubusson, qui située au coeur de la ville, date de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe. Les détenus ne voulaient en changer pour rien au monde, car tout se passait comme en famille : ils étaient peu nombreux – trente ou quarante –, se connaissaient tous entre eux, et leurs proches pouvaient facilement venir les voir. Comme quoi les grandes prisons inhumaines et métalliques ne constituent pas nécessairement la meilleure réponse, monsieur le ministre, même s'il faut éliminer les très vieilles prisons.

Nous avons vécu ce soir un grand moment de vérité et de sérénité, et l'analyse des dysfonctionnements mis en lumière par les rapports fait l'unanimité de la Commission. Vous les avez rapidement diligentés et vous faites preuve de la plus complète transparence : je vous en remercie, monsieur le ministre.
Ce qui m'étonne, c'est la trop grande autonomie dont jouissait le SPIP de Nantes, qui dysfonctionnait depuis très longtemps, à tel point que plusieurs directions ont échoué à l'organiser. Il ressort du débat de ce soir que la réponse dépend surtout d'une meilleure affectation des moyens et d'une amélioration de l'organisation. La transversalité est le maître mot : comment se fait-il que les SPIP fonctionnent de manière autonome et qu'il n'y ait aucune transversalité entre le milieu fermé et le milieu ouvert ? Il appartient au juge d'application des peines de contrôler leur coordination. Approfondissons ensemble ces pistes de réflexion, dans le cadre d'une mission parlementaire, en vue de construire une meilleure justice pour nos concitoyens. Leur attente est forte en la matière.
Je vous remercie, monsieur le ministre, des perspectives que vous avez ouvertes. Je tiens également à saluer le rapport de M. Blanc ainsi que les réflexions de M. le président Warsmann. Nous déplorons depuis trop longtemps les conséquences de la non-exécution et du mauvais suivi des peines en matière pénale. Remédions-y enfin.

Merci pour ce moment de vérité. Le problème des SPIP reste à traiter. Au-delà de la question du nombre, je constate un grand malaise culturel chez les conseillers d'insertion et de probation : jadis travailleurs sociaux de la prison, chargés de préparer au mieux l'entrée et, surtout, la sortie d'une population souvent en très grande difficulté vers l'insertion professionnelle, le lien familial et l'hébergement, ils se voient désormais demander de prédire le profil de dangerosité ou le risque de récidive des détenus libérés, tâche que, faute d'outils, ils jugent très difficile. Les expériences menées au Québec, comme les échelles actuarielles, ne font pas partie de la culture française et restent à évaluer pour être adaptées à notre monde. En matière de suivi, c'est-à-dire en matière humaine, il est difficile de passer du subjectif à l'objectif.
Par ailleurs, le Centre national d'observation (CNO) de Fresnes, conçu voici plus de 60 ans, est désormais quelque peu obsolète et doit être revivifié et régionalisé – je souhaiterais pour ma part que nous disposions de neuf structures de ce type, correspondant aux directions interrégionales. Il ne doit pas s'agir seulement d'outils médico-psychologiques, mais les SPIP doivent aussi pouvoir y faire des stages de formation. De fait, la prévention de la récidive ne doit pas se cantonner au niveau de l'organisation et des moyens et il y entre bien des éléments insaisissables. Les futurs centres doivent être réellement dotés de moyens importants.

Je salue l'événement douloureux qui nous vaut d'évoquer aujourd'hui en même temps un sujet d'actualité et un sujet au long cours, et vaudra sans doute à l'excellent rapport de M. Étienne Blanc d'être mieux entendu et mis en oeuvre.
Je souhaite que les propos délibérément mesurés que nous tenons ici ne soient pas oubliés lorsque nous sortirons de cette salle. En effet, M. Roman, qui nous a le premier invités à la mesure, sait bien qu'une partie essentielle du drame de la vie de Tony Meilhon s'est nouée alors qu'il était lui-même président de la Commission des lois. Ne nous exonérons pas à bon compte en limitant les analyses au manque de moyens : nous avons tous reconnu que ce n'était pas la seule cause des dysfonctionnements. De fait, même quand les moyens augmentent, comme cela a été le cas entre 1997 et 2002 et, plus encore, entre 2002 et 2011, les difficultés subsistent et certaines difficultés nouvelles apparaissent.
Dans sa déposition, Meilhon rappelle que, mineur et voleur, il a été mis en prison avec un mineur et violeur. Le voleur est ainsi devenu violeur pour avoir été mis en prison avec un autre mineur. Ayons l'humilité de réviser nos convictions sur les centres éducatifs fermés : s'ils avaient existé plus tôt, Meilhon aurait sans doute relevé d'un tel centre.
Monsieur le ministre, l'affaire Meilhon nous conduit donc à la question de la justice des mineurs. M. Raimbourg et moi-même avons représenté notre assemblée lors de travaux de la commission Varinard, pour bâtir une esquisse d'avant-projet de loi visant à donner aux principes de l'ordonnance de 1945 modernité et efficacité. À la lumière des événements qui ont marqué la jeunesse de Meilhon et son passage à l'âge adulte, n'est-il pas temps de proposer une vision intégrale de ce que doit être notre justice des mineurs ? Tout ce qui pourra être fait dans ce sens me semblera positif.
Je vous remercie de m'avoir invité à cette séance passionnante de la Commission des lois et je me réjouis que celle-ci soit publique, permettant à nos concitoyens de voir que le législateur et le Gouvernement veulent construire un service public de la justice aussi efficace que possible. Je suis preneur de bon nombre des idées qui ont été exprimées ce soir et je me félicite que les analyses ne se soient pas limitées à incriminer le manque de moyens, mais qu'on ait évoqué de véritables réformes des méthodes de travail et du fonctionnement du service public de la justice.
Récemment arrivé dans ce ministère, je m'interroge sur bien des points. Comme le montre la variation du nombre de dossiers par conseiller – de 64 dans de très grands départements à 184 dans certains départements d'outre-mer, avec une moyenne de 100 –, toute évaluation doit nous conduire à modifier pour tous les services, y compris les tribunaux, les allocations de moyens. Il faut mettre les moyens, si réduits soient-ils, là où sont les besoins et remettre en cause les situations acquises. Sur le terrain, où j'essaie de me rendre souvent pour parler avec les agents de la pénitentiaire et les magistrats, je constate que les charges sont différentes et qu'une évaluation sera très utile. Les moyens statistiques du ministère ne la permettent pas encore et j'espère que j'obtiendrai les moyens que j'ai demandés à cet effet. J'entends faire preuve en la matière de la transparence la plus absolue, car on ne gagne rien à se cacher des choses.
Accroître les moyens sans tenir compte de la réalité des charges de travail ni modifier les méthodes de travail ne permettrait pas l'amélioration optimale que l'on peut en attendre. Je me réjouis donc de la proposition du président Warsmann : 120 millions d'euros doivent bien représenter 1 500 emplois, toutes catégories confondues – ce qui est peut-être même un peu trop : ce budget devrait aussi permettre d'améliorer l'équipement des tribunaux et des services pénitentiaires.
Dans le domaine pénitentiaire, il faut aujourd'hui aider le milieu ouvert et la PJJ est à cet égard essentielle. Je ne peux donc qu'encourager M. Vallini, en sa qualité de président du Conseil général de l'Isère, à signer le plus vite possible avec la PJJ un accord de coopération approfondie.

Le plan d'urgence est indispensable à cause des flux mais aussi des stocks accumulés. La volonté d'assurer un traitement en temps réel et de gérer les stocks doit être très forte.
J'ai obtenu en urgence pour cette année des crédits qui nous permettront de recruter des vacataires pour les SPIP et 400 greffiers dont nous pourrons ainsi disposer immédiatement, en attendant l'arrivée de ceux qui sont en formation. En effet, les postes de titulaires que nous créons ne seront pourvus que dans deux ans.
La Commission autorise ensuite le dépôt du rapport de la mission d'information en vue de sa publication (M. Étienne Blanc, rapporteur).
La séance est levée à 20 heures 15.