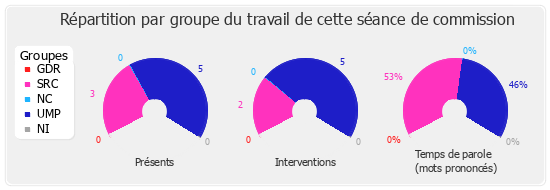Commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies
Séance du 15 septembre 2010 à 17h00
La séance
L'audition débute à dix-sept heures trente.

Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la commission d'enquête parlementaire sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies.
Depuis des années, vous avez multiplié les mises en garde contre les dérives du système financier dans des ouvrages aux titres évocateurs : Les Vertiges de la finance en 1987, La Tyrannie des marchés en 1995, L'Arrogance de la finance en 2009 et, il y a quelques jours, Marchés de dupes : pourquoi la crise se prolonge.
Vous êtes donc pour nous un témoin précieux car vos analyses et vos préoccupations recoupent parfaitement les nôtres.
Notre mission a en effet pour origine la crise financière et, à la suite de celle-ci, la crise grecque qui a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur la sensibilité des marchés financiers aux rumeurs, sur les conflits d'intérêts affectant certains opérateurs à la fois conseils des émetteurs de titres souverains et acteurs sur les marchés des dettes souveraines, sur le mécanisme des credit default swap (les CDS) ou sur les effets déstabilisants des outils permettant les ventes à terme et à découvert de certains produits financiers.
Notre commission d'enquête cherche donc à répondre aux questions suivantes : quelles sont les méthodes employées par les spéculateurs ? En quoi l'automatisation des décisions de vente ou d'achat amplifie-t-elle les mouvements spéculatifs ? Qui se livre aux attaques spéculatives et à partir de quelles zones de marché – nous avons conscience qu'il sera difficile de répondre à cette question – ? Quel est le rôle des hedge funds ? Quel est celui des agences de notations dans les prises de position des fonds spéculatifs et des acteurs de marché ? Peut-on considérer qu'il y a eu, à l'occasion de la crise grecque, « délit d'initiés » ? Enfin, deux ans après la crise des subprimes, les bonnes décisions ont-elles été prises par les acteurs compétents au bon moment pour stopper ces mouvements spéculatifs ?
Nous souhaitons établir les responsabilités des différents acteurs et, in fine, faire des propositions afin d'éviter qu'une telle crise ne se reproduise. Nous avons besoin, à cette fin, de vos lumières.
(M. Henri Bourguinat prête serment.)
Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je tiens, par pédagogie, à faire précéder mon propos d'une brève analyse du concept de spéculation, qui est difficile car il est connoté.
Pour un grand nombre de nos compatriotes, la spéculation, c'est le diable. En 1964, le ministre britannique des affaires étrangères, George Brown, avait évoqué « les gnomes de Zurich », qu'on considérait à l'époque comme les artistes de la spéculation. Je crains que les mêmes artistes n'aient essaimé aujourd'hui : j'en vois dans les paradis fiscaux, du côté de Londres, des Îles Anglo-normandes ou de l'État américain du Delaware ou encore en Chine. La liste n'est pas exhaustive. La spéculation est quelque chose de relativement envahissant. Elle est toutefois, pour les économistes, une catégorie d'opérations comme les autres, répondant à une nécessité du marché.
Spéculer, c'est tenter de réaliser un gain en prenant le risque d'anticiper une variation du prix d'un actif. La spéculation est aujourd'hui de plus en plus « à découvert » : on spécule sur un actif sans le posséder. Il s'agit d'une spéculation pure puisqu'elle ne fait pas intervenir un processus de transformation ou de mise en valeur de l'actif. Spéculer, c'est donc chercher à gagner de l'argent en « voyant au loin » (speculare, en latin), c'est-à-dire en essayant de deviner l'évolution du prix du marché.
La spéculation a fait l'objet depuis longtemps de l'attention des meilleurs économistes. Je pense non tant à Keynes qu'à Milton Friedman, l'apôtre de l'école de Chicago, pour lequel la spéculation est vertueuse car elle doit être gagnante : on spécule pour réaliser un gain. À cette fin, il faut acheter quand les prix sont bas et vendre quand ils sont hauts. La spéculation aurait une vertu stabilisatrice. Cette démonstration était toutefois un peu trop simple car on s'est aperçu, depuis, que la spéculation dépendait notamment des anticipations : elle peut donc également conduire à acheter quand le prix monte ou à vendre quand il baisse.
Un autre économiste, néo-keynésien, a également mis en valeur à la fin des années trente les vertus de la spéculation : il s'agit de Nicholas Kaldor. Pour lui, la spéculation est nécessaire parce que, dans toute société économique, deux catégories d'opérateurs s'opposent : ceux qui prennent des risques et ceux qui ne souhaitent pas en prendre. La spéculation a dès lors un caractère stabilisateur car elle permet de transférer le risque des seconds sur les premiers. Le mécanisme de la spéculation se rapprocherait ainsi de celui de l'assurance. C'est en partie vrai. S'il existe une face sombre de la spéculation – celle qu'on retient aujourd'hui –, il n'en existe donc pas moins une face positive puisque la spéculation peut participer de la croissance et du bien-être économique.
Le seul problème tient au dosage car il convient d'éviter de se lancer dans des mouvements incontrôlés. Il n'en est pas moins vrai que de tels mouvements parsèment l'histoire économique, du XVIIe siècle, avec la folie des tulipes en pays batave, bien avant la crise de 2007, en passant par la spéculation des Mers du Sud au XVIIIe, le mouvement des chemins de fer aux États-Unis en 1905, le krach de 1929. Or, depuis cette date, on observe une accélération de ces mouvements, ce qui ne peut que nous inquiéter : 1987, 1991, 2001 avec la spéculation sur la « nouvelle économie », et, enfin, 2007. Du reste, cette dernière crise n'est toujours pas finie en 2010 : nous sommes engagés dans sa troisième année.
Si la spéculation connaît périodiquement des dynamiques incontrôlables, c'est notamment en raison du comportement panurgéen des opérateurs et des spéculateurs et d'anticipations qui, pour être erronées, n'en sont pas moins autoréalisatrices du fait que tous les opérateurs les développent en même temps. Il ne faudrait pas non plus oublier les « bulles », qu'on évoque parfois à tort et à travers : en effet, il ne saurait y avoir de bulle financière sans prix d'équilibre, ce qui ne fut pas le cas, par exemple, lors de la très forte hausse du prix du pétrole. Il n'y a donc pas eu, à proprement parler, de bulle pétrolière.
En août 2007, ces divers phénomènes ont débouché sur un quasi-blocage du système financier. Le marché interbancaire a presque été stoppé, puisque les banques ne se sont plus prêtées entre elles. Il convient d'ajouter à cette situation la tendance à développer des chaînes d'opérations très longues et très fournies, de ce fait incontrôlables. J'avais essayé à l'époque de mettre en garde contre la perte de contrôle des dérivés de crédits, en raison de leur absence de traçabilité : dans la plupart des cas, ils sont liés en effet à des opérations non pas de couverture du risque mais spéculatives, de prise de risque : songez aux événements récents relatifs à la dette souveraine grecque.
La spéculation peut donc avoir des effets délétères tout à fait impressionnants : le Bureau international du travail estime à 51 millions le nombre de chômeurs engendrés par la crise, que la spéculation a provoquée. C'est un chiffre effrayant.
Cette crise a donné lieu à des plans de sauvetage qui étaient inévitables. Comme l'a noté Martin Wolf, on a fait décoller les « hélicoptères » des banques centrales. Des « torrents de liquidités » ont été versés et on a réussi à colmater les brèches avec beaucoup de difficultés. Nous payons aujourd'hui en termes de déficit budgétaire le prix des politiques mises en oeuvre de lutte contre la spéculation. Or les endettements sont de plus en plus difficiles à gérer, ce à quoi il convient d'ajouter un nouveau phénomène : la dépossession des États. Ce qui s'est passé en Grèce à partir de mars et d'avril derniers montre qu'un mouvement de spéculation, une fois amorcé, est difficilement gérable et qu'il peut mettre en cause jusqu'au sort d'une grande monnaie, en l'occurrence l'euro. Il a fallu mettre en oeuvre deux plans de sauvetage : 110 milliards d'euros tout d'abord avant quelque 500 milliards du côté de l'Union européenne et 250 pour le FMI.
Nous en sommes donc à une période charnière : nous pouvons en effet nous interroger sur les possibilités déstabilisatrices profondes du système actuel, que peut emporter la spéculation. Le marché des obligations commence lui-même à être touché. Les banques centrales, je le répète, ne pouvaient pas ne pas intervenir mais les traites de cette intervention sont désormais tirées sur notre avenir. Or ces traites sont très lourdes et certains gouvernements travaillent aujourd'hui, comme nous l'avons souligné dans notre dernier livre, « sous bracelet électronique ». Les hommes politiques ont désormais l'oeil fixé, du reste fort légitimement, sur la note du triple A, du fait que nous dépendons de l'endettement international et que la spéculation a mis à mal l'équilibre monétaire et financier. Hier, c'était le secteur public qui renflouait le secteur privé des banques ; demain, qui, le cas échéant, sera capable de renflouer le secteur public si la situation des États s'aggrave ?

Monsieur le professeur, nous sommes tout à fait conscients de l'ambiguïté de la spéculation. Son rôle peut être positif lorsqu'elle facilite la liquidité et agit comme un mécanisme d'assurance.
Nous voudrions savoir à partir de quel moment la spéculation devient dangereuse et si des mécanismes doivent être prohibés pour éviter de nouveaux dérapages incontrôlés.
L'Allemagne a pris et maintenu des dispositions, notamment l'interdiction des ventes à terme sur les titres souverains. Certaines autorités ont également décidé d'interrompre temporairement les marchés pour éviter des dérapages.
Qu'en est-il également de la spéculation en haute fréquence, à la nanoseconde ? Est-elle utile à l'économie ?
Quels sont les mécanismes qui vous paraissent devoir être éradiqués ou, du moins, contrôlés ?

Monsieur le professeur, vous nous avez dit qu'en matière de spéculation tout n'est finalement qu'une question de dosage : lorsque celui-ci est mauvais, il enclenche des dynamiques « incontrôlables », mot inquiétant car nous pouvons nous demander si ces dynamiques peuvent être contrôlées.
Voyez-vous dans les dispositifs qui se mettent actuellement en place, aux plans français, européen ou américain, des avancées susceptibles de faire disparaître le caractère « incontrôlable » des processus engendrés par la spéculation ? Auriez-vous des suggestions à faire pour compléter les politiques mises en oeuvre ?
La crise a bien montré qu'à partir d'un moment donné le processus de spéculation n'est plus contrôlable. La réaction de bon sens serait d'éviter l'enclenchement de tels processus, c'est-à-dire de conduire une politique de prévention, en mettant au point un système robuste. Il conviendrait de sérier les causes de la crise véritablement « extra-ordinaire » que nous avons subie afin de proposer des remèdes qui leur correspondent.
Ces causes, nous les connaissons. Les Anglo-saxons ne sont pas les seuls responsables : nous avons également participé au déclenchement de la crise. Selon l'image de la Semeuse, des crédits ont été transformés en titres, ce qui, reconnaissons-le, est tout de même une pratique assez étonnante ! Comment un banquier peut-il ouvrir un crédit à des représentants du secteur immobilier ou à des ménages et transférer le risque, c'est-à-dire, en quelque sorte, « passer le mistigri » à d'autres ? Cela met en cause le processus de titrisation, lequel revient, pour le banquier, à changer la psychologie qui était encore celle de la banque au début des années 1980. La perte de traçabilité de ces dérivés du crédit et de ces montages proliférants que personne ne contrôlait plus est la première origine de la crise. Dans un livre précédent, L'Arrogance de la finance, Éric Briys, ancien professeur d'HEC et opérateur durant dix ans sur la place de Londres, et moi-même avons souligné que la scientificité de la théorie financière n'était peut-être pas aussi avérée qu'on aimait bien le dire. Il ne faut certes pas jeter le bébé avec l'eau du bain : toute théorie financière n'est pas à écarter, toutefois ses présupposés et ses conclusions ne se révèlent pas toujours exacts.
Un modèle d'activité – un business model – qui consiste à faire émerger des crédits et à distribuer le risque est un modèle dangereux. L'idée de faire porter le risque à d'autres que des banquiers ou des assureurs était en soi intéressant. Toutefois, en projetant trop loin le risque, on en a perdu complètement le contrôle. Il conviendrait donc de réfléchir tout d'abord à la titrisation.
Or la loi financière américaine de juillet dernier prévoit que 5 % seulement du risque devraient être conservés par les banques : c'est dérisoire. Il aurait fallu aller plus loin. Les dérivés de crédit sont utiles pour permettre à une banque de se protéger en partie lorsqu'elle ouvre un crédit. Ce faisant, elle étend la base du financement. Les banques devraient toutefois retrouver une partie du contrôle du risque qu'elles ont elles-mêmes ouvert. Je ne discerne non plus aucun progrès sensible du côté de l'Union européenne en la matière.
J'appelle votre attention sur le fait qu'on savait que le processus de titrisation était potentiellement très dangereux : la crise grecque a permis d'en vérifier de nouveau la capacité déstabilisatrice du fait que les crédits sur la dette souveraine grecque étaient négociés naked, c'est-à-dire « nus », sans que même les spéculateurs possèdent les obligations de la dette grecque, ce qui a pu mettre en question jusqu'à la monnaie européenne. Même si la croissance a effectivement besoin d'une finance dynamique, celle-ci n'a pas lieu pour autant de transférer 70 % à 80 % du risque créé. La titrisation étant une des origines de la crise, il conviendrait, je le répète, de la contrôler.
En ce qui concerne la haute fréquence, le fait qu'en quelques millisecondes des opérations se développent sur la base de programmes automatiques, loin d'aller dans le sens d'une appréciation diversifiée des tendances des marchés, va dans celui de la concentration des anticipations. De ce point de vue, la « haute fréquence » est dangereuse. Il est toutefois difficile de l'empêcher car, derrière ce phénomène, il y a l'achat par les banques à un prix élevé d'algorithmes développés et d'ordinateurs surpuissants. Je ne vois pas quelle banque accepterait de modérer la puissance de ses ordinateurs puisqu'il s'agit d'un avantage comparatif évident.
Le dosage, Monsieur le président, est, lui aussi, difficilement contrôlable. En période de calme des marchés, la proportion entre les opérations spéculatives et les opérations non spéculatives est acceptable. De plus, parmi les opérations spéculatives, certaines vont dans le sens de la hausse et d'autres dans celui de la baisse. Cet équilibre relatif disparaît dès l'instant qu'un mouvement de fond est déclenché : tous les opérateurs vont alors dans le même sens et la situation devient difficilement contrôlable.
En 1987, les banques américaines avaient été contraintes de débrancher leur programme automatique – ou program trading. Le G 20 ne devrait-il pas prendre, au moins temporairement, une mesure comparable ? Sans être pessimiste, je tiens à constater que les décideurs ne mettent pas suffisamment l'accent sur les mécanismes qui ont dérapé, si bien qu'on se focalise sur les fonds propres, ce qui conduit déjà les banques à développer, sur cette question, leur lobbying. Elles proclament que 450 milliards d'euros devront être trouvés sur le marché, dont, si on en croit un honorable banquier de la place de Paris, 150 milliards pour les seules banques françaises. Ce lobbying, qui fait partie du jeu, vise à faire passer, en matière d'exigences de fonds propres, un message de modération aux régulateurs de Bâle. Je pense toutefois que la régulation des fonds propres n'apportera pas une sécurité totale. Lehman Brothers avait en effet plus de 12 % de fonds propres. J'enseigne depuis des décennies la réglementation des fonds propres aux étudiants : elle m'a toujours laissé circonspect. Certes, les ratios imposés sont fonction de la nature des crédits. Toutefois, imposer le même ratio de fonds propres à une banque du secteur mutualiste et à une banque d'affaires n'est pas nécessairement de bonne méthode.
De plus, nous l'avons souligné avec Éric Bryis dans le livre que j'ai évoqué, les fonds propres peuvent être aisément manipulés. Lors de la crise de 2007, les banques américaines ont émis des obligations « convertibles contingentes », qui se transforment à point nommé en actions : les fonds propres augmentent automatiquement. En France, on a utilisé le procédé de la dette subordonnée, qui n'est pas éloigné de celui utilisé par les banques américaines. Il existe donc des ersatz de fonds propres. L'accord de Bâle 3 modifiera-t-il la donne puisqu'il prohibe les fonds propres hybrides ? La vérité est que Bâle 3 ne proscrira que certains fonds propres hybrides, de plus à un horizon de cinq ans. C'est loin. Par ailleurs, les États-Unis n'ont pas encore mis en oeuvre Bâle 2, alors qu'ils tiennent pour une bonne part la finance internationale. Il serait mieux de faire les choses dans l'ordre et d'appliquer Bâle 2 avant de penser à Bâle 3.

Monsieur le professeur, vous avez expliqué que le processus de spéculation avait des effets délétères – il aurait à lui seul engendré 51 millions de chômeurs supplémentaires. Ce chiffre fait froid dans le dos. De plus les États se sont endettés alors même qu'on ne sait pas qui pourrait renflouer un secteur public défaillant.
Il existe des responsables. Il est certes difficile de les identifier mais peut-on imaginer la création d'un tribunal international pour juger ceux qui ont des responsabilités dans la crise ? Des tels procès auraient peut-être un effet dissuasif, ce qui aurait pour conséquence de responsabiliser davantage les opérateurs.

Monsieur le professeur, vous avez analysé les origines de la crise financière. Certains économistes, notamment américains, mettent également en cause la taille des établissements financiers et évoquent le caractère frauduleux de nombreuses opérations. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, la crise ne devrait-elle pas nous inciter à travailler sur le cloisonnement des activités des banques de dépôt et des banques d'investissement ?
Enfin, que pensez-vous des règles à appliquer pour limiter ou éradiquer les comportements à risques ? Convient-il, comme aux États-Unis, d'en édicter le principe et, dans ces conditions, doit-on en confier l'élaboration à des hommes de qualité ? Si on en croit Paul Krugman, faire confiance à la qualité des hommes ne permet pas toujours de préserver la bonne santé de l'économie. La constitution d'un groupe de travail intergouvernemental ne présenterait-elle pas, elle aussi, des risques ?
Votre proposition, monsieur Cousin, est intéressante et généreuse. Elle est fondée en équité. Toutefois, vous connaissez suffisamment les comportements des milieux financiers pour savoir que la mesure serait très difficile à mettre en oeuvre alors même qu'on arrive à peine à faire juger par un tribunal international les crimes de sang. Du reste, qui verriez-vous comme juges ? Ils risqueraient d'être très liés à ceux qui ont déclenché les événements.
Ceux-là même qui élaborent actuellement la réglementation de Bâle sont en très grand nombre d'anciens banquiers, certains liés à Goldman Sachs, ce qui se conçoit très bien en raison du caractère technique des mesures à édicter. Je ne me risquerai pas non plus à prévoir un jury populaire car cette même technicité le décrédibiliserait très vite.
Madame Karamanli, vous avez eu raison d'évoquer la taille des établissements : c'est un des problèmes majeurs, que j'ai étudié en détail dans le dernier livre qu'Éric Briys et moi-même avons signé, Marchés de dupes : pourquoi la crise se prolonge. La règle too big too fail – « trop gros pour faire faillite » – est omniprésente dans le débat actuel.
Ce sont principalement les grandes banques d'affaires qui ont été à l'origine de la crise. Mais comme la finance a horreur du vide, elles ont été reprises – je nommerai simplement Merrill Lynch à l'initiative de Bank of America, ou Wachovia qui a été reprise par Wells Fargo. La crise a renforcé la concentration des banques et l'exigence de développer les fonds propres est une incitation considérable à poursuivre la concentration. Or celle-ci est une des causes de la crise. Le remède me paraît donc loin d'être adéquat.
Paul Volcker, qui connaît bien le milieu de la finance, a compris que la seule façon de dégonfler la bulle spéculative était de casser l'oligopole bancaire et donc de séparer les activités de financement et celles de dépôt. Or la loi américaine Dodd-Frank du 15 juillet dernier réformant Wall Street n'a presque rien prévu en la matière. La proposition dite « Volcker », de scinder les deux régimes, empêchait, dit-on, les banquiers américains de dormir : eh bien, pour finir, la loi interdit aux banques de faire des opérations pour compte propre, sauf si elles le font en relation avec un client. On comprend dès lors la mine réjouie des banquiers américains sortant des auditions : il m'étonnerait qu'on ne trouvât pas aux États-Unis un certain nombre de clients prêts à apparaître dans ces opérations ! C'est donc un coup pour rien et j'attends de voir les décisions que prendra Bruxelles en la matière, car elles ne me semblent pas encore très claires. Si on veut écarter le risque de nouvelles dérives, il faut, en premier lieu, interdire la titrisation et en, deuxième lieu, renoncer au principe du too big too fail, en empêchant la concentration bancaire.
En ce qui concerne la France, vous avez entendu parler, comme moi, de projets de fusion de grandes banques françaises : de tels projets ressurgiront dans les mois à venir. L'Assemblée nationale aura alors un rôle de prudence à jouer car il s'agit-là de procédés antiéconomiques.

Vous avez évoqué Nicholas Kaldor : il a défendu la spéculation et enseigné à Harvard dans les années 1980 l'imperfection des marchés et l'inadéquation de l'offre et de la demande pour produire un prix rigoureux.
J'ai lu, plus jeune, François Perroux, Jean Denizet ou Henri Bourguinat, qui s'inquiétaient du déséquilibre structurel de la balance des paiements américaine et de la croissance autonome des eurodollars – des dollars non-résidents – et des masses flottantes et spéculatives, alors que les chiffres étaient à l'époque, par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, très bas – 80 milliards de dollars de déficit des balances américaines de paiement courant. Aujourd'hui, de tels chiffres feraient presque rire.
J'attendais la crise depuis des années : sans oublier vos ouvrages, un livre de Richard Duncan, The Dollar Crisis, l'annonçait. Elle est arrivée en avril 2007.
Aujourd'hui, les masses en cause représentent des dizaines de milliers de milliards. De plus, au cours des années précédentes, pour remédier aux bulles successives, on a baissé les taux d'intérêt et augmenter les liquidités, ce qui revient à soigner un alcoolique en lui faisant ingurgiter massivement du whisky – cela présente l'avantage d'éviter le sevrage mais ne fait qu'aggraver le mal.
À l'heure actuelle, chacun se focalise sur la réglementation : or, comme je l'ai déjà écrit, elle sera inefficace tant qu'on n'aura pas réfléchi à une approche quantitative. C'est en effet la quantité du problème qu'il convient de diminuer en limitant notamment les masses de capitaux flottants grâce à des politiques structurelles de balances des paiements, qui empêcheraient, en particulier les États-Unis, de demeurer perpétuellement en déficit. Ceux-ci injectent en effet chaque année dans la masse spéculative 200 à 300 milliards, qui, de plus, s'autoreproduisent avec le mécanisme des eurodollars. Quelles que soient les règles fixées, elles seront incapables d'agir sur des masses qui augmentent sans cesse.
Il convient également de conduire des politiques de taux d'intérêt qui préviennent, par une hausse justifiée, la bulle spéculative. Paul Volcker a su imposer des taux d'intérêt réels à 17 % : il a été décrié, il n'en reste pas moins que l'économie américaine s'en est mieux portée durant des années et que le dollar a été restauré. Il aurait mieux valu continuer de suivre ses conseils plutôt que ceux de MM. Bernanke et Greenspan.
S'agissant des ratios de Bâle, chacun sait que personne ne saurait connaître les fonds propres d'une banque à partir du moment où elle titrise massivement. Elle devrait diminuer ses fonds propres en fonction des provisions du haut risque : elle ne le fait pas. Les fonds propres annoncés sont dès lors évidemment faux. A-t-on une idée de la quantité de crédit qu'elle garantit ? Non, puisqu'elle en a quatre fois plus hors banque que chez elle. Un rapport de 7 % ou 8 % entre des fonds propres dont on ignore la quantité exacte parce qu'ils ne sont pas provisionnés comme il le faudrait et un portefeuille de créances qui s'élève au quart de ce qu'il est en réalité, cela n'a aucune signification. C'est de surcroît désavantageux pour les entreprises.
Je terminerai par une anecdote : la titrisation était entièrement garantie par une seule société d'assurance, AIG (American international group). Lorsque cette société a été sur le point de faire faillite, le trésor américain, pour l'éviter, a envoyé un message aux banquiers de la place en leur annonçant que cette société avait à elle seule générer un risque à hauteur de 600 milliards de dollars : les banques ont cru que le trésor américain s'était trompé d'un ou deux zéros. Il ne s'était pas trompé ! Face à des systèmes pouvant engendrer des pertes aussi considérables, comment croire à l'efficacité de la réglementation ?

Le problème, à mes yeux, c'est que le système est normalement régulé mais qu'on ne le laisse jamais fonctionné librement. Contrairement aux États-Unis, la France n'a pas osé laisser les banques faire faillite. Il n'aurait pas fallu mettre un kopek dans Dexia ! Tout système économique se régule naturellement : c'est une loi de la nature. C'est l'intervention des hommes, ou plus exactement des politiques, qui interdit chaque fois au système de se réguler.
Il en est de même des pays en état de faillite : fallait-il aider la Grèce ? On aurait dû la laisser tomber. On ne l'a aidée qu'en raison de son histoire, du risque qu'une faillite aurait représenté pour sa démocratie, des Jeux olympiques. En revanche, on envisage de punir le Portugal si le risque de faillite de ses finances publiques se concrétise.
Les politiques sont-ils bien raisonnables de voter des budgets dont le déséquilibre peut atteindre 250 milliards d'euros ? Ils espèrent qu'une croissance à deux chiffres permettra d'éponger la dette, mais un tel niveau de croissance n'est jamais atteint. Ce sont les politiques eux-mêmes qui pervertissent un système qui, je le répète, est naturellement équilibré. C'est une loi qui a toujours été vérifiée : les échanges sont un jeu à somme nulle.
Plutôt que de monter des mécanismes aussi complexes qu'inefficaces, ne serait-il pas plus raisonnable d'envisager quelques solutions simples ? Je vous en proposerai trois : abolition de la titrisation ; interdiction de vendre ce qu'on ne possède pas, car la belle spéculation consiste à assumer le risque qu'on prend ; interdiction pour un Gouvernement, comme c'est d'ores et déjà le cas des collectivités territoriales, de présenter des budgets en déséquilibre – il conviendrait du reste d'en faire un principe constitutionnel.
Les déficits engendrent la spéculation et c'est le contribuable qui, finalement, paiera l'addition.
Il est vrai, Monsieur Giacobbi, que la recherche des origines de la crise ne saurait ignorer le volume des capitaux en jeu et l'excès de liquidités. Il y a une relation de cause à effet entre, d'une part, les déficits américains du compte courant et du budget et, d'autre part, la crise financière. Durant des décennies, les États-Unis ont à ce point répandu des liquidités à travers le monde qu'il a fallu, à un moment donné, démultiplier les liquidités primaires en passant aux dérivés du crédit et aux obligations classées triple A. Nous subissons aujourd'hui les retombées de cette politique. S'il arrivait, un jour, qu'on se mît à douter de la capacité des États-Unis à faire face à leurs dettes, les conséquences seraient très lourdes. La situation est donc sérieuse.
Je citerai Adair Turner, ancien président de la FSA (Financial services authority). Il a surpris son monde en soulignant que les chiffres devaient donner à réfléchir : entre 650 000 et 950 000 milliards pour les dérivés de crédit, et 100 000 milliards pour les crédits bancaires. À ses yeux, on peut douter de l'utilité sociale d'une partie de la finance actuelle. Il a raison : une partie importante de la finance est en surplomb. Toutefois, je ne vois pas très bien comment on pourrait la faire rentrer dans une dynamique d'utilité sociale.
En ce qui concerne la régulation, Monsieur Gorges, je pense que votre orientation est rationnelle mais elle suppose que les banques ne dépassent pas un quantum déterminé. Le bilan de la plus grande banque française dépasse 1 600 ou 1 700 milliards d'euros. Imaginez-vous un Premier ministre annonçant un soir aux Français qu'il accepte la faillite d'un tel mastodonte ? L'effet serait « cataclysmique ». Lorsque Lehman Brothers a fait faillite, les conséquences ont été très lourdes. On ne doit donc recourir à un tel remède qu'avec la plus grande prudence. Il est vrai en revanche que les banquiers doivent toujours avoir présent à l'esprit le risque de ruine. Le hasard moral permet au spéculateur de se sentir protégé des conséquences des bêtises qu'il commet, ce qui l'incite à récidiver. Certes, les banquiers ne font pas exprès de tomber en faillite. Toutefois, s'ils savent qu'ils seront sauvés, ils ne réagiront pas avec la même acuité que dans le cas contraire. Le drame, c'est qu'à la suite de la crise, le « hasard moral » a été légitimé. Vos solutions sont certainement efficaces et de bon sens mais on ne pourra y recourir qu'avec réticence.
Vous avez également raison : on ne devrait pas avoir le droit de vendre ce qu'on ne possède pas. Toutefois, lorsque le chancelier d'Allemagne, Mme Angela Merkel, a pris une telle décision, ce fut un tollé épouvantable, y compris au sein des instances européennes, notamment à l'instigation des Britanniques : l'Europe protesta qu'il était inadmissible qu'une telle décision pût être prise à l'échelle d'un seul pays. Or, mesdames et messieurs les députés, nous n'obtiendrons jamais le consensus de nos voisins européens pour prendre une telle mesure. Seule une décision a minima sera prise à la demande des pays qui désireront réagir le moins possible à l'encontre du secteur financier. Les incertitudes en la matière sont donc nombreuses et la bataille est loin d'être gagnée.
Des travaux sont actuellement menés et on voit se dessiner quelques progrès, y compris sur le plan européen. Toutefois, tant qu'on n'aura pas touché à la titrisation et à la dimension des banques et traité la question de la séparation des opérations de banques de dépôt et de banques d'affaires, la réforme financière ne partira pas sur de bonnes bases. Espérons que d'ici à un an ou deux, une prise de conscience s'opérera permettant d'évoluer vers de véritables solutions.

Vous l'avez souligné, monsieur le professeur, la spéculation peut être une nécessité du marché ; le problème est d'arriver à en contrôler les excès.
Les rumeurs n'exacerbent-elles pas la spéculation ? La propagation d'informations plus ou moins exactes, accompagnée de la méconnaissance d'informations réelles, ne sont-elles pas à l'origine de dérives ? Avant de penser à des mécanismes de contrôle ou de sanction, ne conviendrait-il pas de commencer par améliorer l'organisation de l'information afin de la rendre la plus fiable et la plus complète possible ? Ce serait peut-être le meilleur remède aux effets déstabilisateurs de la spéculation.

Quelle est votre vision de la spéculation sur les matières premières, notamment alimentaires ?
Par ailleurs, que pensez-vous du taux de couverture actuel de nos comptes de dépôt ? Monsieur Barnier envisage la création d'un compte d'épargne européen : l'organisation d'une caisse de dépôt européenne vous paraît-elle une bonne idée ?
Il est vrai, Monsieur Scellier, que spéculation déstabilisatrice et rumeurs vont de pair. Il convient dès lors de porter notre regard sur les organismes qui créent les rumeurs. Selon Le Temps de Genève, qui est un journal sérieux, c'est la réunion à Londres, au mois d'avril, de deux hedge funds et d'une grande banque américaine qui a déclenché la spéculation sur la dette grecque. Une conscientisation des intéressés serait nécessaire et un tribunal devrait pouvoir juger ceux qui répandent les rumeurs.
Les agences de notation elles-mêmes sont devenues des boutefeux d'autant plus influents qu'elles ne sont qu'au nombre de trois : je pense aux avertissements que ces jours derniers Moody's a donnés à la France et à d'autres grands pays. Il conviendrait, pour réduire leur influence, à la fois de diversifier les organes chargés d'opérer la notation et d'en augmenter le nombre. Certaines agences devraient faire une grande place aux organismes gouvernementaux ou internationaux d'expertise. Il est tout de même surprenant que quelques personnes à Londres, New York ou Paris décident du devenir d'un État.
En ce qui concerne les matières premières, Madame Grosskost, il y a beaucoup à faire ! En tant qu'économiste, je ne peux que regretter que les travaux en France sur le sujet soient si rares et insuffisamment poussés. Il conviendrait de réaliser des études systématiques sur l'évolution des prix du blé, du maïs ou plus généralement des céréales. Il se passe en la matière des choses étonnantes.
Les marchés à terme doivent exister. Toutefois, aujourd'hui, c'est le « papier » qui détermine de plus en plus le prix du « physique », trop souvent sur la base de pratiques de manipulation. J'aimerais que l'autorité des marchés financiers se penchât sur ces pratiques dans ce secteur particulier. Encore faudrait-il arriver à les isoler, les expliquer et, éventuellement, les neutraliser.
L'audition s'achève à dix-huit heures quarante.