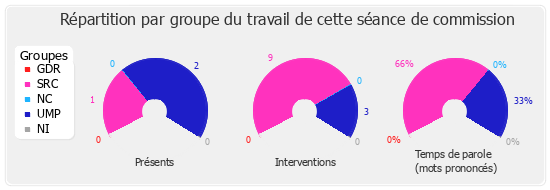Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances
Séance du 28 juin 2011 à 18h00
La séance

Le financement de l'enseignement supérieur fait aujourd'hui appel, en complément des crédits budgétaires ordinaires qui sont loin d'être négligeables, à deux vecteurs principaux : le plan Campus et le grand emprunt.
Ces nouveaux financements, joints aux effets de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, conduisent à des bouleversements en matière de gouvernance, de montants disponibles et de responsabilisation des acteurs, l'enjeu étant de susciter une dynamique nouvelle pour reconquérir des positions perdues au cours des dernières décennies.
Après avoir auditionné notamment les représentants de la Conférence des présidents d'universités, nous avons souhaité avoir entendre ceux de la Conférence des grandes écoles. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je rappelle que nos travaux bénéficient de l'assistance de la Cour des comptes, en la personne de M. Jacques Tournier, conseiller-maître.

Ma première question porte sur la mise en oeuvre du plan Campus : quelles sont, d'après vous, les raisons des retards constatés ?
En deuxième lieu, pensez-vous que les grandes écoles disposent des moyens logistiques et comptables nécessaires pour l'application de ce plan ?
J'en viens enfin au campus de Saclay, qui n'a pas été sélectionné lors de la « première vague » des investissements d'avenir, alors qu'il constitue l'une des fiertés de notre pays. Plusieurs grandes écoles y étant implantées, j'aimerais connaître votre avis sur cet échec.
La mise en oeuvre du plan Campus a été compliquée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les schémas financiers retenus par le ministère n'étaient pas toujours très clairs, notamment en ce qui concerne le recours aux partenariats public - privé (PPP) et l'engagement précis de l'État pour certains établissements – certains d'entre eux ont dû attendre juin 2011 pour être définitivement fixés sur leur sort, alors que le plan Campus a été lancé au printemps 2008. La prise de décision a été retardée par quelques hésitations, ainsi que par l'élargissement du processus.
À cela s'ajoutent les contreparties parfois demandées par l'État aux collectivités territoriales : comme elles ne sont pas toujours de la même sensibilité politique que le Gouvernement, en particulier au plan régional, elles ont manifesté un empressement variable à répondre à l'invitation qui leur était adressée...
L'organisation des élections régionales, au cours des opérations, a également joué un certain rôle.
Bien sûr. Certaines collectivités ont fait savoir qu'elles n'étaient pas du tout favorables à la formule juridique des PPP, dont l'État souhaitait l'application dans certains cas.
Une autre raison est que le plan Campus s'est finalement accompagné, en particulier dans la région parisienne, des investissements d'avenir. L'État a voulu, sinon globaliser l'effort, du moins assurer la cohérence de l'ensemble.
Le degré de maturité des projets était, par ailleurs, assez variable à Saclay. Certains établissements avaient l'habitude de coopérer depuis longtemps, mais ce n'était pas toujours le cas : il a parfois été nécessaire d'apprendre à travailler ensemble, ce qui a pris du temps.

Disposez-vous de données chiffrées sur le nombre de docteurs formés au sein des grandes écoles ? Observe-t-on une évolution dans ce domaine ?
De manière générale, un tiers des docteurs est aujourd'hui formé dans les laboratoires des grandes écoles, contre un quart il y a une dizaine d'années.
On constate, en outre, qu'il y a exactement la même proportion d'étudiants continuant leur formation jusqu'au doctorat dans l'ensemble des masters, toutes disciplines confondues, et dans les écoles d'ingénieurs – je mets à part les écoles de management, car elles ont des problématiques très différentes, en France comme à l'étranger. On prétend souvent que les grandes écoles détournent de la recherche, mais c'est une erreur.
Cela étant, il existe des différences selon la difficulté d'accès aux grandes écoles au plan abstrait : dans les écoles plutôt orientées vers l'innovation technologique, la recherche appliquée, les PME et les PMI, le pourcentage des ingénieurs faisant une thèse est compris entre 1 et 2 %, contre 7 % en moyenne ; il est de 15 ou 18 % à l'École centrale Paris, de 27 % à l'École Polytechnique, et de 50 ou 80 % dans les Écoles normales supérieures – pour des raisons en grande partie endogènes dans ce dernier cas. Je rappelle que ce taux était de 5 ou 7 % à Polytechnique il y a trente ans. Il y a donc eu une évolution considérable.

Si je vous ai posé cette question, c'est que notre pays est handicapé par la présence insuffisante de docteurs dans l'économie marchande par rapport à d'autres pays européens. Pensez-vous que la situation a tendance à s'améliorer ?
L'idée du retard de la France correspond à une vision erronée de la réalité, exception faite des cas très spécifiques de l'Allemagne et de la Suisse : il faut être allé jusqu'au doctorat pour jouir d'une certaine considération dans l'industrie chimique, prédominante dans ces pays, où le titre de docteur fait, en outre, partie de l'identité personnelle. C'est un facteur d'ennoblissement.

Un des principaux aspects de notre réflexion est de comprendre pourquoi la recherche est moins développée en France dans le secteur privé. On sait que beaucoup d'ingénieurs, en particulier ceux qui sont issus des grandes écoles, sont happés par des tâches de management. Qu'en pensez-vous ?
Étant administrateur de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), j'ai eu l'occasion de participer, en 2009, à la réalisation d'une étude sur l'emploi des docteurs. Nous nous sommes demandés si leur proportion était réellement insuffisante en France, et s'il était vrai qu'ils ne se tournent pas assez vers l'entreprise. Dans ces deux domaines, les résultats de la comparaison avec des pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis et le Japon sont assez inattendus.
En premier lieu, les situations sont très différentes selon les pays. En France, les étudiants inscrits en thèse souhaitent devenir, dans 75 % des cas, maître de conférences ou chargé de recherches au CNRS. Or, moins de 25 % des docteurs accèdent à une position académique stable, et près de la moitié doit changer de projet professionnel. Au Brésil, les étudiants inscrits en thèse ont, en revanche, plus de 70 % de chances de trouver un emploi dans une université, car ce pays connaît la situation qui était la nôtre dans les années 1970. Aux États-Unis, la proportion est d'environ 50 % grâce à l'existence d'un extraordinaire système pyramidal, formé de 4 000 entités qu'on peut qualifier d'universités : il est possible de commencer modestement sa carrière dans une petite université de province avant d'être recruté par Penn State, Stanford ou l'université du Wisconsin.
Nous nous sommes également interrogés sur l'avenir professionnel des docteurs qui ne parviennent pas à trouver une position à l'université. Pour répondre à cette question, nous avons comparé le pourcentage des titulaires d'un doctorat dans les états-majors des cent entreprises les plus actives dans le monde en matière de recherche et développement – R&D. Ce taux est de 20 % en France, ce qui est loin d'être mauvais par rapport à la moyenne mondiale – environ 15 % –, même si l'on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de groupes français parmi les cent premières entreprises. Deux pays sortent du lot, l'Allemagne et la Suisse, avec des taux respectifs de 56 % et 35 % – l'Allemagne en raison de son industrie chimique, la Suisse en raison de son industrie pharmaceutique. Mais le plus étonnant est que le Royaume-Uni est moins bien classé que la France, et que les États-Unis se trouvent en queue de peloton, avec un taux de 8 %.
Ce résultat s'explique, tout d'abord, par le fait que 50 % des docteurs entrent dans le système académique aux États-Unis ; en outre, plus de la moitié du reste des docteurs fait entièrement carrière dans la R&D au sein du secteur privé : si les grands groupes et les entreprises moyennes tournées vers la technologie les recrutent, ce n'est pas pour qu'ils deviennent des managers, mais des chercheurs professionnels. C'est un phénomène inconnu en France, alors qu'il faudrait embaucher les docteurs pour ce qu'ils savent faire.

Je suis entièrement d'accord sur ce point. Les grandes écoles recrutent les meilleurs scientifiques ; or ils sont souvent happés par des tâches de management dès leur sortie. Comment pourrait-on mieux irriguer le tissu des PME pour assurer leur développement ?
Il faut, tout d'abord, commencer par éviter certaines erreurs. À une époque, beaucoup de docteurs en biologie ont ainsi accumulé les « post-docs » sans jamais trouver la place qu'ils souhaitaient en France. Si l'on accroît le nombre de docteurs dans un domaine, ce qui est tout à fait cohérent avec l'objectif consistant à développer la recherche, il faut assurer une certaine continuité.
Sachant que seul un quart des docteurs trouveront une position académique stable, nous devons réfléchir à l'avenir des personnes inscrites en thèse dans un cadre global : la politique industrielle des entreprises, notamment celles de taille intermédiaire, la politique de la recherche, la politique de l'emploi, mais aussi la politique étrangère – si l'on ne forme pas des docteurs pour notre pays, on les forme pour d'autres. Nous avons des propositions à faire sur ce point. Il faut, en tout cas, veiller à offrir des carrières intéressantes.
Il est plébiscité par le monde de l'entreprise.
C'est effectivement un très bon outil. Cela étant, la part du PIB investi dans la recherche est restée désespérément basse et plate, au cours des huit dernières années, par rapport aux autres grands pays de l'OCDE. Des pays tels que la Corée, le Japon ou la Finlande atteignent des taux de 3, voire 3,5 %, quand nous passons de 2,1 à 2,2 %.

On s'accorde généralement pour dire que le grand emprunt constitue un coup de fouet, malgré les retards observés. Comment faire pour que les efforts consentis en faveur de la recherche puissent s'inscrire dans la durée et donner une vraie impulsion ? Quel regard portez-vous, plus généralement, sur le grand emprunt ?
Si le total de l'opération est de 35 milliards d'euros, dont 22 milliards pour l'enseignement supérieur et la recherche, les flux annuels ne dépassent pas 600 millions. Or, ce n'est pas suffisant pour rattraper le point de PIB qui manque dans le domaine de la recherche. Quant à l'effort budgétaire réalisé entre 2007 et 2011, il est certes considérable, mais il ne suffira pas non plus.
Notre proposition, qui consiste à tripler le nombre d'étudiants étrangers solvables, permettrait de dégager des recettes sept fois plus importantes sans faire appel aux marchés financiers internationaux – on recevrait directement des devises étrangères.
J'ajoute que les 600 millions d'euros issus du grand emprunt ne représentent que 4 % du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire, doté de 15 milliards d'euros, et qu'ils sont du même ordre de grandeur que les économies réalisées, chaque année, en sous-traitant la formation d'environ 65 000 jeunes aux 60 établissements supérieurs associatifs.
Au total, même si l'effort prévu par l'État peut jouer un rôle catalyseur intéressant, il ne faudra pas en attendre des miracles : on est encore loin des 15 ou 20 milliards d'euros supplémentaires qu'il faudrait trouver, chaque année, pour consacrer 3 % du PIB à la recherche, conformément à l'objectif de Lisbonne.

En effet, cet investissement n'a pas pour vocation d'être uniquement financé par de l'argent public, donc par l'impôt : on peut aussi inciter les entreprises. À cet égard, le crédit d'impôt recherche est un outil nécessaire, mais il n'est sans doute pas suffisant : ce n'est pas en consacrant seulement 2 % du PIB à la recherche que nous allons gagner la compétition. Du reste, il faudrait certainement aller au-delà de 3 %, car nous devons miser sur la seule matière première dont nous disposons.
En ce qui concerne le grand emprunt, le jeu a parfois été à somme négative. Le résultat de l'effort réalisé, que le ministère estime à 6 000 hommesan, a fait de nombreux déçus : seul un petit nombre a été conforté dans ses projets, car le dispositif repose sur le principe de la concentration.
Or, le choix consistant à faire la part belle aux « grains » les plus gros dans les appels d'offres ne conduit pas nécessairement à une allocation optimale des crédits. Je pense, en particulier, à la conception des Instituts de recherche technologique (IRT), qui donne une primauté absolue au concept de technology push. N'oublions pas que seuls 5 % de la valeur ajoutée créée dans la Silicon Valley sont liés à la recherche de l'université Stanford. Le reste est le fruit d'un écosystème complexe, où les cafés et les petites banques jouent un rôle important, et qui est tiré par l'aval. Quant au fameux iphone, vous savez qu'il ne comporte qu'une seule innovation technologique sur 17 technologies clefs. Le choix du big is beautiful parce que big is visible ne correspond donc pas nécessairement à l'optimum dans une économie où 70 % de la valeur vient des services. Le monde intellectuel est devenu très interactif et très mobile, avec des points de très haute intensité.

Le coeur de la stratégie n'est pas tant la taille que le rassemblement. On considère souvent, à l'heure de la dématérialisation, que l'écran suffit comme point de rassemblement. Or, ce n'est pas complètement vrai : l'exemple californien montre que les différents acteurs ont besoin de se rencontrer physiquement, dans le monde réel, et pas seulement de manière virtuelle. C'est un des facteurs de réussite des bassins qui se sont développés en atteignant un point d'excellence dans un domaine précis. Êtes-vous d'accord avec cette analyse ?
Les facteurs décisifs dans la Silicon Valley, comme à Munich, sont la concentration de l'intelligence et la disponibilité du capital d'amorçage. Si vous rassemblez des esprits jeunes, brillants, bien formés, dynamiques et entreprenants, avec du capital à proximité et un réseau scientifique puissant, vous aboutirez à des résultats. On présente souvent les fondateurs de Google et de Facebook comme des « bricoleurs inspirés », alors qu'à l'origine, ils étaient de jeunes étudiants extrêmement brillants, insérés dans un environnement dans lequel il est possible d'entreprendre sans craindre qu'un échec éventuel ait une trop grande importance.
Avec Philippe Courtier, directeur de l'École des ponts et chaussées, auquel je veux rendre hommage, j'ai été l'un des premiers à dire depuis des années que les grandes écoles doivent travailler avec les universités.
Je ne me prononcerai pas sur ce sujet.
En revanche, je peux vous dire que si le conseil d'administration de l'École centrale Paris s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'un déménagement sur le plateau de Saclay, c'est parce que nous avons intérêt à être près de nos alliés, et à chercher à bénéficier d'un effet de concentration dans un certain nombre de champs de recherche assez lourds, ou faisant appel à des compétences variées. Il faudra ensuite accompagner le mouvement en direction des entreprises, mais nous sommes certains de faire émerger de la recherche de très grande qualité.
Le projet de Saclay sera, en outre, un facteur important de visibilité et d'attractivité au plan international, à condition que le campus soit agréable : il faut qu'on ait envie d'y vivre. Notre modèle doit être celui de Cornell ou de Madison, plutôt que celui d'Orsay, même si j'aime beaucoup cette université pour d'autres raisons.

Les projets ont été évalués en amont par un jury international. Comment envisagez-vous leur évaluation dans quatre ou cinq ans ? Comment procédez-vous, par ailleurs, pour évaluer les laboratoires des grandes écoles ? J'aimerais savoir si l'AERES intervient dans ce domaine.
Nous sommes évalués dans les mêmes conditions que les universités. L'École centrale est, du reste, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
Comme vous le savez, le projet de Saclay implique notamment la deuxième université française, celle de Paris 11, six écoles d'ingénieurs comptant parmi les meilleures de France, et une très grande école de commerce, HEC. Notre objectif commun est d'améliorer nos capacités dans trois domaines : attirer de très bons étudiants étrangers, à l'instar des grandes universités américaines, développer des partenariats d'entreprises de grande qualité, et permettre à nos étudiants de réaliser de belles carrières. Ce sont des critères objectifs en matière de formation. L'École centrale a déjà un partenariat avec Cambridge dans le domaine de l'ingénierie, mais elle ne peut pas prétendre à un partenariat scientifique global avec cette université prestigieuse ; en revanche, Saclay pourrait y parvenir.
Il existe, par ailleurs, des critères universellement reconnus dans le domaine de la recherche : les publications, les conférences invitées de haut niveau, le volume des contrats et la qualité du réseau international. À cet égard, la provenance des post-docs est un facteur qui ne trompe pas.
Oui, fort heureusement. L'Agence nationale de la recherche a joué un grand rôle dans ce domaine.
En matière de valorisation, les projets devraient être portés par l'IRT et la SATT, la Société d'accélération du transfert technologique. Pour le directeur de Centrale que je suis, le critère prioritaire de réussite sera le nombre de centraliens portant des projets d'entreprises ou partant dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI). C'est un critère objectif et mesurable. Si nous parvenons à progresser dans ce domaine, nous aurons travaillé pour le bien de la Nation.
S'agissant du rôle de l'AERES, je rappelle que nous avons largement dépassé la distinction administrative, héritée de notre histoire, entre les universités et les grandes écoles.
Si l'on additionne les universités et les grandes écoles, la France compte 300 entités universitaires pour 60 millions d'habitants, contre 4 000 entités appelées « universités » aux États-Unis pour 300 millions d'habitants et 17 millions d'étudiants. La taille moyenne des établissements est d'environ 4 000 étudiants dans ce pays : certaines grandes universités rassemblent entre 10 000 et 30 000 étudiants, quand des centaines d'autres n'en comptent que 1 000 ou 2 000, avec un niveau de recherche souvent inférieur à celui de grandes écoles de taille comparable en France.

Certaines universités américaines sont, en effet, des « collèges » n'offrant pas de masters et ne réalisant pas de recherche.

Comment faire pour que les filières scientifiques attirent davantage les jeunes ? Elles sont aujourd'hui un peu en perte de vitesse.
Un premier aspect de la question est le regard porté sur les sciences et les techniques : il peut y avoir des inquiétudes, liées au principe de précaution ou à la peur des centrales nucléaires.
Un deuxième enjeu est l'attractivité des filières longues et difficiles pour les jeunes issus des milieux modestes. Nous avons découvert qu'il y avait, dans l'ensemble des cycles universitaires scientifiques et dans la filière des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles d'ingénieurs, le même pourcentage d'étudiants dont les parents appartiennent aux catégories socioprofessionnelles les plus élevées. Il y a donc une barrière mentale, sur laquelle nous travaillons dans le cadre de dispositifs tels que les « cordées de la réussite » et l'opération « pourquoi pas moi ».
À cela s'ajoute la perte d'un grand nombre de jeunes filles : alors qu'elles représentent 50 % des candidats au bac S, elles ne sont plus que 20 % des inscrits dans les filières scientifiques au 1er septembre.
Dans ces trois domaines, il y a un véritable travail à mener sur les représentations sociales.

J'en viens à la question de la gouvernance. Que pensez-vous des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES ? Y est-on entré à reculons ? Estimez-vous que le législateur devrait apporter des précisions au dispositif, ou bien considérez-vous, au contraire, que sa souplesse est un atout dans certains cas ?
L'École centrale Paris et Supélec, son allié, ont choisi de participer au PRES UniverSud Paris, peu après sa création, afin de rejoindre les universités d'Evry-Val d'Essone, de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris 11. Nous ne sommes pas du tout entrés à reculons dans le PRES, car il nous paraissait très intéressant.
Cela étant, je tiens à préciser que je ne crois pas aux structures, mais plutôt aux projets : les structures ne sont que des outils pour les réaliser. Pour notre part, nous nous sommes d'abord intéressés aux projets susceptibles d'être réalisés dans le cadre du PRES UniverSud, quitte à faire évoluer cette structure par la suite.
C'est une solution qui fonctionne bien dans un certain nombre de cas, mais pas dans d'autres. Le législateur devra donc accompagner le mouvement.
Lors de la constitution du projet de Saclay, nous avons réalisé une étude sur les universités américaines avant de définir notre propre modèle de gouvernance. Nous nous sommes alors aperçus qu'il existe d'importantes variations dans ce domaine : Harvard, par exemple, est une université extrêmement décentralisée, alors que l'université de Californie est beaucoup plus centralisée. Cela étant, le rapport de Philippe Aghion a fait ressortir un certain nombre de constantes : les universités américaines comportent généralement un board, majoritairement composé de personnalités extérieures et chargé d'élaborer la stratégie, un Sénat rassemblant le corps enseignant et plutôt tourné vers les questions académiques, ainsi que des départements jouissant d'une grande liberté. Je rappelle que ces départements sont voués à l'enseignement : en matière de recherche, les professeurs des universités américaines ne sont pas des hommes de laboratoire, mais des entrepreneurs qui vont chercher des partenaires.
À titre personnel, je pense que les universités du XXIe siècle ne doivent pas être conçues comme des structures, mais comme des lieux où l'on fait de l'enseignement et de la recherche. Il faut donner à ces clusters, ou à ces assemblages, la liberté de définir les structures de coopération qui leur permettront de développer leur projet. On verra bien, dans un second temps, ce qui fonctionne ou non.
Le PRES est certes un cadre, mais il en existe d'autres – un rapport a d'ailleurs été remis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sur ce sujet. Il faut commencer par imaginer des structures de coopération ; il reviendra ensuite au législateur d'intervenir. De toute façon, les solutions qui ne fonctionnent pas seront éliminées par le jeu de la concurrence.
Sur ce point, je précise que la Conférence des grandes écoles est plus favorable aux projets qu'aux structures.
C'est effectivement une tendance dominante. Alors que la loi du 18 avril 2006 offrait aux acteurs un choix entre quatre types de structures, on a cherché très fortement, au niveau central, à imposer une solution unique, ce qui revenait à placer la structure avant le projet.

Il y a là un problème. Cela étant, si le marché suffisait pour élaborer des projets, on le saurait depuis longtemps.
Si vous le permettez, je voudrais vous remettre une synthèse du congrès que nous avons organisé sur le thème : « Quelle réponse au défi de l'international pour l'enseignement supérieur ? ».