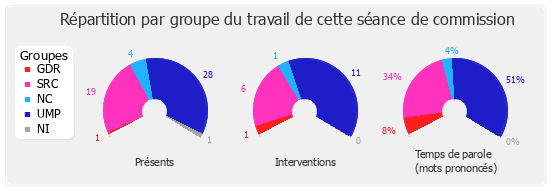Commission des affaires étrangères
Séance du 16 février 2011 à 9h45
La séance
Table ronde sur les évolutions politiques au Maghreb et au Proche-Orient, en présence de M. Patrice Paoli, directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient du ministère des affaires étrangères et européennes, et de M. Denis Bauchard, conseiller spécial pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales.
La séance est ouverte à neuf heures quarante cinq.

Je vous remercie, Messieurs, de bien vouloir tenter avec nous de dresser une analyse prospective de la situation politique au Maghreb et au Moyen-Orient.
L'ampleur et la rapidité des évènements de ces dernières semaines ont surpris. Les diplomaties étrangères ont, pour la plupart, fait preuve de retenue en face de mouvements indiscutablement endogènes. Mais le moment de leur décryptage arrive. Leurs acteurs et les intentions de ceux-ci suscitent des interrogations. Il nous faut aussi analyser les effets et les capacités des gouvernements de transition à répondre aux aspirations de leurs populations.
La question de « l'après » est maintenant posée.
Elle vise d'abord les conditions dans lesquelles une transition politique s'organise en Tunisie et en Egypte, selon quel calendrier et autour de quelles forces politiques. Les autorités de transition font des annonces que l'on ne peut que saluer. Il convient, en face de la pression et de l'impatience populaires, de maîtriser les risques du processus et d'éviter toute dégradation sécuritaire comme, et peut-être surtout, économique.
L'attention se porte aujourd'hui sur les autres États de la région. Sont-ils déstabilisés ? Existe-t-il, ou non, un effet de dominos ? Des protestations s'intensifient dans de nombreux pays, encouragées par le succès des mouvements de Tunisie et d'Egypte. On rappellera aussi la crise politique concomitante dans les territoires palestiniens. Chacun de ces pays présente des caractéristiques propres. Les régimes en place accepteront-ils d'évoluer et sauront-ils le faire ? Quelques signes d'ouverture politique sont à relever en Algérie, au Yémen, en Jordanie et au Maroc. L'opposition iranienne se remobilise pour intégrer le mouvement régional de démocratisation.
Une recomposition géopolitique semble s'amorcer. Quels équilibres régionaux pourraient résulter des changements en cours ?
Les aspirations afférentes au niveau de vie, à la répartition des richesses, à l'emploi et à la sécurité alimentaire sont à l'origine des revendications. Quelles sont les perspectives dans une région qui apparaît aujourd'hui en mal d'avenir ? A cet égard, comment l'aide de la France et de l'Union européenne doit-elle se déployer ?
Je m'exprime, bien sûr, à titre personnel. A partir du séisme qui semble se propager, depuis la Tunisie et l'Egypte, à l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, je voudrais d'abord livrer quelques réflexions sur ces deux pays avant d'essayer de répondre à la question de savoir s'il existe, ou non, un effet de dominos.
On relève plusieurs ingrédients communs à la situation de ces deux pays. Un mélange détonnant a brutalement explosé. Il se composait du rejet d'un autocrate vieillissant chargé de tous les maux dont souffrait le pays, chômage, pauvreté, corruption ; de soulèvements spontanés ; d'une classe politique laminée dont il subsistait seulement quelques partis complaisants à l'égard du pouvoir en place ou bâtis autour d'une personnalité, seuls étant structurés les mouvements islamistes – Ennahda en Tunisie et les Frères musulmans en Egypte - ; enfin d'une jeunesse victime du sous-emploi ou cantonnée à des emplois sous-qualifiés alors qu'elle possède souvent des diplômes de l'enseignement supérieur.
Au cours d'un entretien, en juin dernier, avec le ministre de l'industrie tunisien, j'avais été frappé par son inquiétude devant ce phénomène : chaque année, 70 000 jeunes arrivent sur le marché du travail dont 30 000 ne trouvaient pas d'emploi et s'ajoutaient aux chômeurs des années précédentes.
Il faut aussi signaler l'influence des nouvelles technologies de la communication, qui représentent non seulement des moyens d'information en temps réel et hors du contrôle du gouvernement, mais aussi des moyens de mobiliser la population et d'organiser les manifestations.
On notera cependant des différentes importantes entre les deux pays. En Tunisie, le mécontentement de la population s'est focalisé sur le président Ben Ali, son clan familial et son régime, tandis qu'en Egypte, il s'est concentré sur la personne du président, sans remettre en cause le régime, sauf partiellement vers la fin de l'occupation de la place Tahrir.
Les mouvements islamistes sont également différents. En Egypte, les Frères musulmans constituent une organisation ancienne et bien structurée, disposant de relais importants, notamment de réseaux sociaux, de dispensaires, de systèmes d'aides quadrillant le territoire, ce qui n'est pas le cas d'Ennahda.
Enfin, l'armée ne joue pas du tout le même rôle. En Tunisie, il s'agit plutôt d'une gendarmerie, aux effectifs modestes, alors qu'en Egypte, elle est au coeur du pouvoir, disposant d'effectifs très importants – près de 500 000 hommes –, détenant tous les leviers politiques et les postes sensibles, la plupart des leviers administratifs – les deux tiers des gouverneurs sont d'origine militaire – ainsi qu'un certain nombre de leviers économiques, dans le secteur public et plus récemment dans le secteur privé.
Le déroulement des récents évènements a obéi à deux scénarii distincts. En Tunisie, celui d'un basculement brutal, intervenu en quarante-huit heures, encore mal expliqué, assorti d'une épuration et de la construction d'un nouveau régime, dans un contexte de troubles sociaux et politiques qui se poursuivent. Il en va tout différemment en Egypte : l'armée contrôle la situation. L'armée souhaitait que le président Hosni Moubarak puisse se maintenir jusqu'à la fin de son mandat, en septembre. Sous la pression de la population et, peut-être aussi des États-Unis, le scénario s'est accéléré. La Constitution a été suspendue. L'armée a pris officiellement le pouvoir, sous la forme d'un Conseil suprême des forces armées. Nous en sommes encore au stade des promesses, avec un calendrier encore incertain.
Dans les deux cas, spécialement en Egypte, la population s'inquiète du risque de confiscation de sa révolution.
Peut-on parler d'effet de dominos ? Le monde arabe compte 22 pays, avec des différences de situation considérables. De la Mauritanie au Qatar, en passant par le Soudan, les disparités sont immenses, en termes de régime politique, de liberté d'expression et de niveau de vie. L'écart de revenu par habitant est ainsi de l'ordre de 1 en Mauritanie à 40 au Qatar. De nombreux pays de cette zone sont déjà fragiles pour bien des raisons : certains servent de champ de bataille ou connaissent des crises plus profondes, tels que le Liban, l'Irak et les Territoires palestiniens. D'autres souffrent de graves problèmes de politique intérieure : ainsi de Bahreïn, où la majorité de la population est chiite alors que les dirigeants sont sunnites ; du Yémen, en proie à des risques de sécession, à une implantation du terrorisme par Al Qaïda et à la révolte de tribus contestant le pouvoir central ; de l'Algérie, où depuis 20 ans, et après une guerre civile, l'armée continue d'assurer le contrôle de la situation sans que les problèmes sociaux aient été résolus ; enfin du Maroc, qui mène activement des réformes économiques et , dans une moindre mesure, politiques.
Nous sommes face à une nouvelle donne. La double crise, tunisienne et égyptienne, a fait ressortir l'ampleur du problème de l'emploi des jeunes dans cette zone. La Banque mondiale évalue à 100 millions le nombre d'emplois qu'il faudrait créer d'ici à 2030. La jeunesse est imprégnée par la politique, avec une nouvelle génération à la fois plus éduquée et mondialisée, très à l'aise dans le maniement des outils numériques comme internet.
La politique américaine a retrouvé ce qu'on appelle « le syndrome du shah » : son soutien à certains régimes n'est pas indéfectible. C'est surtout vrai de l'Egypte : le président Obama a personnellement – ce qui est très étonnant- accompagné et commenté le mouvement. Il a envoyé sur place le chef d'état-major des armées ainsi que de hauts responsables du département d'État afin d'exercer des pressions sur les militaires égyptiens. Dans quelle mesure ces interventions ont-elles été efficaces ? La réponse doit être nuancée.
Nulle part, ou presque, dans le monde arabe, il n'existe d'opposition politique structurée. Seuls les mouvements islamistes sont organisés. Les Frères musulmans sont présents dans plusieurs pays : en Egypte, dans les Territoires palestiniens, en Syrie et, plus généralement, au Proche-Orient. En Irak, les mouvements islamistes sont également influents qu'il s'agisse des Sadristes ou du Conseil supérieur islamique.
Dans tous les pays arabes, l'armée et, plus spécialement, les services de renseignement, jouent un rôle essentiel. Toute solution à un problème politique passe par l'armée, soit qu'elle laisse faire les choses, soit qu'elle maintienne son propre pouvoir, comme ce sera probablement le cas en Egypte.
Mais partout s'organise aussi une société civile, avec un développement considérable des associations, dans les domaines caritatif, humanitaire et plus récemment politique. Les professions libérales – avocats, médecins – tiennent une place importante. Une classe moyenne se met en place, importante en Tunisie, moindre en Egypte, presque inexistante dans des pays comme le Yémen. Mais la tendance de fond existe.
Les récents événements auront des répercussions géopolitiques. Dans une région déjà caractérisée par de fortes turbulences, certains pays ont raison de s'inquiéter. Israël a signé des traités de paix avec deux de ses voisins mais, conclus entre États, ceux-ci ne bénéficient pas de l'appui des populations tant jordaniennes qu'égyptiennes, qui continuent de considérer l'État hébreu de façon hostile. Toute évolution dans le sens de la démocratisation risque de refléter cet état d'esprit.
Quels scenarii pour l'avenir ? Les prévisions sont difficiles dans des régions aussi instables que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La seule certitude réside dans la poursuite de la pression exercée par les populations. Va-t-on assister à un printemps arabe généralisé, faisant tomber les autocrates les uns après les autres et installant des régimes démocratiques ? On peut en douter. La démocratie résulte d'un long apprentissage et comporte plusieurs éléments : des élections libres, un État de droit, des libertés fondamentales. Dans la plupart des pays considérés, nous sommes encore loin du compte.
Pourrait-on, à l'inverse, assister à un renforcement des autocrates qui, par le jeu de la carotte et du bâton, entre promesses et répression, se maintiendraient au pouvoir ? C'est possible et déjà observé dans certains pays comme en Irak.
Un autre scénario serait l'instauration de l'ordre islamiste : grâce à la démocratie, leurs mouvements obtiendraient la majorité des voix, ou du moins une partie importante des suffrages, et participeraient au gouvernement. Je ne crois pas à une formule générale mais il s'agit d'un risque à assumer.
Le dernier scénario serait celui du chaos généralisé, s'ajoutant à celui déjà constaté dans certains pays.
Les aspirations démocratiques et l'ouverture au monde représentent une tendance lourde mais la route sera longue et probablement à l'ombre des armées.

Nous sommes en train de préparer une mission parlementaire en Tunisie, que je conduirai avec un représentant de chacun des groupes, soit cinq membres au total. Elle devrait se dérouler avant la fin mars.
Je me réjouis de cette initiative car nous devons manifester notre soutien à cette démocratie en gestation.
Pouvait-on prévoir les évènements ? Non. Nous connaissions les ingrédients de la situation en Tunisie, notamment le contexte économique : nous savions que les débouchés manquaient aux jeunes diplômés, qu'un écart de développement existait entre les côtes et l'intérieur du pays, enfin qu'une insatisfaction politique existait face à un régime qui était l'un des plus policiers de la région. Mais, précisément, avec un policier tous les dix mètres, nous ne pouvions imaginer que les éléments précités se cristalliseraient dans un tel mouvement de révolte. Nous avons affaire à un phénomène nouveau : le soulèvement n'est pas venu des forces hostiles au régime, il n'existait ni opposition islamiste ni opposition politique, le syndicat unique était aux ordres du gouvernement. Le mouvement, extrêmement rapide, a utilisé des moyens nouveaux : les sites officiels furent pris d'assaut par des internautes. Nous avons donc vu sauter le bouchon de champagne là où l'on estimait qu'il ne pouvait pas sauter, en raison du quadrillage du pays.
Le message est donc extraordinairement subversif : dans un pays où il n'existait aucune possibilité d'expression, aucun relais pour les mécontentements, aucun véritable syndicat - même si, depuis lors, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) s'est divisée en deux - et aucun parti politique, une révolution cependant s'est produite. L'évènement peut se comparer avec la révolution iranienne de 1979.
La révolution tunisienne a, pour toile de fond, un certain nombre de phénomènes qu'il va nous falloir prendre en compte.
En premier lieu, l'augmentation du prix des produits de première nécessité, compte tenu de la pénurie générale de produits alimentaires. Devons-nous répondre à ce phénomène par des subventions ? Pourrons-nous procéder à des ajustements structurels ? Comment traiter politiquement les crises sociales ?
En second lieu, l'accélération de l'information, qui touche tous les pays dans le monde : Internet sert aujourd'hui d'instrument de mobilisation rapide d'acteurs qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaît pas encore très bien, comme on l'a vu au centre de la place Tahrir au Caire et dans l'avenue Bourguiba à Tunis : des personnes immatérielles qui, néanmoins, pèsent sur l'évènement sans induire de rapport de forces physique.
Contribuent au même phénomène les télévisions par satellite. Al Jazeera, chaîne militante, n'a cessé de mentir sur la réalité de la situation, aggravant les choses en diffusant des zooms, par exemple, sur la place Tahrir pour augmenter l'impression de masse, tandis que Al Arabiya, plus modérée, présentait une vision en grand angle montrant que la place n'était pas toujours pleine. On ne peut nier qu'il y ait eu manipulation.
Cette réalité nous contraint à reconsidérer notre propre politique audiovisuelle, notamment en direction du Maghreb.
« Effet de dominos » est une mauvaise expression : facile pour poser la question, elle ne permet pas d'y répondre. Nous nous trouvons plutôt en présence d'un « effet tâche d'huile » : la révolution tunisienne est déjà dans tous les esprits. Chacun a désormais conscience que le mur de la peur est tombé, qu'on peut s'exprimer et que, avec des moyens encore hier inenvisageables, voire inexistants, on peut changer les choses en se mobilisant.
Les mécanismes qui ont joué en Egypte sont différents de ceux qui ont joué en Tunisie. Des éléments économiques et politiques s'étant cependant conjugués, quels éléments permettraient de produire un résultat analogue dans d'autres pays ? Les structures n'étant pas partout similaires, les mêmes causes ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. Les monarchies paraissent mieux armées car leur légitimité est, généralement, moins facile à remettre en cause que celle des républiques. Ainsi, dans le débat qui se déroule au Maroc, le régime n'est pas contesté en lui-même. En Jordanie, on note cependant quelques premières atteintes à la dignité de la monarchie mais à travers des attaques contre le comportement de la reine, épouse d'Abdallah II. Au royaume de Bahreïn, où l'activité politique est intense, le criant déficit de démocratie suscite le mécontentement des chiites qui, démographiquement majoritaires, restent minoritaires au Parlement. Car les peuples ne se mettent pas forcément en mouvement parce qu'ils ont faim ou pour des raisons économiques. Il nous faut donc appréhender leurs aspirations en sachant les doser.
Nous ne pouvons pas prévoir ce qu'il adviendra demain dans tel ou tel pays. Nous pouvons seulement dire quels sont les éléments d'analyse et identifier les moyens de résistance des gouvernements et des sociétés. Mais nous ignorons si des systèmes d'alerte sont plausibles.
Pour notre part, quelle politique mener ? La Tunisie a ouvert un débat que l'on croyait fermé : oui, il est possible de changer de régime. On l'a vu autrefois avec la révolution islamique en Iran, montrant à tous les musulmans du monde qu'on pouvait se débarrasser du syndrome Mossadegh, c'est-à-dire d'un régime imposé par des puissances étrangères, États-Unis et Grande-Bretagne. Les sunnites se sont donc posés la même question : pouvons-nous suivre le même chemin que les chiites et restaurer notre dignité ?
On ne peut considérer les révolutions tunisienne et égyptienne en dehors du contexte régional. Au Liban, la récente éviction de Saad Hariri et la mise en place d'un nouveau gouvernement, avec Najib Mikati, représente la victoire d'un camp. Elle paraît de nature à modifier l'équilibre trouvé à Doha en 2008, cette fois au profit du Hezbollah, de l'Iran et de la Syrie.
Ainsi, bien qu'indépendants l'un de l'autre, deux facteurs se conjuguent : ce qui est perçu comme une défaite des Occidentaux au Liban et la mise à l'écart de deux responsables politiques considérés comme leurs alliés, Ben Ali et Moubarak.
Quelle démocratie voulons-nous dans ces pays ? Sommes nous prêts à en jouer pleinement le jeu ? Le spectre de l'islamisme, souvent brandi par les journaux, tend à stopper net le débat. Or, les islamistes ne sont pour rien dans la révolution tunisienne, pas plus d'ailleurs que les autres partis. Doit-on alors faire confiance aux véritables acteurs de la révolution, les encourager et considérer qu'ils sont politiquement mûrs ? Les Tunisiens ne demandent pas qu'on leur procure un Bourguiba plus jeune et débarrassé du clan Trabelsi, pas plus que les Egyptiens ne veulent d'un Moubarak junior. Ils réclament l'instauration de la démocratie. Est-ce possible ? Peut-on intégrer les islamistes ? Doit-on se débarrasser du syndrome algérien de 1992, quand nous fûmes soulagés, peut-être lâchement, peut-être à juste titre, par l'annulation d'élections qui auraient amené une majorité islamiste au pouvoir ? C'était le syndrome turc, celui d'une armée qui défend les institutions. Entre temps, la Turquie a changé de politique. Elle fournit dorénavant l'exemple d'un pouvoir directement inspiré par les Frères musulmans, et pourtant capable de jouer le jeu de la démocratie. Nous devons donc nous mettre en état de parler avec l'ensemble des acteurs et, par exemple en Tunisie, de faire confiance à une société civile qui, déjà apparue au temps de Bourguiba, peut faire la preuve qu'il existe une autre alternative que celle de la dictature et de l'islamisme.
L'Europe veut-elle mener une politique de voisinage tournée vers le Sud, alors même que son balancier l'oriente aujourd'hui vers l'Est ? Le débat est important. Sans doute, et sans négliger bien sûr notre frontière orientale, faudra-t-il accorder une part substantielle de notre action à la zone méditerranéenne et proche-orientale.
Toutes ces idées sont actuellement en discussion au sein du ministère des Affaires étrangères.
Si la Tunisie et l'Egypte deviennent de véritables démocraties, nos interlocuteurs seront moins dociles. Longtemps, nous nous sommes abstenus de considérer la nature des régimes politiques, dès lors que nos intérêts politiques et économiques se trouvaient protégés. Demain, comme nous le vivons déjà avec la Turquie ou le Brésil, des démocraties nouvelles pourraient se montrer plus malcommodes, un peu comme des ennemis de classe potentiels. Il faut en prendre conscience.
Cela nous amène à considérer la position d'Israël, seule nation démocratique de la région et sans doute appelée à revoir sa stratégie pour tenir compte des évolutions à venir.

M'étant rendu à Tunis en octobre dernier, j'ai rencontré les partis d'opposition – car il en existait, y compris un parti communiste clandestin – et indiqué à notre ambassadeur que des forces s'organisaient. On ne s'attendait pas pour autant à une révolution mais on percevait tout de même un désir de démocratie, et l'amorce d'un mouvement qui englobait l'opposition tolérée par le régime.
Ces partis essaient aujourd'hui de mettre en place des institutions qui permettent, selon leur expression, d'éviter un nouveau Ben Ali. Pour eux, la démocratie française est un exemple.
Comment s'opère aujourd'hui l'analyse du gouvernement français sur la situation en Méditerranée ? Quel rôle doit tenir l'Europe vis-à-vis du Maghreb ? Allons-nous jouer « d'égal à égal » avec les nouvelles démocraties ?
Il semblerait qu'en Egypte, les citoyens doivent dorénavant assumer des missions qui relevaient jusqu'ici de l'État, comme l'école ou l'hôpital. Dans ces conditions, des organisations telles que les Frères musulmans, ne vont-elles pas prendre le relais, créant un autre type d'économie et de pouvoir, comme une sorte d'État parallèle, brouillant les responsabilités collectives ?

Il semblerait que les États-Unis, et le président Obama, aient exercé une très forte pression en Egypte. Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ?
Que devient l'Europe dans cette affaire, continent voisin et pourtant inexistant ?
Que devient, dans ce contexte, l'Union pour la Méditerranée, que nous avions regardée comme un projet d'avenir ? Il fut bloqué par le problème des relations d'Israël avec les pays arabes. Ne faut-il pas réanimer cette démarche ?
Les populations tunisienne et égyptienne, en dehors des partis, ne veulent pas voir leur révolution confisquée. Elles attendent un changement d'institutions, et non un simple réaménagement. En Égypte, les Frères musulmans se sont assis, avec les autres organisations politiques, à la table des négociations. Les seuls absents sont les acteurs de la place Tahrir, qui ne se contenteront pas de demi-mesures.
Dans quels délais se feront les changements de constitutions ? Une commission a été mise en place à cet effet en Egypte comme en Tunisie. La France et l'Europe doivent soutenir le processus, mais sans se poser en donneurs de leçons apportant des formules toutes faites.
Les États-Unis se sont trouvés aussi désemparés que nous devant l'accélération des événements. Ils ont tenté de s'adapter aux réalités. Un des dangers de la vie politique internationale, c'est de faire des déclarations trop rapides de peur d'être dépassé par l'actualité. Le discours tranché de Barak Obama n'est intervenu qu'après coup.
Au sein de l'Union européenne, les positions étaient diverses. Le Royaume-Uni militait fortement en faveur du changement. Il faut aujourd'hui que l'Europe trouve sa place. Elle est d'ailleurs déjà présente : Mme Ashton, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s'est rendue à Tunis et fait une tournée dans la région. Mais il serait dangereux de se manifester trop visiblement à un moment où nos interlocuteurs changent.
Des ministres français vont prochainement se rendre en Tunisie, mais il faut se garder de toute précipitation.
D'autre part, on connaît très mal l'armée égyptienne. Lorsque ses hommes reviennent de formation aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux, ils deviennent inaccessibles, démontrant une forte cohésion et une grande opacité de l'institution militaire, appelée à jouer un rôle fondamental.
Présidence de Mme Martine Aurillac, vice-présidente.

Notre réseau diplomatique ne s'est-il pas trouvé en faute en ne prévoyant pas ce qui allait se passer en Tunisie et en Egypte ?
Existe-t-il un risque de propagation des révoltes au territoire français et européen ?

L'armée est, bien entendu, au centre du pouvoir en Egypte. Son chef, Hussein Tantaoui, présidant le conseil supérieur des forces armées, s'est exprimé hier soir. Il a demandé à la commission chargée de la réforme des institutions de rendre sa copie dans les dix jours et annoncé que cette réforme serait soumise à referendum dans les deux mois suivants.
Pouvez-vous nous fournir des précisions sur la situation en Algérie ? Son régime risque-t-il de subir le même sort que ceux de la Tunisie et de l'Egypte ?
Pouvez-vous enfin nous parler de ce qui se passe au Sahara occidental ?
Au cours de ces événements, Les États-Unis ont assuré une forte présence médiatique qui avait aussi, et peut-être surtout, une finalité de politique intérieure. Leur pression fut réelle mais, du côté égyptien, la réaction nationaliste a été très vive, à hauteur de l'esprit de corps de l'armée que nous avons évoqué. Les États-Unis ont-ils contribué à accélérer le processus ? Peut-être, mais c'est la pression de la population qui a été décisive.
L'armée égyptienne avait souhaité un départ plus ordonné du président Moubarak, qui vient de ses rangs. Toutefois, il ne s'est pas déroulé dans les mêmes conditions que celui du président Ben Ali. Et il n'est pas question pour le moment d'engager des poursuites contre lui.
L'inexistence de la diplomatie européenne constitue un réel problème, mais dans un contexte aussi mouvant, il était très difficile à Mme Ashton de trouver le mot juste sans un minimum de concertation préalable avec les principaux États membres, difficile à organiser.
L'Union pour la Méditerranée est, en effet, bien malade. Mais elle l'était déjà : le conflit israélo-palestinien reste pour elle un abcès de fixation. Il a suffi de l'intervention israélienne à Gaza puis de l'arrivée d'un nouveau gouvernement beaucoup moins conciliant pour que sa mission devienne très difficile. Le sommet prévu a été reporté sine die.
Le calendrier de la mise en place des nouvelles institutions en Tunisie et en Egypte reste imprécis malgré les assurances qui ont été données. Dans ce dernier pays, certaines forces estiment qu'il leur faut au moins un an pour s'organiser. Demeure également une incertitude sur le référendum, à tout le moins sur la responsabilité de la préparation de la révision de la Constitution. Le comité qui en est chargé intégrera-t-il des éléments de l'opposition ? On peut craindre que les militaires cherchent à conserver le processus en vase clos, sans véritable dialogue avec les éléments les plus représentatifs de la population.
Je ne pense pas que les services diplomatiques aient commis une faute par imprévision. Comme chacun sait, il est plus facile de prédire le passé que l'avenir. Nous connaissions, je le répète, les éléments de la situation en Tunisie mais leur combinaison a eu des conséquences tout à fait inattendues, dans un pays où la police elle-même n'a rien vu venir, et dont toute l'opposition était réfugiée en France ou dans d'autres pays occidentaux. Depuis lors, notre analyse s'est orientée vers des données nouvelles, inconnues à l'époque précédant la révolution.
En Algérie, les ingrédients sont différents. La capacité de mobilisation populaire paraît assez faible. Les mouvements restent locaux, touchant surtout la Kabylie. Les policiers sont plus nombreux que les manifestants. Les quelques personnes arrêtées ont été relâchées.
En Egypte, on a observé une privatisation de la demande sociale : l'État ne répondant pas aux besoins collectifs, la société les prend directement en charge, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la santé. Ce qui explique d'ailleurs la faible participation aux élections dans ce pays : on ne demande rien à l'État, du coup, on ne vote pas. En Algérie, au contraire, l'État apporte beaucoup : la répartition sociale va très loin, même pour des sommes modiques, comme la pension servie aux moudjahid.
La dernière grande révolte en Algérie remonte à octobre 1988. Peut-elle se reproduire en regroupant tous les facteurs de mécontentement ? Le pays connaît des émeutes presque quotidiennes mais très ponctuelles : on manifeste, par exemple, contre un programme local de logements jugé insuffisant. Dispersées, les différentes demandes ne s'agrégent pas dans une demande sociale et politique forte, même si ce potentiel existe. De plus, l'État algérien est riche grâce au niveau atteint par le prix du baril de pétrole. Ses disponibilités s'élèveraient à environ 150 milliards d'euros. Il peut donc, comme en janvier dernier, apporter une réponse financière à certaines revendications.
À la suite des évènements de 1988, des réformes, notamment sociales, avaient été demandées à l'Algérie : elles ont été arrêtées en 1993 avec la vague terroriste et oubliées par la suite. Le régime algérien, clientéliste, empêche l'éclosion d'activités privées car celles-ci représentent, d'une façon ou d'une autre, une contestation du pouvoir. Il en résulte une certaine forme d'infantilisation du citoyen. Que peut-il se passer ? Une agrégation des revendications, comme celle de 1988, n'est pas à exclure mais elle me paraît peu probable à court terme. On voit cependant fleurir de nouveaux slogans politiques.
La situation au Sahara occidental n'évolue pas. Le blocage est total entre le Maroc et l'Algérie. On voudrait parvenir à un compromis mais aucune des deux puissances ne fera le premier pas, le Maroc estimant qu'une concession de sa part n'entraînerait aucune contrepartie du côté algérien. M. Christopher Ross, envoyé par le Secrétaire général de l'ONU, a beau évoquer la nécessité d'incorporer les notions de droits de l'homme ou de démocratie dans le territoire sous contrôle marocain, nous sommes en face d'un mur bilatéral.

Vous avez souligné l'influence de la question économique, notamment le chômage massif des jeunes, dans l'explosion en Tunisie et en Egypte. Peut-on dire qu'au sein de l'armée et dans la société civile, il existe, au-delà des revendications démocratiques, une préoccupation d'ordre économique et social ?
Quel type de coopération suggérez-vous de développer entre, d'une part, la France et les autres pays européens, d'autre part les pays du Maghreb ?

Les dirigeants européens, de droite comme de gauche, vont souvent passer leurs vacances dans des pays du sud de la Méditerranée, ce qui ne porte guère chance à leurs régimes, comme on l'a vu avec M. Ben Ali et avec M. Moubarak. Notre président de la République s'est rendu au Maroc mais, heureusement, le roi occupe là-bas une position solide. Il faudrait donc demander à nos gouvernants de ne plus se rendre dans des pays auxquels nous voulons du bien.
La préoccupation de l'Europe, exprimée par sa « ministre des affaires étrangères », est apparue bien tardive, surtout par rapport à une UPM qui, pour la deuxième fois, a gâché les espérances placées dans le premier puis dans le second processus de Barcelone. Avec les pays du sud de la Méditerranée, nous ne sommes pas « en voisinage » mais bien en cohabitation lorsque la moitié d'une famille vit à Alger tandis que l'autre habite à Marseille. Ce qui se passe aujourd'hui chez eux se passera un jour en France. Il ne faudrait pas regarder la région comme une banlieue de l'Europe et se préparer à riposter par la violence comme nous le faisons parfois dans les banlieues de nos villes, en postant des canonnières dans les détroits méditerranéens.
Si nous ne voulons pas intervenir dans les affaires de pays indépendants, comme par exemple au Mexique, il faut disposer d'un plan de coopération économique et sociale permettant aux jeunesses de ces pays de trouver des emplois, sans que nous nous ingérions dans leurs cheminements nationaux vers la démocratie. Je regrette donc que l'UPM ait sombré et que nous en soyons à rechercher, tardivement, un troisième processus de Barcelone.

Une délégation parlementaire s'est récemment rendue au Maroc afin d'évaluer la situation du pays, et de renforcer le partenariat avec la France. Le Premier ministre, Abbas El Fassi, nous a indiqué que des réformes étaient en cours afin de moderniser le royaume mais il a précisé que celui-ci perdait 2% de croissance en l'absence d'intégration économique du Maghreb. Quelle analyse faites-vous de l'actuelle situation du Maroc ? Des facteurs de révolution y sont-ils repérables ?

Au cours d'une période récente, la Turquie a manifesté quelque velléité de jouer un rôle dans la résolution de conflits régionaux. La révolution égyptienne a-t-elle eu des incidences sur la position turque ?
La révolution tunisienne, notamment, semble avoir exalté des valeurs de liberté et de progrès. Mais un nombre élevé de jeunes sans emploi continue de quitter le pays, pour un sort souvent aléatoire, alors que l'espérance nouvelle devrait les inciter à y rester afin de le reconstruire. Pourquoi la révolution ne parvient-elle pas à les retenir chez eux ?
La Turquie joue un rôle politique croissant au Moyen-Orient, mais ses intérêts ne coïncident pas forcément avec ceux de l'Occident. Elle intervient dans plusieurs dossiers, notamment ceux de l'Iran et des rapports israélo-palestiniens. Elle occupe aussi des positions économiques très fortes, particulièrement en Irak où elle comble pour partie le vide laissé par les autres pays. Cette politique va se poursuivre. Concernant l'Egypte, le Premier ministre, Tayyip Erdoģan, avait clairement pris parti en faveur des manifestants et demandé le départ de Moubarak.
Le Maroc se caractérise par la coexistence d'éléments de vulnérabilité et de force. C'est d'abord un des pays arabes où les inégalités de revenus sont les plus grandes, avec des poches de pauvreté non seulement dans le sud mais aussi dans les grandes agglomérations, y compris à Casablanca où des bidonvilles jouxtent presque le centre de la ville. Le taux d'alphabétisation de la population est très faible mais, paradoxalement, se pose aussi le problème du chômage des jeunes diplômés. En revanche, la politique du roi, et de son gouvernement, traduit un dynamisme certain et sa légitimité, reconnue même par le parti islamiste, le PJD, joue en faveur de la stabilité des institutions.
Il faut être conscient de ce qui nous échappe quand nous nous interrogeons sur la politique à mener : on ne peut faire le bien des Algériens contre l'action de leur Gouvernement. C'est ce qui explique que notre politique algérienne ne soit pas propice à l'expansion de l'initiative privée. D'ailleurs, en l'absence de système bancaire, il est difficile d'y créer une entreprise. Le problème est de savoir comment compenser éventuellement la défaillance de l'État et comment définir notre demande, au-delà de celle de l'Union européenne, à l'égard de ce pays.
Nos programmes sont souvent excellents. Pour peu qu'ils s'articulent avec un pouvoir plus acceptable, ils seront tout à fait adaptés, puisqu'ils portent sur l'emploi et la formation des jeunes, notamment au métier d'ingénieur. Notre action n'est peut-être pas suffisante, mais nous n'avons pas à en rougir. Pour faire plus, l'Union européenne, qui manque de visibilité, doit trouver en face d'elle un interlocuteur qui réponde à ses questions, car son propos n'est pas d'imposer une solution. Si elle ne fait pas assez entendre sa voix, c'est parce qu'elle doit encore mettre au point son système de gouvernance. Le service européen pour l'action extérieure n'est pas à pied d'oeuvre, bien que Mme Ashton prenne peu à peu sa place et, même si l'UPM reste un projet d'avenir, elle reste inexistante.
À propos du Maroc, vous avez évoqué ce que les chercheurs nomment le « coût du non-Maghreb ». L'intégration régionale favoriserait la croissance, mais les pays restent tributaires d'une vision Nord-Sud et, faute d'une vision Sud-Sud, ne travaillent que très peu ensemble.
Le mouvement qui se dessine au Bahreïn est essentiellement politique. De même, les aspirations des manifestants de la place Tahrir étaient moins économiques que politiques : ils ont d'abord voulu changer le régime et les règles du jeu. Quant au régime marocain, qui a sa légitimité, il a su mettre en place des garde-fous.
S'il ne nous appartient pas de trouver le moyen de retenir les jeunes dans leur pays, nous devons éviter que nos consulats ou nos ambassades deviennent des forteresses d'où l'on jetterait de l'huile bouillante à l'approche des Sarrasins. Pour cela, il faut trouver un équilibre entre notre politique et celle des pays concernés. Le départ en masse vers Lampedusa tient à ce que les policiers tunisiens ont cessé de contrôler les frontières, offrant à une population attirée par l'extérieur le moyen d'émigrer.

Le désir d'accéder à la liberté d'expression en même temps qu'à un emploi ne risque-t-il pas, en cas de déception, de glisser vers le chaos ou vers une forme de radicalisation ?

À l'euphorie de la révolution risquent de succéder des revendications sociales. Quelle est à présent l'attitude de l'UGTT, qui a participé activement à la chute de Ben Ali ? Ce syndicat s'en tiendra-t-il à une vision sociale ou cherchera-t-il à transformer l'essai en devenant acteur de la vie politique ?
Pour éviter l'effet de tache d'huile, l'Autorité palestinienne a annoncé des élections législatives et présidentielles en septembre, mais le Hamas, qui n'entend pas y participer, refusera de les organiser sur son territoire. Que penser de son attitude ? En Cisjordanie, tiendra-t-il en face d'une population qui pourra s'exprimer démocratiquement et qui connaît, comme celle de la bande de Gaza, d'importantes difficultés sociales ?

Quelles sont les conséquences prévisibles des récents événements sur les relations entre Israël et la Palestine ?
Quelle est la situation de Bahreïn, premier pays du Golfe auquel se soit étendue la crise ?
Enfin, la nouvelle politique dont la France a besoin dans la région se décidera-t-elle dans les bureaux de l'Élysée, avec le concours éventuel du ministère des affaires étrangères ? Dans ce vase de plus en plus clos, notre commission et celle du Sénat auront-elles leur place ou sont-elles condamnées à n'être que des académies diplomatiques ?

M. Paoli a laissé entendre que la propagation des événements serait moins importante dans les monarchies que dans les républiques, mais qu'en est-il en Libye, où des manifestations se sont déroulées hier ? La militarisation du régime est-elle de nature à le protéger ? Par ailleurs, à terme, les éléments déstabilisateurs peuvent-ils avoir une influence sur la bande sahélienne où s'est implanté le terrorisme ?
L'UGTT s'est scindée lors de la révolution, créant ainsi un relais qui faisait défaut. Certains de ses membres entendent structurer leur action autour d'un nouveau parti. D'ailleurs, on a probablement sous-estimé l'influence des partis en Tunisie. Ceux de gauche ont pu faire alliance avec des éléments islamistes, lesquels, n'étant l'apanage ni de la droite ni de la gauche, sont entrés en relation avec tous les partenaires ouverts au débat. Nous devons observer attentivement ces recompositions. L'UGTT pourrait être amenée à jouer un rôle, tandis que les personnalités que nous considérions autrefois comme les porte-voix de l'opposition ont été balayées : les Tunisiens leur demandent où ils étaient pendant la révolution.
La question de l'avenir de la Palestine et du Hamas doit être posée de manière plus politique qu'électorale. Que donner à ceux qu'on soutient pour leur permettre de prouver qu'ils ont fait le bon choix ? Sommes-nous capables d'aider Mahmoud Abbas à montrer qu'il a bien fait d'opter pour la modération et la paix ? Les Israéliens ont-ils pris la mesure de ce qu'il faut accorder à leur partenaire pour la paix, afin de le crédibiliser ? Les élections risquent d'ouvrir une crise de légitimité, au moment où, Al Jazeera organise des fuites qui mettent en cause le pouvoir de Mahmoud Abbas et du Premier ministre Salam Fayyad.
Cependant, on peut aussi imaginer que l'évolution de la situation n'ait aucun effet sur les rapports entre Israël et la Palestine. La pression américaine qui s'exerce sur les différents acteurs tend vers zéro, et aucun interlocuteur arabe de poids n'est en mesure d'intervenir. La balle est donc dans le camp des Israéliens. Mais ceux-ci ont-ils compris qu'un accord politique avec la Palestine, sur le modèle de celui d'Oslo, servirait leurs intérêts à long terme ?
Dans le Golfe, plusieurs pays semblent instables. À Bahreïn, qui n'est pas une monarchie constitutionnelle au sens fort, la majorité se sent discriminée tant politiquement qu'économiquement. Dans le contexte actuel, les irruptions de violence, qui se produisent régulièrement, peuvent aller plus loin. En Arabie Saoudite, une demande sociale pourrait se manifester, ce qui n'est pas le cas ailleurs : quand les Émirats arabes unis ont organisé des élections directes, il a presque fallu forcer les électeurs à aller voter. Par ailleurs, les Chiites de la province orientale se sentent exclus. Ainsi, les lignes de fracture sociale, politique et religieuse peuvent se recouper.
Je terminerai par la Libye. L'âge des dirigeants est un des ingrédients fondamentaux de la révolte des opinions publiques. À l'image de Ben Ali, demeuré 24 ans au pouvoir et de Moubarak, qui y est resté 30 ans, Kadhafi gouverne depuis 42 ans. Les Omanais, qui viennent de célébrer le quarantième anniversaire de l'accession du sultan au pouvoir, doivent se demander s'ils ont eu raison de le faire avec autant d'éclat, même si celui-ci reste une figure populaire et charismatique.
Un des problèmes du Golfe tient au fait que les chiites peuvent être frustrés de ne pas être associés au pouvoir. Ils forment la majorité de la population de Bahreïn et représentent une part importante du Hasa, province orientale d'Arabie saoudite et siège de la production pétrolière et gazière. D'ailleurs, il est probable que les manifestations n'ont pas eu lieu sans soutien de l'Iran, ce qui pose le problème plus général de la stratégie de ce pays dans tout le Moyen-Orient. Il est loin d'être inactif. Le Guide suprême s'est réjoui de la Révolution en Égypte, en évitant naturellement de balayer devant sa porte.
Israël est actuellement en proie à l'embarras et à l'inquiétude. Depuis des années, la question palestinienne a cessé d'y être une priorité pour devenir un conflit de faible intensité, géré par des mesures de caractère policier, le principal problème étant l'Iran. Les événements récents risquent de remettre la question palestinienne au premier plan. On voit mal comment le statu quo pourrait être maintenu : quelle que soit l'évolution politique de l'Égypte, Israël connaîtra une pression croissante de la part de ses voisins, en particulier s'ils ont des régimes démocratiques : ce qui ne manquera pas de poser des problèmes très concrets. On peut se demander par exemple si l'Égypte, qui participe au blocus de la bande de Gaza, continuera à contrôler son passage sud.
Pour traiter la question du Sahel, il faut des partenaires. C'est pourquoi nous n'avons rien à espérer de l'affaiblissement des États. La France, qui se heurte au fait que l'Algérie ne veut pas multilatéraliser le problème, a tout intérêt à avoir des interlocuteurs stables et forts, capables d'imposer l'ordre et d'assurer la sécurité dans les zones qu'ils contrôlent.

Qu'en est-il des intérêts économiques de la France ? Quels sont les risques et les perspectives dans ce domaine ? Par ailleurs, même si je conviens qu'il était difficile de prévoir ce qui s'est passé, ne faut-il pas remettre en cause certaines de nos méthodes et s'appuyer davantage sur la diaspora, qui dispose souvent de meilleures informations que les sources officielles des pays, condamnées à la langue de bois ?

Je regrette que les médias aient fait l'impasse sur l'omniprésence et l'interventionnisme des services secrets américains, qui ont mis en oeuvre en Tunisie, une politique d'inspiration Obama et en Égypte, plutôt la politique de Clinton. Ils ont contrôlé le déroulement des opérations, conseillé les chefs d'état-major des différentes armées et organisé les rendez-vous entre les hommes politiques pour former un Gouvernement accepté par la foule. Ce rôle majeur supposait un prépositionnement de longue date. Comment avons-nous pu être aussi absents dans ce domaine précis, surtout en Tunisie, pays voisin et de surcroît francophone ?

M. Bauchard a isolé quatre causes des mouvements intervenus en Tunisie et en Égypte : rejet d'un autocrate vieillissant, absence d'organisation politique et d'opposition structurées, jeunesse éduquée mais sans emploi ou sous-employée, utilisation des nouvelles technologies. Si l'on s'en tient à ces critères, on doit conclure que l'Algérie et la Libye vont tomber, à la différence de la Jordanie et du Maroc, dont les dirigeants autocrates ne sont pas encore assez vieux, ou du Yémen, où il existe une opposition parlementaire tribale, sudiste et socialiste. Mais j'émets quelques réserves à l'égard de cette grille de lecture, tant l'automaticité est rare en science politique.
À mon sens, il faut prendre en compte un changement essentiel. L'armée, en osmose avec Ben Ali et Moubarak, qui en étaient issus, a contribué à les déstabiliser, alors que la religion a eu un effet stabilisateur, surtout dans les monarchies religieuses comme l'Arabie saoudite, les émirats, le Koweït, le Maroc, la Jordanie et Oman. En Égypte même, les Frères musulmans ont consenti à ne pas mettre d'huile sur le feu. En somme, tandis que l'armée a joué un rôle déstabilisateur, la religion, que tout le monde craignait, notamment l'Occident, a été facteur d'apaisement.

En Égypte, la misère peut-elle déboucher sur un autre pouvoir que celui de l'armée ou des islamistes ?
On compte en Algérie 9 000 émeutes par an, généralement d'origine économique. Ne risquent-elles pas de s'étendre et de prendre une dimension politique et démocratique ?
Les diplomates français, dont vous dites qu'ils ne pouvaient pas prévoir l'explosion, ont-ils au moins réfléchi à ses conséquences et au moyen pour la France de jouer un rôle dans ce contexte ?
Je regrette enfin que vous n'ayez pas répondu à la question de M. de Charette : la diplomatie au Maghreb et au Moyen-Orient est-elle une chasse gardée du Quai d'Orsay ou peut-elle être le fait des parlementaires, qui ne partagent pas toujours ses vues ?

Les forces de la place Tahrir, qui ont fait tomber le pouvoir en place, sont-elles organisées et responsables politiquement, ou nées d'un mouvement spontané et passionné, qui n'a pas d'avenir politique ? Certaines figures représentatives de la contestation ont-elles surgi, qui pourraient s'asseoir à la table des négociations ?

Si l'on ne peut reprocher à notre système diplomatique de n'avoir pas prévu ce qui est arrivé, nous sommes nombreux à déplorer son manque d'empathie très préjudiciable à l'image de la France dans cette partie du monde. Ce sont pourtant de nos valeurs que se réclamaient les foules, surtout en Tunisie : respect des droits de l'homme, principes de 1789, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Avons-nous cessé de croire à leur universalité, paralysés par je ne sais quel complexe d'ingérence coloniale, alors que les Américains y adhèrent encore ?
Je regrette que, depuis des années, notre système diplomatique ne se soucie pas assez des associations de défense des droits de l'homme. Leurs membres, peu nombreux, parfois très âgés, ont mené avec courage les manifestations, après avoir milité pendant des années. Ils maintiennent le cap qui devrait être le nôtre.
Je déplore enfin l'insuffisante réactivité de notre système médiatique, comparé à Al Jazeera et aux chaînes anglo-saxonnes. Seuls RFI, quelques segments de notre système audiovisuel extérieur et l'AFP se sont fait entendre. Nous devons rassembler nos forces et investir dans le net. Le retard de notre diplomatie est affligeant, à l'heure où la France doit faire entendre sa voix et affirmer ses valeurs, en s'appuyant sur les communautés nationales présentes sur son territoire.

Si gouverner c'est prévoir, c'est aussi agir, comme le notait Pierre Mendès-France. Or, on ne peut pas dire qu'en matière de réactivité ou d'accompagnement, le temps perdu ait été rattrapé. La diplomatie européenne et nationale, comme l'UPM, sort terriblement abîmée de ces événements. Les valeurs françaises, devenues universelles, ne sont plus portées par la France. Notre pays a-t-il disparu, alors que nos idées continuent à faire leur chemin ?
Peut-on penser que l'onde de choc atteindra la Libye ?
Pour le Sahara occidental, je ne récuse pas votre analyse sur les deux pays encadrants, Maroc et Algérie, mais les peuples eux-mêmes ne peuvent-ils pas prendre d'initiative ?
Enfin, peut-on espérer une adéquation entre les gouvernements qui vont se mettre en place et les peuples qui les ont portés au pouvoir ?
Beaucoup de questions s'adressent au pouvoir politique, et je me garderai bien d'y répondre.
Il n'est pas nouveau que, sous la Ve République, la politique étrangère de la France se décide à l'Élysée, même si le ministre des affaires étrangères et ses services y apportent leur contribution.
En amont, le premier rôle des diplomates est d'informer. Tout laisse penser que notre ambassadeur à Tunis a décrit la situation dans les mêmes termes que son homologue américain. Le second rôle des diplomates est de nouer des contacts. C'est en ce sens qu'on peut parler d'un manque d'empathie. Un ambassadeur peut ne pas avoir les bons contacts au bon moment, mais ce problème délicat ne relève pas seulement de sa personnalité : il est impossible de s'entretenir avec un interlocuteur « sensible » sans autorisation du ministère. Quand j'étais en poste en Jordanie, j'avais été sollicité par les représentants du HAMAS, mais le Quai d'Orsay s'était opposé à ce que je les rencontre.
En aval, les ambassadeurs défendent la politique définie par le Président. Le rôle de chacun est strictement délimité. J'ai connu une époque où s'exerçait une véritable interaction entre le ministère des affaires étrangères et l'Élysée, et où l'on attendait de nous des suggestions sur tel voyage ou telle thématique. En cas de déplacement, le discours du Président de la République était préparé au ministère et relu en équipe à l'Élysée. Toutefois, je me garderai de porter un jugement sur ce qui se passe maintenant.
De manière générale, il faut éviter de surestimer l'influence américaine au Moyen-Orient, même si les États-Unis disposent de services de renseignement nombreux et bien placés. Rappelons-nous la manière dont ils ont subi des rebuffades de la part de personnalités réputées proches d'eux comme le Premier ministre Netanyahou, le Président Karzai, le Premier ministre irakien Al-Maliki ou le général Musharaff, preuve qu'on constate au Moyen-Orient « l'impuissance de la puissance ». Dans cette région du monde, l'influence américaine décline, comme celle de l'Europe, au profit de celle des pays émergents. En Iran, profitant de la politique de sanction, la Chine s'est substituée à l'Europe en devenant son premier partenaire commercial.
Je n'ai donné aucun caractère absolu aux éléments dont j'ai indiqué qu'ils avaient joué un rôle dans la crise tunisienne ou égyptienne, et qui peuvent caractériser d'autres pays. Pour autant, l'armée ne me semble pas toujours un facteur d'instabilité ni la religion, une force de cohésion.
L'armée a permis à l'Égypte d'échapper à une anarchie totale. Si elle n'est pas parvenue à maintenir Moubarak jusqu'en septembre, elle a du moins contribué à préserver un ordre. On peut seulement craindre qu'elle ne soit pas suffisamment sensible aux aspirations démocratiques de la population. Les prochaines semaines montreront ce qu'il en est.
Certaines monarchies religieuses sont stables. Le roi du Maroc, qui descend du Prophète et porte le titre de commandeur des croyants, en tire une légitimité, mais des forces déstabilisatrices peuvent jouer contre lui. De même, le roi d'Arabie saoudite est gardien des lieux saints, sa dynastie s'est alliée au XVIIIesiècle avec la famille Abd al-Wahhab. A l'inverse, la confrérie des Frères musulmans a accompagné le mouvement en Égypte comme dans d'autre pays. S'ils ne l'ont pas provoqué, ils ont été obligés de suivre leurs troupes. Sans doute, quand des élections législatives seront organisées en Égypte, seront-ils assez prudents. S'ils ont déjà annoncé qu'ils demanderaient la création d'un parti indépendant, tout laisse penser qu'ils éviteront de se mettre en avant. D'ailleurs, ils ont déclaré qu'ils ne présenteront pas de candidats à l'élection présidentielle.
Notre action dépend en grande partie des moyens qu'on nous alloue. En tant que fonctionnaire, je n'ai pas à voter le budget, mais je regrette qu'il baisse alors qu'on nous demande d'accomplir des tâches de plus en plus importantes. Notre métier a considérablement changé en trente ans. Il n'est pas toujours facile d'expliquer à la représentation nationale le travail discret qu'accomplissent les ambassades. Les contacts avec des associations ou des mouvements d'opposition, la lutte contre la peine de mort et la défense de nos valeurs n'appellent pas nécessairement de publicité. Mais, puisque la loi organique relative aux lois de finances renforce le contrôle des assemblées sur le budget, j'aimerais qu'elles se manifestent en donnant au Quai d'Orsay les moyens d'agir. Nous préparons actuellement un plan sur la Tunisie en raclant les fonds de tiroirs. Que ferons-nous pour l'Égypte, quand les moyens manquent cruellement ?
L'Élysée et le ministère travaillent en interaction pour définir une ligne. Les fonctionnaires formulent des propositions, mais la décision incombe aux politiques. Chacun, à sa place, doit assumer ses choix. Cependant, il faut garder un regard acéré sur le rôle que l'on veut voir jouer aux experts. L'expertise du Quai d'Orsay est forte et légitime. Le réseau est organisé et structuré. Il travaille bien. On doit le reconnaître pour ce qu'il est, et le défendre.
Certains d'entre vous éprouvent le sentiment amer que nous ne défendons pas certaines valeurs. Posons la question de manière non polémique mais technique : quand une mission parlementaire se rend dans un pays, par exemple en Syrie, son premier rôle est-il de se battre pour les droits de l'homme, au risque d'hypothéquer tout le bénéfice qu'une visite d'amitié pourrait avoir en termes d'influence ? Nous consacrons nombre de démarches aux prisonniers politiques. Il est déjà important d'écrire ce que nous pensons. C'est ainsi que nous manifestons notre intérêt pour cette blogueuse de dix-huit ans que les autorités locales accusent absurdement d'espionnage. Le problème du positionnement de tout visiteur reste posé, et dépasse largement le cadre de la diplomatie. Une mission, qu'elle soit le fait de parlementaires, d'hommes politiques ou d'hommes d'affaires, n'a pas à porter en premier lieu un message subversif. Il n'est pas facile de trouver un équilibre entre le principe de non-ingérence, auquel nous sommes attachés, et la défense de nos valeurs.
La diaspora peut être un prisme déformant. En Irak, les Américains ont eu tort de s'appuyer sur Ahmed Chalabi, notoirement corrompu, dont la banque a fait faillite en Jordanie. La diaspora, qui a son mérite, a aussi ses inconvénients. Ceux que la presse française présente comme les porte-parole de l'opposition tunisienne sont considérés par les acteurs de la révolution comme non représentatifs et non légitimes.
Si nous ne rendons pas publics tous nos contacts, nous nous entretenons avec certains opposants tant à Paris qu'en poste. Mais, sur place, le pouvoir tunisien avait mis en place un système extrêmement inhibant. Il se manifestait chaque fois que nous rencontrions quelqu'un. Ce travail de sape a porté ses effets.
Je partage le point de vue de M. Bauchard sur les services américains. Si ceux-ci étaient aussi bons qu'on le prétend, les politiques auraient agi plus tôt et non a posteriori.
En Tunisie, nous avons eu la chance que l'armée se dissocie du pouvoir. C'est ce qui lui a permis de prendre ses distances vis-à-vis d'un régime policier et de jouer un rôle important.
Il est douloureux pour nous que l'Union ait du mal à trouver sa voie, en dépit de réformes successives. Il faut rester vigilant en la matière, car le Parlement européen a un rôle important à jouer pour maintenir l'attention sur la rive sud de la Méditerranée. Ce que nous ne pourrons pas faire dans le cadre de l'UPM, nous le tenterons avec les moyens que nous avions prévu de lui allouer. Argent, structures et programmes existent. Les États doivent les faire fonctionner. Le rôle d'orientation du Parlement européen s'est développé. Nous disposons d'un laboratoire, mais il faut trouver une voie.
Nous devons aussi modifier notre regard sur le rapport entre l'armée et les forces religieuses. Longtemps, nous avons soutenu des dictatures qui se présentaient comme le meilleur rempart contre l'islamisme, dont elles ont en fait favorisé le développement en le dispensant de se positionner de manière politique. Les Frères musulmans continuent à prétendre que l'islam est la solution sans décliner un vrai programme. Voici venue l'épreuve de vérité. Sommes-nous prêts à considérer que les pays ont acquis une maturité suffisante pour ne pas leur donner de leçons ? Les Tunisiens et les Égyptiens de la place Tahrir nous disent qu'ils vont se colleter avec les Frères musulmans. Ne soyons pas naïfs : les islamistes sont plus structurés que les autres, mais devrait-on leur préférer un Ben Ali sans la famille Trabelsi ou un Moubarak plus jeune ? Il faut trouver un nouveau positionnement, en considérant qu'il n'y a pas de fatalité.
L'armée n'est pas non plus un garant, et les manifestants qui lui font une confiance aveugle pèchent par naïveté. Il n'est pas certain que cette force qui avait maintenu Moubarak au pouvoir puisse se réformer. Comme l'ensemble de l'état-major, le maréchal Tantaoui est très âgé. La jeune génération prendra-t-elle le relais ? L'armée jouera-t-elle en Égypte le rôle qu'elle avait tenu en Turquie ? Nous savons peu de chose à son sujet.
Les Américains ne sont pas mieux informés que nous à cet égard. D'ailleurs, dans bien des pays, ils se sont montrés incapables d'orienter la situation dans le sens de leurs intérêts – à moins qu'on ne considère qu'ils ont fait exprès de s'en remettre à des êtres aussi insaisissables que M. Karzai en Afghanistan ou M. Maliki en Irak.
La force politique des manifestants de la place Tahrir reste un sujet d'interrogation. Six mouvements sont apparus, représentatifs du monde des blogueurs, des internautes et de certains jeunes Frères musulmans. Ils tentent de s'agréger pour créer un parti représentant différents courants, mais les Égyptiens eux-mêmes ne voient pas le mouvement se cristalliser.
On n'explique pas davantage le miracle tunisien de ce choeur d'internautes invisibles mais suffisamment présents pour affirmer que le Gouvernement ne convient pas et l'amener à changer. Les décisions ont été prises sans qu'un rapport de force matériel ou physique ait été créé. L'ancien système a été balayé grâce à une ouverture, un esprit bon enfant qu'on ne rencontre pas en Égypte où l'armée reste aux commandes.
Les entreprises françaises n'auront probablement pas à souffrir des bouleversements, car la présence économique ne dépend pas toujours du politique. Souvent, elles voudraient qu'on intervienne politiquement, alors que les contrats dépendent d'abord de leur compétitivité. Seule la vente d'un satellite ou d'un avion de combat, qui a trait à la souveraineté, concerne le pouvoir politique.
En Tunisie, on attend un appel d'air très important pour répondre à la demande en tourisme ou en investissements. Nous devrons envoyer un signal très fort. La semaine prochaine, la mission que Mme Lagarde et M. Wauquiez mèneront sur place permettra d'exprimer notre confiance dans la Tunisie de demain. La France est le premier investisseur, le premier acheteur, le premier vendeur et le premier fournisseur d'aide à la Tunisie, alors que les Britanniques, si prompts à donner des leçons, n'ont aucun intérêt sur place.
Notre pays sera un acteur majeur de la transition. Nous devrons faire preuve d'empathie et mobiliser les moyens dont nous disposons. Les entreprises joueront un rôle fondamental dans la région, où nos investisseurs sont plus présents que les commerçants. Les Français sont les premiers investisseurs étrangers en Syrie, en Jordanie et au Yémen, où Total est le premier acteur du projet gazier. Nous devons faire prévaloir nos intérêts. Nos entreprises devront également s'acquitter du travail de formation auquel elles se consacrent. La France est le premier employeur étranger au Maroc et en Tunisie.
Compte tenu de l'importance des enjeux, nous devons être vigilants, user de tous les moyens dont nous disposons, comme la caisse de l'UPM et les fonds multilatéraux, et encourager l'investissement dans les démocraties naissantes. Ce sont des marchés qu'il ne faut pas négliger. Nous l'avons dit, Denis Bauchard et moi-même, à la Chambre de commerce franco-arabe. À l'heure de la mondialisation, il n'y a pas de mauvais moment. Je regrette que nos entreprises ne soient pas suffisamment agressives dans le Golfe. Peut-être ne mesurent-elles pas le risque qu'il y a à arrêter la carte du monde à l'Iran en oubliant que la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud investissent ces marchés.
La séance est levée à onze heures trente cinq.