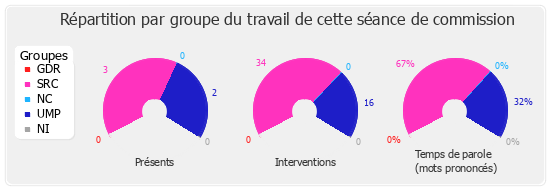Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Séance du 12 février 2008 à 9h00
La séance
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a procédé à l'audition de M. Jacques Sauret, directeur du Groupement d'intérêt public du dossier médical personnel (GIP-DMP).

Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale pour cette audition qui s'inscrit dans le travail que mène notre mission sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments. La mission d'information sur le dossier médical personnel (DMP) conduite par M. Jean-Pierre Door, vient de rendre ses conclusions et elle a vous déjà auditionné. Il nous a paru néanmoins utile de vous entendre à nouveau sur le sujet du médicament.
Je donne sans plus tarder la parole à notre rapporteure.
Le DMP est à la fois dans une phase de travail sur le fond, puisque nous continuons à avancer au sein du GIP et avec les acteurs concernés sur les spécifications et la description du dispositif, et dans une phase d'attente de décisions politiques puisque, à l'issue de la revue de projet menée par l'Inspection générale des finances (IGF), l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et le Conseil général des technologies de l'information (CGTI), qui a rendu ses conclusions en novembre dernier, et des travaux de la mission parlementaire, le gouvernement a constitué une mission de relance du DMP, qui sera suivie d'une concertation avec l'ensemble des acteurs. Présidée par M. Michel Gagneux, membre de l'IGAS, cette mission doit rendre ses conclusions avant la fin du mois de mars. Nous espérons qu'immédiatement après un certain nombre de décisions seront prises par le gouvernement afin de redonner une bonne visibilité aux différents acteurs, indépendamment de la concertation qui permettra pour sa part d'approfondir un certain nombre de sujets.

Pouvez-vous préciser quelles pourraient être ces décisions politiques ainsi que les dispositions que vous souhaiteriez que le gouvernement prenne ?
La principale décision consisterait à donner plus de visibilité aux acteurs, aussi bien aux industriels, qui sont prêts à investir des lors qu'ils sont assurés qu'il va se passer quelque chose, qu'aux professionnels de santé, que le GIP-DMP a aidés sur le terrain, grâce à un appel à projets, à progresser vers les spécifications et l'interopérabilité nécessaires au DMP. Or, faute de visibilité, les porteurs de projets locaux ont de plus en plus de mal à mobiliser les professionnels de santé de base, qui sont réticents à se lancer dans un projet dont ils ignorent s'il sera mené à bien.
Les décisions devraient porter par exemple sur l'hébergement des données partagées, car je distingue les données sur le poste de travail des professionnels de santé, que ce soit en officine, en établissement de santé ou chez un médecin libéral, et les données qui sont mises à disposition par un professionnel de santé pour que ses confrères puissent en prendre connaissance dans le cadre de la prise en charge sanitaire, dès lors que le patient en est d'accord. Nous nous demandons s'il convient d'aller vers un hébergement mutualisé, qui permettrait des économies d'échelle importantes, ou au contraire vers un hébergement totalement réparti, qui donnerait une meilleure visibilité aux acteurs régionaux. À ce stade, le GIP considère qu'il faudra sans doute aller vers un hébergement réparti, mais qu'il ne faut pas commencer par cela, sauf à prendre le risque de complexifier le projet. Mieux vaut faire simple et peu coûteux au début, tester pendant quelques années, ce qui permettra ensuite au gouvernement de décider en connaissance de cause d'aller vers plusieurs hébergeurs nationaux ou des hébergeurs territoriaux.

Compte tenu de la montée en puissance progressive et de ce qui a déjà été fait, par exemple pour le dossier pharmaceutique (DP), quel est selon vous l'agenda crédible de mise en place du DMP et pour combien de personnes ?
On peut imaginer une mise en oeuvre opérationnelle, au départ pour quelques millions de personnes, dans un délai compris entre 24 et 36 mois, le temps que l'identifiant national de santé soit constitué, que la carte de professionnel de santé soit diffusée dans un nombre suffisant d'établissements, que les appels d'offres relatifs à l'hébergement et au portail soient lancés. Par la suite, la montée en puissance dépendra des premiers résultats observés et de la volonté politique.
Ce délai est nécessaire pour les infrastructures. Mais, comme la mission présidée par M. Jean-Pierre Door l'a préconisé, il ne faut pas attendre qu'elles soient en place pour accompagner le changement sur le terrain et pour mener des expérimentations. On pourrait ainsi tester une sorte de DMP régional avec le DP, un autre avec l'historique des remboursements de l'assurance maladie, mais en se plaçant déjà dans une logique d'industrialisation car les industriels sont réticents à investir dans des solutions qui s'écarteraient du dispositif final d'interopérabilité nationale.
Une fois que les infrastructures seront en place, on entrera dans une logique de montée en charge. Il faudra alors se demander si l'on commence par les affections de longue durée (ALD) ou par les maladies chroniques ou si, pour éviter toute stigmatisation, il vaut mieux commencer par des zones géographiques représentant une masse plus importante de population. Ne risque-t-on pas en effet de susciter un rejet de la part des médecins s'ils constatent que le délai de saisie est fort long pour les personnes en ALD, alors que ces dernières ne représentent qu'un peu plus de 10 % de la population ? Il faudra en discuter dans le cadre de la concertation afin de déterminer s'il y a lieu de privilégier les personnes qui en ont le plus besoin ou l'appropriation par les professionnels de santé.

Si l'on prend l'hypothèse des ALD, qui représentent les dépenses les plus importantes de l'assurance maladie et dont les pluri pathologies aggravent le risque iatrogène, pensez-vous qu'au bout du délai de 24 à 36 mois il serait possible de mettre en place le DMP pour les 6 millions de personnes concernées ? Quel en serait le coût ?
Il sera tout à fait possible de commencer au terme de ce délai et il faudra quelques mois pour couvrir l'ensemble de cette population : une fois que l'on disposera des infrastructures, la montée en charge pourra être très rapide.
S'agissant du coût, la revue de projet a considéré que nos évaluations étaient sous-estimées. Tout dépend du périmètre retenu. Si l'on intègre la carte Vitale, on fait exploser les coûts. Pour notre part, nous avons considéré que les coûts de l'évolution vers la carte Vitale 2 et de la diffusion de la carte de professionnel de santé (CPS) ne pouvaient être imputés au DMP. En effet, même si l'on renonçait aujourd'hui au DMP, le décret du 15 mai 2007 sur la sécurisation de la conservation et de la transmission des informations médicales par voie électronique entre professionnels serait appliqué et les établissements de santé seraient effectivement contraints à distribuer la CPS.
Le coût de la constitution du portail a été estimé par la Caisse des dépôts et consignations à une vingtaine de millions d'euros par an. La vérification par des audits externes a été interrompue dès lors que le gouvernement n'a pas souhaité, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), habiliter explicitement la Caisse des dépôts pour le portail. Il s'agit d'une des décisions politiques que nous attendons. Si la Caisse des dépôts n'est pas retenue, il nous faudra lancer un appel d'offres mais l'ordre de grandeur devrait être le même pour un portail capable d'absorber l'ensemble de la population. Une montée en charge progressive réduirait légèrement les coûts.
Pour un hébergement extrêmement sécurisé et une disponibilité garantie, si l'on traite plus de 10 millions de dossiers et si l'on mutualise, le coût devrait être autour d'un euro par DMP et par an. S'il y avait plusieurs hébergeurs, le coût global serait plus élevé.
Mais l'essentiel des coûts tient à l'accompagnement du changement. Les éditeurs estiment que l'adaptation des logiciels des professionnels libéraux devrait revenir à 200 € par poste. L'assurance maladie dépensant déjà une centaine de millions d'euros chaque année pour les aides à la télétransmission, peut-être pourrait-on négocier une enveloppe globale annuelle de soutien à l'utilisation d'outils informatiques qui éviterait de prendre en charge la totalité de cette adaptation. Nous estimons à environ 90 millions d'euros le coût de mise à niveau des logiciels, d'autant qu'un certain nombre d'éditeurs facturent les mises à jour ultérieures ; que la quasi-totalité des pharmaciens sont informatisés avec des dispositifs parfois obsolètes, mais en général à jour ; que 80 % des médecins sont informatisés et qu'ils utilisent l'informatique à des fins médicales dans 60 % des cas, même s'ils se contentent parfois de relever l'état civil des patients et d'imprimer leurs ordonnances.
Il y aura aussi un coût d'appropriation de l'usage, que nous estimons à 20 millions d'euros par an pendant quatre ou cinq ans. Nous considérons en effet qu'il faudra une ou deux journées de formation, non pas à l'utilisation du DMP, qui devra être très simple et nécessiter un ou deux « clics », mais pour l'appropriation psychologique et l'évolution des pratiques liée à la possibilité d'un partage d'informations. Il reste à déterminer qui prendra en charge cette formation. Nous souhaitons donc lancer en 2008 une étude pour déterminer si cela doit relever des institutions de formation médicale continue ou des éditeurs de logiciels, car le DMP ne sera accessible aux professionnels que par l'intermédiaire de leur logiciel métier. Entre 300 et 600 millions d'euros sont consacrés chaque année à la formation médicale des médecins libéraux, dont 60 millions d'argent public. Tout le reste provient de fonds privés, essentiellement des laboratoires pharmaceutiques. Il faut donc trouver la façon de mobiliser l'intégralité des moyens, se demander à quoi doit être destiné en priorité l'argent public, s'interroger sur les synergies possibles avec l'argent privé afin d'amener les professionnels de santé libéraux à utiliser le DMP.
S'agissant de la formation des personnels hospitaliers, des crédits de formation continue existent, mais il est très difficile de les mobiliser car ils servent souvent à boucler les fins de mois des établissements… Les hospitaliers considèrent qu'il convient de prévoir également le financement d'un dispositif de formation des personnels qui seront le plus amenés à utiliser le DMP et le système de partage des informations.
Pour le support, c'est-à-dire la « hot line », le coût peut être extrêmement élevé ou très réduit. Il dépendra très fortement de la montée en charge. Il nous est apparu impossible de lancer un appel d'offre à ce stade car il risquerait d'être surdimensionné ou sous-dimensionné. Qui plus est, nous disposons de la plus grande plate-forme de services en Europe, celle de l'assurance maladie. Si cette dernière acceptait de consacrer un numéro de téléphone spécifique à une sorte de « SOS-DMP », on pourrait profiter de son adaptabilité pour mesurer au cours des premières années le nombre et le type d'appels par DMP ouvert et décider ensuite s'il convient de poursuivre avec elle ou de lancer un appel d'offres. L'idée est de préserver l'avenir, le temps que l'on y voie plus clair. Chaque praticien dispose déjà d'une « hot line », opérée par les éditeurs de logiciels et, d'une certaine façon, par l'assurance maladie. Nous pensons qu'il faudrait aller vers un point d'accès unique pour le praticien mais il convient de réfléchir avec les éditeurs et avec l'assurance maladie et de tester le mécanisme avant de se lancer dans un dispositif très onéreux. Le risque de saturation de la « hot line » paraît assez limité avec l'assurance maladie, qui peut lui dédier 2 500 téléopérateurs, ce dont aucun opérateur privé n'est capable. Il serait dommage de ne pas utiliser cette capacité.
Nous sommes toutefois confrontés à une difficulté qui devra être levée à l'occasion de la concertation : pour l'instant, la loi du 13 août 2004 ne permet qu'aux professionnels de santé délivrant des soins d'accéder au DMP. Jusqu'ici, nous avons considéré qu'un téléopérateur qui répond aux patients ne pouvait pas disposer de cet accès. Or, au moment des expérimentations conduites en 2006, nous avons constaté que les patients parlaient de leur santé, ce qui pouvait d'ailleurs poser des problèmes psychologiques aux téléopérateurs des hébergeurs, qui n'ont pas été formés à cela. Nous devrons donc nous demander s'il convient de modifier la loi, non pas afin que les téléopérateurs puissent apporter des réponses médicales, mais pour qu'ils puissent avoir un aperçu du contenu afin de savoir si un document a été effectivement déposé ou par qui le DMP a été consulté. Il conviendrait sans doute que l'opérateur puisse répondre au patient qui s'inquiète de savoir pourquoi tel professionnel a accédé à son dossier. Bien évidemment, on oppose à cette idée la protection de la liberté individuelle et du secret médical. Mais il me semble qu'une « hot line » qui ne pourrait répondre qu'à des questions techniques susciterait des frustrations voire des angoisses chez les patients.
S'agissant toujours du financement, certains syndicats de professionnels de santé considèrent que le DMP demandera un travail supplémentaire et que le système ne pourra fonctionner qu'avec une aide financière. Pour ma part, je juge cela inutile et contre-productif. La demande est de deux C par patient et par an pour un médecin, soit un coût total de 3 milliards d'euros. Or cela ne changerait rien au pouvoir d'achat des médecins libéraux : si le temps de consultation augmente de 10 % en raison du DMP, les deux C ne changeront pas grand-chose au pouvoir d'achat. À l'inverse, si le DMP apporte un véritable service, on n'aura pas besoin des deux C. Qui plus est, dès lors que le gouvernement ou l'assurance maladie céderaient sur ce point, les pharmaciens, les infirmiers, les kinésithérapeutes demanderaient à être traités de la même façon.
Il me paraît d'autant plus injustifiable de consacrer de telles sommes à ce service qu'il suffit d'attendre. Microsoft est en train de tester le dispositif dans deux États des États-Unis, en vue d'une généralisation en Amérique du Nord, voire en Europe, d'ici deux ans. Deux cents personnes se consacrent à plein-temps à élaborer les interfaces avec les plates-formes techniques de Microsoft, afin que les logiciels des professionnels de santé, en hôpital comme en ville, puissent envoyer très simplement, dès lors que le patient en est d'accord, les informations qu'ils produisent vers le dispositif Healthvault. Par conséquent, si on ne fait rien, le DMP existera, simplement, il sera stocké en Amérique du Nord, dans des conditions qui ne dépendront pas des lois françaises, même si France Télécom est en discussion avec Microsoft pour essayer d'être l'opérateur du dispositif en France et en Europe. Il y a donc là aussi une décision politique à prendre pour savoir s'il appartient à la France de décider elle-même des règles selon lesquelles les informations produites par les professionnels de santé sont partagées. En tout cas, le montant à mettre pour conserver un pouvoir de décision en la matière ne doit certainement pas être de plusieurs milliards d'euros. Nous estimons qu'une fois le dispositif installé tout au plus 300 millions d'euros seront nécessaires.

Pouvez-vous préciser si on parle ici de données partagées ou de données personnelles mais aussi nous indiquer quels professionnels de santé auront accès au DMP et quelles informations y figureront ?
Le débat entre données partagées et données personnelles est ancien. Un peu partout dans le monde on observe qu'il s'agit de données partagées mais de plus en plus accessibles aux patients. Il s'agit donc bien de données de nature professionnelle, fournies par les professionnels de santé à des fins de meilleure coordination des soins et pas d'un outil de vulgarisation de l'information médicale. La grande différence avec le projet anglais – qui est toutefois en train d'évoluer pour donner un accès aux patients via Internet – c'est qu'en France le législateur a dit dès 2004 qu'il voulait que le patient puisse avoir accès à ces informations et s'opposer au partage. En fait, cette possibilité d'opposition remonte à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Quand on regarde attentivement les textes, on s'aperçoit que dès aujourd'hui, dans le code de la santé publique, un patient peut s'opposer à ce qu'une information soit transmise du professionnel de santé qui le prend en charge à tout autre professionnel. En fait, la seule différence entre le DMP et les dossiers de réseaux de soins ou tout autre échange, même par messagerie ou par courrier, c'est que le DMP donnera dès l'origine un accès extrêmement simple au patient. En créant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), la loi du 17 juillet 1978 a rendu tous les documents accessibles, même si cela est parfois compliqué. Si toutes les administrations mettaient en ligne l'ensemble des documents administratifs, comme cela se fait en Suède, les modalités d'accès seraient extrêmement simplifiées. Pour moi, le DMP est une première étape pour rendre réellement et simplement applicable la loi de 2002 et il n'y a pas de différence de substances entre ce dossier et les autres partages et échanges d'informations de santé personnelles.
La mission dirigée par M. Michel Gagneux réfléchit aux modalités de ces échanges, les professionnels de santé ne souhaitant pas qu'on leur demande de poser de multiples questions au patient : êtes-vous d'accord pour ouvrir un DMP ? Êtes-vous d'accord pour ouvrir un DP ? Êtes-vous d'accord pour participer à un réseau de soins sur le diabète ? etc. L'une des pistes de réflexion est d'uniformiser les règles de consentement du patient, qui consentirait simplement au partage des informations de santé entre les professionnels qui le prennent en charge. Dans le cadre du DP, une fois cet accord explicite donné, par la suite l'accord est présumé implicite par tous les pharmaciens, sauf indication contraire du patient. Ne pourrait-on généraliser cette formule à l'ensemble des dossiers partagés, ce qui rendrait le dispositif plus compréhensible par le patient ? Il faut prendre garde à ce que la complexité n'exclue pas toute une partie de la population qui ne comprendrait pas ce qu'on lui demande.
Je pense qu'il est temps de réconcilier les notions de données personnelles et de données partagées en disant bien qu'il s'agit de données à destination des professionnels pour la coordination des soins mais accessibles au patient et sous son contrôle. Ce que fait ensuite le patient de ces données est un autre sujet : il peut télécharger son DMP sur son poste de travail et on ne peut lui interdire ni juridiquement ni techniquement d'en faire ce qu'il veut et de le montrer à qui il veut, par exemple en l'envoyant sur un site qui lui permet de vérifier les interactions médicamenteuses ou la monographie des médicaments. S'il apparaît dans la presse qu'une information du DMP a été rendue publique, nous devrons prouver que la « fuite » ne provient pas de la chaîne du DMP, d'où l'importance de la traçabilité pour savoir qui a accédé aux informations et à quel moment.
S'agissant de la liste des professionnels de santé, nous sommes confrontés à de vraies difficultés parce qu'en 2004 le législateur a visé l'ensemble des professionnels de santé et uniquement eux. Ainsi, les opticiens lunetiers, les orthophonistes, les orthoptistes ont accès au DMP, mais à quoi exactement au sein de ce dossier ? Chacune des professions qui prescrit considère que, dans un certain nombre de situations, elle a légitimement intérêt à avoir accès aux informations de santé. Certes, mais ces cas exceptionnels justifient-ils un accès aux DMP de toute la population ? Les antécédents gynécologiques sont importants pour beaucoup de professions, mais comment faire une sélection document par document ? Notre souhait est de commencer, dans la grille d'habilitation qui sera annexée au décret, à limiter très fortement, c'est-à-dire aux principales professions, là où il y a la plus forte valeur ajoutée en termes de coordination des soins : médecins, pharmaciens, infirmières, sages-femmes. Quelques informations devraient également être disponibles pour les dentistes et les kinésithérapeutes. Après quelques années d'utilisation, il faudra regarder comment les choses se passent avant d'envisager de légères modifications.
Il me semble absolument indispensable de gérer plus finement la question du masquage, qui a fait couler beaucoup d'encre. On ne saurait se placer dans le tout – chaque professionnel de santé a accès à toutes les informations – ou rien – je refuse que l'information soit dans mon DMP. Si l'information n'est pas mise dans le dossier par le professionnel de santé qui la génère, elle n'y figurera jamais. On constate par exemple que lorsqu'une personne atteinte du sida découvre sa séropositivité, elle est assez réticente à ce que cette information soit connue, mais au bout de quelques semaines ou de quelques mois, elle s'aperçoit que c'est une nécessité pour qu'elle soit correctement prise en charge. Si elle n'avait à l'origine pas d'autre choix que d'interdire que l'information figure dans le DMP, elle n'y serait jamais transcrite. Nous rejoignons donc le rapport présenté par M. Jean-Pierre Door sur l'idée qu'il faut se donner le temps de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain, d'observer la réalité du masquage, de constater la réalité des besoins et des pratiques.
Mais on peut aussi considérer que la liste établie par le législateur est trop étroite en ce qu'elle est exclusivement limitée aux professionnels de santé. À la différence du code de la santé publique, elle ne prend pas en compte les professionnels qui travaillent sous l'autorité du professionnel de santé : secrétaires médicales ou aides pharmaciens. Or, les professionnels de santé ont besoin que ces personnes, couvertes par le secret professionnel, puissent continuer à les aider dans la prise en charge des patients. À défaut, ils ne bouleverseront pas leurs pratiques, qui leur ont permis de se concentrer sur la valeur ajoutée médicale, et ils n'utiliseront pas le DMP.
Dans le cadre des discussions internationales sur les normes, nous avons proposé de distinguer l'auteur de la donnée, l'émetteur – celui qui donne l'ordre et qui choisit de transférer – et le transmetteur. Mais nous avons bien besoin d'être assurés que le transmetteur est également habilité. Pour l'instant, si ce n'est pas le professionnel de santé qui transmet, nous rejetons la demande.
Ce thème est aussi l'objet d'une concertation qui pourrait conduire à demander au législateur d'étendre le droit d'émission. Là aussi, il conviendra de garantir la traçabilité, c'est-à-dire de savoir concrètement ce qui se passe sous l'autorité du professionnel de santé titulaire du cabinet ou de l'officine.

Tous les médicaments en automédication ont été intégrés dans le DP actuellement en test dans six départements, ce qui paraît important au regard des interactions médicamenteuses. Le DMP intégrera-t-il également l'automédication ?
L'accord que nous avons trouvé avec le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens prévoit que le DP soit le volet médicament du DMP, c'est-à-dire que les éléments du dossier pharmaceutique soient transmis automatiquement dans le dossier médical, sauf opposition expresse du patient. Afin d'unifier les modalités de consentement du patient, nous souhaitons que les mêmes règles s'appliquent au DP et au DMP. Si tel est le cas, le transfert pourra être automatique, sauf opposition, et cela concernera l'intégralité des médicaments, qu'ils soient ou non remboursés.

Même si vous n'êtes pas directement en charge de la prospective, je suppose que vous avez également travaillé sur les effets attendus du DMP, en particulier sur la prescription et la consommation de médicaments, et sur son impact économique. Pouvez-vous nous donner des éléments à ce propos ?
Les gains attendus, possibles ou réels, pouvant ou non être imputés au DMP, ont fait l'objet de nombreux débats. Pour moi, peu importe si cela est dû au DMP, ce qui compte, c'est qu'il y ait un effet réel. Il est assez difficile en la matière de passer du micro ou macro-économique. Les études internationales montrent un effet réel avec une diminution de la dépense en médicaments liée au partage des informations.
En Andalousie, où la population représente environ 10 % de la population française et le nombre de professionnels de santé également 10 % des professionnels français, on a conditionné la délivrance du médicament par le pharmacien à la consultation du DMP, à la vérification de l'absence de iatrogénie et au respect d'un certain nombre de règles de bonnes pratiques, en particulier en matière de délivrance des génériques. Je ne dispose pas ici des éléments précis sur les résultats et sur les mécanismes et je vous les transmettrai ultérieurement, mais je puis vous dire que cela a effectivement débouché sur des baisses très importantes des coûts.
Cette expérience n'est toutefois pas directement transposable chez nous puisque le législateur français n'a pas prévu que le DMP puisse être un élément de contrainte de la délivrance par le pharmacien.
On constate à travers l'expérience menée sur le DP dans six départements, que dès qu'une interaction peut déboucher sur l'absence de délivrance, cela a un impact sur le chiffre d'affaires de l'officine, les économies s'effectuant sur la base des dépenses payées aux pharmaciens. La profession considère légitimement que l'effet sanitaire vertueux a pour elle des conséquences économiques dont il conviendrait de tenir compte, par exemple par une augmentation du taux de marge. De tels effets induits pourraient limiter les impacts effectifs du DMP comme du DP.
L'étude que nous avons réalisée évalue les gains de productivité liés au DMP, une fois qu'il sera monté en charge, à un milliard d'euros par an en effets directs et à un milliard d'euros également en effets indirects. Ces estimations ont suscité une certaine incrédulité. Pourtant, dans le monde industriel, qui est plus avancé dans l'utilisation des technologies de l'information pour réaliser des gains de productivité, un gain d'un pour cent est le minimum que l'on peut escompter d'une telle opération. Ici, il s'agit d'un projet qui a vocation à améliorer l'ensemble des systèmes d'information de santé ; aussi, si on le rapporte à l'ONDAM – objectif national des dépenses de l'assurance maladie –, un gain de productivité de un pour cent représenterait bien plus d'un milliard d'euros. La société qui a réalisé l'étude considère même que notre estimation est plutôt minorée car on est très loin d'avoir réalisé tous les gains de productivité possibles dans le monde de la santé…
Certains financeurs publics ont par ailleurs fait valoir qu'il s'agissait de gains de productivité et non d'économies. Il faut toutefois prendre en considération que l'on est sur une courbe de dépenses croissante et que, simplement en abaissant la pente de la courbe, les gains de productivité seront immédiatement traduits en économies. Cela ne signifie pas que les dépenses vont baisser mais qu'on va améliorer la productivité, c'est-à-dire la capacité à faire ce que l'on fait à moindre coût. Si ensuite, on décide de faire plus en raison de l'évolution démographique et du progrès technique, cela relève d'un choix politique.
Bien évidemment, ceux des financeurs qui s'opposent au DMP ne peuvent entendre cet argument car ils raisonnent en termes d'annualité budgétaire, alors qu'il faudra un certain nombre d'années pour que cette démarche produise des résultats importants.

Les effets qualitatifs sont sans doute plus difficiles encore à étudier, je suppose que vous avez aussi des objectifs en la matière.
La preuve est déjà faite par le DP. Après quatre ou cinq mois d'expérimentation et alors qu'un peu moins de 200 pharmacies testaient le dispositif, 70 000 dossiers avaient été ouverts et l'on avait recensé 70 alertes graves. Dans la littérature internationale, l'utilité de partager l'information apparaît comme une évidence que nul ne conteste.
Pour que cela soit utile il faut toutefois que cela soit utilisable, c'est-à-dire que l'accès à l'information se fasse à travers le logiciel métier. Le professionnel refuse en effet de perdre du temps à effectuer une démarche en plus de sa démarche professionnelle de prescription ou de délivrance du médicament. Cet aspect psychologique ne me paraît pas suffisamment pris en compte. L'accès Internet doit concerner uniquement le patient tandis que le professionnel doit pouvoir continuer à utiliser son interface utilisateur métier habituelle, par l'intermédiaire du logiciel dont il se sert à longueur de journée. C'est seulement si le DMP s'inscrit dans ce contexte qu'on peut en escompter les effets positifs que tout le monde lui reconnaît.

On ne peut pas fonder la mise en place du DMP sur l'analyse d'objectifs quantitatifs. On a donc bien commis une erreur en le présentant d'abord, en 2004, comme un gage d'économies substantielles. La priorité doit être donnée à l'exigence qualitative, l'augmentation moins forte des dépenses ou les économies suivront. C'est d'ailleurs cette logique qui devrait présider à toute politique de santé.
Alors que l'on est parti de l'idée que le DMP serait une coproduction entre le malade et le professionnel de santé, on a l'impression qu'il se transforme peu à peu en roman-feuilleton dans lequel tout le monde, par exemple la secrétaire médicale, peut ajouter sa petite histoire. Il faut donc revenir à une relation directe entre le patient et celui qui est le mieux à même de l'accompagner, c'est-à-dire le médecin traitant tel qu'il est défini par la loi de 2004. Sans doute conviendrait-il pour cela de commencer par faire simple, en indiquant les informations fondamentales pour une bonne connaissance du patient, avant d'en venir à des choses plus compliquées et à l'intervention d'autres personnes dans le dossier. Évitons une confusion peu propice à la mise en place rapide du DMP !

Merci, Monsieur Sauret, de nous avoir permis de visiter à nouveau ce sujet, après le rapport de la mission d'information présidée par M. Jean-Pierre Door. On le sait, la pédagogie est dans la répétition.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a ensuite procédé à l'audition de M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue au sein de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Notre réflexion porte actuellement sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments. C'est bien entendu sur le troisième thème que nos questions se concentreront. La Cour des comptes a formulé des remarques sur le caractère instable et quelque peu illisible de la fiscalité afférente au médicament, ainsi que sur la spécificité des taxes qui concernent ce secteur.
Quels sont les produits générés par les taxes sur le médicament ? Une relance de l'activité du comité stratégique des industries de santé (CSIS) est-elle envisagée ? Les remarques de la Cour vous amèneront-elles à repenser la fiscalité du médicament, en prenant en compte non seulement le volet sanitaire, mais aussi le volet industriel, avec les questions de recherche et de développement et d'attractivité du territoire qui lui sont liées ?
Dans la nouvelle architecture gouvernementale, je suis responsable de l'équilibre des finances publiques, donc de celui des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. Mon ministère s'intéresse au médicament sous deux angles : son impact sur les comptes de l'assurance maladie d'une part, la fiscalité qui lui est attachée d'autre part.
Le déficit prévisionnel de l'assurance maladie pour 2008 s'élève à 4,2 milliards d'euros, avec une augmentation de 2 milliards d'euros par an. Le non-respect de l'ONDAM est l'un des principaux aléas susceptibles de nous empêcher d'atteindre nos engagements en matière de finances publiques. Or le médicament contribue fortement au rythme élevé de croissance des dépenses d'assurance maladie. Entre 1995 et 2005, les dépenses de médicaments remboursables ont augmenté de plus de 5 % par an. L'année 2006 a constitué une sorte de palier, avec moins de 1 % de hausse, mais 2007 a été marquée par un redémarrage important, l'augmentation s'établissant à 3,6 %. Le dépassement de l'ONDAM pour 2007 est largement lié à ces dépenses de médicaments : l'écart entre le sous-objectif prévisionnel « produits de santé » et le chiffre réalisé est estimé à environ 2 milliards d'euros.
Cette situation s'explique par des phénomènes communs à tous les pays, comme la déformation du marché vers des médicaments de spécialité particulièrement onéreux – notamment les anticancéreux –, mais elle tient aussi aux caractéristiques du secteur du médicament en France : des prescriptions et une consommation excessives, la tendance des médecins français à prescrire en priorité des médicaments récents et coûteux sans que cela soit toujours justifié sur le plan médical, et enfin des coûts de distribution très élevés.
La politique menée ces dernières années a permis de ralentir l'accroissement des dépenses dans ce secteur. Le plan Médicaments, notamment, a généré 2,2 milliards d'euros d'économies. Ses effets sont cependant terminés et les dépenses repartent à la hausse. La politique du médicament est du ressort du ministère de la santé mais nous sommes étroitement associés à ses efforts pour maîtriser les prix des médicaments innovants et pour améliorer la qualité des prescriptions par une meilleure information des médecins et en contrôlant mieux les prescripteurs abusifs, comme les lois de financement de la sécurité sociale en donnent désormais la possibilité.
La fiscalité du médicament est très critiquée par l'industrie pharmaceutique, qui en dénonce régulièrement la lourdeur, la complexité et l'instabilité.
Pour ce qui est de l'attractivité du territoire pour les entreprises de ce secteur, on notera que la fiscalité n'est pas déterminante. Cela dit, il existe de réels problèmes et des possibilités d'amélioration. Nous sommes tous attachés au développement de l'industrie pharmaceutique en France, tant ce secteur est porteur de croissance et de progrès. Il nous faut donc donner plus de visibilité sur l'évolution de la fiscalité. Il n'est pas sain de faire varier tous les ans les taux de certaines taxes ou de créer des contributions « exceptionnelles » que l'on reconduit souvent d'année en année. Les règles doivent être clarifiées de manière à ce que les entreprises n'aient pas de doutes sur leur bonne application et ne recourent pas systématiquement au contentieux.
Nous avons commencé à traiter ces questions dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Il faut maintenant aller plus loin. Je suis prêt à répondre à vos questions sur ce sujet.

Les représentants de l'industrie pharmaceutique ont en effet souligné l'opacité de la fiscalité du médicament lors d'une audition devant la MECSS en décembre dernier. Ils appellent de leurs voeux une fiscalité structurante et souhaitent que l'on mette fin aux taxes imprévues, qu'ils ne peuvent budgétiser pour l'année suivante. Le « taux K » qui correspond à la clause de sauvegarde semble faire partie de ces taxes imprévues. Or, si l'on en croit la communication remise par la Cour des comptes à la MECSS au mois de mai 2007, le rendement de cette taxe est nul. Quel est votre commentaire sur ce point, monsieur le ministre ?
Si le taux K ne rapporte rien, c'est qu'il est fait pour cela : il s'agit d'une mesure dissuasive en vertu de laquelle, au-delà d'une certaine augmentation du chiffre d'affaires, une taxe s'applique. Ce taux, qui a d'ailleurs été élargi dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, ne s'applique pas car il existe des conventions signées entre chaque laboratoire et le Comité économique des produits de santé – CEPS –, au sein duquel est représentée l'assurance maladie, pour fixer à l'avance, de façon fine, l'augmentation du volume de vente des médicaments. Le taux K n'est utilisé qu'en l'absence de convention. C'est une sorte de filet de sécurité, destiné à obliger les industriels à se mettre autour de la table.

Vous avez dénoncé à juste titre la surprescription médicamenteuse en France, monsieur le ministre, mais vous incluez dans ce phénomène la prescription de molécules destinées à la prise en charge de pathologies très lourdes. N'est-ce pas faire fausse route ? Autant je conviens que la prescription de « poudres de perlimpinpin » est excessive – et c'est plus l'éducation du patient qu'il convient alors d'améliorer, en montrant que l'exigence diagnostique et thérapeutique ne se traduit pas forcément par des ordonnances bien remplies –, autant je sais, de par mon expérience personnelle, qu'aucun médecin ne se mettra à prescrire à tort et à travers des antimitotiques ou d'autres molécules entrant dans des traitements très lourds. Au demeurant, ces prescriptions font l'objet de protocoles très rigoureux.

Je crois que Mme Bachelot, que nous entendrons tout à l'heure, sera plus à même de vous répondre, ma chère collègue.

La Haute Autorité de santé – HAS – et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – AFSSAPS – sont chargées de collecter certaines taxes. La HAS est même financée à 90 % par ces revenus. Ces instances, qui surveillent les conditions de mise sur le marché des médicaments, sont les garantes de la santé de nos concitoyens. Le fait qu'elles tirent une part importante de leur financement de l'industrie du médicament ne risque-t-il pas de jeter parfois un doute sur la transparence du dispositif, sachant par exemple que des médicaments contournant les génériques sont mis sur le marché ? Ne serait-il pas préférable que la collecte de ces taxes soit assurée pas l'administration fiscale, l'ACOSS ou les URSSAF ?
Contrairement à la Cour des comptes, je ne suis pas choqué par le système actuel. Il s'agit en effet de taxes affectées, nullement de subventions. Les verser par un autre canal ne changerait rien : la procédure est de toute façon transparente et je ne crois pas qu'elle puisse réduire en quelque façon que ce soit l'autonomie de ces organismes par rapport aux industriels du médicament. En revanche, l'existence d'un florilège de taxe est en effet un problème.

À ce sujet, monsieur le ministre, je me rappelle que le Gouvernement, sous la législature précédente, s'était engagé sur un pacte de stabilité, lequel n'a guère été respecté. Avez-vous des solutions concrètes pour répondre à ces problèmes ? Plus précisément, qu'en est-il de la relance du Comité stratégique des industries de santé ?
Personne ne peut être favorable à la multiplicité des taxes – onze actuellement – auxquelles est soumise l'industrie du médicament. Il faut cependant savoir que l'essentiel du produit est issu de deux d'entre elles : la taxe sur le chiffre d'affaires et la taxe sur la promotion, qui porte principalement sur la masse salariale des délégués médicaux.

Le récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l'information des médecins sur les médicaments propose de renforcer cette taxe sur la promotion, dans la mesure où le dispositif qu'elle vise est susceptible d'inciter à la consommation pharmaceutique. Que pensez-vous de cette recommandation ?
Le travail de simplification ne saurait se faire sans préserver la ressource. De plus, la stabilisation des règles devrait s'accompagner d'une meilleure acceptation, de la part des industries du médicament, de leurs rapports complexes avec les instances publiques qui sont aussi les payeurs.
S'agissant des dépenses de promotion, l'enjeu est assurément de limiter les visites médicales, qui poussent beaucoup à la prescription et à la consommation. Ces visites sont encadrées par une charte qu'il convient sans doute de renforcer. L'augmentation de la taxe peut aussi être envisagée.
Depuis le début de 2007, les prescriptions recommencent à augmenter fortement. Le système de promotion fait que le médecin a souvent tendance à prescrire un médicament nouveau, mais dont l'apport n'est pas évident, plutôt qu'un produit générique. Il y a donc là une vraie question.

Vos services sont-ils à même de mesurer les effets que l'augmentation de cette taxe aurait sur la visite médicale et sur la prescription ?
À ma connaissance, non. Les choses ne sont d'ailleurs pas simples : la visite médicale est aussi un secteur d'emploi important. La taxe est certainement un outil pour limiter la promotion du médicament, mais ce n'est pas le seul. Nous préférons les systèmes conventionnels, tel celui dans lequel s'inscrit la charte de la visite médicale, que nous nous emploierons à privilégier.
Quant à la taxe sur le chiffre d'affaires, qui s'applique de façon indifférenciée à une donnée brute, elle ne permet pas un pilotage politique fin. Sans doute faudra-t-il inventer une modification du dispositif : je n'y suis pas opposé dès lors que l'on protège aussi la ressource.
Le Premier ministre réunira à nouveau le comité stratégique des industries de santé fin avril ou début mai afin de relancer son action. Les priorités qui lui seront indiquées sont l'indépendance sanitaire, les infrastructures propices au développement des activités de recherche et de production de médicaments sur notre territoire, ainsi que la recherche et l'innovation.
Sur ce dernier point, il faut noter que le crédit d'impôt recherche est presque taillé sur mesure pour l'industrie du médicament, qui en bénéficiera à hauteur de 500 ou 600 millions d'euros dans le dispositif mis en place à partir du 1er janvier 2008, contre 100 millions environ dans le dispositif précédent.

On met sur le marché de nouveaux médicaments dont on sait que le service médical rendu est infime par rapport aux médicaments existants, mais dont on sait aussi qu'ils vont accroître le déficit de la sécurité sociale. Pourquoi, dans ces conditions, leur délivrer une autorisation de mise sur le marché alors que l'on pourrait tarir le déficit à la source ?
Je ne peux en effet me prononcer sur le service médical rendu. Plusieurs organismes examinent de près la question. Nous rencontrons régulièrement le CEPS et la HAS pour faire en sorte que les prix soient adaptés.

On a beaucoup parlé de la visite médicale, mais il faudra aussi que l'on se penche un jour de façon sérieuse sur la formation médicale continue, qui est au coeur du sujet.
S'il s'agit en effet d'un problème culturel, il n'est pas sans effets sur le plan comptable. On ne saurait trop insister sur l'importance de mécanismes de régulation. Pour nous, plus ils s'inscriront dans un cadre contractuel stabilisé dans le temps, meilleurs ils seront. Des efforts restent néanmoins à accomplir, tant du côté de l'État que de celui des industries pharmaceutiques.

L'assiette de la taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques est déterminée sur la base des déclarations des industriels. Ne serait-il pas opportun de contrôler ces déclarations ? Aujourd'hui, cela n'est apparemment pas fait.
Les industriels se plaignent plutôt d'être trop contrôlés !

Ils se sont plaints en effet, lorsque nous les avons entendus, d'être maltraités pas le fisc. Des comparaisons ont-elles été menées au niveau européen ?
Pas vraiment. Le système économique du médicament doit être rendu plus transparent pour que l'on puisse y voir plus clair. Beaucoup d'éléments, comme les remises, ne sont pas très lisibles.
D'une manière générale, je n'ai pas le sentiment que les prélèvements obligatoires aient atteint un niveau insupportable pour cette industrie. En revanche, la fiscalité ne permet pas suffisamment le pilotage et les modifications brutales des règles pour remédier dans l'urgence aux dérapages sont mal supportées par les industriels, qui se voient soudainement réclamer des dizaines, voire des centaines de millions d'euros supplémentaires. Nous préférerions trouver avec eux des mécanismes de régulation forts, là où, aujourd'hui, ils ont tendance à contester la plupart des décisions sur la forme et à créer beaucoup de contentieux, ce qui est une source de crispations et de malentendus avec les organismes sociaux ou l'État.
Nous souhaitons naturellement leur développement, mais ils doivent reconnaître dans le même temps que c'est bien le système public français qui rembourse 20 milliards d'euros de consommation médicamenteuse en ville.

Comme l'a suggéré Mme la rapporteure, il serait intéressant de mener une comparaison au niveau européen sur la fiscalité du médicament.
Vous évoquiez, monsieur le ministre, la nécessité d'affiner la taxe sur le chiffre d'affaires. Je note que plusieurs nations anglo-saxonnes modulent leurs taxes en fonction de l'importance du secteur recherche et développement et de l'implantation de sites industriels. Votre ministère examine-t-il une telle orientation ?
Il n'existe pas, à ma connaissance, d'étude comparative de la fiscalité. Au demeurant, une telle étude sera difficile à réaliser tant les politiques d'État sont différentes : la fixation du prix n'est pas la même dans tous les pays, il peut exister des mécanismes de régulation des prescriptions, des mécanismes de régulation des marges, etc., les circuits de distribution ne sont pas les mêmes, non plus que les dispositifs de remboursement… Il faudra donc prendre en compte une multitude de critères, qui de surcroît n'apparaissent pas tous au grand jour.
Je m'en tiens pour l'instant à des idées simples : nous consommons beaucoup, nous remboursons beaucoup, des médicaments innovants existent sur le marché. Il est prouvé que les systèmes de régulation peuvent donner des résultats mais ils doivent s'inscrire dans une plus grande concertation avec l'industrie pharmaceutique si l'on veut éviter les à-coups en cours d'année.

Vous souhaitez donc réviser la fiscalité actuelle, dont on peut imaginer qu'elle a également peu d'impact sur la localisation des laboratoires. Quel sera le calendrier ?
Un calendrier plutôt bref. Les discussions sont en cours pour les deux taxes principales. Nous devrions être prêts pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, en veillant à rester en cohérence avec la révision générale des prélèvements obligatoires.

Votre ministère mène-t-il une réflexion spécifique sur deux secteurs stratégiques dans la compétition mondiale, celui des génériques et celui des biotechnologies ?
Le sujet est plutôt du ressort du ministère de l'économie.
En ce qui concerne la consommation, si les génériques sont entrés dans les moeurs, il reste beaucoup de progrès à faire pour aller jusqu'au bout de la démarche. On ne peut laisser passer des médicaments qui ressemblent à des génériques mais qui n'en sont pas. Le système demeure un peu ambigu.

Lors que nous avons auditionné les représentants des laboratoires spécialisés dans les génériques, ils ont souligné la relative fragilité économique de leurs entreprises : contrairement à leurs concurrents, ils ne peuvent se « rattraper » sur des médicaments nouveaux. Il serait paradoxal que la puissance publique ne se préoccupe pas de cette vulnérabilité au moment même où elle souhaite développer la production et l'usage des génériques.
Je partage votre analyse sur la fragilité de ces laboratoires, même si des entreprises plus importantes fabriquent à la fois des génériques et des non-génériques.
De plus, pour être incitatifs, les taux de remise consentis aux pharmaciens sont aussi élevés que sur les autres médicaments. Il existe donc un problème de composition de la marge pour les génériqueurs.
Pour le reste, je constate une progression satisfaisante de l'usage du générique, même si nous restons derrière la plupart de nos voisins.

Les génériques représentent un marché mondial gigantesque. Si l'on ne réfléchit pas aux moyens de renforcer les entreprises implantées en France, la production, puis la conception, se verront transférées dans des pays tiers.
Le diagnostic est juste.

Le LEEM, lors de son audition, a soutenu que le débat sur la visite médicale était un débat du passé et que la question était bien plutôt de savoir comment conserver sur le territoire la recherche et le développement, voire la production, de nos industries pharmaceutiques. Quel est votre avis sur le sujet ?
C'est un discours que l'on entend souvent dans la bouche des industriels. Fort heureusement, nous pouvons garder une industrie pharmaceutique sur notre territoire : le marché intérieur est très important et nous offrons des formations et des compétences adaptées. Les propos des industriels me semblent surtout dictés par la peur que le marché français ne se réduise, mais nous sommes en présence d'une industrie exportatrice. De plus, nous voulons tout au plus réduire l'augmentation du marché français.
Il faut également insister sur le caractère extrêmement incitatif des dispositifs de crédit d'impôt recherche votés cet automne. En la matière, nous sommes plus compétitifs que de nombreux pays voisins. Je ne crois vraiment pas qu'il existe un problème d'attractivité. Des laboratoires étrangers viennent s'implanter en France, y maintiennent et y développent des usines, parfois dans des territoires qui ne sont pas les mieux desservis par les infrastructures de transport.
L'industrie pharmaceutique en France connaît un développement que la régulation de la visite médicale ne saurait mettre en péril. Elle a en revanche intérêt à accepter les mécanismes de régulation car, si nous continuons à connaître des déficits de cette ampleur, les ajustements seront de plus en plus brutaux. Mieux vaut piloter ensemble un système offrant durablement des soins de meilleure qualité pour un meilleur coût. C'est vers cette culture que l'on doit se diriger, en cessant de se jeter à la tête des anathèmes ou des menaces de délocalisation. Le consommateur de médicament est privé, mais le remboursement est public.

Dans les décennies à venir, les pouvoirs de l'Agence européenne du médicament en matière d'autorisations de mise sur le marché vont s'accroître. Peut-on évaluer le manque à gagner que cela représentera pour l'AFSSAPS ?
Les taxes qui s'appliquent lors de la mise sur le marché ne représentent pas un montant considérable. La taxation principale concerne la production. Je vous donnerai toutefois les chiffres exacts pour 2007.

Vous avez appuyé à plusieurs reprises votre argumentation sur le fait que la prescription et la consommation sont excessives dans notre pays. Deux mesures ont été prises pour tenter de les réguler dans les articles 43 et 44 la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 : les contrats d'engagements individuels des médecins et l'évolution des modes de rémunération des professionnels de santé. Où en est-on dans l'élaboration des textes d'application que nécessitent ces articles ?
Il s'agit de bons outils, fondés sur la contractualisation et qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines. Les décrets d'application ne sont pas encore signés. Un contrat individualisé type sera proposé à la fin du premier trimestre. Mme Bachelot pourra certainement vous en dire plus.
On peut également imaginer des expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération. Beaucoup de jeunes médecins, me semble-t-il, y sont prêts.

Je reviens sur un autre type de promotion, celle qui concerne les médicaments en vente libre.
Ne conviendrait-il pas, dans un souci de santé publique, de taxer bien plus fortement la promotion télévisuelle ou médiatique qui banalise auprès du grand public des médicaments qui, s'ils ne sont pas ou plus remboursés, n'en restent pas moins des médicaments et présentent des risques d'interaction parfois importants ?
Il s'agit généralement de médicaments à faible service médical rendu.
L'automédication, qui est une source d'économies non négligeables pour la sécurité sociale, semble bien fonctionner dans d'autres pays.
Les publicités dont vous parlez poussent à la consommation, mais en dehors de la sphère du remboursement. On notera que d'autres publicités appellent à ne pas consommer, notamment les antibiotiques.
Je conclurai en rappelant que la régulation comporte également la sanction. L'assurance maladie, qui dispose aujourd'hui des moyens de sanctionner les surprescriptions, ne doit pas hésiter à relever les excès, même si ceux-ci ne concernent qu'une infime minorité, et à mettre sous entente préalable des médecins qui abuseraient de certaines prescriptions. Il existe en outre des logiciels qui permettent, sans porter atteinte à l'exercice individuel, d'orienter les prescriptions.

Monsieur le ministre, nous vous remercions de vous être prêté à cet exercice. Si vous disposez d'éléments de réflexion sur la façon dont le législateur pourrait participer à la rationalisation de la dépense publique dans ce domaine, nous vous saurions gré de nous les communiquer.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a enfin procédé à l'audition de Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale pour cette audition qui s'inscrit dans le travail qu'effectue notre mission sur la prescription, la consommation et la fiscalité du médicament. Je donne, sans plus tarder, la parole à notre rapporteure.

Même si l'industrie pharmaceutique dit parfois le contraire, les Français sont de gros consommateurs de médicaments par rapport à leurs voisins européens. Or, on sait que la visite médicale est une des raisons de cette hyperconsommation. Quels moyens avez-vous de réduire la visite médicale, tout en continuant à répondre au besoin d'information sur les innovations thérapeutiques ? En d'autres termes, comment faire que la visite médicale soit une source d'information et non de promotion ?
Il y a effectivement un problème de surconsommation de médicaments dans notre pays : 90 % des visites chez le médecin en France se terminent par une prescription alors que le taux est bien moindre dans d'autres pays.
Les actions de maîtrise médicalisée ont été renforcées au travers de nombreuses mesures que j'ai portées et qui ont été adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment la mise sous entente préalable pour les gros prescripteurs. Il faut concilier la maîtrise médicalisée avec le principe, auquel nous sommes très attachés, de l'accès généralisé et équitable de la population à l'ensemble des médicaments.
La visite médicale n'est pas seule responsable de la surconsommation de médicaments. Cette dernière résulte également du fait que nous avons un champ de protection sociale très large et que nous gardons le taux de prise en charge socialisée des dépenses de santé parmi les plus élevés du monde. La France figure parmi les trois pays qui garantissent le taux de couverture socialisée le plus haut. Par ailleurs, la pratique généralisée du tiers payant crée par nature une demande plus importante, comparativement à nos voisins européens. En notre qualité de docteurs en pharmacie, madame la rapporteure, nous avons pu constater les dérives dues à la déresponsabilisation de la demande. Loin de moi l'envie de critiquer ce que je considère comme une avancée sociale, sur laquelle il ne s'agit pas de revenir, mais on peut quand même indiquer que nous payons celle-ci d'une certaine surconsommation.
L'impact direct ou indirect de la consommation des médicaments sur la morbidité et la mortalité doit être évaluée plus finement, en définissant des indicateurs par pathologie, région, mode de prise en charge, stratégies thérapeutiques, etc. pour mieux cibler les traitements. La faiblesse de l'épidémiologie et notamment de la pharmaco-épidémiologie dans notre pays rendent le suivi de ce type d'indicateurs complexe. J'ai souhaité que ce sujet soit identifié comme prioritaire dans le cadre des travaux du comité stratégique des industries de santé (CSIS).
J'ai également souhaité que la Haute Autorité de santé (HAS) soit investie d'une mission médico-économique, dont elle était privée jusque-là. Elle devra ainsi mieux analyser le rapport coût-bénéfices d'une stratégie de traitement.
Cela étant, il n'y a pas que des inconvénients à cette consommation de médicaments. Les résultats d'une étude académique récente du Commonwealth Fund placent la France à la première place de dix-neuf pays industrialisés pour la prise en charge de maladies médicalement curables. Il ne s'agit pas de clamer que nous sommes les meilleurs mais il faut veiller à ce que les mesures de régulation soient compatibles avec ces bons résultats.
Si j'ai fait ce préambule avant de répondre à votre question sur la visite médicale, c'est parce qu'il ne suffit pas de crier haro sur le baudet et de penser que la surconsommation est uniquement liée à celle-ci. Il faut faire, évidemment, des efforts dans ce domaine. La visite médicale pratiquée par les laboratoires pharmaceutiques n'est pas optimale : elle est trop chère, subjective, orientée vers les médicaments nouveaux, et donc, en général, les plus chers. Mais elle a le mérite d'apporter des connaissances aux prescripteurs : données cliniques, pharmacologiques. La visite médicale doit être améliorée. Les industriels du médicament s'y sont d'ailleurs engagés avec la signature de la charte de la visite médicale, en décembre 2004, et la mise en place d'une certification. La politique de « désarmement » prônée par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est une piste à étudier, même si ce désarmement a déjà commencé du fait du déclin de certaines classes « grand public » et par la montée des génériques.
Dans le cadre de la mise en place de la charte, le comité économique des produits de santé (CEPS) a demandé aux laboratoires, en accord avec le LEEM, de diminuer le nombre de contacts avec les visiteurs médicaux pour quatre classes thérapeutiques : les statines, les sartans, les fluoroquinolones et les médicaments de l'asthme. Sur les quatre classes, seules deux – les sartans et les fluoroquinolones – n'ont pas rempli le contrat alors que les deux autres ont vu leur nombre de contact diminuer significativement – autour de 25 %. Pour les deux classes n'ayant pas rempli le contrat, des sanctions de baisse de prix ont été prises.
Cet effort doit être poursuivi en proposant l'élargissement de ce suivi par le CEPS à d'autres classes thérapeutiques. C'est un sujet que je suis d'extrêmement près. Il faut toujours manier la carotte et le bâton.

Est-il envisagé une alternative à la visite médicale des laboratoires afin d'offrir une information objective répondant au double souci de l'équilibre des comptes de l'assurance maladie et du fait qu'une innovation thérapeutique doit être promue en tant que telle en respectant les deux parties ?
La question de l'information des médecins est, effectivement, plus globale que celle de la visite médicale.
L'information des médecins doit d'abord, à mon sens, être assurée par les institutions publiques. Le système existant gagnerait en crédibilité, en efficacité et en « audibilité », si vous me permettez ce néologisme, à être plus cohérent et mieux coordonné et en prévoyant des mesures d'impact des actions d'information.
Les anciens médicaments qui gardent leur place dans la stratégie thérapeutique ne donnent plus lieu à une information promotionnelle. Or, dans certains domaines, ces médicaments restent le meilleur choix. Il faut donc contrebalancer l'information de la visite médicale qui ne porte que sur les nouveaux médicaments.
A côté des informations sur les effets indésirables dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) assure de mieux en mieux la diffusion, il est nécessaire d'informer et de former les prescripteurs sur la meilleure façon de gérer les risques médicamenteux.
Les efforts réalisés par les caisses d'assurance maladie – entretiens confraternels et délégués de l'assurance maladie, DAM – semblent utiles mais le double rôle de contrôleur et d'informateur peut paraître difficile à comprendre par certains prescripteurs. La visite médicale publique ne pouvant rivaliser en puissance avec la force de vente des laboratoires, elle doit être centrée sur des problèmes de santé publique particuliers et coordonnée avec la politique de santé publique.
Les informations de l'AFSSAPS concernent les médicaments alors que la Haute Autorité de santé s'adresse plus généralement à la prise en charge thérapeutique des patients, l'usage du médicament en étant un élément. Une étroite coordination doit se mettre en place entre les deux organismes, les champs d'intervention de ces deux émetteurs étant distincts et complémentaires.
L'ensemble des recommandations devrait figurer sur les sites des deux autorités de santé, in extenso ou sous la forme de liens bien identifiés. Un effort de lisibilité doit être fait et sera fait sur les sites Internet de l'AFSSAPS, et plus encore sur celui de la Haute Autorité de santé, afin de faciliter l'accès à l'information pour les professionnels de santé et le grand public.
Pour l'avenir, une réflexion est à mener pour mieux articuler les différents intervenants actuels – AFSSAPS, HAS, CNAMTS –, réflexion qui pourrait s'enrichir de l'expertise acquise par les associations de malades et les usagers du système de santé et des actions de communication menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) en direction de divers publics sur les enjeux de santé.
Pour ce qui concerne les données scientifiques et administratives, ces informations sont disponibles sur le site Internet de l'AFSSAPS. Cette agence construit une banque, déjà bien avancée, de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux.
La Haute Autorité de santé construit, quand à elle, une base de données indexée comportant les avis de transparence. En complément pour ce qui concerne la prise en charge, le site Internet de l'assurance maladie met à disposition les données sur les taux de remboursement selon les types de médicaments. Il serait souhaitable que les trois bases, AFSSAPS, HAS et assurance maladie, soient reliées entre elles dès qu'elles seront finalisées.
La Cour des comptes reconnaît que, si la base Thesorimed – ex base Thériaque – permet une mise à disposition gratuite de l'information, elle est difficilement compatible avec les logiciels d'aide à la prescription (LAP). En revanche, les bases de données privées sont payantes, mais elles sont facilement intégrables avec ces logiciels. Dans ce contexte, il conviendrait de conduire une réflexion en vue de développer une base de données publique unique, accessible à tous gratuitement pour répondre aux besoins de chacun des acteurs du système de santé : médecins, pharmaciens, établissements de santé, ministères, etc. Quand nous aurons bâti ce système, la visite médicale prendra toute sa place mais rien que sa place.
Il faut compter à peu près deux ans. Si l'on pouvait en disposer pour la fin de 2009, ce serait bien.

Vous avez souligné les interrogations des professionnels de la santé vis-à-vis des délégués de l'assurance maladie. Cette dernière s'immisce de plus en plus – et de manière heureuse – dans la politique de santé. Ne devons-nous pas, à partir de ce constat, avoir une réflexion plus globale sur l'avenir de la politique de santé ?
Pourriez-vous préciser votre question, madame Génisson ?
Porte-t-elle sur l'avenir de la politique de santé – ce qui déborde un peu du cadre de l'audition d'aujourd'hui – ou sur le rôle de la CNAMTS dans les procédures d'admission au remboursement et de validation ?

Je vous concède, madame la ministre, que ma question déborde un peu le cadre de l'audition de ce matin. J'avais une petite arrière-pensée en la posant dans la mesure où nous venons de prendre connaissance du rapport de la mission d'information, présidée par M. Yves Bur, sur les agences régionales de santé (ARS). Celui-ci contient une série de propositions qui m'ont fait penser qu'en parlant des délégués de l'assurance maladie, le cercle vertueux serait constitué…
J'ai eu l'occasion de venir devant cette mission pour décrire l'architecture que j'entends proposer à partir des agences régionales de santé et que le Parlement examinera lors de la grande loi sur la modernisation de l'organisation de la santé, aussi bien pour les soins de premier recours que pour la gouvernance de l'hôpital. Je souhaite que les agences régionales de santé aient un périmètre le plus large possible avec le médicosocial et le système de santé publique. Il est bien évident que, dans le cadre du rôle de territorialisation des politiques de santé publique assurés par les ARS, la bonne utilisation du médicament sera un élément important.
Votre question m'amène à parler du rôle de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La Cour des comptes considère que la caisse nationale d'assurance maladie devrait avoir plus de place dans la procédure d'admission au remboursement. Même si je salue le rôle de la CNAMTS, je trouve que la vision de la Cour des comptes est un peu idyllique et je vais donc vous donner mon sentiment à ce sujet.

La vision de la Cour des comptes non seulement est idyllique mais encore pose des problèmes de fond.
Je vous remercie de le faire remarquer.
Ce que je constate, c'est que les résultats des actions de maîtrise médicalisée de la CNAMTS sont mitigés – pour employer un terme diplomatique. Sur la base des données du Groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques (GERS) et des données de remboursements du régime général, les économies dues à la maîtrise médicalisée en 2006 – les derniers chiffres à notre disposition – sont évaluées à environ 460 millions d'euros, ce qui correspond à un taux d'atteinte des objectifs initiaux de l'ordre de 58 %. Il n'y a pas de quoi s'esbaudir !
Depuis plusieurs années, les caisses d'assurance maladie cherchent un rôle plus actif dans la gestion des soins. On pense, par exemple, au plan stratégique proposé en 1999 par M. Gilles Johannet.

Cela nous permet de prendre un peu de distance par rapport à l'histoire de notre système sanitaire !
Le rôle théorique d'un « assureur » – terme que la caisse nationale d'assurance maladie utilise volontiers à son profit – impliquerait la possibilité de sélection des patients en fonction du risque, voire celle de modifier le niveau des primes d'assurance ou de déterminer le contenu des biens et des services pris en charge. Aucun de ces éléments n'est réalisable ni surtout souhaitable – pour répondre directement à la question de Mme Génisson – pour les caisses d'assurance maladie en France. Il y a une confusion sémantique qui relève d'une confusion conceptuelle.
Les caisses interviennent actuellement dans le processus de remboursement et de fixation des prix en étant représentées auprès de la Commission de la transparence et au sein du Comité économique des produits de santé (CEPS). Elles ne sont donc pas exclues de la réflexion sur ce sujet. Elles y participent à leur place. Elles interviennent également dans le bon usage du médicament à travers des actions influençant la pratique de prescription des praticiens. Le conventionnement des médecins et l'application des accords de bon usage (ACBUS), l'information par des moyens comme les lettres aux médecins, les entretiens confraternels et les délégués de l'assurance maladie (DAM) en constituent des exemples.
Je le répète de façon solennelle, en France, c'est à l'État de garantir la santé de la population en assurant l'équité d'accès aux soins et en tenant compte de l'efficience. Il n'est donc pas envisageable que les caisses puissent s'affirmer davantage dans le rôle d'assureur dans ces domaines.
L'image de la CNAMTS bon gestionnaire des deniers collectifs, bon père de famille avisé est un peu idyllique. Certaines actions ont porté leurs fruits, mais les effets globaux sont insuffisants, en tout cas pas meilleurs que ceux assurés par d'autres acteurs.
Je ne propose pas un remplacement mais, plus exactement, une meilleure coordination avec la politique du Gouvernement, notamment en mettant à disposition les bases de données et en contribuant à rendre cette politique plus efficiente. Les objectifs sont partagés. Pour moi, une querelle de chapelle serait contre-productive.
Je crois que nous avons, madame Génisson, des philosophies très proches sur ce sujet.

Du fait de la grande consommation de médicaments par les Français, le médicament prend un part non négligeable dans le déficit de l'assurance maladie. Parmi les mesures prises récemment, la franchise médicale a été abordée avec plusieurs de nos interlocuteurs au cours de nos auditions. Aucun n'a soutenu ce dispositif et plusieurs ont tiré à boulets rouges dessus. Avez-vous déjà quelques éléments d'information sur la mise en place de cette mesure et, notamment sur son impact ?
Permettez-moi de rappeler plusieurs points concernant les franchises.
Elles ont été créées pour permettre le financement de nouveaux besoins de santé : maladie d'Alzheimer, cancer, soins palliatifs. J'ai donné, devant la représentation nationale les chiffres très précis et je rendrai compte de l'utilisation de ces sommes. Elles gardent un niveau de prise en charge socialisée des dépenses de santé parmi les plus élevées du monde. Celle-ci reste, même avec les franchises, à près de 80 %, ce qui est considérable. Il faut garder cela à l'esprit.
Un Français sur quatre ne paie pas la franchise : les bénéficiaires de la CMUC, les femmes enceintes et les enfants. Par ailleurs, la franchise est plafonnée à 50 euros. Elle représente donc une dépense de 4 euros par mois en moyenne.
Il est vrai que c'est un effort pour certaines personnes. En cas de très grandes difficultés, j'ai indiqué les mécanismes qui permettaient de faire appel au fonds dédié de l'assurance maladie, sur lequel une somme de 224 millions d'euros a été provisionnée pour 2008. Elle permet de financer aussi bien des actions collectives – pour 30 millions d'euros – d'associations qui s'occupent de personnes particulièrement précaires que des dossiers individuels qui peuvent être présentés soit directement par les personnes, soit par des associations ou des systèmes sociaux, comme les centres communaux d'action sociale.
J'ai choisi, pour supporter la franchise, les secteurs qui, dans notre système de santé, sont, non pas les plus dérapants, mais les plus dérivants par rapport à d'autres pays ayant des performances identiques et même supérieures à celles de la France. Les médicaments en font partie. Tout le monde reconnaît que la consommation de médicaments par les Français n'est pas en corrélation avec nos performances en matière de morbidité et de mortalité. J'ai donc fait porter sur les médicaments une franchise de 50 centimes par boîte.
Il est encore trop tôt pour faire une évaluation. Pour certaines maladies importantes qui nécessitent des médicaments prescrits en fonction de l'autorité du médecin prescripteur, je n'ai pas pensé que cela diminuerait les prescriptions, même si on peut parfois se poser la question de l'adéquation de celles-ci avec les pathologies qu'elles sont destinées à soigner, même dans le cas des affections de longue durée (ALD). On a vu, pour le traitement de l'hypertension ou du diabète, des délivrances de médicaments parfois erratiques.
Les franchises n'ont été appliquées qu'il y a un mois. Les statistiques ne sont pas encore remontées. Mais, dès que j'aurai des évaluations à ce sujet, je vous les communiquerai.

Je vous remercie, madame la ministre, pour la réponse que vous avez donnée à ma question qui débordait de notre ordre du jour.
Vous avez évoqué la question de l'information et de la formation des médecins. J'aimerais que vous parliez de la formation médicale continue, sujet qui est un peu un serpent de mer. Même si des dispositions ont été prises, elles sont encore trop peu appliquées.
De par l'affectation de leurs recettes, les franchises sont un peu la gabelle moderne. Et il est de la responsabilité de l'État de définir comment sont orientées les priorités à partir des recettes ou des éventuelles économies réalisées.
Il faut examiner les conséquences des franchises médicales sur la santé publique. Empêchent-elles ou non l'accès aux soins primaires, y compris pour les pathologies mineures, pour les personnes dont la moyenne des revenus se situe juste au-dessus de celle donnant droit à l'exonération des franchises ? Les études et analyses doivent être orientés sur ce sujet car on peut craindre des problèmes.
Vous posez le problème de l'accès aux soins pour cette zone grise de personnes qui ont trop de revenus pour être prises en charge par les systèmes socialisés et pas assez pour vivre. Le travailleur pauvre en fait partie mais cela touche aussi d'autres catégories.
Les difficultés d'accès aux soins peuvent résulter de plusieurs facteurs. Le premier est l'éloignement géographique, non seulement dans les zones rurales, mais également dans des quartiers populaires. L'application du ticket modérateur n'est pas vraiment en cause. Mais le problème majeur est les dépassements d'honoraires, qui ne représentent pas loin de 2,5 milliards d'euros, sur 18 milliards d'honoraires. J'ai inscrit comme priorité de mon action de les maîtriser. Certains sont justifiés, en particulier pour garder des praticiens de niveau international dans les CHU. Mais il faut combattre de façon déterminée les dépassements d'honoraires illégaux : les dessous de table et les pratiques condamnables.
Il faut également revisiter la notion d'acte. J'ai pris dans la loi de financement de la sécurité sociale un certain nombre de dispositions et je travaille actuellement à un décret sur le montant qui oblige à présenter un devis.
La question que vous posez, madame Génisson, ouvre le débat du bouclier sanitaire. Le pacte de 1945, dont on parle beaucoup même si ceux qui en parlent ignorent généralement quelles étaient les modalités de prise en charge par la protection sociale en 1945, a introduit le principe : « Chacun paie selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. » La question a été soulevée par des experts et des philosophes de tous les horizons politiques de savoir si, devant la difficulté d'accès aux soins pour cette classe intermédiaire, il ne convenait pas d'instaurer un bouclier sanitaire. J'en appelle à la représentation nationale pour que le débat ait lieu au Parlement.

Le débat est actuellement au sein du Gouvernement. La personne qui vous a précédée dans les auditions de ce matin n'y est pas favorable.

Revenons à l'objet de la mission d'évaluation et de contrôle. Peut-être pouvez-vous dire quelques mots de la formation des médecins, madame la ministre, avant que nous vous posions d'autres questions.
La Cour s'est également intéressée à la formation des médecins.
Le ministère de la santé ne gère pas seul la formation initiale des médecins. Il le fait avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je travaille actuellement avec Mme Valérie Pécresse sur la première année de médecine.
Il faut donner toute sa place à la thématique médicament du fait des enjeux majeurs qu'elle représente tant en termes de santé publique qu'en termes d'économie de la santé.
L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) constitue un levier fort, d'autant que la validation de l'EPP permet une validation d'une partie du barème de la formation médicale continue (FMC).
Les critères médico-économiques ne sauraient être occultés. Il faut sensibiliser, dès leur formation, les futurs médecins à la nécessité d'une prise en charge qui conjuguera qualité et optimisation des coûts, dans le respect de l'information et des attentes du malade. L'étudiant ne peut pas vivre toutes ses études dans un monde éthéré où la question du rapport qualité-coût ne serait jamais évoquée. Ce souci d'efficience ne peut pas être limité aux quelques heures consacrées à l'économie de santé et doit être présent dans l'esprit de chacun, si nous voulons préserver la qualité de notre protection sociale. Nous y travaillons avec nos collègues du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en lien étroit avec la HAS.
A la demande de la direction générale de la santé, a été créé, il y a sept ans, un enseignement de la iatrogénie pour les étudiants en médecine de sixième année – cet enseignement fait l'objet d'un séminaire obligatoire – et en pharmacie. Par ailleurs, la direction générale de la santé a transmis l'an dernier au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur des propositions visant à améliorer la formation des étudiants en médecine et en pharmacie tout au long de leur cursus.
Les réflexions en cours sur le LMD (licence, master, doctorat) devraient notamment porter sur la nécessité de bien prendre en compte la thématique du médicament.
Pour ce qui concerne la formation médicale continue, le dispositif professionnel de FMC sera installé en 2008. L'ensemble des dispositifs doit être très lisible pour les médecins : il faut qu'ils puissent s'approprier ces démarches et qu'elles puissent, en particulier pour l'EPP, faire partie intégrante de leur pratique.
Je ne reviens pas sur la visite médicale et la place de l'industrie pharmaceutique car j'ai déjà longuement répondu sur ces deux points.

Je souhaite revenir sur la question de l'octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM) par l'AFSSAPS. Des médicaments sont autorisés à être mis sur le marché alors qu'ils sont des contournements de génériques, ce qui oblige ensuite les pouvoirs publics, via le CEPS, à revoir les prix à la baisse. S'ils n'avaient pas reçu d'AMM au départ, on aurait évité les effets de contrôles en cascade, qui mettent parfois à mal la politique du générique sur certaines molécules.
Il y a eu, certes, des dérives, mais elles sont tout à fait limitées. M. Noël Renaudin, président du CEPS, qui a été interpellé sur cette affaire, a indiqué qu'un produit et son dérivé commercial, le Mopral et l'Inexium, avaient échappé à son rayon laser mais qu'en fait le contournement de génériques était extrêmement difficile. Les produits peuvent être admis au remboursement mais la simple mise à disposition sous une autre forme galénique, qui pouvait d'ailleurs ne pas être sans intérêt, n'entraîne pas une majoration du prix.

La grève du générique des pharmaciens a quand même eu des répercussions sur les comptes de l'assurance maladie. Ces produits ne sont pas anodins. Ils sont chers.
C'est effectivement un vrai problème, mais il ne faut pas, à partir d'un ou deux exemples malencontreux, qui ont échappé aux radars, et qui ont été rectifiés par la suite, dire que c'est une pratique généralisée.

Ces cas ne posent-ils pas la question de l'attribution de l'AMM en général ? Ne peut-on imaginer d'ajouter aux critères d'attribution celui de progrès thérapeutique ?
C'est la base. Si la molécule est la même, il n'y a pas de raison qu'un laboratoire n'ait pas l'AMM. C'est ensuite au niveau du remboursement qu'il y a des différences. S'il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu, le produit est moins remboursé.
Je vais faire un point sur l'admission au remboursement. La Cour estime, en effet, que le circuit de mise sur le marché et d'admission au remboursement est insuffisamment sélectif. Je veux donc en dire quelques mots.
La commission d'AMM évalue le profil d'efficacité et de sécurité individuel des médicaments. La commission de la transparence doit évaluer l'impact par rapport aux alternatives thérapeutiques disponibles, établir la place dans la stratégie thérapeutique et estimer la population-cible des médicaments. La commission d'AMM a une vision individuelle et la commission de la transparence une vision populationnelle, collective, donc de santé publique.
L'intérêt de santé publique (ISP) est un sous-critère du service médical rendu (SMR). Il évalue l'apport d'un médicament dans une population. C'est donc un critère collectif. Aujourd'hui, l'évaluation du médicament repose sur le service rendu par un médicament à l'individu plus qu'à la collectivité, comme le prouve le nombre de SMR importants attribués.
L'ISP introduit dans l'évaluation la dimension de l'accessibilité aux soins. La politique des études post-AMM découle de l'importance donnée à ce critère. C'est un sujet qui intéresse beaucoup Mme Lemorton qui m'avait interrogée sur les études post-AMM. Les médicaments doivent être réévalués sur la base des résultats des études post-AMM et au vu de l'évaluation de l'ISP réellement rendu. Les conséquences doivent en être tirées en termes de population prise en charge.
Nous réfléchissons à l'opportunité d'une réforme de la transparence, pour mieux définir les critères appréciés par la commission de la transparence afin de conduire à une plus grande sélectivité dans le choix des médicaments remboursés par la collectivité.
Toutefois, il faut être prudent avant de changer à nouveau les textes et de bouleverser les règles du jeu : il est nécessaire que la commission de la transparence se concentre sur son rôle propre, qui est de définir la valeur thérapeutique ajoutée d'un médicament, sans doublonner le travail de la commission d'AMM. Il faut qu'elle ose attribuer un SMR insuffisant si son intérêt ne justifie pas sa prise en charge par la collectivité, sans considérer que cela remet en cause l'AMM.
Il est à signaler que l'avis du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie du 29 juin 2006 indiquait que le système français de fixation des prix du médicament était plutôt efficace. Les principes y sont considérés comme sains et conduisent à des niveaux de prix cohérents. Le rapport de l'Office of Fair Trading sur les prix pharmaceutiques anglais de février 2007 cite à plusieurs reprises le modèle français en exemple – ou plutôt un modèle qui est le modèle français mais sans dire qu'il est français.
La mise en oeuvre d'essais comparatifs est effectivement un sujet fondamental et doit monter en puissance. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes aujourd'hui dans un contexte européen et qu'être les seuls à exiger des essais cliniques supplémentaires pourrait conduire à créer des freins majeurs à l'accès aux innovations dans notre pays. Cette question doit être introduite progressivement, par exemple au moment de la réévaluation du SMR et de l'ASMR des médicaments ayant obtenu un prix élevé. Ce sera un des enjeux de la mission médico-économique confiée à la HAS.
C'est une particularité des Français d'anticiper un certain nombre de réglementations européennes avant même qu'elles ne soient mises en oeuvre, puis, quand elles sont appliquées au niveau européen, de montrer l'Europe du doigt et de s'offusquer de ce que l'Europe nous impose des législations alors que nous les avons inventées nous-mêmes.

S'il y a eu un « bug » dans le système concernant la molécule qui a été citée, cela signifie qu'il y a une faille dans ce système.
Dans tous les systèmes humains, il y a des « bugs » !

Quand on voit les problèmes d'épidémiologie qui existent sur certains traitements, dont l'affaire est actuellement en justice, je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres failles.
Du fait de la pyramide des compétences sanitaires, il est parfois difficile de discerner le contour de celles-ci. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 octroie une compétence médico-économique à la HAS. Quelle est la différence entre la compétence économique de la HAS et celle du CEPS ?
La Cour a relevé un besoin d'analyse médico-économique permettant de rapporter l'efficacité des médicaments à leur coût. Elle a cité, à cet égard, l'exemple de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.
L'une des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 que j'ai portée permet, comme vous l'avez rappelé, à la HAS de compléter son approche des stratégies thérapeutiques par la prise en compte de considérations médico-économiques, lui permettant ainsi de privilégier les parcours de soins les plus efficients.
Cette approche médico-économique est développée avec les homologues britanniques – National Institute of Clinical Excellence (NICE) – et allemand – Institut pour la qualité et l'efficience en santé (IQWIG) – de la HAS, avec lesquels celle-ci développe des contacts réguliers.
Le développement de cette nouvelle approche permettra aux décideurs de bénéficier d'une expertise globale en contribuant à la promotion des stratégies de soins les plus efficaces, à une grande sélectivité dans la prise en charge, à une allocation efficiente des moyens et à une information opérationnelle adaptée aux besoins des médecins.
Les deux premiers champs sur lesquels la médico-économie pourrait intervenir sont, d'une part, la prise en charge médicamenteuse de l'hypertension artérielle, pour laquelle plusieurs types de médicaments sont en concurrence, les plus coûteux devant être réservés aux patients pour lesquels ils apportent véritablement un bénéfice supérieur aux alternatives moins coûteuses et, d'autre part, le traitement de l'obésité sévère des patients atteints de diabète, les traitements médicamenteux ne devant être prescrits qu'en deuxième recours, si les patients ne voient pas leur indice de masse corporelle diminuer après une diète et une activité physique adaptées.
Les prescripteurs, en tant qu'ordonnateurs de soins, doivent également être sensibilisés aux aspects médico-économiques de leurs prescriptions. La diffusion par la HAS de recommandations de bonne pratique et de stratégie thérapeutique prenant en compte les aspects médico-économiques devrait y contribuer. Une autre mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 consiste à intégrer dans les logiciels d'aide à la prescription certifiés par la HAS l'affichage des prix au moment de la prescription. C'est une mini-révolution, car les prescripteurs ne connaissent pas aujourd'hui le prix des médicaments qu'ils prescrivent.
En résumé, et pour répondre à la question, le CEPS négocie les prix. La HAS indique à ses interlocuteurs une stratégie qui intègre la notion médico-économique.

Nous vivons à l'époque d'Internet. C'est un moyen important pour l'information des usagers et à la fois l'information et la formation des professionnels de santé. Cet outil est également à la disposition des laboratoires pour faire la promotion de médicaments. Comment la puissance publique peut-elle garder la maîtrise de ces mécanismes et en assurer la moralisation ? Ne peut-on envisager qu'elle mette en place des contre-feux pour contrebalancer l'information fournie aux consommateurs ?

Sur Internet, se pose également le problème des médicaments contrefaits, qui échappent à tout contrôle sanitaire.
La question d'Internet est évoquée dans bien d'autres enceintes.
Pour ce qui concerne l'information donnée aux médecins, les logiciels d'aide à la prescription sont certifiés par la HAS, et j'engage les médecins à n'utiliser que ceux-ci qui leur donnent une totale garantie.
En ce qui concerne l'information accessible à la population, un groupe de travail a été constitué pour réfléchir sur les contre-feux à appliquer. C'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre. Mais ce n'est pas pour cela que nous ne faisons rien.
Pour ce qui est des contrefaçons et la mise à disposition d'un certain nombre de médicament plus ou moins fiables sur des sites dédiés à certains types de produits qui font florès sur Internet, nous sommes totalement dénués de moyens. Nous ne pouvons faire que de l'information aval, en incitant les personnes à ne pas se procurer ces médicaments sur Internet, certains produits ne respectant ni les présentations galéniques efficientes, ni le dosage en principes actifs. Surtout, comme ce sont des médicaments qui ne sont pas dépourvus d'effets secondaires ni de dangers, ils doivent être prescrits selon les règles de l'art.
Les risques de ces produits sont connus. Ils relèvent donc d'une information grand public dispensée par l'ensemble de la chaîne de l'information : les pouvoirs publics, les ministères et les médecins. Il est impossible d'empêcher la vente de ces produits sur Internet. On ne peut qu'inciter les citoyens à suivre le réseau pharmaceutique et le réseau médical, car ce sont eux qui leur donnent la meilleure information et la meilleure protection. Le médicament n'est pas un produit banal.

L'industrie de la contrefaçon sévissant à l'échelle planétaire, le taux de pénétration de ces produits est très élevé.
Il faut reconnaître, à ce sujet, que grâce à la structuration de son système de santé et de délivrance pharmaceutique, notre pays est protégé, comparé à d'autres pays, notamment aux pays en voie de développement où la contrefaçon est dramatique : on vend sur les marchés de telle ou telle capitale d'Afrique des produits totalement inefficaces et même nocifs.

Où en est l'application des articles 43 et 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 concernant le contrat d'engagements individuel et l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération des médecins ? Des textes restent certainement à produire pour que ces mesures soient effectives et des concertations avec les acteurs du système doivent être engagées pour qu'elles prennent effet.
Je pourrai revenir devant vous pour l'évaluation de ces dispositions à la fin du premier trimestre 2008.
J'ai indiqué aux directeurs des missons régionales de santé que je souhaitais que l'on soit très allant sur ces nouvelles dispositions. J'ai d'ailleurs été très sensible au fait que la Cour des comptes ait salué la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comme ayant pris en compte certaines de ses préconisations, même si je ne partage pas toutes les analyses de la Cour.
J'ai ouvert la voie à de nouveaux modes de rémunération et à de nouvelles dispositions dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Ces innovations doivent être considérées aussi bien par l'assurance maladie que par les médecins et les professionnels de santé comme quelque chose qui ne vient pas combattre la logique conventionnelle, mais s'y ajouter et l'améliorer. Pour des médecins qui souhaitent aller plus loin, en particulier en matière de santé publique, je considère que c'est une opportunité intéressante.
Au cours des états généraux de l'organisation de la santé, j'ai été frappée de voir, dans les discours tenus par les jeunes médecins, à quel point ils étaient réceptifs à ces nouveaux modes de rémunération. Pour prendre en charge du dépistage et des politiques de santé publique, c'est une voie extrêmement prometteuse.