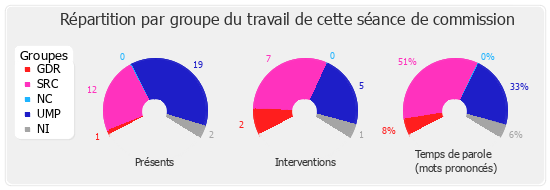Commission des affaires étrangères
Séance du 9 décembre 2009 à 16h00
La séance
Audition de M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l'Afghanistan
La séance est ouverte à seize heures quinze.

Nous avons le plaisir d'accueillir M. le ministre Kouchner, que nous entendrons à nouveau le 22 décembre ; il fera alors devant nous un tour d'horizon de tous les sujets d'actualité. Aujourd'hui, notre séance sera entièrement consacrée à la situation en Afghanistan. Cette réunion d'un genre nouveau se distingue nettement du débat que nous aurons en séance publique, mercredi prochain 16 décembre, et qui se déroulera avec le formalisme habituel, avec les interventions des porte-parole des groupes politiques et des présidents des commissions de la défense et des affaires étrangères.

C'est pourquoi j'ai souhaité, en organisant cette réunion préalable, donner à ceux d'entre vous qui le souhaitent la possibilité d'interroger le ministre ou d'exprimer leur point de vue sur la situation en Afghanistan et l'engagement de notre pays sur ce théâtre.
Après les attentats du 11 septembre, la France a participé, dès 2001, à la fois à l'opération de l'OTAN demandée par l'ONU en novembre 2001 et à l'opération américaine « Liberté immuable », conduite par les Etats-Unis. Les résultats militaires obtenus par la coalition peuvent être qualifiés d'à moitié positifs : le régime talibans s'est effondré en moins d'un trimestre mais ni Ben Laden ni le mollah Omar, qui avaient fui le pays après la prise de Kandahar le 6 décembre 2001, n'ont été capturés. Sans attendre la fin des combats, l'ONU avait préparé la succession politique du régime ainsi défait, dans le cadre de la conférence de Bonn, fin novembre 2001. Réunissant toutes les forces politiques, à l'exception des talibans, cette réunion a débouché sur la rédaction d'une nouvelle Constitution. La conférence de Bonn prévoyait également le déploiement, initialement limité à Kaboul et sa périphérie, d'une force internationale d'assistance à la sécurité, la FIAS, dirigée par l'OTAN. En 2006, celle-ci a étendu son champ de compétence à l'ensemble du territoire afghan et a intégré le commandement de l'opération « Liberté immuable ».
Après les premiers succès vint, suite à l'intervention américano-britannique en Irak en 2003, le temps de l'oubli, puis celui des reculs. En 2004, la victoire électorale de Hamid Karzaï était tempérée par la dégradation inquiétante de la situation du pays. La reprise du trafic de drogue, la multiplication des attentats, le détournement massif des aides ont rompu le consensus initial sur le conflit afghan dans les opinions et dans la sphère politique.
A la suite de l'embuscade d'Uzbin, en août 2008, qui a coûté la vie à dix de nos soldats, le Parlement s'est prononcé, en septembre 2008, en application des nouvelles dispositions de la Constitution, pour la prolongation de la présence de nos troupes sur le terrain afghan.
L'élection de M. Barak Obama a marqué une nouvelle étape avec le transfert de troupes américaines de l'Irak vers l'Afghanistan et la décision, prise il y a quelques jours, d'envoyer 30 000 soldats américains supplémentaires.
La France plaide, depuis l'origine, pour une approche intégrée du conflit afghan, et tous nos alliés conviennent aujourd'hui que la solution n'est pas uniquement militaire. C'est pourquoi notre pays a été si actif lors de la première conférence des donateurs organisée à Paris en 2006. La conférence des donateurs prévue le 28 janvier à Londres s'annonce comme la prochaine étape décisive pour l'avenir de l'Afghanistan.
Voilà, brièvement résumé, l'historique de la situation en Afghanistan depuis neuf ans. Je m'exprimerai sur la situation de ce pays lors du débat en séance publique, la semaine prochaine. Aujourd'hui, je serai contraint de partir avant le ministre, auquel je présente mes excuses, pour participer au débat sur la déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen qui se tient en ce moment dans l'hémicycle. Avant que les orateurs inscrits ne s'expriment, je donne la parole à M. Jean-Paul Lecoq pour un rappel au règlement, puis le ministre répondra à l'ensemble des intervenants. Si le temps le permet, d'autres intervenants non inscrits pourraient interroger le ministre.

Notre groupe s'élève avec vigueur contre la tenue concomitante d'un débat en séance plénière sur un sujet qui nous intéresse au premier chef, et de l'audition du ministre des affaires étrangères par notre Commission. Je n'ai pas souvenir que cette situation inacceptable se soit jamais produite. Devrions-nous être doués d'ubiquité ? Ceux de nos collègues qui sont en séance plénière et qui auraient voulu interroger le ministre ne pourront le faire, cependant que les membres de notre Commission ici présents ne pourront participer au débat relatif au prochain Conseil européen. Un tel épisode doit demeurer une exception.

Votre remarque est parfaitement fondée. Il se trouve que, pour la première fois, le débat relatif au prochain Conseil européen se tient après les questions au Gouvernement ; habituellement ce débat se substitue à la séance de questions et c'est fort de cette expérience que nous avions défini la date et l'heure de l'audition du ministre. Or, je tenais beaucoup à ce qu'un débat sur la situation en Afghanistan ait lieu en Commission, et que nous ne nous limitions pas, sur un sujet d'une telle importance, au débat habituel en séance plénière. L'agenda du ministre étant très chargé, nous avons dû maintenir l'audition à l'heure prévue. Mais nous ferons tout pour qu'un tel télescopage ne se reproduise pas.

J'approuve sans réserve l'observation de M. Lecoq. En matière d'ordre du jour, on frise l'absurdité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous tenons quatre auditions dans la même journée, alors que nous n'en avons tenu aucune hier. Ce fol ordonnancement n'est pas propre à la Commission des affaires étrangères, c'est le fonctionnement actuel de l'Assemblée nationale dans son ensemble qui pêche. Je vous félicite, monsieur le président, d'avoir organisé le débat qui nous réunit, ainsi que l'audition, indispensable, du ministre des affaires étrangères pour un tour d'horizon avant la fin de l'année. Il me semblerait préférable que le ministre réponde à des séries de questions et non à toutes les questions en bloc, ce qui permettrait à ceux d'entre nous qui souhaitent assister, au moins pour partie, au débat qui se déroule dans l'Hémicycle, d'entendre certaines de ses réponses. Cette dispersion est très fâcheuse.
Au mois d'octobre, comme d'autres responsables français, y compris au plus haut niveau, vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à ce que notre pays n'augmente pas l'effectif de ses troupes en Afghanistan, où se trouvent 3 750 soldats et 350 gendarmes français. Tiendrez-vous cet engagement en dépit des demandes de M. Obama ? Le tiendrez-vous encore après la Conférence de Londres ?

La France a, à juste titre, salué le discours du Président Obama et la nouvelle stratégie américaine privilégiant l'approche globale - que nous avons toujours promue - et l'élargissement de l'intervention à d'autres opérations que celles strictement militaires. La Conférence de Londres sera déterminante. Elle suppose des engagements clairs du président Karzaï, qu'il s'agisse de la gouvernance, de la réconciliation nationale, de la lutte contre la corruption ou du statut des femmes. Quelles doivent être les priorités, et quelles seront les exigences de la France à Londres ? Selon vous, l'échéance de juillet 2 011 fixée par le Président Obama pour le début du retrait des troupes américaines d'Afghanistan – un pari ambitieux - peut-elle être tenue et si oui, à quel prix ?
Il faut, dans tous les cas, éviter que l'offensive nouvelle ne soit purement américaine ; ce qui se passe en Afghanistan ne doit pas être considéré comme une guerre américaine alors que toute la communauté internationale est concernée. Enfin, dans l'Union européenne de l'après-Lisbonne, « l'offre européenne » devrait prendre tout son sens. Nous devons donc être particulièrement attentifs à ce que sera le service extérieur de l'Union européenne. Le multipartenariat défendu par Mme Clinton et par Mme Albright impose que l'Europe - puissance prenne toute sa place dans le monde contemporain.

En 2008, à Bucarest, l'OTAN parlait d'exporter la démocratie en Afghanistan. Sommes-nous dans ce cadre ou dans celui du combat contre Al Qaïda, dont le président de la République disait que c'était sa priorité ? Mais l'OTAN nous dit qu'Al Qaïda n'est plus un risque sérieux en Afghanistan ! Sommes-nous alors engagés dans une guerre contre les talibans, exigeant qu'ils rompent avec le terrorisme international ? Participons-nous à une tentative militaire visant à affaiblir le mollah Omar en vue de négocier ? Tendons-nous à promouvoir un gouvernement d'union nationale sans conditions, avec M. Abdullah Abdullah ? Avons-nous mis au point une stratégie soutenable à long terme avec des moyens limités, ou nous apprêtons-nous à abandonner l'idée de nation building et à laisser l'Afghanistan à son sort à plus ou moins brève échéance ? En un mot, où en sommes-nous et, surtout, que veut la France ?

M. Obama, dont ne nous ne pouvons en aucun cas approuver la stratégie puisque nous considérons que l'on ne peut rien régler par la guerre, a semblé privilégier une démarche de sortie de crise. Admettons qu'il en soit ainsi. Pour autant, n'est-il pas temps de se convaincre, comme la présidente de l'Assemblée nationale du Pakistan l'a réaffirmé ce matin encore, que la misère est le terreau du terrorisme ? La conférence des donateurs prévue pour se tenir en janvier à Londres osera-t-elle consacrer aux populations misérables du monde, pendant des années, les sommes considérables actuellement consacrées à la guerre? La France pèsera-t-elle en ce sens ?

Le parallèle est éloquent : un engagement américain progressif ; un président local mal élu, voire corrompu pour ce qui est de Thieu ; un sanctuaire, ici au Cambodge, là au Pakistan ; une stratégie américaine de rouleau compresseur qui échoue. Personne n'ayant encore compris comment les hommes du commandant Massoud ont réussi à déloger les talibans, je ne comprends pas que l'OTAN, une fois encore, se trompe de stratégie. Je l'avais dit il y a plus d'un an déjà, il faut « afghaniser ». La France, et c'est à son crédit, est en train de le faire mais elle est bien seule et le président Obama fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faut cesser de multiplier des bases qui vont être encerclées et qui ne serviront à rien sauf à occuper un terrain vide. On va vers un nouvel échec, et il est incompréhensible que l'on répète maintenant les erreurs commises au Vietnam, alors même que les Soviétiques ont, entre-temps, subi un échec en Afghanistan – sans même parler des Anglais au XIXe siècle.

Pour que les attentats d'Al Qaïda cessent, trois conditions doivent être réunies. La première est que Al Qaïda soit déstabilisé là où elle a ses bases ; la deuxième que nos services secrets fassent bien leur travail, et je pense que c'est le cas ; enfin, que nous ayons de la chance. Notre présence en Afghanistan vise à déstabiliser Al Qaïda et à rien d'autre. Or, Al Qaïda est active dans quatre zones : dans les zones pachtounes certes, mais aussi en Somalie, au Yémen et au Sud-Sahara.
S'agissant de l'Afghanistan proprement dit, attendre de M. Karzaï qu'il mette un terme à la corruption est aussi fantaisiste que d'attendre d'un poisson qu'il respire hors de l'eau. Cela mis à part, le problème le plus grave est celui des talibans. Or, le message de M. Obama - « Nous allons renforcer nos troupes pendant dix-huit mois puis commencer à les retirer » - est ambigu car si cette stratégie est comprise en Occident comme un renforcement, pour les Afghans elle annonce un retrait, et les talibans vont se sentir confortés par cette déclaration ambivalente. Les talibans sont le bras armé du nationalisme pachtoune, ce qui nous importe assez peu ; seulement, à ce titre, ils sont aussi le bras armé du Pakistan contre l'Inde et contre le gouvernement afghan. A l'inverse, ne serait-il pas souhaitable que les Indiens fassent preuve de discrétion au Pakistan ? Enfin, qui dit « talibans » dit un certain projet de société, ce qui pose un vrai problème. Le monde occidental est-il prêt à ce que, dès les troupes de la coalition parties, on ferme les écoles de filles, et parfois mêmes celles des garçons ? Existe-t-il un moyen de négocier d'ores et déjà avec les talibans afin que notre départ ne se traduise pas par un échec pour la société afghane - car, si tel est le cas, Al Qaïda, tôt ou tard, reprendra des forces ?

Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir organisé cette audition, mais je proteste de la manière la plus ferme contre le débat cadenassé qui aura lieu la semaine prochaine en séance plénière. Ce n'est pas ma conception de la revalorisation du Parlement et je vous prie de le faire savoir à la Conférence des présidents.
En Afghanistan, nous assistons à une fuite en avant. Nous sommes pris dans un engrenage : comme c'est le cas dans toute guerre asymétrique où une armée régulière fait face à une guérilla, les militaires vont nous demander d'envoyer toujours plus de troupes, si bien que nous apparaîtrons de plus en plus comme une armée d'occupation. Il n'y a aucune solution militaire possible, et vous le savez fort bien, monsieur le ministre, vous qui insistez sur le fait que la France doit davantage former que combattre. La stratégie américaine est confuse, l'OTAN, devenu le gendarme du monde, est dans une impasse. Tout cela aura des résultats catastrophiques et nous ne pourrons pas nous retirer dans deux ans. Al Qaïda, en déroute en Afghanistan, est beaucoup plus fort en Somalie et en d'autres lieux. Le problème est que l'Afghanistan compte douze millions de Pachtounes, mais qu'ils sont trente millions de l'autre côté de la frontière, ce qui a pour conséquence la déstabilisation du Pakistan. Cette situation est néfaste et tout cela se terminera mal, comme dans toute guerre de ce type - même si nous obtenons des succès militaires, nous devrons nous retirer.
Et, après tout, il ne nous revient pas de choisir le modèle de société que veulent les Afghans. On peut regretter leur choix, mais nous n'avons pas à imposer notre modèle de société, voire de croyance ; plus longtemps nous restons en Afghanistan et plus nous aggravons l'incompréhension entre le monde arabo-afghano-musulman et les sociétés occidentales. La lutte contre le terrorisme peut prendre d'autres voies, et commencer chez nous, en Europe, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France. Nous nous sommes mis dans un mauvais cas et nous le paierons très cher.

Dans son discours de West Point, M. Obama a souligné toute l'importance du Pakistan, partenaire incontournable dans la lutte contre les talibans. Chacun a d'ailleurs noté le changement de stratégie des autorités et de l'armée pakistanaises, et leurs succès récents dans ce combat. Le revers de la médaille, c'est le nombre croissant d'attentats au Pakistan. Dans le même temps, une certaine méfiance réciproque perdure entre les alliés et le Pakistan. On notera avec satisfaction que, depuis cet été, l'Inde a repris le chemin de la discussion avec le Pakistan mais, en cette matière, rien n'est simple. Comment jugez-vous, monsieur le ministre, les efforts récents du Pakistan ?
Sur un autre plan, le récent refus exprimé par le Président de la République d'envoyer des soldats en renfort en Afghanistan est paradoxal, puisqu'il intervient après que la France a décidé de participer au commandement intégré de l'OTAN, et alors que la France a toujours appuyé la politique afghane du président Bush, envoyant même de nouvelles troupes en Afghanistan en 2008. La stratégie française est en question alors même qu'elle s'était singularisée en donnant la priorité à la reconstruction du pays et à sa sécurisation par la formation de policiers et de militaires afghans. Le risque d'isolement de la France est grand, et la position du Président de la République est d'autant plus délicate qu'il n'existe pas de politique européenne commune en cette matière. Sur le terrain, on assiste bel et bien à l'américanisation du conflit. Aussi, quels seront les effets, localement, de la décision française ?

Je suis d'accord pour qu'on laisse l'Afghanistan aux Afghans mais cela ne règlera pas le problème du trafic de stupéfiants, qui alimente le terrorisme. Or, je préfère combattre ce trafic en Afghanistan plutôt que dans les rues de Paris. Peut-on quitter l'Afghanistan en laissant subsister ce foyer ?

Je vous remercie à mon tour, monsieur le président, d'avoir organisé cette audition. Une armée de cent mille hommes en Afghanistan est-elle le bon moyen de combattre Al Qaïda ? Ne sommes-nous pas les otages d'une stratégie que nous n'avons pas choisie ? Al Qaïda, ce sont quelque 500 militants cachés au Pakistan et des relais dispersés du Yémen à l'Algérie, de la Somalie aux pays du Sahel. Dans ce contexte, la stratégie efficace n'est-elle pas de multiplier les opérations de police et de renseignement et de procéder à des actions militaires ciblées, comme le font les Américains dans les zones tribales pakistanaises ? Les leçons des déboires soviétiques en Afghanistan n'ont pas été tirées. Plus l'Union soviétique augmentait ses troupes, plus elle coalisait la population contre elle. Je crains que nous ne participions à un processus de même nature, alors qu'il faudrait obtenir un renversement radical de cette stratégie.

Les objectifs initialement fixés n'ont pas été atteints ; il n'existe pas de règles européennes communes s'agissant de l'engagement en Afghanistan ; surtout, la France n'est pas associée à la stratégie américaine, qui reste floue. Tel est le cadre. Monsieur le ministre, vous qui avez assisté à l'investiture de M. Karzaï, l'avez entendu prendre des d'engagements. Pensez-vous qu'il constituera un gouvernement neuf ou qu'il continuera de s'appuyer sur les mêmes personnes – un certain vice-président ici, un certain général là, sans même parler de son frère - dont on connaît l'implication dans toutes sortes de trafics ? Quelles peuvent être les exigences de la France s'agissant d'une nouvelle gouvernance ?

L'Humanité dimanche a publié un article d'un grand intérêt sur les circonstances de l'intervention soviétique en Afghanistan. On y apprend que cette intervention avait suscité une violente polémique entre les hiérarques. Andreï Gromyko y étant opposé et Iouri Andropov favorable, on a violé la Douma pour que l'intervention ait lieu sans qu'un réel accord se soit fait au sein du Politburo ; après quoi, les Soviétiques ont subi en Afghanistan l'échec militaire que l'on sait - alors que le gouvernement leur était favorable. Pensez-vous, monsieur le ministre, que la coalition puisse aujourd'hui gagner militairement ?

Chacun sait que l'action militaire est vouée à l'échec, et la guerre est impopulaire en France. Du reste, La Dépêche du Quai d'Orsay souligne désormais la nécessité de renforcer les actions civiles en matière de santé, d'agriculture et d'éducation, plus conformes à nos traditions. Il est curieux que l'on en vienne à cette démarche dans un pays où l'on s'est d'abord rendu pour lutter contre Al Qaïda. Veillons à éviter toute « guerre des civilisations ». Cela étant, si les choses étaient si simples, il suffirait de faire venir une masse de coopérants civils auxquels on demanderait de se mettre à la tâche, au lieu que, paradoxalement, il revienne à des militaires de faire le travail de civils. Que l'on cesse donc de vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes ! Nous devons sortir d'Afghanistan le plus dignement possible, en laissant le peuple afghan disposer de lui-même. Nous avions un mandat des Nations unies. Pourquoi, étant donné ces dérives, ne pas suivre la proposition du parti socialiste et demander à l'ONU de redéfinir ce mandat ? C'est à elle qu'il revient de le faire et non à l'OTAN.
Il est agréable d'être interrogé de manière précise par des spécialistes et je vous remercie, monsieur le président, d'avoir permis cette audition.
La France augmentera-t-elle l'effectif de ses troupes en Afghanistan ? Non, monsieur Loncle, elle ne le fera pas. Évidemment, s'il en allait de la sécurité de nos hommes, un ajustement serait possible avant même la conférence de Londres. Par exemple, si nous avions besoin d'un hélicoptère supplémentaire, un équipage serait nécessaire (mouvements divers). Non, vous dis-je, nous n'enverrons pas aujourd'hui de nouvelles troupes ; cela nous a été demandé et nous l'avons très clairement refusé, car ce sont les missions qui comptent et non le nombre de soldats. Or, la mission confiée aux troupes françaises n'a pas changé : elle est de s'occuper des deux vallées de Kapisa et de Surobi, ce que nos soldats font très bien. Donc, nous ne renforcerons pas nos troupes, mais s'il faut ériger des remparts en béton pour les protéger, nous enverrons des techniciens.
Vous avez préconisé, madame Ameline, une approche globale, militaire et civile. Une approche civile, cela signifie que nous n'aurons pas de victoire militaire. Malheureusement, quand il s'agit de faire la guerre avec les Afghans contre les talibans, les choses sont assez compliquées car souvent ils sont de la même famille. Surtout, cela demande que le pays soit sécurisé. Pourquoi ne pas dépêcher des civils pour y accomplir des missions civiles ? Mais parce qu'on les tuerait, comme on tue les volontaires civils afghans, que les talibans prennent pour cible ! Notre préoccupation première est donc la sécurisation ; pour autant, on ne doit pas tenter de sécuriser tout l'Afghanistan ; je reviendrai sur ce point.
La paix sera-t-elle possible en 2011 ? Je ne le crois pas. Tout au plus puis-je constater la concordance des dates avancées par M. Karzaï et par M. Obama pour le début du retrait des troupes. A quel prix ? Au prix du sang des alliés et des Afghans, dont nous voulons que le moins possible soit versé.
Comme vous, j'appelle de mes voeux une offre européenne et si nous sommes revenus dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est pour contribuer au renforcement du pilier européen de l'Alliance atlantique – nous sommes encore loin d'y être parvenus, je le sais, mais cela ne doit pas nous décourager de persévérer. Nous verrons à l'usage ce qu'il en est du service extérieur de l'Union européenne. Enfin, nous souhaitons le multipartenariat depuis l'origine, mais nous n'y sommes pas encore.
Notre objectif, monsieur Cambadelis, n'est pas de faire du nation building. Il serait ridicule de prétendre instaurer en Afghanistan une démocratie à l'occidentale – c'est un leurre, et ce n'est aucunement l'objectif visé. Introduire le plus de démocratie à l'afghane possible sera déjà un grand progrès. A ce sujet, je me félicite de la manière dont le vote s'est déroulé dans les vallées de Kapisa et de Surobi où les troupes françaises sont déployées : le taux de participation y a été de 10% supérieur à la moyenne nationale, et ces électeurs supplémentaires étaient très majoritairement des femmes. Ces femmes, nous ne devons pas les abandonner.
Des talibans, il y en a des deux côtés de la frontière, ce qui explique que des bombes soient déposées en Afghanistan et au Pakistan.
Nous avons, bien sûr, recherché une alliance de M. Karzaï avec M. Abdullah Abdullah mais, comme vous le savez, sa tentative d'accéder au pouvoir est demeurée inaboutie. Nous continuons naturellement d'entretenir des contacts avec lui et de l'encourager, mais les Afghans le considérant comme un Tadjik, il aura du mal à être élu, ce que je regrette. En résumé, nation building, soit, mais seulement s'il s'agit d'un Afghan nation building, car chacun doit suivre son chemin, la communauté internationale devant s'attacher à ce que se développent en Afghanistan un système scolaire, le minimum de soins de santé et les droits des femmes - et les Français font beaucoup à ce sujet.
Vous m'avez interrogé, Monsieur Lecoq, sur la sortie de crise. Les Soviétiques ont obtenu un bien plus grand succès qu'on ne le croit : Mohammed Nadjibullah n'a-t-il pas gardé le pouvoir deux ans et demi après que leurs forces se furent retirées ? C'est une leçon que nous devons méditer ; j'ai d'ailleurs demandé qu'un dialogue renforcé soit mis en place entre l'OTAN et la Russie sur l'Afghanistan, et nous avons évoqué la situation en Afghanistan au cours de la réunion OTAN-Russie qui s'est tenue la semaine dernière. Si, à l'époque, les Soviétiques ont abandonné la course aux talibans dans les montagnes afghanes pour se concentrer dans les villes, c'est que l'on peut plus facilement se rapprocher de la population en y construisant écoles et dispensaires. Il faut tirer les enseignements de cette période.
Comment ne pas être d'accord avec vous quand vous demandez que des sommes considérables soient consacrées aux populations ? Sait-on que le coût annuel d'un soldat américain en Afghanistan est de un million de dollars ? Mais, à supposer que l'on puisse le faire, encore faudrait-il que ces ressources soient utilisées, ce qui signifie la sécurisation préalable du pays ; pour cela, il faut être tourné vers la population. C'est ce que font les troupes françaises dans les deux vallées où elles sont déployées, et c'est pourquoi elles sont perçues comme un modèle en matière de dialogue avec la population.
La France pèsera-t-elle en faveur de l'affectation de ressources aux populations démunies ? Mais elle pèse déjà, monsieur Lecoq. L' « afghanisation » n'est pas la vietnamisation, car nous ne sommes pas dans un pays que nous avons colonisé ou que nous voulons coloniser. Plus de la moitié de la population croit en ce que nous faisons, et la sortie de crise se fera quand la population demandera à nos soldats de rester pour continuer les projets civils engagés. C'est ainsi que nous pourrons mesurer le succès obtenu ; ce ne sera pas un succès militaire mais un succès acquis grâce à notre effort militaire.
L'évolution est lente, je le sais d'expérience lorsque j'étais médecin en Afghanistan : pour faire accepter qu'un médecin examine des femmes malades, il a fallu cinq ans ! Pendant cinq ans, nous les avons vues mourir devant nos yeux faute qu'on nous laisse les soigner ! Il faut du temps ; savoir si nous aurons ce temps est une autre histoire.
Vous avez voulu comparer l'Afghanistan au Vietnam, monsieur Labaune. Je le répète, ce n'est pas le nombre de soldats qui compte mais la mission. Nous remplissons celle qui nous a été assignée, ce pourquoi nous n'augmenterons pas nos troupes en Afghanistan.
J'étais très proche de Massoud, et nous avons entretenu des liens étroits avec Abdullah Abdullah, son disciple et ami.. Doit-on « ethniciser » le conflit ? Pour donner une cohérence à l'armée afghane, il faudrait que les diverses composantes du pays se rassemblent. Il faut tenir compte de tous les groupes ethniques et en particulier des Pachtounes, car si tous ne sont pas des talibans, je ne connais aucun taliban qui ne soit pas Pachtoune… Certes, les hommes de Massoud l'ont emporté contre les talibans à Kaboul, mais ensuite la guerre a été tellement farouche… Nous devons nous rapprocher de toutes les composantes de la population, sans exclusive.
Il faudrait, dit M. Boucheron, déstabiliser Al Qaïda. Mais que faut-il entendre par là ? Les talibans posent des bombes artisanales le long des routes, ce qui est très dangereux pour nos soldats, que nous essayons de protéger au mieux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, nous n'augmenterons pas nos effectifs en Afghanistan mais nous ferons ce qu'il faut pour renforcer la sécurité de nos hommes si c'est nécessaire.
Nous devons combattre Al Qaïda dans quatre zones, nous avez-vous dit aussi. Sommes-nous en guerre contre tout le monde ? Non. Devons-nous, accroître notre effort en Somalie ? Oui, car les musulmans modérés – qui sont les plus nombreux - nous le demandent. A cette fin, nous avons formé 500 soldats à Djibouti et l'Union européenne en formera 3 000 en Ouganda, et peut-être au Kenya par la suite. Nous ne relâcherons pas notre effort. Mais, en Afghanistan, la guerre est d'une autre nature.
Peut-on mettre un terme à la corruption en trois ans dans un des pays les plus pauvres du monde ? Il faut s'y astreindre, essayer du mieux que l'on peut, mais cela ne se fera pas tout de suite car la corruption s'explique par la misère. Encore une fois, nous devons renforcer nos moyens d'accéder aux populations ; ce ne sera pas suffisant pour assurer une victoire militaire, mais nous ne visons pas une victoire militaire
Que penser des relations entre l'Inde et le Pakistan ? Au Pakistan, la situation est difficile mais le président Zardari et l'armée sont très déterminés à combattre certains groupes de talibans et ils ont obtenu des succès qui, pour être modérés, doivent être soulignés. Ils seraient plus nets encore si une coordination s'établissait des deux côtés de la frontière.
C'est à Paris que s'est tenue la première réunion des voisins de l'Afghanistan. Ce n'est pas suffisant mais c'est indispensable car la solution aux multiples problèmes qui se posent sera en partie régionale, notamment pour ce qui concerne le trafic de stupéfiants.
Je laisse aux talibans le soin de définir leur projet de société - un projet d'enfermement et de soumission des femmes, et un projet de théocratie. Ce n'est pas le mien, mais ce n'est pas mon pays.
S'achemine-t-on vers une négociation avec les talibans ? Dans son discours d'investiture, le président Karzaï a parlé de négociation et de réunification de la société afghane. Ce n'est pas à nous de négocier avec les talibans, mais un moment viendra où M. Karzaï devra parler avec eux. Toutes les guerres finissent ainsi, sauf victoire militaire totale. Dans le cas qui nous occupe, je ne crois pas à une victoire militaire mais je crois à la négociation, et M. Karzaï a déclaré vouloir négocier.
Il faut, m'avez-vous dit, parvenir à sortir d'Afghanistan sans échec. Mais l'on peut déjà dire que, dans les vallées où sont déployées les troupes françaises, il n'y a pas d'échec. Bien sûr, tout n'est pas réglé, bien sûr, il y a encore des talibans. Mais comment, dans la foule qui attend au dispensaire, distinguer un taliban du reste de sa famille ? Les talibans ne sont pas une armée rangée en bon ordre sous un drapeau ! Les talibans, ce sont, pour partie, des gens misérables qui, pour nourrir leur famille, font quelques opérations pour lesquelles ils sont payés trois fois plus que ne le sont les soldats de l'armée afghane, avant de rentrer chez eux. Les talibans, ce sont aussi d'autres gens dans la mouvance d'Al Qaïda, et avec ceux-là on ne s'entendra jamais. C'est avec les talibans « nationaux » et non avec les idéologues que le président Karzaï négociera un jour.
Oui, monsieur Myard, nos troupes sont des troupes étrangères aux yeux de la population mais la manière dont nos soldats s'approchent, à pied, de la population pour parler avec les gens, le fait qu'ils aient donné des semences et des engrais à des milliers de paysans - tout cela ne peut manquer d'avoir un impact. On verra, au printemps, quand les cultures rendront, que les troupes françaises ont été efficaces et c'est ce qu'elles peuvent faire de mieux. Je vous annonce aussi que nous donnerons des visas. A ce sujet, permettez-moi de dire que je ne suis pas particulièrement partisan de renvoyer les Afghans chez eux, mais que je suis très partisan de les faire venir en leur donnant un visa. Les interprètes de nos soldats, par exemple, pourront venir bientôt à Paris…

Je suis très favorable à ce qu'on leur délivre des visas car c'est la seule manière de leur sauver la vie le jour où nous partirons.
Allons ! Ils ne sont pas tous considérés comme des traîtres mais comme des gens qui gagnent leur vie ! Mais nous nous réjouirons qu'ils viennent volontairement en France.
Le Pakistan sera-t-il déstabilisé ? Maintenant que l'armée, peut-être contre le président Zardari, s'est engagée plus qu'auparavant dans la lutte contre ses propres talibans, le Pakistan est dans une situation qui, pour être encore très difficile, n'en est pas moins meilleure qu'elle ne l'était. Je pense que même si la situation politique y est compliquée, le pays n'est pas déstabilisé. Il n'est pas question d'y envoyer des soldats.
D'une manière générale, je le redis, nous ne prétendons pas imposer notre modèle de société – ce serait utopique.
Sans doute le président Obama a-t-il fait grand cas du Pakistan dans son discours, madame Langlade, mais il n'a rien décidé à propos de ce pays où, malheureusement, les attentats se multiplient, ne parlant que de renforts pour l'Afghanistan. Là-bas, les industries, ce sont la guerre, la fabrication d'armes et la drogue.
L'Inde nous encourage à demeurer engagés en Afghanistan. Quant aux efforts actuels du Pakistan, nous les apprécions avec une certaine circonspection, mais le déploiement des deux armées, au Nord et au Sud du pays, a montré une détermination à lutter contre les talibans qui est un élément positif.
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le rôle respectif de l'ONU et de l'OTAN dans la définition d'une stratégie en Afghanistan : il s'agit toujours d'une mission dont le principe a été décidé par l'ONU. Les deux organisations collaborent, l'OTAN étant théoriquement sous l'autorité de l'ONU. On s'apprête à désigner, aux côtés du représentant spécial de l'ONU en Afghanistan, un représentant civil de l'OTAN et un représentant civil de l'Union européenne. Tous trois seront responsables, ensemble, de l'aide aux populations civiles et de la répartition des millions de dollars de l'aide internationale. Mieux vaudra, évidemment, qu'il s'agisse de fins politiques, l'objectif étant bien de parler aux Afghans pour instaurer la confiance et rendre possible la réalisation d'objectifs communs, telle l'installation d'un système de soins, même rudimentaire. J'espère que les trois personnalités sauront s'entendre pour rendre crédible notre démarche d'afghanisation, maintenant que les décisions stratégiques sont entièrement partagées par tous les membres de l'OTAN.
M. Julia a évoqué le trafic de drogue. De fait, les recettes issues du trafic du cannabis auraient doublé récemment en Afghanistan. Cela signifie que, là où nous avions eu la satisfaction de constater qu'il n'y avait plus de plants de pavot, le trafic de cannabis se développe. Pour ne pas se mettre les paysans à dos, on a évité de détruire les récoltes. Peut-on le faire maintenant ? On a décidé de le faire pour les précurseurs chimiques, mais j'ai des doutes sur l'efficacité des mesures prises. De ces trafics, tout le monde profite, les talibans les premiers mais aussi les paysans et, en réalité, tout l'Afghanistan. On peut certes tenter de convaincre de l'intérêt des cultures de substitution, mais chacun comprendra combien c'est difficile. La corruption est une pratique sociétale très ancienne en Afghanistan, contre laquelle nous avons insuffisamment lutté. Cela dit, ce ne sont pas les paysans afghans qui sont responsables de la consommation, c'est nous, et cette consommation se développe. Si quelqu'un connaît un moyen de remédier à cette situation, qu'il m'en fasse part sans délai.
Vous me demandez, monsieur Souchet, si avec une armée de 100 000 hommes on peut lutter efficacement contre les talibans en Afghanistan. Nous y sommes presque, puisqu'ils seront 100 000 sous peu. Les Soviétiques en avaient déployé 140 000 ; ont-ils été efficaces ? Non, si ce n'est qu'ils ont pu maintenir en place pendant deux ans et demi un gouvernement stable, celui de Mohammed Nadjibullah, qui n'est tombé que parce que le mur de Berlin est tombé, et non parce qu'il était confronté à des difficultés sur le plan local.
Faut-il courir à la poursuite des talibans avec les forces spéciales ? Je ne suis pas un stratège militaire, mais je pense qu'il le faut. Les Soviétiques avaient continué de le faire, mais ils s'étaient concentrés dans les villes, où le contact avec la population était plus facile. Je suis persuadé que l'on ne peut contrôler entièrement l'Afghanistan et qu'il nous faut donc choisir d'intervenir là où notre modèle est mieux connu et plus convaincant. J'observe que personne, en France, ne demandant que nous retirions nos troupes...
… il nous faut trouver une stratégie qui nous permette d'être utiles.
M. Bascou a souligné que les règles d'engagement en Afghanistan diffèrent selon les pays. C'est exact.
Les promesses faites par M. Karzaï lors de son récent discours d'investiture seront-elles tenues ? Que vous dire à ce sujet ? Que nous avions beaucoup de difficultés avec le gouverneur de la province où nos troupes sont déployées, qui n'était pas notre favori ; que nous avons demandé qu'il soit remplacé ; que cela n'a pas été fait ; qu'il a été prolongé dans ses fonctions. Ce n'est pas bon signe. De même, je sais qui étaient les vice-présidents de M.Karzaï et je constate qu'il les a reconduits, mais je sais aussi ce qu'est la politique, même en Afghanistan, et qu'il est plus facile de constituer une majorité avec ceux qui y sont prêts qu'avec M. Abdulah Abdullah. J'espère que M. Karzaï tiendra ses promesses, les trois personnalités civiles dont je vous annonçais la nomination y veilleront, comme le font les ambassadeurs. De plus, la France a proposé que le secrétaire général de la présidence soit chargé d'harmoniser les grands ministères, ce qui permettrait un dialogue plus facile. J'espère que cette proposition sera suivie d'effet.
La situation actuelle, monsieur Bacquet, n'est pas celle qui prévalait du temps du Politburo. La France l'a dit dès la conférence de Paris : nous ne gagnerons pas militairement, nous gagnerons avec les Afghans, pour réaliser des projets civils. Nous continuons à agir en ce sens.
Monsieur Dufau, vous considérez que nous courons à l'échec. Tout dépend de ce que l'on recherche, et nos cherchons une victoire civile. Oui, trois fois oui, il faut lutter contre la misère. On oublie trop souvent que l'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde ; or, dans ce pays, un soldat de l'armée afghane est payé 70 dollars par mois, celui qui s'engage chez les talibans 300 dollars… et un garde d'une société privée américaine Blackwater 15 000 dollars. Aussi longtemps que de telles différences perdureront, la lutte contre la misère sera un échec. L'important, c'est de mener à bien des projets civils ambitieux, tels que l'électrification, l'irrigation, le don de semences, ce que font nos troupes dans les vallées où elles sont déployées. Le terme de « guerre de civilisations » est une expression que je n'emploierais pas, mais il existe des oppositions dans le monde dont il faut bien tenir compte.
Encore une fois, la mission à laquelle nous participons en Afghanistan est une mission des Nations unies pour laquelle la Conférence des donateurs qui se réunira en janvier prochain à Londres marquera, je l'espère, un tournant.

Monsieur le ministre, cinq de nos collègues, Gilles Cocquempot, Daniel Garrigue, Robert Lecou, Didier Mathus et Alain Néri, auraient aimé vous poser d'autres questions, mais je sais que votre emploi du temps ne le permet pas. Je vous remercie de vous être prêté à ce débat.
La séance est levée à dix-sept heures trente cinq.