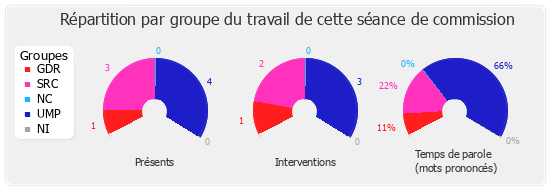Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 31 mars 2009 à 16h00
La séance
– Audition de Alain Legrand, psychologue et psychanalyste, de SOS-Violences familiales, membre de la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales (FNACAV), de M. Pascal Cuenot, psychologue clinicien responsable de l'association Parenthèses à la violence (Belfort), de Mme Catherine Vasselier et de M. Charles Heim, psychologues-psychothérapeutes du centre de consultations de La Durance (Marseille).
MISSION D'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Table ronde sur la prise en charge des victimes
Mardi 31 mars 2009
Présidence de Mme Danielle Bousquet, présidente
Table ronde réunissant :
- Alain Legrand, psychologue et psychanalyste, de SOS-Violences familiales (Paris), membre de la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales (FNACAV),
- M. Pascal Cuenot, psychologue clinicien responsable de l'association Parenthèses à la violence (Belfort),
- Mme Catherine Vasselier et M. Charles Heim, psychologues-psychothérapeutes du centre de consultations de La Durance (Marseille).
La séance est ouverte à seize heures vingt.

Mes chers collègues, notre mission a souhaité organiser une table ronde sur la question des auteurs de violences. En effet, si nous parlons beaucoup des femmes victimes, nous avons aussi besoin de savoir qui assure le suivi des auteurs et dans quelles conditions.
Je vous propose d'organiser notre discussion autour de deux questions. La première porte sur le suivi des auteurs à proprement parler. Quand intervenez-vous ? Est-ce uniquement dans le cadre d'un contrôle judiciaire ? Existe-t-il des bonnes pratiques en la matière ? Pouvez-vous évaluer vos résultats, notamment en termes de récidive ?
La deuxième question est celle des moyens alloués à ce suivi. Quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles vous intervenez ? Avez-vous des partenaires institutionnels et lesquels ? Y a-t-il un budget régulier consacré au suivi des auteurs ?
A titre personnel, je souhaiterais, au préalable, savoir quel terme vous semble le plus adapté pour parler de votre action à l'égard des auteurs de violences : « suivi », « prise en charge » ou « prise en compte » ?
La terminologie est encore un peu aléatoire. Nous utilisons plutôt le terme de « prise en charge », étant bien entendu que les formes en sont multiples. En clair, nous préconisons un suivi psychologique.
On parle de « suivi » mais cela pourrait laisser entendre que les personnes dont nous nous occupons marchent devant et que nous marchons derrière : cela ne correspond pas à la réalité, et nous préférons le terme de « prise en considération ». Certes, ceci n'est pas un terme juridique mais il est beaucoup plus important pour une personne, auteur ou victime, d'être prise en considération que simplement suivie.
Nous utilisons plutôt le terme « intervention », soulignant que nous sommes actifs dans la prise en charge. Nous parlons aussi de prévention de la récidive, puisque nous intervenons pour une grande part auprès des auteurs de violences conjugales qui ont fait l'objet de poursuites ou sont mis en cause par la justice.
Nous intervenons bien entendu sur injonction judiciaire, c'est-à-dire auprès de personnes en obligation de soins – ce dernier terme étant probablement à revoir. En effet, est-ce du « soin », et à partir de quel moment ? Nous préférons donc parler d'« obligation de suivi psychologique », dans la mesure où nous ne nous référons pas toujours à une pathologie mentale : même si nous sommes en présence d'une problématique psychopathologique sous-jacente, elle ne réfère pas forcément à un diagnostic précis, comme on pourrait en établir en psychiatrie ou en psychopathologie.
Nous intervenons également auprès de personnes qui viennent nous voir volontairement. Autrement dit, madame est partie ou s'apprête à partir et, pour qu'elle reste ou qu'elle revienne, ils acceptent de consulter. Mes collègues corroboreront ou non, selon leur expérience, la signification que nous donnons au mot « volontairement ». Certains viennent d'eux-mêmes à la suite d'une véritable réflexion, sans injonction judiciaire ou demande de leur compagne. Ils restent cependant encore très minoritaires parmi les personnes que nous recevons.
Nous avons trois types d'intervention.
Depuis trois ans, un groupe fonctionne sur Marseille, où la plupart des auteurs viennent de manière volontaire, pas toujours parce que madame est partie ou menace de le faire, mais aussi parce qu'ils souhaitent mettre fin à leur comportement. Ces personnes se sont engagées à long terme, certaines ayant déjà effectué un travail régulier en groupe. Très peu viennent dans le cadre d'une obligation de soins, car nous avons du mal à fonctionner avec le réseau et peu de personnes nous sont adressées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP.
Dans un autre groupe, à Aix-en-Provence, nous travaillons avec le procureur dans le cadre d'un protocole et la plupart des personnes sont reçues dans le cadre d'une obligation de soins.
Nous menons également des thérapies de couple sous certaines conditions très strictes. Soit monsieur, soit – la plupart du temps – madame appelle, ni l'un ni l'autre n'envisage une séparation et nous travaillons avec eux. Les conditions sont très spécifiques, j'y insiste, car nous affrontons immédiatement les notions de danger et de responsabilité : monsieur doit reconnaître les faits et se sentir responsable, il doit arrêter les violences et, à la moindre rechute, au premier événement violent, nous séparons le couple pour une thérapie individuelle.
Enfin, nous avons des prises en charge individuelles, également dans certaines conditions, pour des personnes qui ne peuvent pas rejoindre le groupe.
Dans le Territoire de Belfort, j'anime une équipe d'intervenants qui se déploie sur la Franche-Comté. En effet, depuis deux ans, nous avons mis en place des consultations ouvertes aux auteurs de violences à Vesoul, dans la Haute-Saône, à Montbéliard dans le Doubs, prochainement à Besançon, et dans le Jura, à Dole et à Lons-le-Saunier. Nous nous sommes rapprochés d'un partenaire précieux, à savoir les parquets dans les TGI, principaux demandeurs de ce type de consultations.
Au moins 45 % des personnes auprès de qui nous intervenons sont soit sous main de justice, soit adressées dans le cadre d'alternatives aux poursuites, dites compositions pénales, pendant lesquelles le mis en cause doit effectuer cinq à dix séances de consultations échelonnées sur deux à trois mois. Dès l'instant où il se plie à cette contrainte, et en l'absence de nouveaux faits dans le temps imparti, les poursuites sont abandonnées
Les autres personnes que nous recevons sont soumises à une obligation de soins, le terme « soins » étant effectivement mal approprié car nous intervenons non sur une maladie, mais sur le versant psychologique, voire psycho-éducatif. Nos partenaires privilégiées sont le SPIP dans le cadre des sursis avec mise à l'épreuve (SME), mais également, depuis un peu plus de deux ans, en association avec les parquets, nous intervenons dans le cadre de mesures « pré-sentencielles ». Il y a aussi l'Aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de protection de l'enfant quand les parents, en particulier le conjoint, sont mis en cause dans des violences conjugales. Les associations locales orientent également des auteurs de violences vers les consultations.
Enfin, à peine 10 % des personnes, font la démarche de venir nous voir sans volontairement, à la suite d'une prise de conscience souvent après avoir vu une émission télévisée ou lu un article de presse.
Il est en effet important de nourrir un partenariat avec les réseaux locaux. Au niveau des départements, nous nous inscrivons dans des logiques différentes. Cela demande un travail de fléchage pour permettre à nos partenaires potentiels de nous repérer et de savoir comment nous travaillons.
Les auteurs de violences eux-mêmes ont du mal à nous repérer, et c'est un des premiers problèmes. Certains d'entre eux, dans le cadre d'une injonction d'obligation de soins, nous ont appelés de Lyon car ils cherchaient des personnes spécialisées. Il faut donc réfléchir à la façon de donner cette information car, comme le dit Pascal Cuénot, c'est parfois à la suite d'une émission télévisée, radiophonique ou d'un article de presse que certains s'adressent de manière volontaire à nos structures. Plus on parle des violences conjugales du côté des auteurs – comme on en parle aujourd'hui pour les victimes –plus cela les incite à faire la démarche de venir nous voir.
La « publicité » de notre action devrait être imaginative et sans limite. Dans cette optique, j'ai accepté il y a quelque temps de donner une interview au journal Entrevue – qui s'est présenté à moi comme « un journal people de luxe pour les femmes » –, à propos d'une chanteuse américaine maltraitée par son conjoint, mais qui persistait à vouloir vivre avec lui. Si Françoise Dolto parlait sur France Inter, nous pouvons bien parler des violences conjugales dans les journaux à fort lectorat, pas seulement dans Le Monde où Le Figaro.
La plupart des auteurs reçus chez nous – même s'ils justifient le plus souvent leurs violences par le comportement de l'autre – admettent non seulement que les violences sont interdites, mais surtout qu'ils n'auraient pas dû y recourir.
Notre regard sur l'auteur des violences est évidemment lié au type de victimes. Un homme qui a giflé sa femme après avoir découvert qu'elle l'avait trompé – c'est à peine caricatural – a peu à voir avec un individu qui, jour après jour, maltraite sa femme et exerce sur elle une véritable domination, une emprise. Cela pose la question de la typologie des auteurs, qui reste encore à préciser. Des études devraient donc être menées sur ce point, avec l'idée de pouvoir proposer, à terme, des programmes adaptés aux différents profils de personnalités reçues.
Que ce soit clair : la distinction que vient de faire Alain Legrand ne signifie pas que nous cautionnions quelque acte de violence que ce soit.

Absolument. Vous parlez d'une adaptation de vos programmes à la typologie des auteurs. Puisque vous travaillez en réseau, j'imagine que vous avez déterminé ensemble des manières d'intervenir. Y a-t-il des bonnes pratiques, des choses à ne pas faire ?
Selon moi, les pratiques sont très différentes et dépendent du contexte dans lequel nous intervenons.
Dans le cas, par exemple, de personnes en obligation de soins, la durée des soins est fixée par les magistrats.
Avec ceux qui intègrent le groupe de Marseille, nous passons un contrat pour 21 séances, à raison d'une fois tous les quinze jours, ce qui représente quasiment un an de travail. Ce contrat entre eux se justifie, car ce temps est nécessaire pour que le cheminement se fasse. On ne passe pas, en quelques semaines, d'un comportement violent à une gestion appropriée des conflits. Les auteurs doivent exprimer leurs émotions, être capables de parler de ce qu'ils ressentent et il est difficile pour eux – hommes ou femmes, on en a reçu quelques-unes – d'évoquer ce qui se passe lorsqu'ils se sentent agressés par leur partenaire. C'est tout un apprentissage.
La notion de temps étant importante, les programmes ne peuvent être très courts, sauf dans certains contextes où l'on n'a pas le choix, par exemple en milieu carcéral. En tout cas, nous sommes plutôt partisans d'un temps relativement long.
Il nous paraît important également que les groupes ne soient pas composés uniquement de personnes sous main de justice. À Marseille, nous avons l'expérience de groupes composés aussi de personnes qui viennent de leur propre chef. Cette rencontre est riche d'enseignements, car les uns et les autres ne se doutaient pas qu'ils pourraient être dans des situations aussi différentes après les mêmes actes.
Autre point très important de notre point de vue : il s'agit d'un véritable travail de prise en considération. Nous ne faisons pas des réunions avec un programme de conférences théoriques sur les thèmes « qu'est-ce que la violence », « qu'est-ce que la responsabilité ». Nous faisons de la thérapie, terme ambigu, comme l'a dit notre collègue, car nous ne considérons pas ces gens, sauf exception, comme des malades. C'est leur comportement relationnel qui est à prendre en considération. Or ce travail exige une solide formation en psychologie, en psychopathologie, en dynamique des groupes, en animation et en accompagnement des groupes.
Enfin, peut-être les magistrats pourraient-ils être davantage sensibilisés à ce que signifie le fait de venir travailler en groupe, d'y venir pour prendre soin de soi-même. Nous sommes attentifs aux conclusions que les magistrats tirent du fait qu'une personne a participé à un groupe une fois ou deux, car cette participation n'offre aucune garantie pour l'avenir : s'il en résulte qu'ensuite les magistrats prononcent moins d'injonctions de soins, notre travail aura été contre-productif…
Je crois que l'intervention en direction des auteurs de violences conjugales nécessite une formation sur cette thématique. Elle est différente d'une intervention envers tout autre auteur de violence, car elle embrasse à la fois une dimension sociétale et une dimension plus intime, plus psychologique.
Concernant les bonnes pratiques, il me paraît important de distinguer le préventif – qui pourrait s'apparenter à un groupe de parole – du curatif, celui-ci étant un processus de développement personnel et de prise en charge psychothérapeutique.
Autre point important sur les bonnes pratiques : notre intervention s'articule par rapport à la protection des victimes, en particulier l'épouse et dans certains cas les enfants ; l'intervenant a toujours à l'esprit la protection des personnes. Ainsi, si un auteur de violences manifeste une agressivité accrue lors d'un groupe ou d'une séance individuelle, l'intervenant doit tout mettre en place pour protéger les victimes. C'est un protocole un peu particulier, que l'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres types de prise en charge plus classiques.

Intervenez-vous seulement auprès d'hommes auteurs de violences en milieu familial, ou aussi auprès d'hommes auteurs de violences extrafamiliales, comme les viols ?
Dans le cadre de nos consultations, nous pouvons intervenir auprès d'adolescents ou d'adultes, mais notre travail se concentre essentiellement sur les violences faites aux femmes dans le cadre conjugal.
Nous aussi. Ne viennent aux groupes que les auteurs de violences conjugales.
La notion de temps dans la prise en charge est une condition sine qua non pour obtenir des effets durables. Autrement dit, si nous voulons voir ces personnes s'installer dans un autre type de relation, nous devons pouvoir avoir du temps, – même si des effets peuvent être obtenus très rapidement – car ils doivent s'inscrivent dans la durée. En ce sens, le fait que l'obligation de soins soit aujourd'hui de 18 ou 24 mois pour la plupart des personnes interpellées est pour nous une excellente chose. Même si elles sont réfractaires au départ, elles acceptent au fil du temps de prendre en compte le travail que nous leur proposons.
Ce temps permet l'accompagnement après l'arrestation et après la condamnation. En effet, les auteurs, qui au départ se sentent plus victimes qu'auteurs de violences – même s'ils reconnaissent leurs actes –, se sentent ensuite doublement victimes quand ils sont arrêtés et condamnés. C'est en les amenant à jouer le rôle du juge en groupe de paroles qu'ils finissent par s'auto-condamner.
J'en viens aux bonnes pratiques, même si nous nous interrogeons toujours sur ce terme. Nous avons travaillé dans le cadre d'un programme européen, après une réunion sur ce thème en janvier 2008, à Berlin, où sont intervenus des représentants de presque tous les pays de la Communauté européenne. Nous avons donc mené ensemble une réflexion sur cette problématique, dont les résultats devraient être publiés bientôt.
Par ailleurs, la FNACAV, qui regroupe aujourd'hui plus d'une vingtaine de structures en France, a établi une première charte qui, sans énoncer à proprement parler des bonnes pratiques, y renvoie en indiquant les valeurs premières dans le travail que nous souhaitons faire.
C'est tout d'abord, bien sûr, le refus de la violence sous toutes ses formes, avec cette idée forte que l'intervention auprès des auteurs de violences est complémentaire des actions de justice et n'est pas une alternative à l'application de la loi.
C'est ensuite l'idée que l'auteur est seul responsable de ses actes, sauf en cas de légitime défense, prévue par la loi.
C'est d'autre part la conscience des limites de notre intervention, et de la nécessité de ne pas perdre de vue la sécurité des personnes dans notre travail : nous recevons des gens plus ou moins dangereux, certains très dangereux, et nous avons en ce sens des obligations légales et déontologiques.
Quatrième idée : la nécessité d'un travail en réseau et en partenariat.
Enfin, l'obligation de formation et de supervision des intervenants d'autant que la question du traitement des auteurs de violences conjugales est aujourd'hui enfin prise en compte. Ne pas le faire aboutirait à toujours et seulement soigner les victimes, alors que le but est de mettre fin aux violences, ou au moins de les ramener au niveau le plus bas possible.
Catherine Vasselier. Je voudrais ajouter une chose sur le protocole passé entre le procureur d'Aix-en-Provence et le réseau associatif.
Aujourd'hui, avant le jugement, nous recevons les personnes seulement deux fois (un entretien individuel et une séance en groupe) dans les deux mois qui suivent leur garde à vue et leur mise en cause. En effet, l'expérience nous a montré que, lorsque nous recevions les mis en cause plus souvent avant le jugement, il en résultait une absence de condamnation au moment du procès. Les deux rencontres que nous pratiquons maintenant n'ont donc pas pour objectif un travail thérapeutique: il s'agit simplement, dans ce temps très particulier où les auteurs de violences sont évincés du domicile conjugal, de les entendre, d'abord par rapport à leur garde à vue mais aussi, pour certains, sur le fait qu'ils ne voient plus leurs enfants ou se retrouvent dans un foyer d'hébergement. L'entretien individuel leur permet de poser tout cela, mais sert aussi à éviter que leur conjoint soit en danger car c'est la période pendant laquelle elle l'est le plus. Il est donc important d'avoir ces entretiens avec ces personnes, tout en évitant qu'ils aboutissent ensuite – et c'est là toute la difficulté – à une absence de condamnation par le magistrat ou encore à des peines minimes.

Dans vos thérapies où le couple essaie d'éviter de se séparer, vous posez des conditions très précises, à savoir qu'au moindre incident, vous séparez le couple. Jusqu'où allez-vous ? Pouvez-vous anticiper et faire de la prévention ?
Sur l'obligation de soins, vous avez souligné l'importance de la durée, dont nous sommes tous conscients. Pouvez-vous faire évaluer le temps nécessaire ?
Enfin, vous avez souligné la nécessité de l'information en direction des auteurs, car si certains sont susceptibles de venir vous voir, encore faut-il qu'ils vous connaissent. Nous avons aujourd'hui des outils comme Internet, probablement plus facile d'accès grâce à l'anonymat qu'il permet. Peut-on relayer des informations dans ce domaine ?

Pendant les thérapies de couple, pouvez-vous éviter que l'homme exerce une emprise sur la femme ? La femme peut-elle résister à toute forme de domination ou de peur par rapport à l'individu qui est en face d'elle ?
Devant la sanction pénale, les auteurs vous disent qu'ils se sentent victimes, ne reconnaissant pas leurs agissements comme un acte de violence répressible. S'agit-il d'un vécu domestique, consistant pour l'homme à dire « j'ai le droit de le faire parce que je suis chez moi, c'est ma compagne, elle m'appartient et je la domine » ? Ou bien ces hommes ont-ils le sentiment que l'on fait trop d'affaires autour d'actes pas si violents que ça ?
Sur la thérapie de couple, il y a deux situations.
Dans la première situation, madame appelle et dit clairement qu'elle souhaite venir nous voir, parce qu'elle souhaite que les violences s'arrêtent et ne veut pas se séparer. Nous lui demandons si monsieur est au courant de son appel et s'il est d'accord pour venir. En les recevant tous les deux, nous évaluons le niveau de violence par rapport à ce qui s'est passé – il y a peut-être déjà eu plainte – ainsi que par rapport à la façon dont lui parle des faits de violence et à la manière dont elle répond. Si elle a peur, n'a pas la possibilité de parler, nous le sentons. Si elle est sous emprise – se demandant ce qui va lui arriver sur le parking après l'entretien -, des regards, des silences nous en informent. Dans ce cas, il est évident qu'une thérapie de couple est impossible et nous ne l'engageons pas, même si le couple le souhaite.
Il y a des situations où monsieur reconnaît la violence et dit souhaiter arrêter, et où madame aussi est capable de dire ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, nous leur faisons signer, dès la première séance, un engagement sans valeur juridique, mais de portée symbolique. Nous demandons à monsieur de s'engager, jusqu'à la prochaine séance et pour baliser le démarrage de la thérapie, à ne pas exercer de violences, quelles qu'elles soient, sur madame, et nous réfléchissons à ses stratégies d'évitement – car il en a déjà. Et nous demandons à madame de s'engager à quitter le domicile dès qu'elle sentira qu'il pourrait y avoir un acte de violence. Cet engagement prévoit aussi que, en cas de rechute, nous repartirons sur une thérapie individuelle pour chacun des deux, et monsieur pourra éventuellement rejoindre le groupe.
Quand nous travaillons ainsi, et dès le premier entretien, nous faisons l'inventaire de ses ressources familiales et amicales, mais aussi financières pour voir si elle pourrait éventuellement aller à l'hôtel.
Nous nous orientons alors vers une association pour trouver un hébergement d'urgence.
Dans ces situations, nous travaillons bien par rapport à la demande initiale du couple de pouvoir continuer ensemble, et le conjoint l'entend. C'est très important. Il n'entend plus : « je m'en vais définitivement » mais « je me mets à l'abri pour éviter une rechute et nous permettre de continuer ». Dans notre ouvrage, je donne l'exemple d'un couple dans lequel le mari avait signé l'engagement, mais sa femme refusait en lui expliquant : « je ne veux pas que tu penses que je veux te quitter ; je ne veux pas te quitter, donc je ne veux pas signer ». Il a fini par lui dire : « il est clair que si tu quittes le domicile, ce n'est pas pour me quitter, mais pour nous protéger tous les deux ». C'est donc un autre type de travail par rapport à la première situation. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ils existent. D'où l'intérêt des différents modes d'intervention.
Je réponds aussi sur les thérapies de couple. Parenthèses à la violence a un point de vue et une pratique très tranchés sur la question : nous distinguons la problématique du conflit de celle de la violence, de sorte que nous ne faisons pas de thérapie de couple.
En revanche, nous avons mis en place avec Solidarité femmes de Belfort un protocole que nous appelons un peu pompeusement « cothérapie scindée ». En face du projet commun du couple de poursuivre ou de reprendre la vie commune, nous mettons en oeuvre un protocole dans lequel monsieur s'engage à suivre des soins à Parenthèses à la violence et madame à rencontrer la psychologue-psychothérapeute de Solidarité femmes. Si leur projet est toujours le même, après échange entre les intervenants, nous décidons d'une entrevue à quatre, où le thérapeute de monsieur et celui de madame travailleront pour reconstruire, en quelque sorte, les bases du couple. Mais ce genre de cas représente très peu de situations. Parfois nous travaillons plutôt à faire que la séparation se fasse de la manière la plus sereine, la plus tranquille possible, et non dans la violence.
Pour répondre à Mme Buffet, les auteurs qui disent : « j'ai le droit, on n'a pas à me condamner », restent relativement rares parmi ceux que nous recevons – lesquels, il est vrai, ne sont pas représentatifs de l'ensemble, car différents biais font que nous ne recevons pas n'importe qui dans nos structures. Quoi qu'il en soit, ceux dont nous nous occupons ne se situent pas, en général, dans cette idée mais plutôt dans une revendication par rapport à l'arrestation policière : « on m'a maltraité, on m'a traité comme un assassin, un criminel ». Et leur argument le plus fort est : « j'ai répondu à sa violence à elle » : les auteurs disent en somme qu'ils se sont défendus. Au fond, leur idée est toujours qu'ils ont été en situation de légitime défense. Notre travail va consister, entre autres, à les rendre responsables de leurs actes. Cette main qui part toute seule est quand même reliée à leur cerveau !
Sur l'information, nous avons mis en place au niveau de la fédération un site Internet, qui reste à parfaire, comportant les adresses des structures et des liens renvoyant à de la documentation, des articles de loi et les structures existant dans les différentes régions. Nous envisageons aussi – d'où la question des moyens – d'organiser des campagnes d'information, de sensibilisation en direction des auteurs, avec des messages faits pour eux, pouvant être entendus par eux, mais traduisant aussi notre position sur les violences.
Sur la question bien plus difficile de l'évaluation, je pensais que nous pourrions commencer cette année à y travailler au niveau de la fédération, mais cela n'a pas été possible, car exister simplement en tant que fédération représente déjà beaucoup de travail. J'espère que nous pourrons prochainement consacrer l'essentiel de notre temps à réfléchir aux questions techniques sur notre travail.
Il existe des éléments d'évaluation même si nous ne pouvons que très rarement, évaluer notre travail après coup, sauf pour les gens suivis par la justice, une évaluation étant faite par les instances judiciaires elles-mêmes, mais seulement pour les gens qui sont à nouveau arrêtés. Nous ne pouvons donc évaluer la récidive que pour une part des auteurs. Mais nous pouvons prendre en compte d'autres éléments, quand, au fil du temps, ces personnes investissent des activités, acquièrent un autre regard sur le monde, se créent des amitiés, par exemple. Nous voyons des choses changer. D'où l'importance de la durée.
Le regard des auteurs sur leur compagne, c'est-à-dire la façon dont ils jugent ses propos à elle et comment ils les reçoivent, nous intéresse aussi directement. Car au bout du compte, la question est de savoir comment ils reçoivent en eux ce qu'ils vivent comme des attaques – en tout cas ils disent le vivre ainsi, car nous rencontrons tous les cas de figure, de la personnalité faible et fragile jusqu'au pervers manipulateur capable de vous faire croire qu'il a changé… Il y a tout un panel de personnalités, face auquel les critères d'évaluation devront donc être différents.
En tout cas, l'évaluation est pour nous l'objet d'un travail à préciser, même si nous avons déjà quelques idées fortes sur la question.
Quelques précisions sur la nécessité d'informer les gens.
Comme le dit Alain Legrand, nous sommes face à toutes sortes de personnalités, mais les personnalités perverses sont loin d'être la majorité parmi les auteurs de violences conjugales ; la plupart – hommes ou femmes, même si ces dernières sont moins nombreuses – sont atteints d'une véritable souffrance psychique. Ces gens ne comprennent pas comment ils en sont arrivés là et ne savent qu'une chose : on parle aux victimes, mais pas à eux.
J'ai coutume de dire que ce sont des « monstres », mais en expliquant toujours l'étymologie de ce mot : en fait, ils montrent ce que chacun d'entre nous serait capable de faire si nous étions placés dans les mêmes conditions socio-économiques, de genre, d'éducation, qu'eux. Par conséquent, dans les campagnes de publicité, il faut prendre en considération le fait que ces personnes ne s'attendent pas à ce qu'on s'adresse à eux. À mon avis, le ressort est là pour obtenir qu'ils viennent se faire aider – comme les victimes se font aider aujourd'hui. On a su parler aux victimes, on doit trouver un discours adapté aux auteurs.

Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre éclairage, qui renforce la conviction de plus en plus profonde de notre mission que tout est nécessaire : un cadre juridique – et tout le monde en convient, le cadre juridique actuel constitue une base solide à partir de laquelle on peut construire des réponses, même si on peut le compléter –, une prise en charge adaptée des victimes, et une prise en charge également adaptée des auteurs ; je crois que le parallélisme des termes ne fait injure à personne.
À partir de cet éclairage, je voudrais vous poser trois questions.
La première porte sur ce qui est un symbole, plus qu'une mesure généralement appliquée, car elle n'est pas toujours souhaitable : l'éviction du conjoint violent. Quel jugement portez-vous sur le principe même et sur la réalité de sa mise en oeuvre – sachant que si ce principe doit parfois être mis de côté pour prendre en compte une autre réalité, en particulier la protection des enfants ? Dans bien des cas, vous tenez les enfants pour des victimes au même titre que le conjoint victime de violences. Quelle est votre appréciation globale sur la question de l'éviction du conjoint violent et, partant, sur ce qu'il nous appartiendrait de faire pour apporter une réponse mieux adaptée ?
Ma deuxième question porte sur le lien entre ceux qui s'occupent des victimes et ceux qui s'occupent des auteurs. Manifestement, vous travaillez en lien avec la justice – et c'est plutôt de bon aloi –, vous établissez des relais et vous travaillez beaucoup en creux par rapport à ce que d'autres font en direction des victimes. Avez-vous des contacts fréquents avec les associations qui prennent en charge les victimes ? Sinon, pourquoi ? Cette articulation est-elle, selon vous, une bonne idée, dans la mesure où – du fait de la grande diversité des cas de figure que vous avez évoquée – la prise en charge de chaque situation doit être adaptée à sa problématique ?
Ma troisième question porte sur la prévention. Quand des associations de femmes victimes de violences interviennent devant des publics jeunes, garçons et filles, elles frappent les esprits, mais parfois pas ceux de certains garçons, ou pas comme on le souhaiterait. Il me semble que des structures qui prennent en charge les auteurs pourraient utilement parler aux garçons. Notre mission s'intéresse à la violence de genre et nous sommes nombreux à penser que nous ne sommes pas au bout de nos peines pour ce qui est de la considération que portent aujourd'hui les jeunes gens aux jeunes filles. À mon avis, vos propos pourraient utilement et très en amont frapper l'esprit des garçons sur certaines questions qu'ils ne se posent pas, parce que beaucoup d'entre eux en reviennent à de fausses évidences que nous pensions abandonnées depuis longtemps.
Vous l'avez compris : nous avons des pratiques différentes d'un site à l'autre.
Il y a très peu d'évictions en Franche-Comté. Le côté symbolique de l'éviction est effectivement important car il signifie à l'auteur de violences que c'est lui le responsable. Mais dans les faits, d'après les échos que j'ai eus, les mesures d'éviction aboutissent plutôt à renforcer la victimisation de l'auteur qui dit : « on m'a mis dehors, je dois rechercher un nouvel appartement ». À mon avis, on n'a pas su utiliser ce dispositif d'éviction comme un levier pour permettre à l'auteur de violences de prendre conscience de sa responsabilité et de la portée de ses actes. Par conséquent, il me semblerait judicieux de sensibiliser et de former tous les partenaires impliqués en ce sens.
Sur la question de l'articulation, j'ai envie de dire que Belfort est presque un exemple. L'articulation entre Parenthèses à la violence, créée en 1989, et Solidarité femmes, qui s'occupe des femmes victimes de violence, revêt un aspect préventif puisque, depuis deux ans, nous avons mis en place un « pôle prévention » dans le cadre duquel nous intervenons en duo sur la question du genre, c'est-à-dire des relations entre les filles et les garçons. Vous avez raison de souligner la nécessaire mobilisation des hommes : ils doivent aborder cette question auprès des petits garçons. Cette année nus fêtons notre vingtième anniversaire, à cette occasion, nous projetons de sensibiliser et de mobiliser les hommes, hommes politiques, chef d'entreprises, responsables d'associations, père de famille et conjoints, afin qu'ils viennent manifester à nos côtés, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre.
A Aix-en-Provence, l'éviction du conjoint violent pendant la période de deux mois qui précède le jugement fait presque systématiquement partie du protocole. Elle n'empêche pas, parfois, que les conjoints se rencontrent, mais elle permet à chacun de se poser et de réfléchir. Elle est importante symboliquement, puisqu'elle permet de notifier à monsieur qu'il a commis un acte délictueux ou criminel, sur lequel il doit réfléchir, et que madame doit être en sécurité. Néanmoins, il convient d'être vigilant, s'agissant du lieu d'accueil. Le conjoint violent ne doit notamment ne pas être trop éloigné de son travail, pour éviter de lui faire perdre son emploi
Pendant cette période, il faut aussi réfléchir aux enfants. Nous avons beaucoup travaillé sur les conséquences qu'ont sur eux les violences conjugales. On pourrait prévoir, pendant cette période, des rencontres médiatisées, en dehors du domicile, qui seraient un élément d'évaluation.
Pour nous, le plus important est qu'on ne se trompe pas de métier. Nous travaillons contre les actes de violence, et nous n'avons pas à devenir les avocats, soit de l'auteur, soit de la victime, ce qui arrive malheureusement assez souvent ; ainsi il est fréquent que des services d'accompagnement de l'enfant fassent valoir que monsieur « a le droit » de voir ses enfants, même s'il est condamné pour violences envers sa femme. A quoi ceux qui accompagnent la victime rétorquent que son vrai but est de voir la mère… Ces discours nous éloignent de ce qui est notre vrai travail : aider les gens à ne plus utiliser, dans la relation, des actes violents, ou à cesser d'être en relation. Il faut fuir les querelles autour de la question : « qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ? » et les croyances du style : « la violence a toujours existé » ; « les hommes ont toujours été violents », etc.

L'un de vous a indiqué qu'il veillait à réunir, dans les séances de groupe, des personnes sous main de justice et des volontaires. Pratiquez-vous d'autres formes de mixité : mixité sociale, mixité culturelle (entre les cultures issues de l'immigration et la culture européenne) ou mixité générationnelle ? Quelles en sont les vertus et les difficultés ?
Vous intervenez dans le cadre des violences conjugales, d'ordre physique. Qu'en est-il du traitement de la violence dite psychologique, ou du harcèlement ? Intervenez-vous en cas de violence des enfants sur leur mère ? C'est une situation qu'on retrouve notamment chez les enfants placés dans les ITEP. Intervenez-vous en cas de violence entre adolescents, comme celle des jeunes gens contre les jeunes filles de leur génération et le juge des enfants est-il amené à vous envoyer des « patients » ?
Enfin, comment passer du curatif au préventif ? En tant que thérapeutes, estimez-vous toucher une partie significative de la population qui se livre à ces violences ou qui les subit ? Nous découvrons qu'il s'agit d'un phénomène massif, plus important que ce que l'on pourrait penser.
La mixité culturelle et sociale fait partie intégrante de notre travail. Malgré certaines limites, que je n'ai pas le temps de développer, elle constitue un facteur positif. Quant à la mixité générationnelle, je ne saurais vous répondre, n'ayant aucune expérience en la matière.
Faut-il parler aux garçons ? Oui. Il y aurait beaucoup à faire, et sans nier la différence des sexes. Si nous pouvons prétendre à l'égalité de droits, nous ne sommes pas égaux, en ce sens que nous ne sommes pas tout à fait pareils. C'est dans la reconnaissance de la différence qu'on s'enrichit et qu'on évolue. Il vaudrait peut-être mieux accentuer les différences que d'essayer de les gommer, pour faire bien voir qu'il y a dans l'altérité quelque chose à penser et qui nous interpelle fondamentalement.
Je devais le mener en partenariat avec l'Espace Solidarité du vingtième arrondissement. Certaines contraintes, notamment de temps, ne nous ont pas permis de le faire, mais ce serait intéressant.
Le partenariat peut poser des problèmes, notamment entre des structures comme les nôtres et celles qui travaillent auprès des femmes victimes. Là aussi, il y a de grandes disparités d'approche. En cas de conceptions très rigides et dures, la communication est difficile. Heureusement, il existe beaucoup d'exemples de partenariats qui fonctionnent très bien, à Paris, à Marseille, etc.
Non. Il y a des féministes avec lesquelles il est facile de dialoguer. Je visais des structures où, par exemple, on résume la violence masculine à un désir de domination de l'homme sur la femme. D'autres problèmes, à mon sens plus aigus, peuvent conduire à cette violence. Cela ne signifie pas qu'il faille nier cet aspect des choses qui facilite le passage à l'acte violent, et peut même l'autoriser aux yeux de certains. J'ai constaté que certaines personnes d'origine étrangère considéraient que la France était le pays des femmes – « elles ont tous les droits, elles peuvent tout faire ! » Il y a bien du travail en ce domaine et la mixité est un outil intéressant pour balayer ce genre d'idées. Je me souviens néanmoins d'un homme d'origine maghrébine qui avait lu à d'autres personnes de même culture, un texte du Coran disant : le meilleur d'entre nous est celui qui est le meilleur avec sa femme.
Toutes les violences sont d'abord et avant tout d'ordre psychologique, même si ce sont des violences physiques qui amènent la plupart des personnes à venir nous consulter. Pour que la situation évolue, il faudra mener un grand travail de reconstruction des mentalités à travers les médias, à travers l'information qu'on peut dispenser, et ce sera long. Des hommes de plus en plus nombreux nous appellent eux-mêmes, même si c'est souvent sous la pression de l'entourage. Ce n'est pas le cas des jeunes gens. Il convient de s'interroger au niveau de l'école, du collège ou du lycée.
Touchons-nous suffisamment de personnes ? Pas encore. Pour changer en profondeur les mentalités, nous devons tenir un discours qui mette en jeu, non seulement ce que nous voulons dire aux auteurs, mais aussi ce qu'ils peuvent entendre. Il faut pouvoir leur dire : « Nous reconnaissons votre souffrance, mais cela ne vous autorise pas à faire preuve de violence, et nous allons travailler là-dessus ».
Travailler la question de la violence, c'est travailler avec toute personne qui, à un moment où un autre de sa vie, est auteur de violence. C'est donc aussi travailler avec des enfants ou des adolescents, qui sont les adultes de demain.
La notion de respect est un axe de travail important. Nous ne cherchons pas la non violence, mais le respect. La non violence c'est s'abstenir de violence ; mais si j'ai été très violent avec quelqu'un, il me suffira ensuite de hausser le ton pour qu'il s'incline. La promotion de la notion de respect constitue un véritable chantier pour notre société.
Nous ne nous posons pas la question de savoir si nous touchons une partie suffisamment significative de la population : nous ne connaissons pas la réponse, ou nous savons qu'elle risque d'être désagréable…
Comment passer du curatif au préventif ? Lorsque nous aidons des gens à ne plus commettre de violence dans leur famille, nous faisons de la prévention « après coup ». Nous avons la conviction que l'on ne naît pas violent – on n'a pas découvert le gène de la violence. Nous pensons aussi qu'il ne suffit pas de vouloir modifier des comportements individuels, mais qu'il faut modifier des façons d'être en relation. Mais la loi précède le travail des traitements des violences et de la relation, et non l'inverse. Vous ne viendrez pas en thérapie si l'on ne vous a pas dit que ce que vous avez fait est interdit.
Le préventif se base aussi sur l'interdit. Certes, un conjoint ou un père violent doit apprendre à ne plus l'être, mais la mère constitue aussi une figure de référence pour les enfants. Il ne s'agit pas seulement de faire de la prévention sur les auteurs. Il faut pouvoir apprendre à une jeune fille à faire en sorte de ne pas se laisser violenter. Si les jeunes filles, quand elles apprennent à devenir des femmes, considèrent que le fait d'être battue par son homme fait partie du fait d'être une femme, la prévention sera difficile. L'un de nous a parlé du travail à faire à l'école, mais je pense que chacun de nous, dans nos familles, doit se sentir responsable de la prévention.

Avez-vous des statistiques sur la reproduction de la violence parentale par les jeunes gens lorsqu'ils deviennent adultes ? Quelle est, au delà du couple, la place de la famille ? Utilisez vous les familles pour accompagner votre démarche ?
Très souvent, les familles sont au courant des deux côtés et qui poussent l'un ou l'autre à réagir.
Lorsque, dans un groupe, nous interrogeons les participants sur le modèle dans lequel ils ont grandi, nous apprenons que beaucoup d'entre eux ont assisté à des violences conjugales entre leurs parents.
Je reçois des personnes en thérapie individuelle pour des problématiques (notamment de couple) autres que la violence. Très fréquemment elles ont vécu, enfants, des violences conjugales. Le vécu, dans l'enfance, de violences extrêmement graves, finit par émerger des années après, alors qu'il avait été tu jusqu'alors.
Je vous ai apporté le compte rendu d'une étude américaine, longitudinale, qui porte sur 17 000 personnes. Elle montre l'effet que peuvent avoir les expériences négatives vécues durant l'enfance, notamment les violences conjugales. Les taux de diabète et de cancer, par exemple, sont multipliés par 1,4 ou 1,6 par rapport à la population normale, pour ne parler que des effets physiologiques – car on observe aussi bien sûr des effets d'ordre psychologique.

La difficulté de donner une définition de la violence psychologique est un sujet fréquemment abordé avec notre collègue Guy Geoffroy. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure que toute violence était d'abord psychologique. Je trouve cela très important.

Lorsque vous intervenez auprès de volontaires, qui ne sont pas sous main de justice, quels sont vos partenaires institutionnels ? Dans quelles conditions matérielles et financières fonctionnez-vous ?
En premier lieu, je tiens à dire que l'association n'est pas financée par la justice, même lorsque nous recevons des personnes sous main de justice et de son côté, l'association n'a pas à rendre de comptes à une instance judiciaire. En revanche, nous rendons des comptes à nos financeurs, dont l'État, au titre du GRSP.

Lorsque quelqu'un à qui l'on a adressé une injonction de soins vient vous voir, vous n'êtes pas rémunérés par la justice ?
En effet. Le financement de l'association provient d'autres sources : de l'État, dans le cadre du plan de santé publique – chez nous le GRSP – ou du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), des collectivités locales – conseils généraux ou villes – ou du service aux droits des femmes .
Ce point nous importe, car pour nous les violences conjugales sont un problème de santé publique. La société soit se mobiliser pour le résoudre et les fonds que nous recevons n'ont pas à venir spécifiquement de la justice.
Le recours à la famille peut-être intéressant, lorsque c'est possible ; mais la famille n'est pas toujours une ressource – elle peut même être un facteur aggravant – et il faut savoir évaluer la situation.
Une notion me semble devoir être réhabilitée par notre société : celle du conflit. Une des difficultés principales pour l'auteur de violences est en effet l'évitement du conflit. La prévention peut aussi passer par un apprentissage dès l'enfance de la manière de gérer un conflit, dans le respect de l'autre et sans avoir recours à la violence.
Je suis tout à fait d'accord. De la même façon, il faudrait réhabiliter les émotions, même la colère, et apprendre aux enfants comment gérer cette colère, et gérer les conflits, sans passer à l'acte. Le programme est vaste !
Je suis un peu gênée de vous dire qu'à Marseille, nous en avons eu assez de réclamer des financements, de nous inquiéter, tous les ans, de leur éventuelle reconduction et de nous demander si nous allions devoir arrêter les groupes. Cela s'est produit dans certains départements et je trouve cela révoltant. En 2002, nous avons donc fait le choix de ne plus rien demander à personne ; ainsi, ce sont d'autres actions – les actions de formation – qui financent les groupes sur les violences conjugales, quelle que soit d'ailleurs la situation socio-économique de leurs auteurs. Ils ne paient que 10 euros la séance d'une heure et demie, car nous ne voulions pas que l'argent soit un frein pour eux.
A Aix-en-Provence, ce sont le conseil régional et la communauté d'agglomération qui financent nos actions ; l'État ne nous a pas accordé la subvention demandée.

Pensez-vous qu'un homme violent doive garder des relations avec ses enfants, à partir du moment où les violences sont dénoncées et pendant que vous l'avez en traitement ?
Nous avons coutume de dire qu'il n'existe pas d'hommes violents, mais qu'il existe des gens qui utilisent des actes violents dans leur relation. Par ailleurs, ce sont des citoyens à part entière même si, à un moment donné, ils sont sous le coup de la justice. A ce titre, rien ne les empêche d'avoir des relations avec leurs enfants.
En revanche, dans notre contexte de travail, nous considérons que les enfants sont aussi des victimes – nous avons d'ailleurs intitulé une de nos études « les enfants victimes de violences conjugales ». Il nous revient donc d'informer les magistrats sur notre appréciation de la dangerosité de la situation pour les enfants, et il nous arrive de préconiser de les éloigner soit de l'auteur, soit de la victime, soit des deux.
Cela n'a pas encore été discuté au sein de la Fédération. S'agissant des moyens, nous avons en revanche une position commune : nous déplorons le manque de moyens dont disposent les structures qui s'occupent de ces questions sur l'ensemble du territoire.
Pour vous donner un ordre d'idées, nous avons reçu en tout et pour tout, à Paris, 20 000 euros de subventions l'année dernière ! C'est très insuffisant. Sans un bénévolat nombreux et sans personnes très motivées, nous ne pourrions pas travailler. Pour 12 millions d'habitants, il n'existe que deux centres : le centre de psychiatrie légale, qui est déjà une structure particulière, et nous-mêmes. Voici dix ans que nous fonctionnons avec 20 000 ou 30 000 euros.
Nous avons toujours été aidés par le secrétariat aux droits des femmes, qui participe en fonction de ses moyens, pour 7 000 euros. La Ville de Paris nous octroie 10 000 euros. Et nous recevons de temps en temps un millier d'euros… Il est bien difficile de travailler dans ces conditions. Mais je parle au nom de tous mes collègues dans toutes les structures, dont la situation est identique.
Pour terminer, je voudrais appeler votre attention sur les groupes de parole qui se mettent en place au sein de l'institution judiciaire. Ils seront animés, sur dix ou douze séances, par des conseillers d'insertion et de probation. On est en droit de s'interroger sur le fait que ces groupes de parole seront conduits par des gens de l'institution elle-même.
Les conseillers d'insertion et de probation informent directement le juge de l'application des peines, ce qui leur donne un certain pouvoir. Comment la parole pourrait-elle circuler librement dans de tels groupes ?
La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq