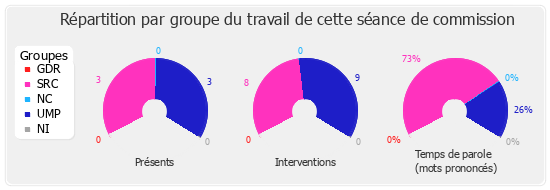Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 9 mars 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 9 mars 2011
La séance est ouverte à seize heures vingt.
(Présidence de M. Serge Blisko, député, coprésident et de M. François Pillet, sénateur, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies entend M. Patrick ROMESTAING, président de la section « Santé publique » du Conseil national de l'ordre des médecins.

Notre mission d'information traitant des toxicomanies essentiellement sous l'angle sanitaire, il était logique que nous entendions le président de la section « Santé publique » du Conseil national de l'ordre des médecins, auquel je souhaite la bienvenue. L'approche et le traitement des toxicomanies ont beaucoup évolué tant du fait de découvertes scientifiques récentes que de la mise en oeuvre de divers programmes de santé publique : mise à disposition et échange de seringues, afin de prévenir les infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou par le virus de l'hépatite C, délivrance de produits de substitution qui permettent de mieux suivre les toxicomanes – même si certains d'entre eux, en rupture de la société, vivant dans des milieux très défavorisés, avec parfois la rue pour tout logement, échappent à tous les dispositifs. Avec toutes ces évolutions, le corps médical est aujourd'hui plus étroitement associé à la prise en charge de la toxicomanie. Une autre question est celle des produits consommés. Plusieurs pharmacologues nous ont alertés sur la consommation croissante de cocaïne, en complément notamment du cannabis, et de drogues de synthèse, devenues d'accès plus facile grâce à internet et qui constituent les dangers de demain. Nous aimerions, monsieur, connaître votre avis sur tous ces sujets.
Je vous remercie d'avoir convié le Conseil national de l'ordre des médecins à participer à vos travaux. Oto-rhino-laryngologue libéral, président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, je préside également depuis un an et demi la section « Santé publique » du conseil national. Comme vous le voyez, je ne suis absolument pas spécialiste des toxicomanies. Je vous prie donc de m'excuser s'il est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. La section le fera ultérieurement par écrit.
Pour ce qui touche à la toxicomanie, l'institution ordinale est surtout sollicitée au niveau local. J'ai ainsi eu à connaître, dans le Rhône, du cas de confrères qui s'étaient rapprochés de l'ordre parce qu'ils avaient du mal à gérer certains toxicomanes. L'un d'entre eux, qui exerçait dans un quartier difficile où il en recevait beaucoup, a été récemment retrouvé mort, ligoté. Nous étions au courant de ses difficultés avec sa patientèle car nous l'accompagnions depuis quelque temps.
Les conseils départementaux ne sollicitent que rarement le conseil national. Cela peut arriver face à des conduites « hors norme » de certains confrères qui exercent en général dans des banlieues difficiles et avec lesquels nous entrons alors en contact. Les problèmes les plus fréquents concernent les traitements de substitution.
Le conseil national a débattu de l'ouverture de « salles de shoot » – comme les ont appelées les médias –, sans prendre de position officielle sur le sujet. Notre dernière initiative publique et officielle en matière de toxicomanies a été prise conjointement avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens : il s'agissait d'appeler l'attention des médecins et pharmaciens sur le respect des procédures dans le suivi des toxicomanes.
Si vous souhaitez maintenant aborder d'autres points, je suis à votre disposition.

Pensez-vous que, dans le cursus médical, la formation à la prévention et au traitement des toxicomanies soit suffisante ? Il semble que les praticiens se forment essentiellement au contact des patients toxicomanes, ce qui n'est pas l'idéal. Existe-t-il des enseignements post-universitaires spécifiques ?
Le sujet de la toxicomanie fait partie des enseignements de santé publique, domaine qui n'était jusqu'à présent qu'effleuré durant les études médicales. Depuis la toute récente mise en place de la première année commune des études de santé, les programmes ont été passablement modifiés et se sont ouverts davantage à cette dimension de la santé. Mais la formation initiale des médecins déjà en activité, en matière de toxicomanies comme de santé publique en général, est indigente. Quant à la formation continue sur le sujet, elle concerne surtout les praticiens qui, de par leur lieu d'exercice ou leurs relations professionnelles, ont été amenés à prendre en charge des patients toxicomanes et s'intéressent à cette patientèle particulière.

Notre politique de prévention des toxicomanies et des addictions en général vous paraît-elle suffisante ? Les médecins s'intéressant à cette question sont peu nombreux tandis que les associations, très actives dans la prise en charge de la toxicomanie, mettent avant tout l'accent sur la réduction des risques. Quelles sont vos propositions en la matière ?
Hormis en matière de vaccination, la prévention est très insuffisante dans notre pays. On pourrait dire que nos confrères ne cessent d'en faire, mais qu'en même temps ils en font très peu, faute de temps. Ils souhaiteraient que ce pan essentiel d'activité soit spécifiquement rémunéré, par exemple au forfait. Le sujet est d'ailleurs à l'ordre du jour de la négociation conventionnelle. Une mixité de la rémunération permettrait sans doute aux médecins de consacrer plus de temps à la prévention. Cela dit, ils déplorent aussi d'y être mal formés, celle-ci étant le parent pauvre de la formation médicale. Il faudrait développer la prévention sanitaire dès l'école et ne pas attendre l'université où les étudiants sont moins réceptifs, parfois même braqués contre certains messages.
Le rôle des associations est essentiel dans la prise en charge des toxicomanes. Ce sont surtout elles qui soutiennent ces patients et sont les mieux à même de leur assurer la présence et l'écoute nécessaires.
La déontologie impose-t-elle des limites aux médecins dans l'accompagnement et la prise en charge des toxicomanes ? Si oui, lesquelles ? Certaines vous paraissent-elles regrettables ?
L'exercice médical obéit à une déontologie très stricte. Un médecin doit recevoir tout patient qui s'adresse à lui et ne peut opérer aucune discrimination. Nous n'avons pas eu à connaître de difficultés particulières à ce titre. Force est néanmoins de constater que ce sont presque toujours les mêmes praticiens qui, en empathie avec les toxicomanes, les prennent en charge. Certains confrères, en revanche, changent parfois de lieu d'exercice pour être moins confrontés à cette population particulièrement difficile à gérer.
La déontologie impose également la confidentialité et le respect absolu du secret médical. Nous n'avons pas eu à connaître, non plus, de difficultés particulières sur ce point. Ce secret est préservé, y compris dans le cadre de la mise à disposition ou de l'échange de seringues et de la prescription de produits de substitution.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a-t-il une doctrine officielle sur ce que vous appeliez les « salles de shoot », c'est-à-dire les centres d'injection supervisés ?
Je l'ai dit, le conseil national n'a pas pris de position officielle. Lorsque le sujet est venu en débat, nous avons eu un échange nourri au sein de la section « Santé publique ». Même si certains avancent que de telles structures permettraient un meilleur suivi des toxicomanes, nous n'étions pas favorables à l'autorisation de centres dédiés à la consommation de drogues, estimant que cela irait à l'encontre de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et de toute politique de prévention, en levant un interdit. Par ailleurs, tel que présenté, le projet excluait les associations, dont nous persistons à penser qu'elles sont les mieux à même de prendre en charge ce type de patients. Mieux vaudrait, selon nous, en rester là.

Je préférerais qu'on parle de salles de consommation supervisées ou à moindre risque plutôt que de « salles de shoot ». Le Conseil national de l'ordre n'y est pas favorable. Mais quel sentiment le médecin que vous êtes éprouve-t-il face à des toxicomanes qui s'injectent n'importe quoi dans la rue, les parcs publics ou les parkings souterrains ?
Je suis d'accord avec vous sur le fait que le vocabulaire n'est pas neutre. Je n'ai parlé de « salles de shoot » que parce que c'est ainsi que les médias avaient au départ désigné ces centres.
Plusieurs praticiens avec qui j'en ai discuté à Lyon m'ont dit que, quoi qu'on fasse, il est quasiment impossible d'amener les toxicomanes à modifier leurs comportements. L'ouverture de centres où il serait possible de prendre des substances jusqu'à présent illicites lèverait un interdit et reviendrait de fait à une légalisation, sans changer vraiment les réalités de terrain. Même avec des « salles de shoot », une bonne part de ces personnes continuerait vraisemblablement de se droguer dans les lieux publics.

L'ordre a-t-il envisagé d'envoyer une délégation pour s'informer sur certaines expériences menées à l'étranger, en Espagne et en Suisse notamment ? Des élus ont fait ce déplacement. Pourquoi des médecins, qui ont vocation à protéger la vie, ne s'intéresseraient-ils pas à des initiatives comme celle prise à Bilbao, où une salle de consommation à moindre risque a été ouverte avec l'aide d'une municipalité de gauche, puis maintenue par la municipalité suivante, de droite ? Ce n'est certes pas la panacée mais cela permet de mieux encadrer les pratiques, et même de sauver des vies en donnant à certains toxicomanes goût aux soins et en les motivant pour se libérer de leur addiction.
Le Conseil national de l'ordre des médecins ne se déplace pas hors des frontières. Je peux en parler au président mais à ce jour, ce n'est pas dans notre politique. L'ordre prend connaissance de ce qui se fait à l'étranger au travers de publications et rapports. Lorsque la section « Santé publique » a abordé le sujet des salles de consommation supervisées, plusieurs de ses membres ont fait état d'expériences étrangères ayant tourné court aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, à Lausanne notamment. Sur le fond, nous en sommes d'accord, il faut tout faire pour assurer une prise en charge correcte des toxicomanes. Mais prévenir les toxicomanies, c'est aussi ne pas exposer, aux yeux des jeunes en particulier, des lieux de consommation légale.

Des médecins qui suivent de façon régulière et sérieuse des toxicomanes savent que certains s'injectent le Subutex, parfois associé à d'autres substances. Fort heureusement, bien que cela constitue un détournement d'usage du produit, ils continuent, par déontologie, de recevoir ces « injecteurs compulsifs ». Pourquoi d'autres médecins ne pourraient-ils pas assurer un suivi de même type dans des centres de consommation supervisés ? Le conseil de l'ordre n'y est pas favorable. Mais avez-vous auditionné des confrères qui prennent en charge des toxicomanes ? Cela pourrait faire évoluer votre avis. Songez-vous à de telles auditions ?
C'est tout à fait envisageable. Cela ne nous poserait en tout cas aucun problème.
Il y a une différence fondamentale entre la prise en charge d'un toxicomane dans un cabinet médical, où la confidentialité est garantie, et celle qui se ferait dans un lieu public dédié à la consommation de drogues. En cabinet, la prise en charge est individualisée et passe par un échange entre deux personnes, le médecin et son patient. Elle n'a rien de comparable à ce qu'elle pourrait être en un lieu collectif, plus semblable à une vaste consultation hospitalière.
Pour l'heure, l'ordre n'a pas souhaité prendre de position officielle sur le sujet. Je reposerai la question lors d'une prochaine réunion du bureau du conseil national.

La formation initiale des médecins en matière de toxicomanies étant indigente, vous l'avez dit, une formation continue sur le sujet ne serait-elle pas indispensable, d'autant qu'il peut y aller de la sécurité même des praticiens ? Sans formation appropriée, peu d'entre eux seront disposés à suivre ce type de patients. Avez-vous des propositions sur le sujet ?
Puisque vous m'en donnez l'occasion, et même si cela nous éloigne de notre thème d'aujourd'hui, je dirai un mot de la formation médicale continue. Celle-ci est, hélas, dans les limbes depuis des années. La profession est excédée de voir se succéder en vain les sigles – de FMC, « formation médicale continue », on est passé à DPC, « développement professionnel continu » – et les modes d'organisation ! Les trois structures distinctes prévues pour les médecins salariés, hospitaliers et libéraux ont été supprimées, trois ans seulement après leur mise en place, au profit d'une structure unique. Il est urgent de remettre sur les rails une véritable formation continue. C'est une priorité que de former les jeunes médecins à toutes les facettes du métier. Aujourd'hui, formés à l'hôpital, ils ignorent tout ou presque des réalités de l'exercice libéral. Cette méconnaissance explique d'ailleurs pour partie que si peu soient prêts à s'installer en milieu rural, et en exercice libéral d'une manière générale. Sans formation psychologique particulière, il leur est par exemple difficile de prendre en charge des toxicomanes, très demandeurs et parfois agressifs. Nouer le contact avec les patients, résister à leurs demandes, cela s'apprend, et c'est un aspect essentiel de la formation, en matière de toxicomanie plus encore que dans d'autres domaines.

Il n'y a pas qu'en milieu rural qu'on manque de médecins. Il existe aussi des déserts médicaux dans certaines zones urbaines sensibles.
Des praticiens sont agressés par des toxicomanes. Avez-vous une idée du nombre de ces agressions ? Ces confrères appellent-ils à l'aide ?
Nos jeunes confrères rencontrent de plus en plus de difficultés. L'insécurité est une source d'angoisse majeure qui explique leurs réticences à s'installer en libéral. L'ordre a mis en place un « observatoire de l'insécurité médicale » qui va bientôt rendre publiques des statistiques. Mais les incivilités comme les agressions les plus violentes sont largement sous-déclarées. Lorsque les médecins se tournent vers l'institution ordinale, c'est souvent que, déjà, ils n'en peuvent plus. J'ai évoqué le cas de ce confrère retrouvé ligoté après une agression, décédé d'un accident cardiaque. Il aimait son métier qu'il exerçait depuis longtemps, ayant dépassé la soixantaine, mais il se trouvait dans une grande détresse psychologique face à une patientèle de toxicomanes qui le mettaient « sous pression » pour obtenir les produits qu'ils voulaient. Après qu'une pharmacie nous l'eut signalé pour ses prescriptions de Subutex à tour de bras, à des dosages bien supérieurs à la normale, l'ordre était entré en contact avec lui et l'accompagnait depuis quelque temps – ce qui n'était pas le surveiller, comme on a pu le lire dans certains médias. Mais d'une manière générale, les médecins se plaignent peu, même lorsqu'ils exercent dans des banlieues difficiles où se concentrent ces difficultés.

Un tiers des produits de substitution seraient détournés de leur usage. Le Conseil national de l'ordre travaille-t-il sur le sujet ?
Pas du tout.
J'ai bien entendu la différence de nature que vous établissez entre la prise en charge d'un toxicomane dans le secret de la consultation médicale en cabinet et celle qui pourrait avoir lieu dans un centre de consommation. Imaginons que de tels centres soient expérimentés, sous des modalités restant à déterminer : cela ne saurait se concevoir sans la présence de médecins. En cas de problème, leur responsabilité civile, voire pénale, ne risquerait-elle pas d'être engagée, d'autant qu'aucun bilan de santé préalable des patients n'aurait pu être dressé ? Vos confrères ne s'en inquiètent-ils pas ?
C'est précisément l'une des réserves qu'avait formulées notre section. Nous tenions à appeler l'attention des médecins qui accepteraient de travailler dans ces centres sur leur responsabilité, y compris pénale.

L'ordre des médecins n'a pas travaillé sur le détournement d'usage des produits de substitution, dites-vous. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau national mais en région, notamment en Midi-Pyrénées en 2004, du fait d'une actualité brûlante, l'ordre s'était, sans délai, engagé aux côtés de l'ordre des pharmaciens et des caisses d'assurance maladie pour stopper certains mésusages.
J'ai répondu tout à l'heure en tant que président de la section « Santé publique » du conseil national. Les conseils départementaux s'impliquent en effet fortement à l'échelon local. C'est souvent, je l'ai dit, vers l'institution ordinale que les médecins se tournent lorsqu'ils ne peuvent plus eux-mêmes faire face ou qu'ils ont repéré qu'un confrère était en difficulté. Merci d'avoir cité l'initiative tout à fait intéressante d'un conseil départemental. Il y en a eu d'autres, ailleurs, qui n'ont pas fait la une de l'actualité.

La prescription de Subutex et celle de méthadone obéissent à des réglementations très différentes. La première peut être le fait de tout médecin quand la seconde est beaucoup plus strictement encadrée, l'initiative en étant réservée à certains praticiens. Avez-vous réfléchi à un assouplissement en ce qui la concerne ?
N'étant pas du tout expert de ces sujets, je préfère ne pas répondre.

La prescription, par un médecin, de substances susceptibles de provoquer la mort ne vous pose-t-elle pas de problèmes éthiques ? Imaginerait-on des lieux dédiés à la consommation d'alcool pour les personnes souffrant d'addiction à cette substance ?

Il n'a jamais été question que les médecins prescrivent des drogues dans ces centres ! Les consommateurs s'y injecteraient, sous la supervision d'un médecin – ou d'un infirmier – les produits qu'ils auraient apportés.
Autoriser ces centres, c'est en effet ouvrir la porte à d'autres pratiques, encore plus contestables. L'ordre croit en la force des interdits : de même qu'il n'avait pas souhaité que des médecins puissent être autorisés à donner la mort à des patients en fin de vie, afin de ne pas lever un interdit, il est contre l'ouverture de tels centres pour que perdure un interdit fort sur ces substances illicites.
Reste à savoir que faire des toxicomanes. Il faut qu'ils soient pris en charge par des associations ou par des structures spécialisées. La solution n'est pas d'ouvrir des centres de consommation supervisés, c'est-à-dire, à ce que j'avais cru comprendre, placés sous le contrôle d'un médecin – ce qui nous paraissait en tout état de cause le minimum.

J'entends bien ce raisonnement. Mais quelle hypocrisie, tout de même, dans notre pays où on autorise les pharmaciens à délivrer aux toxicomanes des kits Stéribox ! On se donne bonne conscience en se disant qu'avec une seringue stérile, on prévient au moins le risque d'infection par le VIH ou par le virus de l'hépatite C. Cela suffit sans doute aux bien-pensants, et des pharmaciens estiment leur éthique ainsi préservée. Mais pouvons-nous continuer de nous voiler la face ?
Je comprends votre interrogation. Le problème est complexe. Je le redis, les toxicomanes constituent une population très difficile à gérer. D'après ce que nous rapportent ceux qui les reçoivent, ils échapperont de toute façon aux dispositifs et même si on ouvrait des lieux de consommation légale, il en resterait toujours en marge, peut-être moins nombreux, mais au prix de la mise en place de structures officielles très dérangeantes sur le plan des principes.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite Mme Isabelle ADENOT, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Nous vous souhaitons la bienvenue, madame. Le rôle des pharmaciens est à l'évidence essentiel dans la prise en charge et l'accompagnement des toxicomanes : ce sont les professionnels de santé avec lesquels ceux-ci sont le plus fréquemment en relation, pour se faire délivrer des médicaments ou pour procéder à l'échange de seringues. Nous voudrions connaître le point de vue de l'ordre des pharmaciens sur la politique de lutte contre les toxicomanies, et les suggestions que vous auriez à faire pour éventuellement améliorer la situation.
Le pharmacien est le dispensateur du médicament. En tant que tel, son rôle est défini à l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, mais celui-ci est complété par l'article R. 4235-61 relatif au refus de vente, sur lequel j'aurai à revenir quand nous évoquerons la lutte contre le mésusage. Grâce à un maillage serré des officines, le pharmacien est aussi un professionnel de proximité. C'est également un éducateur en matière de santé, qui doit transmettre des déclarations d'addictovigilance en cas de situation anormale. Enfin, les pharmaciens d'officine disposent à eux tous d'environ cent kilomètres de vitrines sur l'ensemble du territoire, ce qui est précieux pour des actions de communication.
Les toxicomanes sont des gens en rupture avec la société, parfois agressifs, toujours attachants. Les pharmaciens sont disponibles : on les trouve au coin de la rue, ce sont les seuls professionnels de santé qu'on peut solliciter sans prendre rendez-vous. Nous nous sommes donc beaucoup impliqués. Depuis 1987, les seringues sont en vente libre. L'ordre n'a pas de données précises mais on estime que dix des quinze millions de seringues distribuées le sont par nos officines. Puis, en 1995, on a vu apparaître le Stéribox, ainsi que la buprénorphine – plus connue sous son nom commercial de Subutex – et la méthadone. La buprénorphine est prescrite par le médecin de ville qui, depuis 2008, doit certes indiquer le nom du pharmacien chargé de sa délivrance sur l'ordonnance, mais seulement en vue d'assurer le remboursement. La prescription de la méthadone, elle, est beaucoup plus encadrée puisque réservée depuis 2002 aux médecins exerçant en établissement de santé. Il y a donc beaucoup moins de dérives que pour le Subutex. Les mésusages de ce dernier sont connus : injection intraveineuse, « sniff », utilisation comme première et unique drogue, trafic et, enfin, cumul avec les benzodiazépines.
Pour ce qui est de l'ordre, ce n'est pas un syndicat : il exerce une mission de service public, par délégation de l'État. Comment intervient-il en matière de toxicomanies ? D'abord, nous avons un site internet ouvert à tous, Meddispar – pour « médicaments à dispensation particulière » –, qui détaille le cadre réglementaire applicable à chacun de ces médicaments, y compris ceux qui sont assimilés aux stupéfiants. Mis à jour quotidiennement, il est très utile pour combattre les mésusages, comme ceux dont le Tranxène 20 fait l'objet, et il facilite notre dialogue avec les médecins prescripteurs dont certains se montrent oublieux des règles – comme d'ailleurs certains pharmaciens.
Ensuite, le Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (CESPHARM), dirigé par Mme Fabienne Blanchet, dispose lui aussi d'un site internet pour partie ouvert au public. Son autre volet, réservé aux pharmaciens, leur permet de commander gratuitement des documents d'information sur nombre de sujets et, par exemple, sur le cannabis ou l'héroïne. Ce dispositif nous évite d'envoyer aux officines des kilos de documents qui ont de grandes chances de finir à la poubelle : si le pharmacien les demande, il va les utiliser. Nous en arrivons à distribuer ainsi 770 000 documents, dont 121 000 sur les drogues et 145 000 sur les addictions en général.
Nous avons également un partenariat avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie qui a débouché l'année dernière sur la formation et l'installation, dans chaque région, de référents en addictologie, pharmaciens chargés de former à leur tour leurs collègues ou d'animer des campagnes d'information.
Grâce à vous, et nous vous en remercions, nous avons aussi mis au point le dossier pharmaceutique qui fait la liste de l'ensemble des médicaments que son titulaire a demandés sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, si le pharmacien doit être à même de le proposer, ouvrir ce dossier n'est pas une obligation pour le patient. À ce jour, 85 % des officines disposent de l'équipement nécessaire et 13 millions de Français ont un dossier – nous enregistrons 30 000 ouvertures par jour !
Par ailleurs, nous avons bien sûr des chambres de discipline : lorsque des confrères ont perdu certains repères – cela arrive –, nous sommes obligés de les sanctionner. Enfin, l'association Croix verte et Ruban rouge, qui est complètement indépendante mais que nous soutenons financièrement, conseille depuis 1994 les pharmaciens sur tous les sujets relatifs à la toxicomanie.
J'en viens à nos propositions. À notre sens, il faut d'abord absolument développer la « e-prescription ». Cela réduirait notamment les mésusages du Subutex. Ensuite, on pourrait rendre obligatoire la mention, sur l'ordonnance, de l'officine chargée de délivrer ce même produit : actuellement, elle n'est exigée que pour le remboursement par la sécurité sociale. Par ailleurs, il faut bien sûr développer tout ce qui a trait à la prévention, ainsi qu'à la formation et à la sensibilisation du pharmacien.
En dehors de ces points, d'autres questions restent ouvertes. Ainsi, faut-il porter la durée maximale de prescription de la méthadone à vingt-huit jours, au lieu de quatorze ? Faut-il faire des études plus poussées sur la Suboxone ? C'est une association de buprénorphine et de naloxone qui est censée régler les problèmes de manque, mais qui est sans effet quand elle est injectée. Enfin, faut-il rendre le dossier pharmaceutique obligatoire pour ceux qui prennent du Subutex, de la méthadone ou d'autres médicaments de ce type ?
Pour finir, la toxicomanie est certes un problème majeur de santé publique et de société, mais les pharmaciens de terrain ont deux autres sujets d'inquiétude dont on ne se préoccupe pas suffisamment par ailleurs : les jeunes femmes qui fument et prennent la pilule – il va vraiment falloir se pencher sur la question – et la consommation d'alcool par les jeunes le soir et le week-end.

Merci. Ces deux derniers points nous importent, mais ne peuvent être traités dans le cadre de cette mission. Pour le reste, j'ai constaté que vous avez beaucoup de questions alors que ce sont les réponses qui nous intéressent…
Les pharmaciens sont présents sur l'ensemble du territoire ; ils font des efforts de formation ; ils disposent de Meddispar et d'un référent régional en addictologie. On ne peut que vous en féliciter. Peut-on encore améliorer les choses ? Pouvez-vous jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les mésusages ? Et que recouvre exactement l'addictovigilance ?
Il y a, à l'évidence, place pour des progrès. Pour commencer, il faudrait une sensibilisation plus poussée au cours des études et un effort supplémentaire de formation. Mais en matière de toxicomanie, les choses évoluent terriblement vite. Une formation presque récente peut ne plus être valable. Il faut donc des formations très organisées pour les confrères qui le souhaitent ou qui sont confrontés aux toxicomanies, en lien avec tous les réseaux, associations, instituts de formation et partenariats que nous avons.
Pour prendre mon exemple personnel, j'ai exercé jusqu'à l'année dernière dans un village du Morvan, mon officine desservant une zone où la population était de l'ordre d'une trentaine d'habitants au kilomètre carré. Vous imaginez bien que ces questions n'étaient pas prégnantes… Aujourd'hui, je suis dans le 18e arrondissement de Paris. Du jour au lendemain, j'ai connu un véritable choc : il faut tout revoir, y compris son attitude. Il faut arriver à communiquer avec la personne toxicomane que vous avez devant vous. Vous pouvez déclencher vous-même son agressivité, ou vous pouvez l'accepter telle qu'elle est et essayer d'avancer avec elle. Néanmoins, avec certains, cela reste difficile. Lorsque j'ai été entendue par la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) en janvier, j'avais déjà été agressée et je l'ai été de nouveau depuis. Un client est arrivé avec deux ordonnances, l'une pour du Rohypnol et du Rivotril, qui mentionnait bien la pharmacie Adenot, et l'autre pour du Subutex. J'ai refusé la vente, ce qui a déclenché une agressivité extrême. J'ai appelé le médecin prescripteur, qui exerce dans le Val-de-Marne alors que je suis dans le 18e et que le patient habite encore un autre arrondissement : il m'a sermonnée, soutenant que je n'avais pas le droit de refuser la vente. La personne est revenue deux fois dans la journée, perturbant l'activité de mon équipe, pour finir par m'expliquer en fin de soirée que, dans mon officine, j'étais sous la protection de la vidéosurveillance – c'est obligatoire à Paris – mais que, dès que je sortirais, je pouvais me faire « descendre » ! Tout cela pour bien vous faire comprendre à quel point le refus de vente peut poser problème.
Il faut donc une formation non seulement pour mieux connaître les produits et pour apprendre à sensibiliser la population ou à répondre aux sollicitations des jeunes et des parents, mais aussi pour communiquer avec les toxicomanes. Il faut savoir où sont les bornes à ne pas franchir, sous peine de se laisser entraîner aux dérives qui amènent certains de nos confrères en chambre de discipline.
Ces dérives existent en effet, qu'elles soient le fait de médecins qui, pour des raisons diverses, prescrivent ce qu'ils ne devraient pas ou de pharmaciens qui ferment délibérément les yeux sur les mésusages. Or il est difficile d'arrêter ces derniers : on peut certes signaler à quelqu'un qu'il prend un médicament à trop forte dose, mais le refus de vente déclenche les réactions que je vous ai décrites.
Quant au dispositif d'addictovigilance, il conduit parfois à saisir la justice mais, la plupart du temps, il se traduit par un colloque particulier avec le médecin : on le prévient qu'on a détecté une situation anormale, par exemple un patient qui voit plusieurs médecins et pharmaciens. Cela est rendu possible notamment par le dossier pharmaceutique. Comme il n'est pas obligatoire, quelqu'un qui prend, par exemple, du Subutex en est dépourvu mais, lorsque le toxicomane utilise une carte Vitale volée à un patient qui en avait ouvert un, le pharmacien a accès à toutes ses ordonnances… Cela étant, on retombe toujours sur le même problème et certains confrères ne refusent pas la vente par peur des conséquences.

Combien de pharmaciens font-ils l'objet d'une sanction disciplinaire et comment, à votre avis, en sont-ils arrivés là ?
En matière de toxicomanies, les cas sont exceptionnels : ce sont ceux de confrères qui se sont laissés déborder et finissent par se faire presque complices d'un trafic. Toute la difficulté pour la chambre de discipline est alors de faire la part des choses : qu'aurait-il fallu faire, et était-ce possible ? Ce qui conduit à examiner la localisation de l'officine, sa clientèle, l'environnement, les actions possibles avec la mairie et la police… Lorsqu'un confrère a commis une erreur, nous cherchons à l'aider, mais lorsqu'il a manifestement perdu ses repères, nous sommes obligés de le sanctionner.

Ce que vous dites sur les agressions est absolument terrible. Sait-on combien, au niveau national, sont liées aux toxicomanies ?
Par ailleurs, vous avez évoqué l'atout pour la communication que représente votre réseau d'officines, avec ses kilomètres de vitrines. Avez-vous déjà été sollicités, ou pourriez-vous l'être, pour faire de la prévention en direction des jeunes et de leurs parents ? J'ai vu des grands-parents s'informer sur la toxicomanie pour porter la bonne parole dans les collèges. Les pharmaciens auraient tout leur rôle dans ce domaine.
Il existe une fiche de déclaration d'agression. Le hasard veut que j'aie travaillé à son élaboration et c'est ce qui m'a amenée à m'impliquer plus fortement dans l'ordre des pharmaciens. Lorsque j'étais présidente du conseil régional de Bourgogne de l'ordre des pharmaciens, un drogué posait d'énormes problèmes. Sur les douze pharmaciens du territoire concerné, onze refusaient catégoriquement de le servir. Après concertation, le douzième a accepté de s'occuper de lui. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que les membres de son équipe se fassent agresser à la seringue. Le maire a été saisi, puis la police et la justice. Et j'ai alors été littéralement écoeurée, le procureur m'expliquant qu'il s'agissait d'un refus de vente et que les douze pharmaciens, qui avaient le monopole de la dispensation des médicaments, seraient condamnés en conséquence. J'ai clairement fait savoir que ce ne serait pas eux qu'il faudrait condamner, mais le président du conseil régional de l'ordre. Finalement, le préfet de région a pris les choses en mains – et il s'est avéré que le drogué était en sous-dosage et qu'il fallait le mettre sous méthadone.
Bref, il existe une déclaration d'agression – et des raisons très diverses de nous faire agresser. Je vous communiquerai les statistiques, mais elles sont très en dessous de la réalité. Au début, nous avions fait la publicité de ce dispositif dans les journaux ordinaux et nous avons enregistré mille déclarations ou plus sur une année, mais leur nombre a ensuite décliné progressivement – moi-même, je n'ai déclaré que la dernière des sept agressions dont j'ai été victime depuis cet été ! J'ai donc demandé qu'on relance le dispositif. Nous sommes notamment en train de travailler à la télédéclaration par internet, ce qui devrait faciliter l'utilisation de cette procédure. Les statistiques deviendront alors peut-être plus probantes. J'ajoute qu'un protocole va bientôt être signé avec le ministère de l'intérieur afin que les professionnels de santé victimes d'agression disposent d'un référent régional, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Pour la prévention, il existe des livres absolument remarquables, comme Drogues et dépendance ou Le cannabis : les risques expliqués aux parents, édités par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en collaboration avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Reste à les mettre à disposition, ce que certains confrères font mieux que d'autres. Nous y travaillons avec le CESPHARM. Sachant que les documents ne sont envoyés aux pharmaciens que sur demande, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure prennent tout leur poids.
Par ailleurs, imaginer le même message sur cent kilomètres de vitrines, c'est bien sûr merveilleux. L'été dernier, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a édité des affiches sur le thème « J'en ai besoin pour faire la fête ? » ou « La dépendance, ça commence quand ? » : les pharmaciens les ont trouvées « tristounettes » et, pour ma part, il a fallu qu'on m'explique certaines subtilités graphiques… Elles ont par conséquent peu été mises en valeur, ce que la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie nous a reproché à juste raison. Une solution, et pas seulement dans le domaine de l'addictologie, serait de fournir non seulement des affiches, mais des vitrines complètes aux pharmaciens, comme le font les laboratoires. Nos confrères ayant de moins en moins de temps, il faut leur envoyer un « pack ». Le CESPHARM est en train d'y travailler. Le résultat devrait être probant. Je ne peux pas vous dire quand cela sera réalisé, mais les instructions ont été données.
Merci pour votre intervention extrêmement intéressante. Je suis un consommateur de médicaments comme les autres, et je dois avouer que j'ignorais totalement l'existence du dossier pharmaceutique. Comment cela fonctionne-t-il ?
Comme je l'ai dit, les patients sont libres de faire, ou non, ouvrir ce dossier ; 13 millions de Français en ont déjà un, mais 17 % le refusent. C'est une base de données qui recense tous les médicaments – y compris ceux qui ne sont pas remboursés – que vous vous êtes fait délivrer au cours des quatre derniers mois dans n'importe quelle officine du territoire national. Le pharmacien ne peut y accéder que sous votre contrôle puisqu'il lui faut pour cela, outre sa carte professionnelle, votre carte Vitale. C'est l'ordre qui finance le dispositif, pour environ 4 millions d'euros par an, et qui en est le maître d'oeuvre, mais il n'a pas accès aux données : pour des raisons de confidentialité, personne ne peut avoir accès aux dossiers, hormis le pharmacien au moment de la délivrance. De ce fait, je ne puis, par exemple, vous dire combien de boîtes de Subutex sont délivrées chaque année en France. Au reste, en ce qui me concerne, je n'ouvre jamais de dossier pharmaceutique à quelqu'un qui est sous Subutex : il aurait le sentiment qu'on cherche à le contrôler. Surtout, j'ignore ce que veut la société à ce propos : empêcher le mésusage du Subutex, auquel cas il y aura transfert sur un autre produit, ou continuer à l'utiliser de façon contrôlée afin d'éviter ces transferts ? Car il suffit d'obliger toute personne sous Subutex à ouvrir un dossier pharmaceutique pour stopper immédiatement le mésusage.
Je pense que la plupart font comme moi, mais je n'ai pas de données sur ce point. Néanmoins, certains patients sous Subutex nous demandent de les aider. C'est le bienfait de ce produit : les intéressés réduisent leur consommation, retrouvent une vie sociale normale, travaillent, ont des enfants. Ceux-là nous demandent de les aider à ne pas replonger et c'est vraiment un plaisir, pour le pharmacien, de les accompagner.

Le dossier pharmaceutique était censé éviter le nomadisme médical. Si les patients sous Subutex peuvent le refuser, ils échappent à votre regard.
Le dossier pharmaceutique n'a pas été conçu pour contrôler les personnes, mais pour éviter les interactions entre médicaments. Dans le cas du Subutex, l'interaction avec les benzodiazépines comme le Rohypnol ou le Rivotril a des conséquences graves. Nous insistons d'ailleurs auprès de la commission compétente de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour qu'elle classe ce dernier médicament comme stupéfiant ou, à tout le moins, parmi les substances exigeant une ordonnance sécurisée. Ce produit est en effet impliqué dans des affaires de viol – en France mais aussi au Maghreb, car nous voyons passer beaucoup d'ordonnances pour cette région.
Vous avez évoqué un nouveau médicament censé réduire la dépendance, la Suboxone. Où les recherches en sont-elles ? Est-elle en vente ?
La Suboxone n'est pas en vente en France, bien qu'elle ait reçu son autorisation de mise sur le marché européenne en 2006. Elle associe la buprénorphine et la naloxone qui est un antagoniste des récepteurs des opioïdes. En principe, lorsqu'elle est injectée, la Suboxone augmente l'effet de manque, ce qu'aucun drogué ne recherche, alors que, quand elle est administrée par voie sublinguale, seule la buprénorphine passe dans le sang, ce qui permet d'arriver au résultat souhaité. Le malheur, c'est que les drogués sont portés à s'injecter tout et n'importe quoi. Par ailleurs, la revue Prescrire a mis en doute l'efficacité de ce médicament. Le problème aujourd'hui est donc de savoir si nous devons définitivement l'oublier ou, enfin, le soumettre à des études sérieuses.
Peut-il être utilisé pour combattre les addictions alcooliques ?
Pas à ma connaissance.

Le fait d'être pharmacien en activité apporte beaucoup à vos réponses. Menez-vous une réflexion commune avec l'ordre des médecins sur les questions de sécurité ? Il me semble que le sujet exige surtout un travail en partenariat avec les collectivités territoriales, avec les forces de police ou de gendarmerie, avec les médecins, avec les associations et avec les services publics de santé et de psychiatrie. Il devrait dès lors relever des contrats locaux de sécurité et donner lieu à l'élaboration d'une « fiche-action », de nature à favoriser les échanges entre tous ces acteurs – les associations de terrain, en particulier, pourraient sans doute beaucoup vous aider.
Cela étant, avez-vous le sentiment de concourir à limiter les risques en dispensant ces produits ? Ayant donné votre accord pour participer à la distribution de matériel d'injection, en éprouvez-vous un vague sentiment de complicité ou estimez-vous qu'il vaut la peine de s'assurer que les gens utilisent du matériel stérile ?
Je continue d'exercer, et j'y tiens. Je ne conçois pas une présidence « en lévitation ».
Nous n'avons pas de discussions avec l'ordre des médecins sur le problème des agressions. Nous le devrions, assurément, mais nous sommes requis par de nombreux autres sujets importants et M. Legmann et moi n'avons jamais abordé la question.
Je me réjouis vivement de la signature, avec le ministère de l'intérieur, du protocole que je mentionnais tout à l'heure : cela témoigne d'une prise de conscience bienvenue. Mais d'autres partenariats sont évidemment nécessaires. La participation aux réseaux se développe dans notre profession. Le problème, c'est que c'est un mille-feuille : il y a un réseau pour la diabétologie, un pour la fin de vie, un pour la toxicomanie… Le pharmacien est certes un généraliste, mais il ne peut participer à tous. Il faut donc tout faire pour faciliter l'information et un dispositif comme la fiche-action pourrait en effet nous donner des moyens opérationnels pour faire face immédiatement à une situation difficile.
Il ne me paraît pas niable que la profession contribue à réduire les risques. En tout cas, elle a beaucoup travaillé en ce sens.
D'après certains rapports. Nous n'avons pas de statistiques propres sur ce sujet, pas plus que sur le nombre de personnes sous Subutex : peut-être 130 000… Ce sont les caisses de sécurité sociale qui ont les données précises mais je pourrai vous communiquer le nombre de boîtes vendues par dosage après avoir consulté la base de données IMS.
Nous contribuons donc à limiter les risques mais chaque nouveau programme ou dispositif suscite une réaction ambivalente chez nos confrères. Comme je l'ai dit, aux termes du code de la santé publique, le pharmacien est celui qui dispense les médicaments, mais aussi celui qui est tenu de refuser la vente s'il estime que le produit nuit à la santé du patient. Les deux dispositions ne sont en rien contradictoires, mais la balance est difficile à tenir, ce qui nous amène à nous interroger, qu'il s'agisse de la distribution des seringues et du Subutex, des salles d'injection – encore que, sur ce point, nous ne soyons pas très concernés – ou, surtout, des programmes d'échange de seringues. Chaque pharmacien a sa position, qui peut de plus varier en fonction du contexte. D'un côté, nous sommes conscients qu'il importe de réduire les risques de contamination par le VIH ou par le virus de l'hépatite et que tout ce qui peut y contribuer est un moindre mal. Ainsi mes confrères considèrent-ils maintenant le Subutex comme un outil d'accompagnement pour la santé, parce qu'ils voient bien que, malgré toutes les dérives, il ouvre l'espoir de réduire les doses et de mettre fin à la dépendance. De l'autre côté, nous avons des dispositifs qui aboutissent au maintien de cette dépendance. C'est le cas du programme d'échange de seringues, auquel la profession n'est pas très favorable pour cette raison. C'est aussi le cas pour les salles d'injection – même si nous touchons là à un débat de société, et non de professionnels. Au surplus, l'ouverture de ces lieux soulèverait bien des questions : faut-il par exemple contrôler la qualité des drogues utilisées ou accepter que le toxicomane s'injecte ce qu'il apporte ?
Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question d'injonctions : il faut amener petit à petit la profession à évoluer, ce qui n'est pas si facile dans un tel domaine.

Il faut bien comprendre que le pharmacien est soumis à plus d'agressions que le médecin. Le toxicomane qui a obtenu son ordonnance sous contrainte s'en va. Dans l'officine, il sait que le produit est juste à portée de main…
De la part de nos collègues, il y a une sous-déclaration évidente, d'abord parce que beaucoup ne connaissent pas la procédure et ensuite parce que ce qui choquerait la plupart des gens – se faire traiter de tous les noms, voir le drogué passer de l'autre côté du comptoir… – devient, pour ceux qui sont confrontés à des centaines de toxicomanes, une habitude… jusqu'au moment où se produit une agression grave. Dans ma pharmacie, j'ai été confrontée deux fois à une arme à feu, une fois à une arme blanche, sans compter le bris de ma vitrine. Quand on s'est retrouvé avec une lame de rasoir sur la jugulaire, ce n'est plus à l'ordre qu'on s'adresse : on va voir la police ! Cependant, même avec une arme à feu sur la tempe, on ne cède pas parce qu'on sait que si l'on commence, cela ne finira jamais. Le problème étant qu'un jour, le coup peut partir…
Une question me taraude : que faire vis-à-vis des pharmaciens qui, préférant vendre du vernis à ongle, refusent de délivrer du Subutex ou de la méthadone à des gens qui ne cherchent qu'à s'en sortir ? Ou vis-à-vis de ceux qui emploient des gardes privés pour interdire l'entrée de leur officine aux toxicomanes ? Faut-il les dénoncer au conseil régional de l'ordre ? Ce n'est pas franchement souhaitable, mais il y a des endroits où ce sont toujours les mêmes médecins et pharmaciens qui prennent en charge les toxicomanes.
Par ailleurs, s'il est vrai que les pharmaciens sont sollicités pour participer à une multitude de réseaux, le traitement des toxicomanies est certainement le domaine pour lequel, avant tout autre, cette participation s'impose. On n'a pas besoin d'appartenir à un réseau pour apprendre à une personne âgée comment contrôler son taux de glycémie ; en revanche, c'est un gros atout pour qui risque d'être confronté à un toxicomane en pleine crise de manque. Avoir à ses côtés des assistants sociaux, des travailleurs de rue, des médecins qui ont le même engagement permet de mieux s'en sortir. L'ordre ne peut-il pas mettre l'accent sur ce point, d'autant qu'un toxicomane qui se sait suivi par un centre spécialisé, par un médecin et par un pharmacien est moins susceptible de se comporter dangereusement ?
Enfin, je pense, moi aussi, que la contribution des pharmaciens à la prise en charge de la toxicomanie est essentielle. À cet égard, que pensez-vous de la récente attaque à laquelle s'est livré M. Frédéric Van Roekeghem contre le dispositif mis en place en Haute-Garonne pour combattre les mésusages ? Il s'agissait de faire travailler ensemble les médecins, les pharmaciens et la sécurité sociale pour repérer les « mégaconsommateurs », dont tout porte à croire qu'ils alimentent l'économie souterraine de la drogue. Le médecin conseil vérifiait les remboursements et, le cas échéant, un médecin et un pharmacien étaient nommément désignés pour s'occuper du patient, tous les autres étant avertis de refuser la délivrance. Un tel dispositif est loin d'être parfait en raison de son caractère autoritaire et parce qu'il pose problème au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mais il permet de juguler rapidement des dérives. M. Michel Laspougeas, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, m'a interpellée sur ce point et nous attendons la réaction de M. Xavier Bertrand, ministre chargé de la santé. Quel est votre point de vue ?
L'encadrement limite incontestablement les dérives, comme le confirme la comparaison entre méthadone et Subutex. Le problème est que les patients savent très bien s'orienter entre les pharmaciens au comportement professionnel ou libéral – appelez cela comme vous voudrez – et ceux qui ne veulent pas d'eux. Faut-il limiter le nombre de toxicomanes qu'une officine peut prendre en charge afin d'obliger ses voisines à faire leur part ? On peut l'envisager mais je ne suis pas tout à fait convaincue que ce soit viable, parce qu'on touche là à quelque chose d'essentiel : la clause de conscience, qui fait largement débat en ce moment, l'Association française des pharmaciens catholiques demandant à pouvoir s'en prévaloir, comme leurs collègues italiens, en ce qui concerne les médicaments pour l'interruption volontaire de grossesse. Quelle que soit la décision, je ne pense pas qu'on puisse user de l'injonction à l'égard de ceux qui se sentiraient devenir de véritables « dealers en blouse blanche ». On peut les sensibiliser, les amener à entrer petit à petit dans un schéma, mais pas les obliger. Il est au reste très facile de ne pas avoir le bon médicament au bon moment : le toxicomane ne reviendra pas. C'est ainsi que tous se concentrent sur les pharmacies réputées avoir du stock, même un samedi soir. Cela étant, il est possible de rappeler leurs obligations à nos confrères, et l'ordre va bientôt publier un article en ce sens.
Une prescription de Subutex s'accompagne toujours de la mention du nom du médecin et du pharmacien chargé de délivrer le produit, ce qui est très bien à ceci près que le même patient peut avoir plusieurs couples de médecins et de pharmaciens. C'est ce qui a motivé des actions comme celle que vous avez citée, en Haute-Garonne. À titre personnel, j'approuve l'initiative, et l'ordre s'y était d'ailleurs impliqué, mais on ne peut envisager d'étendre la mesure tant qu'on n'aura pas répondu à une question préalable, qui est : voulons-nous, oui ou non, nous donner les moyens d'arrêter les trafics ? Parce que, si nous le voulons, nous le pouvons ! Ce sont les règles qui aident les toxicomanes à s'en sortir : un dispositif comme celui de la Haute-Garonne, ou comme le dossier pharmaceutique obligatoire, donnerait un coup d'arrêt immédiat aux trafics.

J'ai voulu faire installer des distributeurs-échangeurs de seringues devant certaines pharmacies, ouvertes jusqu'à deux heures du matin et situées le long de grands axes de circulation… Elles ont toutes refusé, les petites sous prétexte que c'était dangereux, alors même que ces distributeurs sont généralement utilisés en dehors des heures d'ouverture, et les grandes au motif que cela allait attirer les toxicomanes. J'ai fini par en mettre un devant la mairie, là où il y a tellement de panneaux que personne ne le voit… Je souhaiterais que les pharmacies importantes, bien situées, dans des zones bien éclairées, participent à cet effort qui contribue à la réduction des risques.
Par ailleurs, en tant que médecin, j'ai été il y a longtemps membre d'un réseau de suivi des toxicomanes. Étant déjà élu local et disposant donc de peu de temps, j'avais demandé à ne prendre en charge qu'un petit nombre d'entre eux, mais cela allégeait d'autant le fardeau des autres. Je me félicite de l'expérience. Tout se passait bien dans la salle d'attente, où le jeune couple de « toxicos » venu chercher sa prescription de Subutex côtoyait les gens du quartier. Il faut bien insister sur le fait que ce n'est pas terrible de s'occuper de ces personnes, et que c'est quand certaines pharmacies ne font pas leur part que la situation devient incontrôlable.
Le Portugal s'est lancé dans un programme d'échanges de seringues. En France, les pharmaciens s'impliquent dans le dispositif, mais il y a débat sur la gestion des seringues dans le cadre de la collecte des déchets d'auto-soin. Nous attendons avec une très grande impatience le décret qui doit paraître. Tant que ce point ne sera pas réglé, je ne pense pas que la profession s'engage plus avant.
Aujourd'hui, les pharmaciens sont prêts pour la récupération des seringues utilisées pour l'auto-traitement du diabète, par exemple, mais cela n'a pas été sans mal et l'on peut comprendre que les syndicats tiennent à avoir leur mot car cette récupération, qui s'accompagne de toute une série d'obligations légales, a un coût.
Certains ont des distributeurs-échangeurs, mais ces machines tombent souvent en panne et ont, en tout état de cause, un fonctionnement compliqué, avec leur double circuit, entre la seringue qu'on rend et celle qu'on récupère, le tout avec un système de jetons. S'ajoutent à cela des questions de traçabilité… Je relaierai bien sûr votre demande, mais il faut être conscient que ce sera une charge supplémentaire pour nos confrères.
Faut-il ou non imposer un nombre limité de prises en charge ? Il y a des avantages et des inconvénients dans l'un et l'autre cas. Étant une parfaite libérale, j'inclinerais à laisser faire le « marché ». En cas de dysfonctionnement, c'est localement qu'il faut trouver des solutions. Ce n'est pas du ressort de la loi, mais de celui de l'agence régionale de santé, qui connaît bien le bassin de vie.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite Mme Dominique LE BŒUF, présidente du Conseil national de l'ordre des infirmiers, et M. Alain MARTIN, président du conseil régional de Lorraine de l'ordre des infirmiers.

Madame, monsieur, pourriez-vous nous dire quelle est la place des infirmiers dans le dispositif français de prévention et de prise en charge des toxicomanies ? Jugez-vous ce dispositif efficace et adapté ou pensez-vous qu'il pourrait être amélioré ? Quelles difficultés particulières avez-vous rencontrées dans votre expérience professionnelle de la toxicomanie ?
La place des infirmiers dans la prévention et la prise en charge des toxicomanies est importante puisque nous sommes susceptibles de rencontrer le toxicomane à tous les âges de sa vie. En effet, cette prise en charge ne se cantonne pas à l'hôpital : elle peut avoir lieu dès l'école et le collège, où exercent les infirmières scolaires, ainsi que dans le monde de l'entreprise. D'autre part, nous sommes de plus en plus confrontés à des phénomènes de toxicomanie chronique, avec toutes les conséquences que cela implique, notamment en matière de traitement médicamenteux, et le travail des infirmières consiste de ce fait davantage en un suivi qu'en la gestion de situations de crise.
La prévention de la toxicomanie fait naturellement partie de nos missions et elle commence dès le milieu scolaire. Conformément aux prescriptions du Plan de lutte contre les drogues et les toxicomanies, l'ordre travaille en ce moment, avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sur la notion de repérage des toxicomanes, le plan prévoyant la mise en place de formations des infirmiers scolaires dans ce domaine.
Je voudrais également mettre l'accent sur un phénomène que nous rencontrons de plus en plus fréquemment : la polypathologie des toxicomanes. Son incidence sur la prise en charge du patient n'est pas négligeable, puisque nous devons à la fois gérer son addiction et soigner ses maladies.
Une trentaine d'années d'activité au sein de structures publiques de prise en charge de patients toxicomanes m'a permis de voir évoluer les concepts et les pratiques en la matière. Au début de ma carrière, on parlait de drogués, voire de marginaux, alors qu'on parle aujourd'hui de conduites addictives. L'évolution ne se réduit cependant pas à un changement terminologique. Dans les années 1970, le professeur Claude Olievenstein, pionnier dans la prise en charge des patients dépendants de produits illicites, a ouvert le centre de Marmottan. La loi du 31 décembre 1970, loi prohibitionniste, pénalisant l'usage de ces produits, fut une révolution dont nous sommes les héritiers. Il s'agissait alors d'accompagner les patients vers l'indépendance, voire l'abstinence, celle-ci étant le seul outil à notre disposition pour traiter cette pathologie.
L'autre évolution majeure a eu lieu dans les années 1984-1985, quand l'émergence du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) vint changer la donne. Les toxicomanes injecteurs constituant une population à risque, l'épidémie nous a contraints de revoir complètement la prise en charge de ces patients. Alors qu'on considérait jusqu'ici la toxicomanie comme un symptôme de mal-être plus que comme une maladie, on en est venu à médicaliser le traitement des dépendances et à mettre de plus en plus l'accent sur la réduction des risques. La première à s'engager dans cette voie fut Mme Michèle Barzach qui autorisa la vente libre des seringues, mais c'est au nom de la même politique de santé publique qu'ont été ensuite autorisés les traitements substitutifs aux opiacés. Il a néanmoins fallu attendre l'année 1995 pour que la méthadone bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.
Sans vouloir opposer des pratiques qui ont toutes leurs vertus, la politique de réduction des risques me semble plus pragmatique que les excès du « tout psy » qui l'avaient précédée. Reste que nous avons tous, soignants, sujets dépendants et familles, été victimes d'une illusion partagée : celle de penser que les traitements de substitution aux opiacés étaient « le » traitement de la toxicomanie. Il est vrai qu'ils nous donnent du temps, élément essentiel dans la prise en charge de toxicomanes qui sont, eux, dans l'immédiateté et le « tout, tout de suite ». Mais s'ils permettent le sevrage des produits illicites, les traitements de substitution aux opiacés entraînent une dépendance majeure et il s'avère extrêmement difficile de se débarrasser de la « béquille ». Il serait peut-être temps de dresser le bilan de ces traitements, avant de lancer le débat sur les salles d'injection supervisées.
Force est de constater que nous sommes désormais engagés dans des prises en charge longues de patients sous traitements de substitution aux opiacés. Si ces traitements sont assez confortables pour les sujets, qui ne souffrent plus du manque, ils font problème en ce qu'on n'en voit pas la fin. Disant cela, je ne cherche pas à nier leurs bienfaits du point de vue de la santé publique : ils ont permis notamment de réduire considérablement le nombre des surdoses. Je pose simplement la question : et après ? Que faire de toutes ces cohortes de patients qui se retrouvent en médecine de ville, puisqu'il est hors de question qu'ils deviennent dépendants de structures spécialisées, forcément stigmatisantes ? Je persiste à penser, en effet, qu'aussi longtemps qu'on vient chercher son produit de substitution dans un centre de soins, on reste un toxicomane dans sa tête.
Je voudrais également évoquer la question des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qui regroupent moyens et personnels en addictologie, qu'il s'agisse d'alcoologie, de tabacologie ou de toxicologie. Certes, on manque encore du recul suffisant pour évaluer les résultats de ces centres, d'autant qu'il n'y en a pas sur tout le territoire. Mais l'idée d'instaurer une porte d'entrée unique pour toutes les formes de dépendance est une bonne idée : ce guichet unique doit permettre de traiter les polytoxicomanes qui nous échappaient jusqu'ici. Si l'avantage est incontestable pour les patients, les équipes devront avoir à coeur d'établir un projet de soins très clair afin que chacun trouve sa place dans le dispositif.

Quelle est la place des infirmiers dans le milieu scolaire et sur les lieux de travail ? Ceux de vos collègues qui y travaillent sont-ils formés au traitement des toxicomanies ?
L'Éducation nationale a lancé un grand nombre d'expérimentations s'agissant du repérage et du suivi des élèves toxicomanes. Le rôle des infirmières scolaires est surtout de faire de la prévention, mais on leur demande de plus en plus d'être capables de détecter et d'orienter ces jeunes toxicomanes, et elles sont de plus en plus formées à percevoir les alertes, à y répondre et à assurer le suivi d'adolescents qui doivent absolument pouvoir trouver un interlocuteur. Telles sont les questions sur lesquelles nous travaillons avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
En entreprise, la question est celle du maintien du toxicomane dans son milieu de travail afin d'éviter sa marginalisation. La vigilance quotidienne que cela impose à l'infirmier est encore plus nécessaire dans les métiers à risque où la prise d'un traitement peut vous exposer à des accidents du travail.
Dans les deux cas, nous avons une mission de prévention, même lorsqu'il s'agit d'adultes, et de suivi de l'observance du traitement en cas de toxicomanie avérée, d'autant que celle-ci s'accompagne souvent de pathologies associées. Il s'agit aussi pour nous de gérer le risque, afin d'éviter toute marginalisation de ces toxicomanes qui ne doivent pas devenir des assistés.

Vos témoignages présentent le grand mérite de refléter une expérience quotidienne du terrain.
Les jeunes qui s'adressent aux infirmières scolaires sont-ils déjà des consommateurs de drogues qui veulent mettre un terme à leur consommation ? Demandent-ils des conseils ou un accompagnement ? Les orientez-vous vers une structure de soins ? Bénéficiez-vous de l'appui d'un référent au niveau des académies ?
Vous avez exprimé votre désillusion à l'égard des traitements de substitution aux opiacés. Ces traitements ont-ils fait l'objet d'une évaluation depuis leur mise en place ? Que fait-on des 150 000 personnes qui sont sous substitution aujourd'hui ? Si ces patients doivent suivre ces traitements à vie, ne leur faudra-t-il pas aussi un accompagnement à vie ?
Les infirmières scolaires disposent, au ministère de l'éducation nationale, d'un interlocuteur unique en charge de l'ensemble de ces questions. S'agissant des jeunes qui sont déjà consommateurs de drogues, toute la question est de les repérer et de leur apporter la réponse la plus rapide possible. Le problème, c'est que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie souffrent d'un défaut de visibilité. Il est vrai qu'il s'agit d'une institution très récente et que les jeunes ne s'y retrouvent pas nécessairement. L'important, c'est qu'ils disposent d'un interlocuteur au sein des établissements scolaires. C'est tout l'intérêt des expérimentations que l'Éducation nationale est en train de mettre en place. Je pense notamment à ce que fait l'académie de Versailles : les infirmières scolaires y sont formées à repérer et orienter les jeunes à risque. Mais cela suppose que les structures auxquelles on peut adresser ces jeunes soient clairement identifiées. Il ne faudra pas non plus négliger les retours d'expérience.

Ne manque-t-il pas une structure susceptible d'accueillir ces jeunes, puisque les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ne semblent pas convenir à ce type de public ?
Il faut prendre garde à ne pas créer sans cesse de nouvelles structures si on veut que ces publics sachent à qui s'adresser. S'il est vrai que ces centres sont trop spécialisés dans le traitement des toxicomanies avancées, ils présentent l'avantage d'être bien identifiés dans un paysage qui souffre d'un manque de lisibilité. Il faudrait plutôt renforcer le réseau relationnel et les possibilités d'échanges entre l'Éducation nationale et les institutions sanitaires.
À la demande du Gouvernement, des consultations d'évaluation et d'accompagnement pour jeunes consommateurs de cannabis ont été mises en place sur tout le territoire – celle de Nancy date de 2004 –, et elles sont distinctes du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ce qui prouve qu'on fait la différence entre toxicomanie avérée et usage « récréatif ». Ces structures sont en principe destinées aux jeunes en difficulté avec ces produits, mais l'expérience montre qu'elles ne touchent pas forcément les publics initialement visés : nous rencontrons dans ces consultations des personnes qui ont déjà une vingtaine d'années, alors que les plus jeunes nous échappent. À mon avis, ces consultations pourraient sans dommage être intégrées à un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, conformément à sa vocation de guichet unique, d'autant que l'ensemble du dispositif souffre déjà d'un déficit de lisibilité auprès des professionnels de santé eux-mêmes. Il faudrait peut-être faire en sorte que ces centres de soins répondent aux besoins des consommateurs les plus jeunes, sachant que les adolescents ont du mal à consulter. On pourrait aussi aborder les problèmes de dépendance au sein des maisons des adolescents et, d'autre part, il conviendrait certainement de réintroduire les généralistes dans le dispositif.
Il faudrait également donner corps aux prescriptions de la circulaire du 29 mars 1972 relative à l'organisation sanitaire dans le domaine de la toxicomanie qui prévoit une prise en charge des parents et de l'entourage des jeunes usagers. Je rencontre en consultation des parents complètement désorientés face à la consommation de leurs enfants, ne sachant s'il faut les envoyer en psychiatrie ou les dénoncer à la police. Il ne faut pas faire comme si les toxicomanes n'avaient pas de parents, même si les relations sont parfois tendues. On doit au contraire inciter la famille à faire un travail sur elle-même, d'autant que le toxicomane est souvent porteur d'un symptôme familial.

Ce que vous venez de dire nous rappelle que la toxicomanie est la rencontre entre un individu et un produit. Il s'agit de rompre ce « colloque singulier » en faisant intervenir toute une série de partenaires.
À propos des infirmières scolaires, on ne peut pas ne pas évoquer le problème du manque d'effectifs : j'ai l'exemple d'un lycée de Toulouse qui compte une seule infirmière pour 1 600 élèves. Ce déficit est d'autant plus grave qu'on leur assigne un nombre croissant de missions.
Vous dites qu'elles sont désormais formées à repérer la consommation de drogues par les élèves, mais le problème de la consommation de cannabis, c'est qu'elle est peu visible, même si le décrochage scolaire est rapide. N'avez-vous pas l'impression que les enseignants répugnent à faire part de leurs soupçons aux infirmières et qu'on préfère souvent poser une chape de plomb sur ces phénomènes, à la demande parfois du proviseur lui-même, soucieux de la réputation de son établissement ?
Vous avez raison, les dispositifs souffrent déjà d'assez de dispersion pour qu'on n'y ajoute pas. Certains professionnels de santé ne connaissent toujours pas le nouveau numéro où joindre le service public d'information, de prévention, d'orientation et de conseil à distance concernant les addictions, l'ancien Drogues Info Service devenu ADALIS, Addictions drogues alcool info service.
Je suis tout à fait d'accord avec vous : nous manquons d'infirmiers – comme d'ailleurs de médecins – de santé scolaire. Il est vrai que la question de la prévention de la toxicomanie est devenue essentielle pour eux ; ils sont davantage sollicités dans ce domaine et ils se forment.
Les infirmiers scolaires nous rapportent en effet que les enseignants se désintéressent des élèves qui succombent au cannabis – quand ils ne préfèrent pas ce comportement à celui d'élèves perturbateurs ! Mais il arrive aussi que des proviseurs fassent pression sur ces mêmes professeurs pour qu'ils se livrent à des dénonciations. Aucune de ces deux attitudes ne permet de gérer le risque. Différentes expérimentations en milieu scolaire, et même à l'université, ont permis aux infirmiers de se doter d'outils de réponse, en dépit du manque de moyens, mais cela ne suffit pas. Nous espérons que le prochain plan « Santé » nous apportera de nouveaux éléments, beaucoup d'infirmiers scolaires demandant à l'ordre de travailler sur ce sujet. Vous devez savoir que la prise en charge de toxicomanes est une tâche particulièrement usante, et je peux comprendre que des enseignants reculent devant la lourdeur et la complexité de ce travail. Il faudrait trouver des outils pour les aider.

La note que vous nous avez remise évoque la prise en charge des personnes dépendantes depuis longtemps, qui menace de devenir un grave problème de santé publique.
On néglige en effet trop souvent la question, nouvelle, des toxicomanes vieillissants sous traitements de substitution aux opiacés. Ces patients, qui souffrent souvent de pathologies associées telles que diabète, troubles cardio-vasculaires ou cancers, commencent à être considérés comme des malades chroniques. Cette entrée dans la chronicité conduit à se préoccuper de l'observance : il s'agit de gérer le rapport bénéfice-coût de ces traitements au mieux de l'intérêt de la société. Il est incontestable que les traitements de substitution aux opiacés ont permis de réduire non seulement le nombre des surdoses, mais également celui des hospitalisations et de tous les traitements lourds que celles-ci supposent.
En vérité, je n'ai pas de recettes à vous proposer, car nous manquons de recul sur ce phénomène nouveau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous gérons ces patients comme tous les malades chroniques : il s'agit de leur permettre d'être insérés dans le monde du travail tout en suivant leur traitement et d'anticiper les crises afin d'éviter les « accidents de la vie ». Ce phénomène me fait penser à la situation des personnes infectées par le VIH : grâce aux nouveaux traitements, cette maladie, de mortelle qu'elle était, est devenue chronique, ce dont on ne peut que se féliciter. Reste qu'on ignore comment va évoluer cette situation inédite.

La Suisse, qui a été pionnière dans le domaine des traitements de substitution aux opiacés, se retrouve obligée aujourd'hui d'ouvrir des « homes » d'accueil pour des toxicomanes quadragénaires dont on ne sait plus que faire.
Il y a aussi la question du maintien dans l'emploi, avec tous les risques qu'il comporte. Nous manquons d'autant plus de recul sur ces problèmes de société que notre ordre est jeune. Nous apprenons en marchant.

Quelle est la position de l'ordre en ce qui concerne la solution, fort controversée, des centres d'injection supervisés ?
Nous n'avons pas encore débattu du sujet. La question est très complexe puisqu'il s'agit de savoir si on doit rendre licite l'illicite sous prétexte de gérer le risque. Où s'arrêter, et comment gérer la règle ?
La séance est levée à dix-neuf heures cinq.