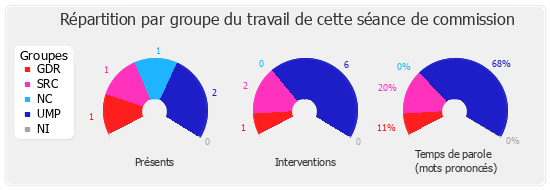Commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe a
Séance du 13 avril 2010 à 17h00
La séance
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MANIÈRE DONT A ÉTÉ PROGRAMMÉE, EXPLIQUÉE ET GÉRÉE LA CAMPAGNE DE VACCINATION DE LA GRIPPE A(H1N1)
Mardi 13 avril 2010
La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq.
(Présidence de M. Jean-Christophe Lagarde, président de la commission d'enquête)
La Commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) entend M. Michel Setbon, sociologue au Centre national de la recherche scientifique et à l'École des hautes études en santé publique.

Nous accueillons M. Michel Setbon, sociologue au Centre national de la recherche scientifique et à l'École des hautes études en santé publique.
M. Michel Setbon prête serment.
Mon parcours de chercheur, orienté vers la sociologie de la santé publique et des crises sanitaires, privilégie une approche interdisciplinaire. Il a été scandé par plusieurs crises sanitaires, dont trois essentielles : l'émergence du VIH et les contaminations post-transfusionnelles qui ont suivi ; la crise de la « vache folle » ; les maladies infectieuses émergentes présentant des risques épidémiques, dont la grippe A est le dernier avatar après le chikungunya, la dengue, etc.
De cette longue expérience en matière de recherche, j'ai retenu que l'on ne peut traiter correctement un problème émergent de santé publique sans un effort massif et soutenu pour améliorer nos connaissances sur trois sujets : sur l'agent infectieux lui-même ; sur la façon dont il se propage – données épidémiologiques recueillies au fur et à mesure, cibles atteintes, facteurs de risque que l'on découvre petit à petit, intensité de la propagation... – ; enfin, sur la perception, les comportements et les réactions du public exposé.
De ces éléments susceptibles d'éclairer et d'orienter la réponse publique, le troisième a toujours été négligé, voire ignoré. C'est pour moi la cause principale de nos échecs et des désastres qui en ont résulté : désastre sanitaire pour ce qui est de la contamination post-transfusionnelle par le VIH ; désastre socio-économique pour ce qui est de la vache folle ; désastre stratégique et économique dans le cas de la grippe A.
Le modèle suivi invariablement dans toutes ces crises est de type « top-down » : quelques experts énoncent certaines connaissances ou certaines prédictions à un moment donné ; les politiques et les administratifs déterminent « la » bonne solution pour y faire face ; et le public n'a qu'à s'y conformer !
Le problème est que ce modèle ne marche pas, comme on l'a vu dans les trois grandes crises que j'ai évoquées.
En 1983, on avait demandé aux centres de transfusion sanguine d'écarter les donneurs présentant un facteur de risque et susceptibles de transmettre le nouvel agent, et à ces personnes de ne pas se rendre dans les centres. Cela n'a pas été suivi d'effet.
En 1998-1999, en dépit de nombreuses et coûteuses décisions en matière de sécurisation de la viande bovine, des farines animales, etc., le public s'est détourné massivement de la consommation de viande bovine et le coût de l'opération a été prohibitif.
En 2009, on a demandé aux Français de se faire vacciner. Or seuls 10 % l'ont fait à ce jour.
Ces crises sont certes différentes, mais toutes montrent que les individus, exposés à un risque en même temps qu'à une consigne visant à les protéger et à protéger autrui, ne sont pas des sujets passifs mais bien les décideurs finaux, ceux qui ont la latitude de mettre ou non en oeuvre les décisions énoncées. Ces décisions sont souvent fondées, bonnes, mais on ne se préoccupe pas de savoir comment le public les comprendra, les interprétera et les appliquera. Or c'est lui qui détient la clé.
C'est un point crucial pour toutes les actions de santé publique dans les pays démocratiques développés : si les comportements des citoyens-acteurs décident de la réussite ou de l'échec d'un programme, il est impératif d'en découvrir les mécanismes et les déterminants. Or, en France, on ne s'y intéresse pas. On ne voit pas ces données-là alors qu'il existe quantité de travaux scientifiques publiés sur lesquels s'appuyer pour mener des recherches fécondes et produire des connaissances utilisables.
Dans le cas de la grippe A, nous disposions d'un avantage inédit par rapport aux crises précédentes, celui d'avoir anticipé l'arrivée d'une pandémie. C'était une première en matière de santé publique. Cela dit, anticiper ne signifie en rien prédire ce qui se passera. La nature, l'intensité et les caractéristiques de la pandémie à venir dépendent de nombreux paramètres qui sont totalement ignorés au moment de l'anticipation : gravité, prévalence, facteurs de risque, cibles les plus vulnérables, etc. On ignore également quels seront les comportements adoptés par la population. Il faut donc passer par des recherches.
Les facteurs qui déterminent le choix de se faire ou non vacciner sont bien connus. Ils sont en lien direct avec les perceptions que les individus ont du risque auquel ils sont exposés. De nombreux travaux empiriques puis théoriques ont montré pourquoi une personne décide volontairement de se faire vacciner, par type de population par exemple, en fonction de l'agent contre lequel il s'agit de s'immuniser. On sait également comment la profession médicale perçoit la vaccination et se comporte, etc.
Les individus se posent les mêmes questions que les scientifiques mais ils y apportent des réponses différentes.
En premier lieu, croient-ils ou non à l'imminence annoncée d'une pandémie ? L'exemple de la grippe aviaire H5N1 a montré que les Français pouvaient douter de la réalité d'un tel phénomène.
Ensuite, s'ils pensent que la pandémie va arriver, la perçoivent-ils comme grave ? Se perçoivent-ils eux-mêmes comme susceptibles de contracter la maladie ? Sur quelle expérience fondent-ils ce jugement ? Quel rapport bénéficerisque chacun établit-il à la mesure de ses compétences, de son expérience et de ses connaissances ? Faut-il faire confiance aux autorités sanitaires et au discours qu'elles tiennent ? Quelle est l'influence du médecin ?... Toutes ces questions sont fondamentales pour comprendre et prédire comment les gens se comporteront en fonction de la nature de l'épidémie.
Après certaines difficultés, nous avons pu réaliser une première enquête financée par le service d'information du Gouvernement, le SIG, en juin 2009, soit un mois et demi après l'annonce de la pandémie. Nous avons posé quelques questions sur la vaccination puisque nous savions que, dès qu'un vaccin serait disponible, il serait proposé à la population mais selon des modalités encore inconnues. Il est apparu que 61 % de notre échantillon représentatif se déclaraient favorables à leur propre vaccination – mais l'on sait que, de l'intention à l'action, il y a une déperdition importante. Cependant, deux facteurs principaux soutiennent l'intention de vaccination : être soi-même inquiet face au risque de contracter le virus de la grippe A ; avoir eu une expérience antérieure de vaccination contre la grippe saisonnière.
Ces données nous permettaient de conclure de façon pessimiste quant à la proportion de Français qui se feraient vacciner. En effet, le niveau d'inquiétude de l'ensemble de l'échantillon s'est révélé extrêmement bas et le deuxième facteur favorisant l'intention de vaccination, à savoir le fait de s'être fait vacciner contre la grippe saisonnière, était l'apanage des personnes de plus de 60 ans – de fait, alors qu'en France, 26 % de la population se fait vacciner contre la grippe saisonnière, ce taux s'élève à 70 % pour la tranche d'âge au-dessus de 60 ans, mais tombe à 8 % au-dessous de 34 ans. Or on n'avait pas l'intention de vacciner en priorité les personnes âgées, mais au contraire les enfants et les personnes entre 20 et 40 ans. Tout laissait donc à penser que cette cible serait difficilement atteignable.
Les mois suivants ont confirmé cette perception de la grippe A – le niveau d'inquiétude est resté bas – ainsi que nos prévisions concernant la vaccination.
Nous avons réalisé la deuxième enquête entre le 10 et le 20 décembre 2009, c'est-à-dire au plus fort de l'épidémie. Cette période correspond à la fois au pic d'intensité de la propagation de la contamination et au pic d'intensité de la vaccination. Le vaccin était alors proposé depuis près de deux mois. Alors que nous étions alors en situation réelle et non plus dans une perspective d'intention pure, la perception de la grippe et l'intention de se faire vacciner n'ont pas connu de changement notable
Nous avons toutefois observé que d'autres facteurs liés au débat public qui s'est tenu autour de la vaccination ont fait basculer dans le refus ceux dont l'intention était indécise. Les trois variables que nous avons identifiées étaient : l'opinion des proches et des amis ; l'opinion du médecin généraliste ; la croyance de la personne dans les vertus de la vaccination en général. Au moment de cette enquête, 7,5 % de notre échantillon étaient vaccinés, soit exactement la même proportion que dans l'ensemble de la population, 20 % disaient en avoir l'intention et 70 % affirmaient qu'ils ne le feraient pas même si la vaccination leur était proposée par leur médecin généraliste.
En conclusion, l'échec de la campagne de vaccination pouvait être prévu. On ne s'est pas donné les moyens de l'anticiper et d'en tirer les conséquences opérationnelles. Enfin, si la réponse vaccinale était au départ tout à fait justifiée, les incertitudes pesant sur les paramètres de l'épidémie et sur leur impact sur les comportements en matière de vaccination auraient dû conduire à adapter le programme. Or on a fait le choix inverse, celui de l'irréversibilité. Déterminer une stratégie avant l'émergence de l'épidémie, c'est bien ; la maintenir alors que les faits poussent à sa révision, c'est courir à l'échec – un échec qui, à mes yeux, n'est pas seulement celui de la campagne de vaccination mais qui atteint la crédibilité à venir de l'action en matière de santé publique.
Il n'y en a pas eu beaucoup. Quelques sondages d'opinion tout au plus.

A-t-on réalisé des études à l'étranger, aux États-Unis par exemple, où un grave problème de vaccination s'est posé dans les années 1970 ?
Il existe beaucoup d'études là. En novembre 2009, un article publié dans une grande revue américaine, Vaccine, montre exactement la même corrélation entre l'intention vaccinale et le fait de s'être déjà fait vacciner.

L'« irréversibilité » dont vous parlez est-elle celle du plan retenu, l'attitude consistant à rester « droit dans ses bottes » ?
Oui : une fois que l'on s'est dit que l'on allait vacciner tout le monde, on a persisté alors que les faits démontraient que ce n'était ni nécessaire ni faisable. En d'autres termes, on n'a pas changé d'avis devant les faits. Ce qui, d'un point de vue scientifique, est renversant !
J'en reviens aux deux enquêtes quantitatives de juin et de décembre 2009. Celles-ci ont été réalisées par questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de 1 001 personnes. Elles utilisent des échelles et des outils normalisés et portent sur les attitudes et les représentations du risque et de la maladie. Les catégories de variables explorées sont : la connaissance de la maladie ; les changements de comportement déclarés ; les changements de comportement anticipés ; la perception de l'efficacité des mesures de protection ; l'intention – ou l'action – vaccinale ; la perception de la maladie ; la perception du risque infectieux ; le soutien social ; l'expérience de la grippe saisonnière ; les attitudes et les valeurs sociopolitiques.
Les deux paramètres clés pour connaître l'intention vaccinale d'un individu sont sa perception de la gravité de la maladie et sa perception de la probabilité de contracter la maladie. Les études font apparaître que la majorité de la population a perçu la grippe A au même niveau que la grippe saisonnière. Si l'on considère que celle-ci n'est pas grave et qu'on ne l'attrape pas souvent, on pense de même, par analogie, de la grippe A. Le poids de l'expérience est donc important.
La gravité perçue, de 5 sur une échelle de 10, peut être qualifiée de faible. Il en va de même de l'inquiétude ressentie, un peu supérieure à 4 en moyenne.
Par ailleurs, sur une échelle de perception du risque où l'on a demandé de noter de 0 à 10 différents risques, la grippe A figurait en juin 2009 en dernière place, au même niveau que la grippe saisonnière et bien au dessous du tabagisme et des OGM. En décembre, on a constaté très peu de variation. Le risque perçu concernant la grippe A restait au bas de l'échelle, à peine plus haut que celui de la grippe saisonnière.
Ce n'est pas qu'une question de morts. Le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob a provoqué 50 morts mais le niveau d'inquiétude du public était, au moment de la crise de la vache folle, largement supérieur. On ne peut dire que la perception du risque soit fonction du nombre des décès ou de la prévalence de la pathologie. Les variables sont de nature qualitative. Le problème de la grippe A est qu'elle a été très vite perçue comme n'étant pas nouvelle, mais comme une simple grippe. Dès lors le facteur majeur de perception haute du risque disparaît.
Nous les avons faites.

Avait-on alors le sentiment d'un risque plus important ? La grippe aviaire ou la « grippe porcine » sont transmises par les animaux, ce qui peut susciter des réactions relevant de l'ordre du fantasme. L'appellation « grippe A » ne renvoie qu'à une grippe habituelle...
Dans le cas de la grippe aviaire, la mortalité observée était extrêmement importante, de l'ordre de 50 % des personnes ayant contracté le virus.
D'un autre côté, je pense que le non-événement qu'a constitué la grippe aviaire en France a été un facteur aggravant pour ce qui est de la capacité de produire des messages audibles.

De manière plus générale, ne pensez-vous pas que les autorités sanitaires, à force de crier au loup et d'annoncer des catastrophes qui vont balayer le monde, finissent par désensibiliser le public, le « vacciner » contre tout cela, si j'ose dire ?

Une fois que des idées, erronées ou non, circulent sur internet ou sur d'autres supports, il est difficile de les corriger : elles sont passées dans l'opinion publique et dans les réseaux sociaux. Cela semble avoir été le cas de cette impression de méfiance, voire de déni, qui a circulé.
Il est encore plus difficile de corriger ces idées lorsqu'on les connaît mal. Je ne dis pas qu'il est facile d'agir sur les perceptions, croyances ou rumeurs, mais la première condition pour cela serait de les connaître, de les mesurer.

La cellule de crise et les autorités sanitaires vous ont-elles contacté pour que vous leur parliez de ces questions ?
C'est une de mes grandes déceptions. Le SIG, en lien avec la direction générale de la santé, a financé la plupart de ces travaux. J'ai transmis les résultats au directeur général de la santé, au cabinet, etc., en juillet...

Certes, les personnes véhiculent différentes choses dans leur inconscient. Je crois néanmoins que le décalage net entre ce que les citoyens vivaient et observaient autour d'eux et le discours alarmiste qu'on leur tenait a conforté l'idée d'un mensonge. Pourquoi ce décalage entre l'expérience vécue et le discours tenu ?

Le fait que la population ait entendu parler du sujet en plein été, à une période où les journaux n'ont rien à se mettre sous la dent et où il est inhabituel de contracter la grippe, n'a-t-il pas eu un rôle ? Le temps de latence entre l'annonce d'un danger et le moment où ce danger survient amplifie-t-il l'impression, pour les individus, qu'il ne se passe rien en réalité ?
C'est toute la difficulté de rendre crédible une anticipation sans être en mesure de prédire ce qui va se passer. Anticiper n'est pas prédire : c'est se préparer à un événement qui va arriver. Le problème est le même avec le changement climatique.

Il nous reste beaucoup de choses à connaître dans ce domaine. Ce qui est déroutant, c'est qu'on ne vous ait pas consulté pour comprendre ce qui se passait après les études que vous aviez remises.
En décembre, les pouvoirs publics avaient compris que ce qui se passait était différent de ce qu'ils attendaient.
C'est impossible ! Je l'ai dit !

On s'est fondé sur des campagnes menées sur de petits territoires après l'apparition d'un cas de méningite fulgurante, en supposant que le schéma serait le même. Vous considérez que le raisonnement est faux ?
Faux, c'est-à-dire non fondé par les connaissances scientifiques sur le sujet. Aucun membre du comité d'experts ne représentait ce domaine de la connaissance. En outre, sur quels arguments le comité a-t-il arrêté sa position ? Personne n'a étayé l'argument selon lequel il fallait vacciner 85 % de la population.

Il faut bien distinguer deux choses.
Vouloir vacciner 85 % de la population est une décision politique et médicale visant à arrêter une pandémie.
En revanche, différentes modélisations permettaient de prévoir dès juin que la plupart des gens n'iraient pas se faire vacciner. Or on prévoyait d'en vacciner 75 %. C'était donc l'échec assuré ?
Là où réside, à mes yeux, la grande difficulté : c'est de savoir que faire lorsque l'on sait que l'on n'arrivera pas à convaincre 80 % de la population de se faire vacciner et que l'on veut programmer des moyens pour vacciner tout le monde. Même si, au bout du compte, 20 % seulement de la population se fait vacciner, rendre le vaccin accessible à tout le monde est une exigence politique et éthique. Ce n'est pas la même chose.

Lorsqu'Yves Bur évoquait une acceptation de 75 %, votre réaction a été que c'était impossible. Vous semblez donc avoir une certitude scientifique. Pourquoi le taux de 75 % vous fait-il réagir à ce point ?
On ne peut exclure que l'épidémie atteigne une gravité et une intensité telles qu'elles en viendraient à convaincre la majorité de la population. C'est pourquoi je défends les idées de flexibilité et d'adaptabilité : il est possible de programmer un accès généralisé au vaccin et ajuster au fur et à mesure le dispositif à la réalité des données de l'épidémie et des comportements humains – sachant que, pour une épidémie moyenne, l'on ne dépasse pas 30 % de personnes vaccinées.

Peut-on prévoir le pourcentage de personnes qui se feront vacciner en fonction de la perception de la gravité et de la vulnérabilité ?
À partir du moment où l'on a identifié ces deux facteurs clés, on peut commencer à préciser la prédiction. Globalement, les 60 % d'intentions de vaccination ont été divisés par deux, 10 % de la population ayant été réellement vaccinés. C'est avec ces données qu'il faut travailler.

Vous indiquez que ce travail a été réalisé à l'étranger et que les résultats sont à peu près les mêmes…
En l'occurrence, je ne dispose pas de données suffisantes.

À la fin de juillet et au début d'août 2009, plusieurs décès de personnes jeunes ont fait la une des journaux. Pour vous, ces messages sont-ils restés lettre morte, de même que l'annonce de 300 morts aux États-Unis ?
Par ailleurs, après qu'il eut été annoncé en Norvège, à la fin de novembre, l'éventualité d'une mutation virale, j'ai constaté un pic de demandes dans le centre de vaccination de ma commune. Au Canada, c'est l'annonce par le Gouvernement d'un risque de pénurie de vaccins qui a poussé la population à se précipiter.
Il ne suffit pas de se fier à des impressions. L'impact de ces nouvelles sur la perception de la population peut se mesurer et se vérifier. Le 15 décembre, au moment du pic de l'épidémie et au moment où les médias montraient des centres de vaccination très encombrés, la perception du risque restait à 4,1 sur une échelle de 10.

Ce qui semble signifier que, si l'on avait été à 7, les centres de vaccination auraient été complètement submergés.
Il ne faut jamais accuser le thermomètre...

Il me semble que le SIG vous a posé des questions parce qu'il cherchait comment communiquer. Mais personne ne se demande comment décider et adapter l'action par rapport à la communication du SIG. On voit bien que l'on a là affaire à une science humaine étrangère à la « culture maison ».

Notre commission essaie d'étayer ses analyses sur des données scientifiques. Le Gouvernement, pour sa part, ne s'est jamais situé dans le registre de l'information scientifique des populations : il s'est situé dans celui de la communication d'une part, dans celui de l'ordre d'autre part.
Vous avez affirmé que les pouvoirs publics, en décembre, avaient compris qu'ils avaient perdu. De mon point de vue, le Gouvernement pensait au contraire qu'il avait gagné et que la situation allait se calmer.

Il avait tout de même bien compris qu'il y avait un problème et que, si la pandémie n'avait pas eu lieu, il avait raté la campagne de vaccination.

C'est égal : il avait gagné la bataille de la communication. Sa hantise, c'était que se reproduise le schéma de la canicule de 2003. Je suis persuadé que le Premier ministre, Brice Hortefeux et Roselyne Bachelot-Narquin considèrent qu'ils ont gagné.

Des médecins ont souligné devant notre commission le rôle des « gestes barrières ». Des études comme les vôtres pourraient-elles fournir des informations fiables en la matière ? Alors que les Français ne sont pas réputés avoir une excellente hygiène, l'insistance sur le lavage des mains, par exemple, a-t-elle produit des effets mesurables ? Peut-on corréler des changements de comportement à la perception du danger ? Ou au contraire les décorréler – « ce n'est pas assez grave pour se vacciner mais suffisamment pour se laver les mains... » – ?
Les enquêtes ont évalué la croyance dans l'efficacité des différentes mesures préconisées et l'adoption effective de ces mesures. La seule qui ait été plébiscitée est le lavage des mains – c'est-à-dire la plus aisée, la moins coûteuse et celle qui répond à un risque considéré comme banal.
Oui. Dès lors qu'on arrive à le mesurer et que l'on établit que le vaccin arrive en dernière ligne, que cela va coûter une fortune et que les gens n'y auront pas recours, il faut modifier sa ligne de conduite !
Une irréversibilité qui était dans les têtes – peut-être aussi provoquée par certaines signatures.
Une autre dimension de l'épidémie, esquissée dans les travaux de Xavier de Lamballerie et Antoine Flahault, est que, parmi les personnes qui étaient porteuses des anticorps du virus, trois sur quatre n'ont pas présenté de symptômes. On peut parler de chance. Si l'on avait eu une autre proportion de cas symptomatiques, la visibilité de l'épidémie aurait été totalement différente.

Lors du pic pandémique, j'étais à La Réunion où les personnes estimaient que la grippe A n'était rien du tout par rapport au chikungunya. Celles qui l'avaient contractée affirmaient que cela s'était traduit simplement par un petit accès de faiblesse pendant 24 heures. Même pour les cas symptomatiques, c'était moins grave qu'un rhume !
Ce sont des paramètres qu'il faut prendre en considération lorsque l'on passe de la prédiction à l'observation. À quoi cela peut-il servir de se trouver en situation réelle si l'on ne tient pas compte des faits ?

Après l'étude de séroprévalence que M. Antoine Flahault a menée chez les femmes enceintes à Marseille, estimez-vous indispensables, à l'avenir, les études portant sur des cohortes – femmes enceintes, jeunes, personnes à risque, personnes obèses... – ?
Une étude baptisée « CoPanFlu », à laquelle je suis associé au titre des sciences humaines, devrait être lancée, mais elle ne démarre que très péniblement, et trop tard.
Comme on l'a vu pour le chikungunya, le problème est d'être en mesure de réaliser des recherches en temps réel. Or notre dispositif de recherche n'est pas adapté à cette démarche. J'ai eu toutes les peines du monde pour rassembler des financements et j'ai dû travailler avec des bouts de ficelle !

Il y a une différence entre la science médicale et les sciences humaines. Pour les secondes, une enquête menée six mois après ne sert plus à grand-chose.
C'est ce qui s'est passé pour le chikungunya : je n'ai pu mener mes enquêtes qu'à la fin de l'épidémie.

Je vous remercie pour votre contribution, qui nous sera très utile. La commission vous serait reconnaissante de lui faire parvenir les données qui vous paraîtraient significatives, ainsi qu'une bibliographie.
Je vous transmettrai également un article consacré à l'enquête du mois de juin, qui sera publié prochainement dans une grande revue internationale.
La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq.