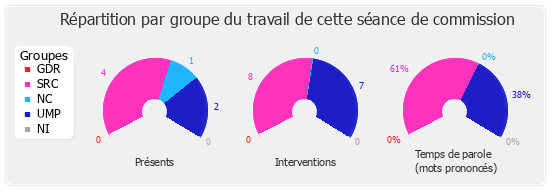Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 2 mars 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 2 mars 2011
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. François Pillet, sénateur, coprésident et de M. Serge Blisko, député, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies entend le Dr Michel Le Moal, psychiatre, professeur émérite à l'université Victor Ségalen à Bordeaux, professeur de neurosciences, membre de l'Académie des sciences.
- Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui deux praticiens psychiatres et médecins qui vont nous donner leur vision clinique de l'addiction aux drogues. Ils vont nous éclairer, de façon aussi pédagogique que possible, sur les conséquences de l'absorption de drogue sur le corps humain et sur le comportement.
Le premier de ces deux praticiens est le docteur Michel Le Moal, psychiatre, professeur émérite à l'université Segalen de Bordeaux, professeur de neurosciences et membre de l'Académie des sciences, dont nous avons entendu les représentants il y a quelques semaines.
Vous avez la parole.
- L'essentiel, dans un domaine aussi complexe, est d'être simple.
Vous avez rappelé mes fonctions : je suis essentiellement connu, au plan international, pour mes recherches fondamentales. Je m'intéresse à la psychiatrie et je cherche par ailleurs à comprendre ce que veut dire un cerveau perturbé ce qui n'est guère simple, la psychiatrie étant certainement, de toute la médecine, la partie la plus complexe, peut-être la plus méprisée !
Etant récemment rentré de Los Angeles, je n'ai pas eu le temps de lire les comptes rendus de mes prédécesseurs. Je ne sais donc pas ce qui a été dit, ce qui est bien sûr un handicap. Ce que je vais dire sera donc peut-être hors norme.
Peut-être l'avez-vous déjà entendu dire par des gens plus qualifiés que moi : l'addictologie est, en France, apparue relativement récemment, avec quinze ans de retard sur les Etats-Unis. Au cours de mes études dans une école psychiatrique de grande renommée nationale -celle de Bordeaux- j'ai dû voir entre cinq et dix malades. Notre manuel de psychiatrie, qui était à l'époque une bible et qui est demeuré valable, consacrait trois pages à ce phénomène.
Si cette apparition est récente, on sent néanmoins une accélération des choses. Pourquoi ? L'explication est assez complexe. Lorsqu'on parle de substances toxicophiliques ou addictogènes, il ne faut pas oublier les objets d'addiction comme le jeu pathologique - qui a donné lieu, il y a deux ans, à une étude de l'INSERM à laquelle j'ai d'ailleurs participé - les achats, le sexe, le chocolat etc.
Il existe également tout un monde qui entre dans le cadre des addictions. On pensait qu'il existait des différences mais on les voit à présent s'atténuer, dans la mesure où le syndrome qui en résulte a les mêmes caractéristiques symptomatologiques.
J'ai depuis de nombreuses années travaillé sur ces sujets avec mes collègues américains en essayant de comprendre ce qui a été parfaitement défini par le Surgeon General, l'équivalent aux Etats-Unis du ministère de la santé. C'est lui qui supervise l'ensemble de la santé publique américaine. Il fait chaque année un rapport très attendu destiné aux acteurs et au gouvernement, essentiellement centré, cette année, sur les troubles psychiatriques –ce que l'on appelle depuis quinze ans, aux Etats-Unis, « l'épidémie de troubles psychiatriques et comportementaux ».
Dans son analyse de 2003, il définissait le phénomène comme un ensemble de « pathologies sociales chroniques » qui mettent en péril d'une part les finances des Etats-Unis en représentant de 16 à 17 % du PIB et, d'autre part, l'avenir même du pays. C'est ce que, dans d'autres cercles, on appelle les maladies « sociogéniques de masse ».
Il s'agit d'un ensemble de perturbations dans lesquelles on englobe l'addiction mais qui n'est pas simplement réduit à l'addiction, comme l'obésité, apparue il y a trente ou quarante ans. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il une véritable épidémie de lombalgies ou une épidémie de fatigue chronique ? Pourquoi une épidémie d'anxiété ou de troubles dépressifs ?
Ce que l'on voyait il y a trente, quarante ou cinquante est sans commune mesure avec ce que l'on voit maintenant. C'est le message que le Surgeon general a porté de manière officielle devant le Gouvernement.
Il s'agit donc de drogues et, plus largement, d'objets addictogènes. Peut-être les addictions sont-elles à classer dans un ensemble plus vaste de pathologies de nature et d'origine sociale, avec des objets divers…
Vous avez sans doute traité de certaines substances qui semblent employées de plus en plus par les jeunes, ce qui est bien sûr angoissant. Les responsables des différentes agences que vous avez entendus ont dû vous fournir des statistiques. Vous avez pu constater que celles-ci sont extrêmement fluctuantes, telle substance dominant durant cinq ans avant d'être remplacée par telle autre. Il y a trente ans, on ne connaissait pas le cannabis. Dans la bible de la psychiatrie mondiale, le « DSM IV » et sa dernière édition 2000, l'addiction au cannabis n'est pas mentionnée. Les choses arrivent lentement et la recherche est là pour faire émerger une certaine vérité. Nous sommes maintenant tous d'accord pour dire qu'il existe une addiction au cannabis. Tout cela est fluctuant et tout se complète à la suite des recherches.
Je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui se développe de manière insidieuse et sournoise mais générale. Il s'agit de l'utilisation instrumentalisée des drogues.
Des secteurs de plus en plus larges de la population -comme les jeunes adultes- sont en quête de méthodes destinées à maîtriser leurs états mentaux : recherche d'euphorie, modification de l'humeur, changement hédonique de leur état mental mais aussi automédication. Toutes les substances toxicophiliques ou addictogènes ont une valeur d'automédication et peuvent être utilisées pour compenser un léger état affectif négatif. Vous le savez, les grands malades mentaux consomment presque tous des drogues. Qu'elles soient licites ou illicites est pour moi la même chose !
Cette automédication permet aussi de réguler des états de stress, d'améliorer des performances, de chercher de façon presque épidémique à améliorer les performances ou accroître les interactions sociales. Il peut également s'agir d'améliorer le comportement sexuel, de maîtriser les apparences physiques. Le Médiator était ainsi primitivement l'une des mille et une substances destinées à maîtriser l'apparence physique en réduisant l'appétit.
Toutes ces molécules ont également la faculté de changer les capacités sensorielles. Toutes ces différentes facultés sont pratiquement partagées par toutes les substances addictogènes.
Nous sommes dans une société qui veut maîtriser ses états mentaux et surtout les améliorer. Vous allez me faire remarquer qu'il est curieux de rechercher un produit qui n'est pas naturel pour se sentir naturel, performant, efficace. Pourquoi la société actuelle crée-t-elle ces besoins ? Pourquoi certains ont-ils besoin de cette béquille pour apparaître au mieux ? C'est un phénomène très important qui infiltre actuellement notre société.
Or, toutes ces personnes supposent qu'elles maîtrisent ce qu'elles font. Il existe donc une rationalité de l'utilisation. Il y a aussi derrière cela un autre facteur explicite : ces personnes ne veulent pas savoir que, parmi toutes celles qui prennent ces substances, certaines sombreront et passeront de l'autre côté. C'est là le fond du problème de l'addiction.
J'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler non pas sur l'usage de drogues mais sur le problème de l'addiction, qui est l'aboutissement d'un processus où selon moi, après usage et mésusage, on débouche sur un état neurobiologique qui est un état de maladie.
Tout ce qui touche à la drogue est un champ bourré de controverses, de camps, de clans, souvent d'ailleurs en raison de l'origine des acteurs. La masse des sociologues, dans l'ensemble, récuse l'idée de maladie et le fait que l'on puisse naturaliser et médicaliser le processus -ils le disent également pour beaucoup d'autres choses. Les neurobiologistes -c'est mon clan- ont une analyse à courte vue. Ils travaillent toute leur vie sur des souris et des ras ; selon eux, il s'agit d'un cerveau malade, un point c'est tout ! Entre les deux, les psychiatres se divisent entre ces deux clans. C'est un champ est extrêmement conflictuel et je traiterai quant à moi de l'addiction comme d'une maladie chronique du cerveau. Il s'agit de la phase terminale d'un processus à partir duquel on ne revient pas -ou très peu- car il s'agit d'une maladie chronique à rechutes.
Quelles sont les symptômes cardinaux ? Selon moi -cela a fait l'objet d'une publication de ma part et de la part de certains de mes collègues aux Etats-Unis, il y a une dizaine d'années, qui résumait assez bien le consensus- le premier symptôme central est la perte des capacités d'autorégulation, la perte du contrôle. Nous pensons qu'une partie spécifique du cerveau est atteinte, le cortex préfrontal, dernier élément de l'évolution, très développé chez les primates et chez l'homme. C'est un cortex qui est venu tardivement dans la phylogenèse, un cortex d'inhibition et de contrôle, en position pontificale pour réguler les autres fonctions du cerveau. L'atteinte des fonctions de ce cortex entraîne la désinhibition et la perte de contrôle.
Le second symptôme est la compulsion. Au cours de l'usage ou du mésusage, on sent une conduite impulsive -en général consciente- à l'égard de l'objet. Mais il y a encore contrôle dans une certaine mesure. Si on le lui fait remarquer, la personne le reconnaît et l'objet peut être laissé de côté. A partir d'un certain moment, le processus neurobiologique s'enclenche, avance, les dégâts au sein du cerveau progressent et on passe à l'état de compulsion. Le sujet est non seulement impulsif mais répète cette impulsivité sans aucun contrôle ni autolimitation. Les régions motrices du cerveau sont atteintes.
Le troisième symptôme est lié à ce que j'appelle l'homéostasie hédonique. Nous savons tous faire la part entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, contrôler le passage de l'un a l'autre dans la recherche du plaisir, moteur essentiel de notre existence. Or, le sujet en état d'addiction ne recherche pas le plaisir, contrairement à ce que beaucoup disent. Le grand système neurologique à la base du cerveau, appelé système de récompense ou de plaisir, est atteint.
Enfin, il existe deux symptômes complémentaires ; il y a chez le sujet un état de compulsion permanente : son répertoire comportemental se rétrécit au fur et mesure des semaines et des mois pour ne plus être axé que sur une seule chose : l'obtention de la drogue ou de l'objet. J'ai vu une mère laisser mourir son nouveau-né !
Tout ce qu'il y a de plus phylogénétiquement fondamental dans les conduites de préservation de l'individu et de perpétuation de l'espèce, qui sont programmées depuis des millions d'années, disparaît. Ce qu'il y a de plus fondamental dans le vivant est atteint. C'est quelque chose d'assez angoissant…
Voilà ce que représente le syndrome de cet état de maladie qu'on appelle l'addiction. Il s'agit d'un syndrome subjectif : le sujet se sent dans une prison, estime avoir perdu sa liberté, se pense dépossédé de soi, lamentable. Ces symptômes, extrêmement graves, sont parmi les premiers à traiter afin que le sujet retrouve une perception plus positive de soi.
Durant la première période, il existe une recherche du plaisir lié à la consommation : l'objet vous crée du plaisir. On reconnaît le passage à l'état de maladie -donc d'addiction- lorsque le sujet est obligé de consommer de la drogue pour se sentir bien et supprimer l'ensemble des symptômes que j'ai décrits. On a complètement inversé la donne : le sujet est obligé de consommer pour retrouver un certain équilibre dans le déséquilibre !
Pourquoi certains sujets sombrent-ils ? Il existe dans le monde des neurosciences deux attitudes. L'une veut faire de l'apparition de l'addiction une dérive iatrogène : on consomme de la drogue, la drogue va transformer le cerveau et le cerveau ainsi transformé va provoquer un état d'addiction. On l'obtient chez l'animal. L'objet essentiel est donc la consommation. Si vous consommez, vous transformerez votre cerveau et immanquablement arriverez à cet état. Si l'on veut supprimer l'addiction, il faut supprimer la disponibilité de l'objet consommé ! Cela signifie aussi que l'on trouvera peut-être un jour la molécule permettant de bloquer le processus…
Voyant les choses du côté de la psychiatrie et face aux progrès de l'épidémiologie psychiatrique, je dirais -sans en être totalement sûr- que la personne dépendante possède, depuis la petite enfance ou non, un état psychopathologique préalable.
Raisonner ainsi déplace le problème car il ne suffit pas de supprimer les données pour régler le problème : encore faudrait-il se préoccuper de la santé mentale de la société dans laquelle nous vivons. Peut-être parviendra-t-on alors, par là, à régler toutes les questions dont je vous ai parlé.
- Vous avez témoigné d'une pédagogie qui permet aux Béotiens que nous sommes de saisir parfaitement les problèmes que vous avez évoqués.
La parole est aux rapporteurs…
Quels sont les états psychiatriques préalables ?

Toutes ces précisions ne sont guère réjouissantes !
La recherche permet-elle d'envisager une aide plus concrète pour ceux qui sont déjà tombés dans l'addiction ? Quels seront les dégâts pour ceux qui sont les moins fragiles ? Y en aura-t-il ?
- Absolument ! La simple consommation répétée et continue présente son propre danger en transformant les synapses, les neurones, etc. Grâce à certains articles récents, on sait qu'elle change même certains aspects du génome. Les substances sont des toxiques. Lorsque nous buvons du vin, nous savons bien que ne buvons pas du lait -même si, à l'Assemblée nationale, un député a dit que le vin n'est pas de l'alcool ! Je veux dire par là que même si l'on fume un peu, on sait que l'on fume une substance toxique.
L'aspect toxique est bien là : on ne peut l'éviter et il joue sur l'ensemble de l'organisme, dont le cerveau. Il existe cependant une porte d'entrée majeure lorsqu'il y a des états psychopathologiques préalables ne serait-ce que par la recherche de l'automédication.

Est-il envisageable que la recherche, dans les années à venir, puisse réparer les dégâts causés au cerveau ?
- Je récuse totalement cette forme de béatitude médiocre de l'ensemble des neurosciences qui prétendent que l'on pourra régler l'ensemble des problèmes de la psychiatrie à partir des connaissances sur le cerveau ! Je ne vois strictement aucune piste permettant de le dire !
Peut-être attendons-nous celui qui viendra envisager les choses d'une autre manière et reprendre les neurosciences par le bon bout mais je suis pour l'heure irrité par les gens de ma confrérie qui nous annoncent tous les matins que l'on va raser gratis ! Je ne peux plus le supporter ! En 1954, La première substance neuroleptique est arrivée en psychiatrie par hasard, grâce à mon maître, Henri Laborit. On a depuis inventé des molécules voisines mais on n'a fait aucun progrès, surtout dans le domaine conceptuel.
J'ai la chance d'avoir participé à la naissance des neurosciences. A chaque décennie, on a pensé avoir trouvé la solution, qu'il s'agisse des neurotransmetteurs, des récepteurs ou de la transition cellulaire… En l'état actuel, il n'existe pas de médicament !
- C'est totalement différent ! Une substance qui se fixe sur le récepteur mµ et qui l'occupe durant deux ou trois jours au lieu de quelques heures pour remplacer la morphine ne constitue pas un médicament.
Votre question précédente porte sur une substance qui changera la nature même de la thérapeutique psychiatrique : de ce côté, on tourne en rond et on est dans le même paradigme depuis 1954. Cette molécule, qui est ce qu'elle est, a été découverte par hasard. On parle de « camisole chimique » à propos des neuroleptiques. Cela étant, heureusement qu'on les a ! Ils permettent au sujet de reprendre une existence parfois correcte et de supprimer ses hallucinations mais dans le domaine qui nous occupe, pour l'heure, il n'y a rien !

- Il en va de même en ce qui me concerne. Je regrette que la recherche pharmaceutique n'ait pu avancer dans le domaine de la substitution sur la cocaïne ou ses dérivés.
J'ai beaucoup apprécié votre exposé, qui a la grande vertu d'être audible et que chacun peut comprendre.
J'ai cependant été surpris par le fait que vous disiez que le cannabis est un phénomène qui remonte à une trentaine d'années. Je crains hélas que ce ne soit plus ancien, même si cela n'a jamais eu la même répercussion qu'aujourd'hui. On a connu le comptoir du kiff, lorsque le Maroc faisait partie de l'ensemble français…
- Le DSM IV, la bible de la psychiatrie mondiale, ne fait pas état de l'addiction. Nous avons donc été obligés de le constater et de l'étudier cliniquement. La nocivité du cannabis est relativement récente dans les esprits des chercheurs…

- Je n'étais pas en contradiction avec votre propos : je m'interrogeais seulement. Lorsque des sportifs veulent se doper, ils recherchent avant tout la performance mais développent un phénomène d'addiction.
Car les drogues sont aussi une manière d'exploiter les gens. Pendant la guerre de 1914, on donnait des gourdes de gnôle aux Poilus pour affronter l'ennemi. Les droguait-on ou voulait-on qu'ils oublient les risques face à l'ennemi ? C'est vrai dans beaucoup de domaines : les mineurs consommaient également de l'alcool pour surmonter leur angoisse.
Vous n'avez pas souhaité emprunter cette voie et vous en êtes cantonné à l'analyse du phénomène chimique et à celle des produits ; toutefois, l'environnement sociologique est sans doute à prendre en considération. On ne peut l'ignorer : chez certains, la situation sociale et l'angoisse peuvent pousser à la prise de risque...
- Pourquoi est-on obligé de changer son état mental ? J'ai dressé tout à l'heure la liste de tout ce que peut procurer la drogue. Les firmes pharmaceutiques inventent des centaines de molécules ; lorsqu'elles arrivent à trouver une molécule dont elles pensent qu'elle peut avoir un effet thérapeutique, le staff se réunit pour savoir si celle-ci est addictogène ou non. Les recherches commencent alors mais on ne le saura que le jour où un mammifère -l'homme peut-être- l'aura prise. Nous avons dans le cerveau des molécules qui rencontrent ce qui existe dans la nature, se marient et font fonctionner les systèmes neuronaux. Ma conviction profonde est que nous sommes dans des sociétés de plus en plus pathogènes.
D'aucun ont dit que toutes les civilisations sont mortelles. Je suis presque aussi souvent aux Etats-Unis qu'en France. J'observe régulièrement ce pays depuis 1973 : pourquoi ne l'imite-t-on jamais dans ce qu'il a de bien ? Je l'ai dit, le Surgeon General, en 2003, estimait déjà que la société américaine était en péril !
Mon champ de recherches n'est pas simplement les substances addictogènes ou l'addiction en général : je travaille beaucoup sur les conséquences du stress -et particulièrement du stress intra-utérin. Nous sommes dans des sociétés qui, manifestement, cumulent et accumulent la pathogénicité d'un environnement délétère !
Certains prétendent que nous sommes la civilisation la plus heureuse : j'affirme le contraire et cela rejoint ce que je disais tout à l'heure : l'augmentation croissante des troubles psychiatriques dans le monde occidental est peut-être à la base de cette vulnérabilité préalable à l'addiction.

- comme les intervenants précédents, le cartésien que je suis a été ému par ce que vous avez dit mais je suis sorti de certaines auditions un peu plus optimiste que je ne sortirai de celle-ci !
J'ai bien compris que la société était de plus en tournée vers les addictions et j'ai cru entendre que l'on se trouvait devant des réseaux avec des « clapets anti-retour ». Les malades ont avancé dans leur cheminement et n'ont que fort peu de chances de retourner aux phases initiales.
J'en retire donc un sentiment assez pessimiste : la société se tourne de plus en plus vers cette demande et les traitements, à l'heure actuelle, sont quasi inexistants. On comprend le phénomène mais il n'existe pas de remède !
- Les psychiatres ont l'habitude de la difficulté. C'est la spécialité médicale la plus complexe qui soit, du fait de ses objets et de la nature même des syndromes pathologiques, ne serait-ce que parce qu'il n'existe pas de marqueur. Quelle est la part de la génétique, de l'environnement, de ce que le patient a acquis durant la vie intra-utérine ?
L'état d'addiction n'est qu'un élément. Les psychiatres ont l'habitude de certaines molécules qui colmatent les brèches -à tel point que nous sommes les premiers consommateurs au monde d'anxiolytiques. Pourquoi ? La recherche va bon train dans le domaine des psychothérapies, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est un corps-à-corps entre le sujet, son environnement, sa substance, etc. Fort heureusement, les services se multiplient et l'addictologie est devenue une discipline, ce que je n'aurais pas imaginé il y a quinze ou vingt ans. Mis à part Marmottant, temple de l'addictologie en France, il n'y avait rien à l'époque -ou presque.

- Vous avez parlé de situations addictogènes. Il était important de le préciser car la mission a tendance à s'en tenir aux produits. Or, on légifère parfois dans le mauvais sens en autorisant la publicité d'alcool sur Internet, etc. Je n'y reviendrai pas…
On parle ici de soins et de sortir les gens de cette impasse. Vous avez dit que lorsqu'on a atteint un état compulsif, on a déjà détruit une partie du programme génétique qui existe depuis des milliers d'années chez l'être humain. Il y a là un côté irréversible. Dans des situations extrêmes, le but n'est-il pas simplement de maintenir la tête de la personne hors de l'eau, sans avoir de grandes ambitions ni vouloir restaurer tout ce qui a été détruit ?
- J'ai été lapidaire afin d'être pédagogique -même si je ne retire rien de ce que j'ai dit.
La substance transforme pratiquement tous les réseaux neuronaux du cerveau. Le symptôme le plus grave est le rétrécissement progressif du répertoire comportemental. Le sujet est de plus en plus attaché à la prise compulsive de substances. J'ai toujours été frappé de constater, sur le plan de la neurologie, à quel point ce processus investit également ce qui permet à tout être vivant d'exister : savoir se protéger, procréer… Je ne puis dire où ces programmes se situent dans le système nerveux central car on ne le sait pas. Je ne serais pas étonné que tout le cerveau y participe -et peut-être le faut-il d'ailleurs.
Il est cependant étonnant de constater le niveau auquel l'être biologique est réduit. C'est absolument fascinant et incroyable ! Il faut en prendre conscience quand on traite de l'addiction.
- Nous vous remercions chaleureusement de la qualité de ces informations et de leur clarté.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite le Dr Marc Valleur, psychiatre, médecin chef du Centre Marmottan à Paris.
- Mes chers collègues, nous accueillons maintenant le second praticien de l'après-midi, le Docteur Marc Valleur.
M. Valleur est également psychiatre, médecin-chef du Centre Marmottan, à Paris. Il va pouvoir nous faire part de son expérience en matière de traitement de population toxicomane mais aussi, plus généralement, de politique de prévention et de réduction des risques.
- Merci. Je suis impressionné d'être invité à témoigner devant une assemblée aussi éminente. Je suis ravi que cette mission existe. Le 31 décembre dernier était la date du quarantième anniversaire de la loi du 31 décembre 1970, qui régit toujours le champ de la toxicomanie en France.
Le 24 juin prochain, Marmottant fêtera son quarantième anniversaire, le centre ayant été créé pour répondre à l'exigence compassionnelle de la loi de 1970 instaurant le droit à la gratuité et à l'anonymat des toxicomanes volontaires demandeurs de soins, en contrepartie de son volet extrêmement répressif qui sanctionne d'un an de prison tout usager de substance illicite.
Il me semble que cette mission est nécessaire car, après quarante ans, il serait intéressant de tirer un certain nombre de conclusions de la mise en oeuvre de cette loi, de prendre en compte ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d'étudier si certaines choses peuvent ou non être modifiées.
La loi du 31 décembre 1970 n'a pas changé beaucoup de choses ; par contre, beaucoup de choses ont changé dans le champ des toxicomanies : les usages de drogues et les addictions ne sont plus les mêmes, et les modalités d'intervention ont beaucoup évolué.
La politique de réduction des risques et la généralisation des traitements de substitution ont été des éléments majeurs de modification du champ de l'intervention en toxicomanie mais aussi des pratiques d'usage des toxicomanes. Un tournant plus important encore me semble-t-il a été pris à partir de 1997, à la suite du rapport Roques, avec l'élargissement du champ de la MILDT à l'alcool et au tabac, drogues légales. Je me suis inscrit, dès 1997, avec Marmottan, parmi ceux qui pensaient qu'il fallait aussi élargir les addictions aux addictions sans drogue et en particulier aux jeux pathologiques.
2010 a été une année importante, la loi de juin légalisant partiellement certains jeux en ligne marquant la fin d'une prohibition plus que millénaire concernant les jeux d'argent en France. On est là devant une véritable révolution en matière de régulation du jeu. Les jeux d'argent sont en effet interdits en France depuis la nuit des temps, sauf dérogation accordée par l'Etat à l'Etat. C'est selon moi très important et très intéressant, la France ayant depuis quarante ans, en matière de drogues illicites, un modèle prohibitionniste très dur. La comparaison entre les modèles implicites qui sous-tendent la loi de 1970 et ceux qui sous-tendent la loi de légalisation des jeux en ligne devrait être de nature à donner un peu de recul dans le débat sur les drogues et toxicomanies.
Il est très facile d'agiter des réactions compassionnelles ou sécuritaires. Les deux positions sont fausses et les deux modèles -prohibitionniste et libéral- constituent tous deux des erreurs.
Il faut selon moi partir des addictions au sens large et du principe que les addictions avec drogues, légales ou illicites, sont un sous-groupe dans le grand champ des addictions, qui comportent des addictions comportementales, des addictions aux jeux d'argent et de hasard ou, pour certains, l'addiction aux jeux en réseau sur Internet, les addictions sexuelles et certaines formes de dépendances affectives et troubles des conduites alimentaires incluant l'obésité avec boulimie.
J'écoutais Michel Le Moal, avec qui je suis souvent d'accord. S'il existe, en matière d'addiction, de faux débats, de fausses querelles c'est qu'il y a aussi de faux consensus. On croit parler de la même chose alors que ce n'est pas le cas.
Il existe trois regards possibles en matière d'addiction, en quelque sorte trois addictions différentes. Le premier regard est le regard clinique. C'est le mien. Cela fait trente-sept ans que je travaille à Marmottant. Pour le clinicien, la définition est simple : il s'agit pour le sujet lui-même de vouloir plus ou moins consciemment tempérer ou cesser sa conduite sans y parvenir. Ce qu'il fait ne lui plaît plus mais il n'arrive pas à arrêter. C'est ce que Pierre Fouquet, fondateur de l'alcoologie, appelait la « perte de liberté de s'abstenir ». C'est cette dimension qui laisse la place à une demande de soins et qui légitime l'intervention thérapeutique.
La seconde définition -Michel Le Moal s'en rapprochait en disant qu'elle était asymptotique et impossible- est celle des chercheurs et des neurobiologistes. Michel Le Moal, Jean-Paul Tassin, Pier Vicenzo-Piazza, en France, ainsi qu'un certain nombre de personnes, supposent que l'addiction répond à un phénomène biologique sous-jacent que l'on pourrait isoler, un facteur « x » dont la présence ou l'absence permettrait de signer l'existence d'une vraie addiction.
Il faut, avec Michel Le Moal, rappeler que ce facteur est hypothétique. On a cru le trouver dans les endorphines, dans la dopamine ; on pense aujourd'hui le situer dans les découplages des circuits sérotoninergiques et noradrénergiques ; d'autres pensent le trouver dans la perte de la plasticité cérébrale… On peut prévoir que dans dix ans, dans quinze ans, dans vingt ans, d'autres modèles auront cours.
On s'appuie trop souvent sur un modèle hypothétique comme s'il s'agissait d'une certitude. Au moment du rapport « Roques », le modèle était la dopamine. Grâce à elle, on a pu placer dans le même groupe alcool, tabac et drogues. Ce modèle scientifique -dont tout le monde pense aujourd'hui qu'il est faux- a donc eu un impact politique extrêmement intéressant.
Le troisième axe, qui devrait davantage intéresser les politiques, est celui de la santé publique. Dans une optique de santé publique, l'addiction n'est plus la perte de la liberté de s'abstenir mais ce que Pierre Fouquet disait à propos de l'alcoologie, considérant l'alcoologie comme l'ensemble des relations existant entre les êtres humains et l'alcool, champ infiniment plus vaste que la dépendance d'un sujet envers l'alcool. Dès lors, il y a là des raisons d'être plus optimiste que ne semblait l'être Michel Le Moal…
Si l'on considère l'ensemble de la population, une part est concernée par une conduite donnée ou une substance donnée et l'autre non : joueurs, non-joueurs ; buveurs, non-buveurs ; fumeurs, non-fumeurs… Parmi les personnes concernées par cette conduite 0,5 %, 2 %, 4 % de personnes perdent la liberté de s'abstenir, d'autres seront dans l'abus ou dans l'usage nocif et d'autres n'auront pas de problèmes.
Les problèmes d'abus et d'usage nocif sont probablement plus coûteux pour la société que les problèmes de dépendance au sens large. Il suffit d'une ivresse pour qu'un jeune de vingt ans se tue au volant un samedi soir. Il n'a jamais été alcoolique et n'aura jamais besoin de voir un alcoologue mais il mourra du fait d'une seule ivresse ! Il suffit d'une injection de cocaïne ou d'héroïne pour contracter le virus du Sida ou de l'hépatite. Il suffit de se reprendre après avoir dérapé dans le jeu et l'on n'aura jamais besoin de se faire soigner à Marmottan, mais on peut être surendetté pour le restant de ses jours, avec tous les drames que cela entraîne pour toute une famille.
Beaucoup l'ignorent mais l'immense majorité des expérimentateurs d'héroïne ou de cocaïne ne deviendront jamais dépendants de ces produits. On estime le pourcentage de personnes qui ont basculé dans la dépendance aux drogues les plus dures entre 10 et 20 % du nombre total d'usagers.
La drogue la plus addictogène reste le tabac, 30 % des expérimentateurs devenant utilisateurs quotidiens mais les dommages pour la société vont bien au-delà des 2 à 3 % de personnes très problématiques.
Certaines personnes vont connaître des problèmes de santé du fait d'un surpoids. Parmi les obèses malades, ceux qui ont des problèmes génétiques, des problèmes psychologiques ou des problèmes préexistants vont être surreprésentés par rapport aux autres groupes. Ce schéma va pouvoir s'appliquer à tous les objets de consommation.
Deux grands modèles virtuels de santé publique sous-tendent les politiques réelles. Le premier consiste à ignorer la part pathologique, permettant ainsi à la majorité de la population de devenir des consommateurs normaux. C'est ce qui a été proposé dans beaucoup de pays à travers ce que certains spécialistes appellent le « modèle de Reno », du nom de la capitale du Nevada.
A l'opposé, d'autres vont tendre à imposer un modèle prohibitionniste total. Ces deux modèles n'existent pas dans l'absolu car aucun ne serait bon. Pourquoi ? Le modèle de Reno a été proposé par quelques spécialistes à Reno et concerne le jeu pathologique.
Ce modèle consiste à faire confiance à la logique de développement durable des producteurs, des industriels et des opérateurs de jeux qui vont alors financer l'information rationnelle du public en matière de règles du jeu ainsi que des actions ciblées de prévention et d'avertissement des publics vulnérables, des personnes à risques et des personnes qui montrent des signes de dérapage. Ils financeront également des centres de soins pour le traitement des joueurs pathologiques. En retour, ils seront autorisés à augmenter leur offre au maximum. Ainsi, le jeu pourrait devenir la norme. Dès lors, il serait extrêmement difficile de savoir quels problèmes de santé publique lui sont imputables.
C'est ce que l'épidémiologiste anglais Geoffrey Rose appelle le « prevention paradox » : si chacun fume 40 cigarettes par jour, le cancer sera considéré comme une maladie génétique, personne ne pensant alors à faire le lien entre tabac et cancer. La plupart des gens continueront à ne pas développer de cancer et l'on se demandera pourquoi telle personne est atteinte alors que telle autre ne l'est pas. Le facteur sociétal massif, unanimement partagé, disparaîtra. C'est la question que l'on peut se poser actuellement à propos de la télévision. On ne sait ce qu'elle produit sur les gens parce que tout le monde la regarde !
L'autre modèle est le modèle prohibitionniste absolu qui tendrait à interdire le plus possible l'accès aux substances.
Ce modèle a été mis en oeuvre de manière absolue en Iran, après la révolution islamique, pour l'opium et l'héroïne. On sait où cela a conduit : les peines pour usage simple ont augmenté jusqu'à la peine mort. 40.000 personnes ont été tuées, dont beaucoup pendues à des grues sur la place publique pour essayer de mettre fin à la toxicomanie. Le résultat est catastrophique ! L'Iran est aujourd'hui le pays du monde qui a le plus d'héroïnomanes -3 millions- rapportés à sa population.
Le premier modèle risque donc d'augmenter les problèmes sans fin, le second d'être catastrophique. La loi de 1970 est partie, dans l'esprit de beaucoup, de ce modèle prohibitionniste. Pour un certain nombre de substances, elle a plutôt bien fonctionné parce qu'elle a été largement modulée par la politique de réduction des risques, par la généralisation des traitements de substitution et par l'existence de centres de soins. C'est parce qu'on a mis dans ce modèle des éléments de l'autre modèle que celui-ci est devenu relativement opérant.
Les chiffres tendent à le montrer. Le nombre d'expérimentateurs d'héroïne en France est de 1 % de la population. Sur ce chiffre, le nombre d'utilisateurs réguliers ou dépendants n'apparaît pas dans les enquêtes de population générale. On peut dire que, pour l'héroïne, ce modèle mixte a relativement fonctionné. Pour la cocaïne, on constate une augmentation de 2,5 % des expérimentateurs dans la population générale mais les utilisateurs quotidiens, réguliers ou à problèmes n'apparaissent toujours pas dans les enquêtes. On est donc très loin de la catastrophe sanitaire et c'est pourquoi on peut être relativement optimiste.
Le seul produit pour lequel ce n'est pas vrai est le cannabis qui compte 12 millions d'expérimentateurs pour 500.000 utilisateurs réguliers. C'est très peu en pourcentage mais beaucoup trop pour un an de prison si on l'utilise chez soi et deux ans de prison si on l'utilise au volant. Ce n'est pas réaliste ! Une seule personne a eu le courage de le dire, c'est Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'intérieur, estimant qu'il faudrait peut-être remplacer la peine de prison par une amende.
La loi sur le jeu constitue un exemple d'une démarche qui pourrait gagner à être mise en perspective avec ce qui a été fait pour les drogues. Cette loi est une loi de légalisation mais il s'agit d'une légalisation partielle, certains jeux ayant été légalisés et pas d'autre. On a donc là un peu de prohibition dans un modèle d'allure libérale. Cette loi ne marchera que si les opérateurs sentent au-dessus de leur tête une épée de Damoclès constituée par une possible prohibition. Autrement dit, le modèle prohibitionniste ne fonctionne que si des actions de prévention, de soins, d'accompagnement sont mises en oeuvre ; le modèle libéral ne fonctionnera que s'il intègre la possibilité -au moins virtuelle- d'une prohibition, d'un retour en arrière…
On pourra mesurer l'efficacité de cette loi à l'aune du pouvoir des autorités de régulation qui ont été mises en place. On peut avoir quelques inquiétudes quant au Comité consultatif des jeux, qui devait dépendre du Premier ministre. Pour des raisons que je n'ai pas comprises, les services du Premier ministre ont saisi le Conseil constitutionnel pour ne pas être chargés de ce dossier, ce qui peut inquiéter les spécialistes du jeu pathologique.
Il me semble qu'après quarante ans de mise en oeuvre de la loi de 1970, on pourrait sortir des débats passionnels. Nous sommes devant des modèles de santé publique qui ont un passé certain et on peut commencer à essayer de tirer des leçons de toute cette expérience.
- Je crois pouvoir dire que nous n'avons jamais entendu de tels propos, tout du moins dans leur synthèse !
Existe-t-il des répercussions comportementales en fonction des drogues consommées ? Peut-on relever des distinctions selon le type de drogues, selon le type de public voire selon les techniques d'usage ?
- Oui et non. On s'est beaucoup interrogé sur le choix de la drogue par les toxicomanes. Depuis quarante ans, on constate que la variable la plus déterminante dans le choix d'une drogue est la disponibilité. On sait que, depuis l'élargissement des traitements de substitution, l'héroïne a diminué dans l'imaginaire des toxicomanes et a progressivement été remplacée par la cocaïne -alors que ce devrait être le contraire !
On a avec l'héroïne un anesthésique, un analgésique qui calme toutes les souffrances ; il s'agit d'un produit d'automédication par excellence. C'est une des rares substances qui mette fin aux souffrances des psycho-traumatisés alors que la cocaïne constitue un produit excitant, un produit d'action. Or, ce sont les mêmes personnes qui recourent aux deux produits !
Il ne faut donc pas trop faire de psychanalyse -même si c'est humiliant pour nous : ce que veulent les toxicomanes, c'est ne plus être eux-mêmes, c'est être ailleurs, ce qu'ils peuvent faire avec n'importe quel produit dès lors que cela entraîne un changement de l'état de conscience !
Cela étant, le lien entre dangerosité sociale, passage à l'acte et usage de drogue est extrêmement complexe. On a vu, dans les années 1970, des toxicomanes devenir agressifs parce qu'ils étaient en manque. Cette délinquance d'acquisition pouvait devenir extrêmement violente. C'est l'époque des casses de pharmacie et des arrachages de sacs à main perpétrés par des gens qui avaient besoin d'argent pour s'acheter leur drogue et qui tombaient dans la délinquance.
On a le même schéma, même atténué, avec les jeux d'argent. Le joueur qui veut se refaire et qui n'a plus d'argent va commencer par faire des chèques sans provision et finira par commettre des détournements de fond, des faux ou des vols afin de continuer à jouer et tenter de se refaire. Il s'agit d'une délinquance acquisitive, liée à l'état de manque et au besoin de continuer.
Il existe également des délinquances de type psychopharmacologique, où le passage à l'acte est déclenché par l'effet même de la substance : c'est le cas avec certains délires amphétaminiques ou cocaïnique, le produit le plus en cause restant toutefois l'alcool, produit le plus documenté en matière de passage à l'acte suicidaire ou délinquant. Un train entre Nice et Grasse a ainsi été saccagé par des jeunes qui ont massacré tout le monde, lors d'un retour de réveillon !
Le troisième type de lien entre toxicomanie et délinquance est ce que l'on peut appeler un lien systémique : les mêmes personnes, pour des raisons sociologiques, psychologiques et culturelles vont être amenées à être à la fois délinquants et usagers de drogues. Traumatisés dans leur enfance et n'ayant pas foi en l'avenir, ils sont malheureux et ne voient leur salut que dans la révolte et la délinquance. Demandant en quelque sorte réparation à un monde qu'ils considèrent injuste, ils vont s'adonner à la drogue pour essayer d'atténuer des souffrances préexistantes.

Vous avez éludé l'aspect compassionnel pour vous concentrer sur les différentes politiques menées par les uns ou les autres. Vous avez dit que les drogues étaient un sous-groupe des addictions. Avez-vous une classification de la dangerosité des drogues ? Beaucoup de cancers sont provoqués par le tabac et beaucoup d'accidents surviennent du fait de l'alcool mais beaucoup sont aussi dus aux psychotropes en tous genres -médicaments, cannabis, etc.
Par ailleurs, à Marmottan, comment prenez-vous en charge les personnes dépendantes ? Comment les orientez-vous vers la substitution ou vers le sevrage ? La substitution existe pour certains produits mais pas pour l'alcool ni le jeu.
- La dangerosité des drogues était l'intitulé du rapport commandé à Bernard Roques en 1997. J'avais d'ailleurs participé à sa rédaction et je pense que les données en sont toujours d'actualité, même s'il est très discutable. On avait eu trois mois pour le rédiger : c'était un peu rapide et beaucoup de données neuropsychologiques sont probablement aujourd'hui dépassées mais la classification serait la même : il existe des drogues extrêmement dangereuses en matière d'addictivité ou de toxicité somatique, de la toxicité cérébrale et de la dangerosité sociale.
L'alcool demeure la pire de toutes les drogues. Pour ce qui est de l'addictivité, c'est le tabac. Pour ce qui est des chiffres de santé publique, l'alcool provoque 60.000 morts par an, le tabac représente 45.000 morts par an en France. Ces deux produits demeurent donc les produits phares parmi les drogues les plus dangereuses. On trouve ensuite l'héroïne et les opiacés, qui sont extrêmement accrocheurs et qui, en fonction de leurs conditions d'utilisation dans un monde prohibitionniste, sont également extrêmement dangereux.
Les excitants et la cocaïne se situent un peu en dessous ; ces produits ne donnent pas lieu à dépendance physique comme l'héroïne mais à des dépendances beaucoup plus variables.
Le cannabis est une drogue beaucoup moins dangereuse que les autres. C'est une des raisons pour lesquelles les jeunes en consomment. En outre, il pousse partout et est très difficile à éradiquer.
Le jeu se situe probablement au même niveau. Il serait en cause dans plus de 10 % des suicides effectifs. Cela en fait un problème de santé publique non négligeable ; c'est pourquoi il convient de ranger les addictions sans drogue aux côtés des addictions avec drogue.
Comment soigne-t-on les gens ? Il faut que l'on puisse réaliser dans les centres de soins et de prévention des addictions ce que les nord-américains appellent des approches multimodales et mettre une palette d'outils à la disposition du patient en fonction de son état et de l'évolution de celui-ci. Ce peut être des psychothérapies plus ou moins « technologiques », des thérapies cognitivo-comportementales, des thérapies psychanalytiques, des médications de l'addiction, comme les produits de substitution pour les opiacées ou des produits antagonistes qui empêchent l'action d'une drogue et qui finissent par faire perdre l'intérêt pour celle-ci -Nalorex pour l'héroïne…
Ce peut également être des traitements des troubles psychiatriques associés qui ne sont pas toujours dramatiques, comme les états anxio-dépressifs, bipolaires...
Il faut pour ce faire des services sociaux efficaces, que ce soit pour les toxicomanes -qu'il faut réinsérer, à qui il faut réapprendre à vivre au quotidien- ou pour les joueurs à qui il faut réapprendre à faire un budget, ce qu'est un plan de surendettement, une tutelle, une curatelle ou une protection des biens. Il faut prendre en charge l'entourage quand il en existe encore : parents, conjoints, enfants des joueurs, familles.
On peut recourir en parallèle à des groupes comme « Narcotiques anonymes », « Alcooliques anonymes » ou « Joueurs anonymes » qui ne sont pas concurrents des autres formes de prise en charge, sauf en ce qui concerne les traitements de substitution, car ces groupes sont assez dogmatiques dans leur définition de l'abstinence.
On a donc toute une panoplie, avec des hospitalisations, des séjours de rupture, parfois des séjours en postcure qu'il va falloir utiliser pour chaque addiction, même pour les joueurs, que l'on hospitalise ou à qui l'on donne des médicaments, tout comme pour une autre addiction.
Ce qui fait que le traitement va être efficace, c'est la qualité relationnelle avec la personne, le fait qu'elle aura été reçue dans une ambiance sympathique, par les gens qui ne la jugent pas et qui sont prêts à entendre ce qu'elle a à dire. C'est là la vraie base de la thérapie. C'est une erreur, que de vouloir comparer telle forme de thérapie à telle autre : on sait depuis 1936 que le succès d'une psychothérapie n'est jamais dû à sa théorie de rattachement. Ce n'est pas le fait d'être psychanalyste, comportementaliste ou biologiste qui fait que cela fonctionne mais la qualité du thérapeute lui-même !
Il existe de bons thérapeutes parmi les psychanalystes ou les comportementalistes. Il faut savoir qui sont les bons et qui sont les mauvais ! Ce qui est compliqué pour les chercheurs, c'est le fait que l'essentiel du traitement va être déterminé par des facteurs non spécifiques : l'ambiance, l'ouverture d'esprit du thérapeute, l'humeur dans laquelle il se trouve le jour où il reçoit la personne, des choses impalpables très difficiles à objectiver dans une recherche. A Marmottan, on essaye de faire en sorte que l'ambiance soit chaleureuse et on s'interdit de juger les personnes.
- Saul Rosenzweig, psychanalyste, ami de Frederic Skinner, fondateur du comportementalisme, a écrit en 1936 un article rappelant « Alice aux pays des merveilles » intitulé : « Tout le monde a gagné et chacun doit avoir un prix ». Il a essayé de comparer les différentes formes de psychothérapies en se demandant quelle était la meilleure, de la psychanalyse ou du comportementalisme. Il s'est aperçu que le succès des psychothérapies n'était pas lié à leur théorie de rattachement.
Quantité de recherches ont été menées depuis pour essayer d'invalider ce postulat très vexant pour tous les psychothérapeutes mais qui n'en demeure pas moins vrai ! Cela a été prouvé par toutes les études qui ont eu lieu et confirmé récemment par une étude sur la drogue intitulée « Collaborative cocaïne treatment study » qui comparait des psychothérapies comportementalistes et des psychothérapies psychodynamiques en matière de prise en charge des cocaïnomanes. Celles-ci donnent en effet des résultats catastrophiques pour une raison très simple : on les a tellement technicisées que l'on a stérilisé la créativité des thérapeutes. C'est la seule fois dans l'histoire qu'une psychothérapie a eu des résultats pires que l'absence de traitement !
- Dans ce dualisme nécessaire entre prohibition et compassion, y a-t-il place pour des centres d'injection supervisés ? Est-ce utile ? Est-ce nécessaire ? Peuvent-ils apporter quelque chose ?
- C'est ainsi que la question aurait dû se poser. Il s'agit d'une question technique : en a-t-on besoin et en a-t-on les moyens ? Or, elle a été débattue comme une question politique opposant ceux qui estimaient qu'on ne pouvait aider les gens à se droguer à ceux qui criaient au scandale, affirmant qu'on voulait laisser mourir les usagers de drogues !
Il existe plus d'une centaine de centres d'accueil de proximité, de CAARUD. Si, dans certains endroits, comme à Paris ou Marseille, les intervenants alertent les autorités sur l'existence de scènes ouvertes et de lieux où les gens s'injectent leurs produits -portes cochères, toilettes publiques- et échangent les seringues à la sauvette- la logique de santé publique voudrait que l'on crée des centres d'injection supervisés. En a-t-on les moyens ? Combien cela coûte-t-il ? Le budget existe-t-il ? Ce sont là des questions techniques. Si ces centres sont implantés sur des lieux de scène ouverte, les riverains devraient être satisfaits : cela mettrait fin au danger qui existe pour les enfants, qui peuvent trouver des seringues, etc.
L'expertise de l'INSERM sur la réduction des risques et particulièrement sur ces questions montre que les évaluations des expériences étrangères sont positives à tous niveaux. Cependant, l'étude indique également que cela coûte cher ; il convient donc de savoir sur quel budget ces sommes seraient prises. J'aurais compris que l'on estime l'idée intéressante mais coûteuse mais j'ai été très choqué, lors d'un débat à la radio auquel j'ai participé, qu'un participant dise qu'il n'y avait qu'à laisser mourir les intéressés ! On retrouve dans les débats la passion que l'on a pu connaître dans les années 1970. On a pourtant quarante ans de recul ! Il serait temps d'en tenir compte !

- Confirmez-vous qu'il n'existe pas de mono-toxicomanie et que l'on se trouve souvent face à des poly-addictions ? L'image qui me vient à l'esprit est celle du joueur qui, seul devant son écran, fume des produits licites ou illicites, tout en buvant éventuellement, totalement désocialisé…
- Cela a toujours été une évidence et constitue un problème pour la recherche car il n'existe pas, par exemple, de cocaïnomane pur. Les gens qui consomment de la cocaïne prennent aussi de l'alcool, du tabac, des opiacés et des médicaments psychotropes en même temps. La poly-consommation est donc actuellement plus la règle que l'exception. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une conduite irrationnelle mais que la rationalité des consommations est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine.
Michel Le Moal a dit que la France est le pays qui consomme le plus de psychotropes. C'est vrai mais c'est une très bonne chose : cela ne veut pas dire que les Français vont mal, qu'ils sont désespérés ; cela veut dire que l'on a une très bonne couverture sociale et que cela ne coûte pas cher. Les Américains prennent beaucoup moins de tranquillisants parce que cela coûte une fortune et que ce n'est pas remboursé !
- Vous avez dit que la vraie base de la thérapie reposait sur la qualité de la relation avec le thérapeute. Comment celle-ci s'objective-t-elle dans la durée ? S'agit-il d'une autoévaluation du thérapeute ? Une nouvelle aventure se joue-t-elle à chaque fois entre le patient et son thérapeute ? Existe-t-il une rémanence lorsque le patient replonge dans son environnement habituel ?
- Je pense qu'il n'existe pas de mesure objective de la qualité relationnelle entre le patient et son psychothérapeute ; cependant, cela change la manière que nous avons de nous auto-évaluer. A Marmottan, on l'a compris depuis le milieu des années 1970 : le meilleur critère d'évaluation de base pour la prise en charge d'une addiction réside dans la facilité avec laquelle le patient va revenir vous voir quand il aura à nouveau des problèmes, contrairement à ce que l'on pouvait croire au début. On aura alors des prises en charge au très long cours mais de manière séquentielle.
On a vu des gens revenir parce qu'ils étaient retombés dans l'alcool alors qu'ils avaient arrêté l'héroïne depuis dix ans. On en voit aujourd'hui revenir pour le jeu, après avoir arrêté l'alcool depuis dix ans. Il existe ainsi des passages d'une addiction à une autre et c'est pourquoi les CSAPA doivent devenir des lieux de référence, un peu comme un hôpital général.
Je ne partage pas le pessimisme de Michel Le Moal. Cela fait 37 ans que je suis des toxicomanes ; quelques-uns viennent malheureusement toujours me voir parce qu'ils vont très mal -certains sont psychotiques, d'autres connaissent des troubles psychiques majeurs- mais j'en connais qui sont devenus des collègues et qui ne supporteraient même pas d'être considérés comme d'anciens toxicomanes. Ils se vivent autrement. Ayant traversé une période de leur vie, ils ne veulent pas être réduits à celle-ci.

- Quelle est la part d'influence et de dédiabolisation des produits que peuvent avoir de grands artistes comme Gainsbourg et d'autres chanteurs ou Verlaine, dont on dit qu'il a abusé d'un certain nombre de produits ? Il y a un paradoxe dans notre société, beaucoup de prohibitionnistes étant remplis d'admiration pour ces exemples -qui n'en sont pas toujours à certains égards !
- Véronique Nahoum-Grappe a écrit de très belles pages sur l'opposition entre la figure de l'artiste et celle de l'homme politique : l'artiste se doit d'être très mal dans sa peau, alcoolique, cocaïnomane et reçoit du ciel des traits de génie sans jamais travailler ; l'homme politique, au contraire, travaille sans arrêt, est submergé de dossiers et n'a manifestement pas le temps de s'amuser ! La réalité est bien sûr différente… Si on expliquait que Gainsbourg passait son temps à travailler et qu'il était tellement angoissé qu'il fallait qu'il se calme en buvant, qu'il s'agissait d'une sorte d'antidote contre le surmenage, on casserait le mythe. Si l'on racontait la véritable existence des hommes politiques, on casserait probablement aussi pas mal de mythes. Il s'agit là d'une représentation sociale.
Le plus dangereux reste que la société récupère tout : cette image de la star est une image de marketing inventée avec le rock'n'roll. Le sociologue François Dubet fait remonter à 1954 les débuts de l'adolescence au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est l'époque du premier 45 tours d'Elvis Presley. Le coût de génie du marketing et de la publicité est d'avoir utilisé un mouvement qui se présentait comme un mouvement de libération et de révolte pour en faire un vecteur de consommation à destination des jeunes ! On continue à parler d'une « attitude rock'n'roll » comme s'il s'agissait d'une attitude de rebelle dirigée contre le système alors que c'est le meilleur moyen de rentrer dans le système en achetant des chaussures de telle marque, des disques de tel chanteur, etc. !
Ce qui fabrique l'addiction dans la société c'est l'idée que le bonheur passe par la possession d'un certain nombre d'objets de consommation. Le problème est que même les révoltes contre cette société sont récupérées : le mouvement punk a ainsi donné lieu à une mode en l'espace de six mois !
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Per Holmström, ministre plénipotentiaire de l'ambassade de Suède en France
- L'audition à laquelle nous allons procéder maintenant va nous permettre d'établir une comparaison entre la politique française en matière de toxicomanie et celle d'un autre pays européen doté d'une politique très spécifique, la Suède.
Sans dévoiler ni détailler le contenu de cette politique, ce que fera dans un instant M. Holmström, je crois que l'on peut qualifier celle-ci de globalement très restrictive à l'égard des drogues et de la toxicomanie -et ce depuis une quarantaine d'années. Il nous a semblé intéressant de tirer les fruits de l'expérience suédoise et de réfléchir à ce qui pourrait être transposé dans notre pays.
Vous avez la parole…
- Je ne suis pas expert en matière de politique suédoise de toxicomanie. Etant donné les circonstances et les événements internationaux récents au Sud de la Méditerranée, je n'ai malheureusement ni eu le temps suffisant pour me préparer de la façon que j'aurais souhaité, ni reçu le soutien que j'aurais espéré de mon ministère des affaires sociales et de la santé.
Je vous propose donc de répondre dans la mesure du possible à vos questions et, pour celles qui dépassent ma compétence, de le faire plus tard, soit par oral, soit par écrit.
- Fort bien ! Pouvez-nous présenter la politique suédoise de lutte contre les drogues illicites ? Quels en sont les grands axes ?
- Il est vrai que la politique suédoise en la matière est répressive et concerne non seulement les drogues mais également, l'alcool, le tabagisme, le dopage et les jeux.
L'accès à l'alcool est assez restrictif et la consommation d'alcool par tête d'habitant est de ce fait inférieure à la moyenne européenne. Il existe en Suède un monopole de la distribution et la vente d'alcool aux moins de 20 ans.
En ce qui concerne la législation sur les drogues illicites, la France et la Suède ont depuis longtemps des politiques assez fermes au sein de l'Union européenne. Depuis 1988, avoir de la drogue sur soi, en transporter ou aider quelqu'un à en vendre constitue une infraction pénale ; les pouvoirs publics affichent une tolérance zéro en la matière. C'est un point essentiel à retenir.
En 2009, d'après les dernières statistiques basées sur des sondages anonymes auprès de jeunes et d'adultes, environ 26.000 personnes sur une population de 9,5 millions d'habitants ont été considérées comme dépendantes. Les questionnaires qui sont établis en troisième auprès des jeunes de 15 ans révèlent que 9 % des garçons et 7 % des filles avouent avoir essayé, une fois dans leur vie, des drogues -cannabis ou autres.
Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à 2008 ; toutefois, dans les années 2000, les statistiques étaient un peu plus élevées.
Lorsqu'on demande aux jeunes s'ils ont utilisé du cannabis dans les 30 jours écoulés, on se situe entre 2 et 3 % pour les garçons contre 1 % pour les filles. Pour ce qui est des adultes, environ 15 à 16 % des hommes et 7 à 8 % des femmes ont essayé des drogues au moins une fois dans leur vie. L'utilisation durant les douze derniers mois est à peu près égale chez les hommes et chez les femmes et tourne autour de 1 à 2 %.
- Je vous ferai parvenir le dernier rapport national soumis à l'Union européenne contenant des statistiques sur l'utilisation des différentes substances. Il s'agit en grande partie de cannabis, de cocaïne et d'héroïne.
- Cette tolérance zéro a-t-elle toujours existé ? Les législations antérieures n'étaient-elles pas plus permissives ?
- Comme partout en Europe, durant les années 1970, la consommation et la possession pour usage personnel de drogues légères ont peut-être donné lieu à un certain laxisme mais sur le fond, nous avons toujours adopté une position assez restrictive sur les drogues. A la fin des années 1980, le resserrement a été encore plus fort.

- Vu de France, votre pays a la réputation de mener de grands plans de prévention. En milieu scolaire, quels moyens mettez-vous en oeuvre pour lutter contre les addictions de tous ordres ? De quels personnels disposez-vous -infirmières, médecins ? La sensibilisation au cannabis dans les écoles est-elle réalisée par les forces de l'ordre ?
- En Suède, les ministères sont de petites entités. Le ministère des affaires sociales et de la santé ne compte pas plus de 300 personnes. Les ministères envoient des impulsions politiques aux administrations centrales et locales indépendantes, qui agissent sur la base de ces orientations.
Le ministre de la santé a créé il y a quelques années un secrétariat de coordination relatif aux questions d'addiction chargé de veiller à la cohérence de tous les acteurs de la société, soit dans le domaine de la prévention, soit dans celui de la répression ou la réhabilitation.
En Suède, les communes -qui ne sont pas aussi nombreuses qu'en France- ont une plus large autonomie, un plus grand pouvoir de taxation et des responsabilités plus grandes qu'en France. Les écoles relèvent par exemple de la responsabilité des communes. Les communes ont vivement encouragé la création de postes spécifiques autour de la toxicomanie et des dépendances. Les trois-quarts des communes ont mis en place des personnels qui supervisent la cohérence des structures sociales et communales en la matière.
Beaucoup de moyens sont mis en place dans les écoles en matière d'information. Ce n'est pas la police qui en est chargée mais des civils -professeurs, habitants de la commune…
Il existe également un certain nombre d'interventions sur les sujets qui tournent autour de la drogue ; certaines actions touchent à la fois aux mobiles et aux risques auxquels peuvent être confrontés des adolescents.
Des moyens financiers viennent également soutenir nombre d'organisations et d'associations. Je vous invite à vous rendre sur le site en langue anglaise « Drugsmart.com », qui est uniquement tourné vers les jeunes, avec des chats, des informations sur les drogues formulées de telle façon que les adolescents les comprennent, des jeux, des concours. Il est également possible d'obtenir des bourses en faveur d'activités que l'on veut encourager.
- Pouvez-vous nous apporter davantage d'informations sur la partie curative concernant les personnes alcooliques ou se trouvant dans un processus de décompensation liée à la prise régulière de certaines drogues ?
- Je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre aujourd'hui. Je reviendrai vers vous…
- Vous avez la possibilité de nous apporter un certain nombre d'informations ou de compléments par écrit -certes dans des délais quelque peu contraints, notre mission achevant ses auditions dans deux mois.

- Je souhaiterais revenir sur la prévention et la prise en charge par les communes. N'existe-t-il pas de programme national ?
J'ai par ailleurs cru comprendre que la prévention intervenait très tôt, dès le CM 2, non seulement en matière de toxicomanies mais également de pédophilie, de tabac ou d'alcool. Pouvez-vous nous le confirmer ?
Enfin, le testing s'applique-t-il uniquement dans les collèges ou est-il généralisé ?
- Il existe des programmes nationaux mis en oeuvre par les préfectures mais aussi par les communes. Les actions concernent tous les domaines : ce n'est donc pas réservé aux communes même si les grands axes sont définis nationalement.
S'agissant de l'information délivrée aux enfants, elle commence avant le collège mais l'essentiel se fait au collège.
Quant au testing, je ne puis vous dire si cela se fait dès le collège ; je devrai donc revenir vers vous pour cela.

- Existe-t-il en Suède un service civique ou militaire, au moment de l'adolescence et du passage à l'acte ?
Comment appréhendez-vous la question du risque sanitaire et de la transmission de maladies comme le VIH -même si vous y êtes moins confrontés que la France, du fait de son mélange de populations ?
Enfin, quelle réponse apportez-vous aux trafics ? Cela peut sembler marginal en Suède mais il doit bien exister des trafics ! Réglez-vous cette question par la prison ? Comment faire en sorte que les gens s'amendent avant qu'ils n'en sortent -s'ils y vont ?
- Il n'existe pas de service civique pour les adolescents. Le service militaire est devenu aujourd'hui quasiment volontaire en Suède. Personnellement, je trouve cela dommage mais c'est un débat assez similaire à celui que vous connaissez en France et qui n'est pas tranché.
Le débat à propos de la question sanitaire est également assez vif en Suède. Pour l'instant, l'échange de seringues, malgré le fait que cela peut réduire les risques de transmission de certaines maladies comme le VIH, n'est pas considéré comme une réponse au problème. C'est une question d'idéologie et il n'est pas question de l'aborder pour l'instant. Cela n'empêche toutefois pas le débat. La Suède a étudié ce qui se passait en Suisse et le Gouvernement en a tiré ses conclusions.
Le trafic est bien sûr une question essentielle de la stratégie globale qui consiste à travailler au mieux sur l'offre. Des moyens sont mis à disposition des douanes. J'imagine qu'elles travaillent à peu près comme en France. Les flux, en Suède, sont importants et le trafic est sévèrement réprimé ; il peut facilement donner lieu à dix ans de prison.

L'échange de seringues paraît encore faire polémique chez vous. Qu'en est-il de la contamination par le VIH ? Connaissez-vous une épidémie importante de Sida ? La prévention que vous pratiquez limite-t-elle le nombre de personnes contaminées ?
- C'est une question difficile ; les réponses figurent dans les statistiques sur le VIH.
- Nous les retrouverons dans le document…
Nous vous remercions pour toutes ces informations.
- Puis-je vous poser une question : sur quoi la réflexion doit-elle aboutir ?
- Nous sommes une mission d'information ; elle peut aboutir à des propositions mais peut également donner lieu à des initiatives du Gouvernement ou d'un parti.
Notre objectif est d'apporter à l'ensemble de nos collègues de l'Assemblée Nationale et du Sénat le maximum d'information sur ce sujet.

– Nous pouvons peut-être dire qu'un débat est né en France autour des salles de consommation à moindres risques. La ministre de la santé avait considéré que ce débat pouvait être intéressant. Le Premier ministre ne l'avait pas suivi. Quelques élus sont allés à l'étranger visiter ces types de structures et le Sénat et l'Assemblée nationale ont voulu en savoir plus.
- Il est exact que cette mission n'est pas arrivée là par hasard. Elle intervient à un moment particulier d'un débat public.
- La mission répond-elle aussi au sentiment que le problème de la toxicomanie s'aggrave en France ?
– Il y a des problèmes et nous nous posons des questions…

La mission a sans doute été provoquée par le débat de l'été dernier sur les salles d'injection mais notre débat se veut beaucoup plus large : il est également destiné à évaluer notre politique en direction de la prise en charge des toxicomanes.
- Sans vouloir absolument avoir le sens du consensus, je puis dire que tout le monde a raison au terme des réponses qui vous ont été données !
Merci.
La séance est levée à dix-neuf heures.