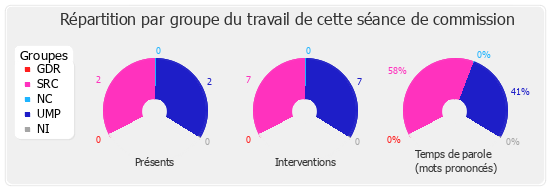Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 18 mai 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 18 mai 2011
La séance est ouverte à seize heures vingt-cinq.
(Présidence de M. François Pillet, sénateur, coprésident et de M. Serge Blisko, député, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies entend le professeur Dominique Maraninchi, directeur général, et Mme Nathalie Richard, membre de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
- Professeur Maraninchi, merci de nous apporter le témoignage de votre expérience. Vous êtes président de l'AFSSAPS mais également cancérologue et avez présidé l'Institut national du cancer.
Je vous propose de nous présenter les missions de l'AFSSAPS dans le domaine de la toxicomanie et des stupéfiants.
Professeur Dominique Maraninchi - Merci.
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, je suis un jeune directeur général de l'AFSSAPS et très fier d'assumer cette fonction.
D'après les conventions de l'ONU, chaque État doit désigner une organisation responsable de l'application de deux conventions internationales, l'une sur les stupéfiants, l'autre sur les substances psychotropes ; en France, c'est l'AFSSAPS qui assure cette mission.
Le rôle de l'AFSSAPS est d'assurer la sécurité et de suivre la distribution de l'ensemble des produits de santé sur le territoire. L'AFSSAPS a donc le pouvoir, de par la loi, de réglementer, de prendre des décisions de police sanitaire ; pour ce faire, elle s'appuie sur des expertises et exerce également des responsabilités sur les corps d'inspection et de contrôle.
Il s'agit donc de procéder à une analyse extrêmement fine de tous les produits de santé pour s'assurer du respect des sources de production et de la qualité des produits.
L'AFSSAPS a l'avantage de pouvoir fédérer en son sein les acteurs qui participent à la lutte contre la toxicomanie et à l'usage de psychotropes ; elle rassemble l'ensemble du dispositif existant en France. Les centres d'évaluation et d'information de la pharmacodépendance se réunissent et préparent les travaux de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes. L'AFSSAPS compte un département dirigé par Nathalie Richard, ici présente, qui coordonne l'ensemble de ces travaux et travaille en association avec la MILDT, l'OFDT, l'OEDT. L'AFSSAPS pèse aussi dans ce domaine à l'échelle européenne.
Le contrôle du marché des substances est un élément extrêmement important pour suivre les pratiques illicites dans les zones frontières. Tous les produits de santé sont en effet destinés à faire du bien mais peuvent aussi avoir des effets secondaires dangereux. En cancérologie, la consommation de kilos de morphine est signe d'accès au traitement de la douleur et non forcément un abus d'usage. Nous nous situons donc dans un contexte global.
L'AFSSAPS exerce le contrôle du marché de l'ensemble de ces substances et occupe une position privilégiée pour travailler sur la notion de bénéfice-risque des drogues à visée thérapeutique ou qui comportent des dangers.
L'AFSSAPS a la responsabilité de la mise sur le marché, de la surveillance et de l'utilisation de ces substances, en particulier les substances impliquées dans la dépendance aux opiacés -Subutex ou Méthadone. Nous sommes là dans le domaine de la régulation des produits pharmaceutiques, l'AFSSAPS intervenant également sur les conditions de traitement et de distribution des produits proposés au ministre de la santé.
La troisième faculté de l'AFSSAPS -peut-être mieux exercée dans ce domaine que dans d'autres- est d'évaluer et de surveiller un produit une fois celui-ci mis sur le marché, de rassembler des études et des expertises en provenance de milieux et d'acteurs divers -pharmacies, médecins sentinelles, système médico-légal, études programmées de pharmaco-épidémiologie utilisant les données de l'assurance-maladie. Il s'agit d'un élément critique qui permet une meilleure vision du bon usage du médicament avant de prendre des décisions.
L'AFSSAPS a également la capacité de repérer, d'analyser et d'interpréter les signaux relatifs à l'usage et à l'usage abusif de drogues.
Enfin, l'AFSSAPS a la capacité de proposer le classement des substances dans la liste des stupéfiants.
Les pratiques médicales sont en cours de traitement. Nous étudions par exemple les ordonnances sécurisées et la généralisation de leur usage ou l'empilement de divers types d'ordonnances dans les cabinets médicaux.
Le choix de la France a été de confier à l'AFSSAPS cette mission exercée dans le cadre de ses responsabilités générales. Le département de Nathalie Richard utilise donc l'ensemble des ressources d'évaluation et de vigilance au sein de la direction de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques, avec toute la spécificité liée à la nature de ces produits.
Nathalie Richard pourrait peut-être à présent prendre des exemples plus concrets pour illustrer certains de mes propos…
- M. Maraninchi a bien situé le rôle de l'AFSSAPS. Il convient de souligner la position de référent qu'occupe l'AFSSAPS par rapport à l'ONU et à l'OICS. L'AFSSAPS transmet en effet annuellement des rapports à l'OICS concernant la consommation et la production de stupéfiants.
L'AFSSAPS ne s'occupe pas que des produits de santé mais est également en charge de l'ensemble des substances psychoactives, ainsi que des drogues. C'est pourquoi nous travaillons également sur les alertes sanitaires liées à celles-ci.
L'AFSSAPS s'appuie sur un réseau de centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. Les CEIP sont au nombre de treize et sont situés sur l'ensemble du territoire français ; ils sont essentiellement composés de pharmacologues et de toxicologues.
Le rôle de l'AFSSAPS concernant le marché licite des stupéfiants est peut-être moins connu. La France est le second pays producteur de stupéfiants dans le monde, derrière l'Australie. Cette production est mise en oeuvre par Francopia, filiale de Sanofi, qui cultive en France deux variétés de pavots, utilisés à la fois pour la production de dérivés de morphine mais également pour la production d'Oxycodone ou de Buprénorphine.
Cette production licite de stupéfiants par la société Francopia est réalisée en lien avec l'AFSSAPS. Nous sommes donc en charge de ce contrôle licite des stupéfiants et des cultures de pavots en France.
La lutte contre la douleur s'est développée en France à partir de 1999 avec trois plans triennaux. On a ainsi vu la consommation et la production d'Oxycodone passer de un kilo à 657 kilos en 2009, la transformation en médicament entraînant une consommation beaucoup plus importante.
Le second axe de développement et de production est la Buprénorphine. La production est passée, pour cette dernière, de 151 kilos en 1998 à 339 kilos en 2009, soit environ 117 000 patients sous Buprénorphine, Subutex et générique. Pour la Méthadone, on est passé de 149 kilos en 1998 à 816 kilos actuellement, soit 3 700 patients.
Ces médicaments sont indispensables en termes de lutte contre la douleur ou contre la toxicomanie. Cette mission de contrôle des stupéfiants par l'AFSSAPS est donc absolument nécessaire en termes de santé publique.
En France, seuls deux médicaments ont une AMM et sont commercialisés dans le cadre de la dépendance aux opiacés : le Subutex, commercialisé en 1996, dont cinq génériques sont maintenant sur le marché et la Buprénorphine, psychotrope dont la prescription suit une partie de la réglementation des stupéfiants, avec prescription sur ordonnance sécurisée et limitation de la durée de prescription à 28 jours. Toutefois, la Buprénorphine et le Subutex ne sont pas des stupéfiants.
Ces deux médicaments peuvent être prescrits par n'importe quel médecin, ce qui n'est pas le cas de la Méthadone.
En effet, il a fallu enrayer l'épidémie de Sida et généraliser l'utilisation de la Buprénorphine, beaucoup moins dangereuse que la Méthadone, dont la toxicité directe est bien plus importante. La Méthadone a été dans un premier temps réservée à des centres de soins spécialisés, la Buprénorphine étant beaucoup plus générale.
L'AFSSAPS et les services répressifs ont identifié cinq types d'utilisation problématique du Subutex, en particulier une auto substitution par certains patients, un usage toxicomaniaque, une utilisation par voie injectable et par sniff. Cette utilisation hors AMM induisait un certain nombre de problèmes graves de santé publique -dépressions respiratoires, infections, problèmes vasculaires- ainsi qu'un nomadisme médical et le développement d'un trafic international pour le Subutex.
Dès 2007, l'AFSSAPS avait déjà informé les professionnels de santé sur les risques et le bon usage de la Buprénorphine et attiré l'attention des médecins sur la nécessité de suivre leurs patients de façon plus étroite, recommandant que le nom du pharmacien figure sur l'ordonnance du patient afin de créer un lien entre médecin et pharmacien, et de favoriser une meilleure prise en charge du patient. Cette recommandation s'est concrétisée par un arrêté de l'assurance-maladie.
Le second type de mesure a porté sur la mise en place d'un plan de gestion des risques pour la Buprénorphine, le Subutex et ses génériques, avec suivi de pharmacovigilance et d'addictovigilance. L'AFSSAPS réalise des bilans très réguliers ; le dernier a été présenté en janvier 2011. Il est vrai que l'on continue à avoir des problèmes de mésusage, d'injection et de détournement mais on rencontre ces problèmes davantage avec le Subutex qu'avec les génériques. C'est ce qui ressort des études des CEIP.
Un autre problème a préoccupé l'AFSSAPS, la composition du générique du Subutex, qui comportait plus d'excipients solubles et était moins injectable que le Subutex, la galénique pouvant réduire ou augmenter son effet.
Une étude mutualisée va être mise en place par l'Agence avec l'ensemble des laboratoires génériqueurs et princeps, sous le contrôle de l'AFSSAPS, afin d'avoir une idée plus précise du mésusage.
Enfin, l'AFSSAPS, à la demande de la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes, a rédigé avec des addictologues, des pharmaciens et des toxicologues, une mise au point destinée à favoriser le bon usage de la Buprénorphine. Cette mise au point est destinée essentiellement aux généralistes, qui sont les grands prescripteurs de Buprénorphine. La prescription généralisée de Buprénorphine posant peut-être le plus de problèmes, le but est de mieux informer les médecins prescripteurs, qui ne sont pas forcément spécialistes. Cette mise au point devrait être publiée en juin.
Le second médicament à disposer d'une AMM dans le cadre du traitement de substitution de la dépendance aux opiacés est la Méthadone, mise sur le marché en 1995 sous forme de sirop, dont la formulation empêche l'injection. Cela s'est avéré efficace et empêchait également le trafic car il n'est pas aisé de revendre des flacons de Méthadone au marché noir.
La toxicité de la Méthadone étant plus importante que celle de la Buprénorphine, les conditions de prescription sont dans un premier temps beaucoup plus contraintes pour la Méthadone en sirop, avec une primo-prescription par des spécialistes dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes et dans des milieux hospitaliers spécialisés.
La Méthadone sous forme de gélule est apparue en 1997, développée par le même laboratoire. Celle-ci présentait une plus grande acceptabilité pour les patients. Elle est plus maniable, sans sucre et sans alcool, ce qui n'était pas le cas du sirop.
Si la gélule est plus maniable pour les patients, elle l'est également pour les trafiquants. L'AFSSAPS a donc souhaité encadrer la délivrance de la gélule et a réservé sa prescription à des sujets stabilisés sous sirop sur le plan des pratiques addictives et sur le plan médical. Le patient retourne donc en centre de soins pour la prescription de la gélule et peut être pris en charge ensuite par son généraliste.
Par ailleurs, un plan de surveillance de la Méthadone extrêmement important a été mis en place ; il fait appel aux centres de pharmacovigilance et aux centres d'addictovigilance ainsi qu'aux centres antipoison pour ce qui est des intoxications.
Le bilan à deux ans est plutôt rassurant pour la Méthadone sous forme de sirop et la Méthadone en gélule. Le seul point qui pose encore problème à l'AFSSAPS et aux autorités sanitaires en général est lié à la toxicité et aux intoxications accidentelles chez l'enfant, chez qui l'on déplore un certain nombre de cas graves. Le blister contenant les gélules est si bien sécurisé que les patients déconditionnent les gélules et ouvrent les flacons de sirop qui sont également sécurisés. Les enfants peuvent donc avoir accès à ces produits et deux ou trois catastrophes ont déjà eu lieu. On essaye donc de faire en sorte que la communication soit renforcée autour de cette problématique.
Il existe bien sûr des médicaments utilisés hors AMM, comme les sulfates de morphine, le plus ancien étant le Néocodion, qui ne pose toutefois plus trop de problèmes…
- Non. Certaines personnes l'utilisent encore comme substitution d'appoint ; en général, ce sont des toxicomanes assez anciens mais le Néocodion ne présente plus, comme dans les années 1980-1990, de problèmes de santé publique depuis l'apparition de la Buprénorphine.
- Les comprimés étaient en effet plus détournés que le sirop…
Deux autres sujets sont en cours d'étude, la DGS ayant saisi l'AFSSAPS et la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes au sujet de la possibilité d'utiliser des médicaments injectables dans le cadre particulier de la substitution d'une part et, d'autre part, de la mise à disposition de la Naloxone, antidote de l'héroïne qui, dans plusieurs pays, a fait ses preuves en matière de prévention des overdoses mortelles.
L'AFSSAPS a proposé un essai en France ; son rôle sera alors de veiller au respect réglementaire de l'essai clinique et à la traçabilité des médicaments, à leur bonne utilisation et à la surveillance de la pharmacovigilance.
Il faut citer le Rupnol s'agissant du détournement d'usage de certains médicaments. Dans les années 1990, certains médecins avaient lancé une pétition pour le retirer du marché français suite à des utilisations par les toxicomanes pouvant aller jusqu'à 200 comprimés par jour et par personne. La Commission des stupéfiants avait proposé un certain nombre de mesures de communication qui n'avaient pas donné les résultats escomptés. On a donc appliqué au Rupnol une partie de la réglementation des stupéfiants.
L'AFSSAPS a recommandé la prescription du Rupnol, hypnotique assez puissant, sur ordonnance sécurisée avec limitation de traitement à quatorze jours. L'utilisation chez les personnes dépendantes existe toujours mais les volumes de ventes ont été réduits de près de 60 %. Nous avons été les premiers surpris qu'une mesure réglementaire qui nous semblait insuffisante produise des effets aussi étonnants !
Professeur Dominique Maraninchi - Cet exemple illustre le problème des zones frontières. Peser sur les conditions de prescription et sur la responsabilité des prescripteurs peut être très efficace pour limiter les mésusages médicaux. Hors trafic, l'usage de benzodiazépine est extrêmement élevé en France et peut inciter certaines personnes à devenir dépendantes, même si les effets sont moins spectaculaires qu'avec d'autres drogues. Je trouve l'expérience éloquente…
- Les CEIP et l'AFSSAPS ont mis en place des études épidémiologiques permettant de cibler les toxicomanes, dont on arrive à connaître les consommations et l'usage des produits quantitativement et qualitativement par le biais de la médecine générale et de la médecine spécialisée.
Nous avons par ailleurs utilisé les bases de l'assurance-maladie pour étudier la consommation des médicaments de substitution. Nous collaborons d'autre part avec les experts médico-légaux, dans le cadre de l'étude DRAMES, sur les décès par overdoses en Europe. Les substances sont clairement identifiées. Cette étude est une référence car elle permet de suivre la toxicité des médicaments d'une année sur l'autre.
L'AFSSAPS, l'INVS, l'OFDT et la DGS recueillent des signaux liés aux drogues -circulation d'héroïne très dosée ou coupée avec des produits qui ajoutent encore à la toxicité-, les évaluent et font remonter des messages d'alerte sanitaire. Nous en avons eu environ dix-huit en 2010 qui ont donné lieu à des communications vers les médecins, les services d'urgence et les addictologues.
Enfin, l'AFSSAPS et la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ont pour rôle de proposer l'inscription des substances sur la liste des stupéfiants.

- Merci pour cette présentation. Nous avons parfaitement saisi votre rôle d'évaluation et de régulation de tous ces produits psychotropes.
Mon attention a été attirée par les risques de toxicité de la Méthadone, impliquée dans plus de 34 % des décès par overdose, ce qui est énorme.
Le risque ne devient-il pas très important ? Doit-on persister dans cette substitution ou aller vers autre chose ?
- Non. La Méthadone, en France, est uniquement prescrite dans le traitement de substitution de la dépendance aux opiacés. Dans d'autres pays, on peut l'utiliser également contre la douleur.
Professeur Dominique Maraninchi - Vous posiez la question générale du bénéfice-risque. Celle-ci s'examine dans un contexte particulier, pour une population particulière.
La préoccupation porte sur les usages abusifs de Méthadone et sur les accidents mentionnés chez les enfants.
En tant que toxicologue, je ne puis qu'être préoccupé par le détournement d'usage et les conséquences en termes de risques et d'overdoses. Le dispositif n'est donc pas suffisant pour limiter le risque.

- La Méthadone est-elle uniquement délivrée dans un centre de Méthadone ? La prise ne se fait-elle pas devant l'infirmier ou le médecin ?
- La première prescription de Méthadone est faite dans un centre de soins par un spécialiste. Il peut y avoir ensuite délivrance dans les centres de soins mais également dans une pharmacie de ville
- Si, bien sûr. La durée maximale de prescription est de quatorze jours ; le patient peut donc se faire délivrer la Méthadone par une pharmacie de ville et la prendre chez lui.
C'est un spécialiste qui délivre la primo-prescription. Le relais peut ensuite être pris par un médecin de ville. Ces médecins sont en général très impliqués -peut-être plus que ceux qui prescrivent du Subutex. La prise de produit ne se fait pas forcément devant un personnel médical.
Le problème de la toxicité de la Méthadone a été appréhendé dès le départ. Le fait que Subutex et Méthadone n'aient pas les mêmes conditions de prescription, de délivrance et d'accès était prévu, la Méthadone comportant davantage de contraintes. Certes, on rencontre plus d'overdoses chez les sujets sous Méthadone, produit extrêmement toxique -1 mg par kilo peut tuer une personne naïve- mais il faut toutefois ramener le nombre de décès à celui des patients traités…
- En effet mais la Méthadone étant en général réservée aux patients les plus difficiles à traiter et figurant de ce fait parmi les sujets à risques, le nombre d'overdoses mortelles est également plus élevé.
La question nous préoccupe ; nous avons mis en place un plan de gestion de risques renforcé avec les centres antipoison pour bien appréhender le problème de la toxicité.
- Quels sont les chiffres des overdoses dues aux autres produits ?
Par ailleurs, avez-vous mené une étude sur l'usage de Méthadone dans le cas où la drogue serait légalisée ?
- En 2009, le nombre de décès par overdose lié à l'utilisation de produits ou de médicaments était de 260 -chiffre fourni par des toxicologues analystes. Les drogues illicites représentaient 53 % et les drogues licites 57 % des cas de décès.
- Il s'agit de médicaments contre la douleur qui sont détournés. On trouve dans ces chiffres 48 cas de décès imputables à la Méthadone et 30 cas de décès par Buprénorphine.
- Il s'agit quand même d'une forme d'overdose !
- On a volontairement restreint le champ. Il est difficile de faire la différence avec un toxicomane qui se suicide mais il ne s'agit pas ici de chiffres de suicides.
Professeur Dominique Maraninchi - Ce type d'accès permet de mener une politique de prévention de la catastrophe ; on n'est toutefois pas totalement efficace, certains utilisant des mélanges très farfelus.
L'analyse porte sur l'overdose mortelle, qui ne prévient pas totalement tous les inconvénients de la toxicomanie. Que ce soit avec la Méthadone, très dangereuse mais cadrée, ou avec des drogues licites détournées, on retrouve des cocktails extrêmement dangereux.
Quant à la permissivité éventuelle, la zone frontière est celle des psychotropes. Il s'agit de médicaments utiles, comme les antalgiques. Notre problème est d'en réguler le détournement de l'usage. Il nous semble que la régulation des conditions de prescription et le contexte sont extrêmement importants. La responsabilisation des médecins et des pharmaciens constitue un élément très important. La prescription de Méthadone est d'autant plus grave de conséquences que le sujet se trouve dans un contexte social particulier. Augmenter l'accès ne peut donc entraîner qu'une suite de conséquences néfastes.
- L'AMM est-elle révisée au niveau européen ?
Par ailleurs, êtes-vous saisi d'une demande d'AMM concernant le cannabis en matière d'usage médical ?
- Même si l'Union européenne nous reproche que nos chiffres ne sont pas fiables, ce sont les plus bas d'Europe ! Nous avons mis en place un comptage croisé entre l'INSERM, l'étude DRAMES et la police. Nous arrivons à 500 décès par overdose en France, donnée inférieure aux chiffres européens.
Par ailleurs, aux États-Unis, l'Oxycodone est un problème de santé publique extrêmement grave que l'on ne rencontre pas en France.
Quant à l'AMM de la Méthadone, elle est nationale.
Professeur Dominique Maraninchi - Nous en avons donc la responsabilité totale. Il n'existe aucun frein européen -pas plus que pour le Médiator. L'AFSSAPS a autorité, pour des raisons de santé publique, à prendre des décisions qui, dans l'affaire du Médiator, pour diverses raisons, n'ont pas été prises.
- Il n'existe pas d'alerte de la Sécurité sociale dans le cas où une personne voudrait s'approvisionner deux fois de suite en Subutex à un jour d'intervalle ! Ce n'est pas le cas pour les autres ordonnances renouvelables…
- Il est en effet étonnant que les patients qui se fournissent en Subutex plusieurs fois de suite soient remboursés sans contrôle. En 2004, l'assurance-maladie a mis en place un plan d'action permettant d'identifier les posologies de Buprénorphine supérieures à 32 mg, voire plus importantes et également de savoir si le patient avait plus de trois prescripteurs.
Dans ce cas, une alerte des caisses d'assurance-maladie est déclenchée. Il existe d'ailleurs un service contentieux…
- C'est à l'assurance-maladie de vous répondre. Le nombre de prescripteurs intervient, de même que la posologie. Le système a été renforcé depuis 2007 et s'est révélé efficace.

- Vous avez évoqué des propositions d'inscription de substances sur la liste des produits stupéfiants et des psychotropes. Quelles sont-elles ?
- Cette inscription est du ressort de la santé ; c'est bien la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes qui examine les substances et qui propose leur classement au ministre.
Cette procédure nationale est une transposition des procédures internationales mais l'ONU a laissé toute latitude aux États signataires, si une substance pose problème, de l'examiner et de la classer sur la liste des stupéfiants. C'est ce que nous faisons. L'AFSSAPS a ainsi récemment proposé le classement d'une nouvelle drogue de synthèse, la méphédrone. L'intervalle entre l'arrivée de la substance sur le territoire et son classement sur la liste des stupéfiants a été de six mois.
Il existe une procédure européenne similaire. La France a classé la méphédrone sur la liste des stupéfiants et l'Europe a interdit et réglementé son accès six mois après.
Les États signataires peuvent donc réguler l'inscription des substances et les inscrire sur la liste des stupéfiants. Il s'agit de l'arrêté du 22 février 1990 ; trois annexes constituent la transposition des substances inscrites à l'ONU, l'annexe IV comportant un classement franco-français. Depuis 2001, trente substances ont été placées sur la liste des stupéfiants.
Quant à la légalisation du cannabis, elle n'est pas du ressort de l'AFSSAPS. En France, il existe un certain nombre de médicaments dont certains sont sous conditions temporaires d'utilisation et qui contiennent des THC de synthèse, comme le Marinol. Dans un cadre particulier, un médecin peut demander que son patient utilise ce médicament. Des ATU -autorisations temporaires d'utilisation- ont donc été délivrées.
En France, l'utilisation thérapeutique du cannabis n'est pas autorisée, contrairement au THC.
Professeur Dominique Maraninchi - Nous devons renforcer la médicalisation de la prescription d'un nombre de substances de plus en plus grand et être capables de les surveiller. Il existe des mesures compliquées mais aussi des mesures simples. Les débats portent depuis des années sur l'utilisation d'ordonnances sécurisées. Ce sont des questions de priorité : favorise-t-on les ordonnances bizones pour le remboursement ou des ordonnances sécurisées pour être sûr du bon usage d'un médicament ?
Sécuriser l'usage de beaucoup de médicaments, même non classés, pourrait améliorer la sécurité sanitaire et renforcerait la responsabilité des prescripteurs. Ceux-ci commencent à y être sensibles. Il ne faut surtout pas donner libre accès à ces médicaments, qu'il s'agisse de produits de substitution ou de médicaments très utiles dans certains cas. Il faut donc qu'on les traite comme des médicaments comme les autres.
Je me souviens qu'en 1975, on testait déjà le THC pour ses vertus anti-vomitives dans le cadre d'essais cliniques qui n'ont pas démontré leur efficacité. On rencontre beaucoup d'allégations autour de ces substances et il faut que l'on puisse mieux les étudier scientifiquement. Certains cadres restreints permettent de le faire par le biais d'autorisations d'essais cliniques.
Nous pouvons vous faire parvenir des documents complémentaires si vous en avez besoin…

- Il serait intéressant que nous puissions avoir connaissance des analyses cliniques sur le cannabis…
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Yves BOT, premier avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne.
- Nous recevons M. Yves Bot, premier avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient témoigner au titre de ses anciennes fonctions de Procureur général près la Cour d'appel de Paris.
Nous souhaiterions en effet approfondir le pilier répressif de la lutte contre les toxicomanies qui est régulièrement contesté mais qui reste, de l'avis de beaucoup, néanmoins indispensable. Les choses étant susceptibles d'évoluer, c'est surtout sur ce point que nous souhaiterions recueillir votre expertise.
- Je vous remercie de me permettre de renouer avec un tropisme personnel qui ne m'a pas vraiment quitté. Ce sont des fonctions dont on sort rarement indemne et j'avoue ne pas être encore vacciné.
Je dois dire que je suis étonné que l'on parle encore de la question éventuelle d'un changement de statut pénal concernant la consommation de cannabis. Les publications périodiques de l'OEDT démontrent notamment que le trafic et la consommation de cannabis ne faiblissent pas ; elles constituent une part extrêmement importante du chiffre d'affaires global de la drogue. Ce phénomène n'est peut-être pas toujours pris en compte comme il le devrait.
L'alternative qui s'offre à nous se situe souvent entre répression et prévention, le choix médian étant d'essayer de mettre les deux en oeuvre.
L'option qui a été prise depuis fort longtemps par la législation pénale et la pratique judiciaire françaises, a consisté en une approche pluridirectionnelle, tout en gardant le principe de l'interdiction totale, avec possibilité d'aménager des poursuites grâce au principe de l'opportunité. Celle-ci permet d'asseoir une véritable politique pénale aussi individualisée que possible autorisant, selon les hypothèses, à choisir la voie pénale classique ou celle de l'injonction thérapeutique, du soin, de l'examen, etc.
Je suis personnellement favorable au maintien de la pluridisciplinarité de cette approche mais elle ne peut être réellement efficace que si on lui maintient certains moyens juridiques. Ainsi, la garde à vue permet d'abord de faire le point. On ne va pas punir pénalement l'usager simple mais comment détermine-t-on qu'il s'agit bien d'un usager simple ? Seul le statut d'infraction à caractère correctionnel permet d'asseoir un choix de politique pénale sur des éléments objectifs.
La garde à vue permet également de mettre l'usager simple en présence d'une équipe qui va établir un premier contact. La qualification pénale correctionnelle de l'usage simple va donc permettre d'enclencher une prise en charge par les autorités médicales.
Ceci suppose bien entendu la mise en oeuvre d'une politique pénale, mais aussi la bonne volonté des services enquêteurs, des parquets, des services éducatifs. C'est une expérience que j'ai mise en place à Boulogne-Billancourt pour les mineurs ; elle doit encore fonctionner. Elle consiste à prévoir, dans les locaux de police, à côté du service qui traite ce genre de procédure, une antenne de service de soins ou de service éducatif, qui permet d'établir un contact personnalisé. Cela ne fonctionne pas dans tous les cas mais permet une action éducative en direction des usagers de stupéfiants encore rattrapables.
Par ailleurs, il ne faut pas se cacher le fait qu'une addiction en cache très souvent une autre. Un petit trafic peut en cacher d'autres, qui portent sur des drogues d'une autre nature. Il suffit pour s'en convaincre de se référer à l'exemple du Portugal ou à la situation des Pays-Bas.
La Cour de justice européenne a d'ailleurs rendu un arrêt récent concernant les coffee-shops, les Pays-Bas eux-mêmes cherchant à revenir sur leur politique de tolérance, qui ne produit pas les effets escomptés mais en génère d'autres -tourisme de la drogue, présence de revendeurs de cocaïne et d'héroïne…
Il faut donc être extrêmement prudent dans cette démarche.
Par ailleurs, la vente par petites quantités se fait avec des produits de plus en plus concentrés en THC, qui vont rendre le consommateur de plus en plus dépendant. Il y a plus de trente ans est paru un livre intitulé « L'herbe bleue » dans lequel une jeune femme expliquait que c'était par le cannabis qu'elle était arrivée à l'héroïne. Lutter contre des petits trafics permet donc aussi de lutter contre le trafic de fourmis, à partir de substances de plus en plus enrichies en matières toxiques. La personne addicte est un client fidélisé à qui on va fournir d'autres produits !
On a longtemps essayé de lutter contre l'offre et la demande. Je crois qu'il faut aussi lutter contre la production de la matière. Le cannabis est maintenant produit chez nous, sous serre. C'est un point vers lequel il faut orienter les actions policières et judiciaires et, pour ce faire, accepter de sortir des frontières !
Sur Internet, on trouve des adresses hollandaises où l'on propose des graines de cannabis et autres produits, avec la possibilité de payer par carte bancaire par liaison sécurisée. Les commandes peuvent être envoyées dans le monde entier dans un colis très discret. On n'a même plus besoin de se déplacer !
Le nouvel angle d'attaque se situe donc là. Cela étant, cela suppose-t-il un durcissement de l'arsenal législatif ? Je ne le pense pas. Peut-être pourrait-on prévoir une circonstance aggravante de la cession ou de la facilitation de l'usage à autrui à partir du moment où, dans la substance saisie, le taux de concentration dépasse un certain pourcentage… En dehors de cela, je ne vois pas quelle mesure législative supplémentaire serait possible.
En revanche, développer et coordonner la lutte des services de police et des autorités judiciaires des pays de l'Union européenne volontaires, me paraît être une priorité. Depuis le traité de Lisbonne, s'il est un domaine dans lequel des coopérations renforcées, voire un parquet européen peuvent être mis en place, c'est bien celui-là ! Les chiffres de l'OEDT sont dix fois supérieurs à ceux de la France ! A ce rythme, quel sera le nombre d'habitants de l'Union, dans cinq à dix ans, à n'avoir pas touché à la drogue ?
- Bien souvent, l'usager simple n'est pas mis en garde à vue ni pris en charge médicalement mais convoqué pour un rappel à la loi ultérieur.
Une politique contraventionnelle ne constituerait-elle pas, notamment chez les jeunes, une sanction immédiate, quitte à prévoir un fichier en cas de récidive ?
On peut mettre en garde à vue tous les consommateurs à la sortie d'un lycée ou d'un collège lorsqu'ils sont pris ! Une politique contraventionnelle pourrait-elle être une manière d'alerter les familles avec une amende qui, dans l'échelle des sanctions, n'existe pas actuellement…
- Où sera la limite entre le correctionnel et le contraventionnel ? On a là un choix de qualification alternative qui n'est pas conforme au principe de légalité des délits et des peines !
- On pourrait définir une quantité correspondant à un usage personnel…
- Les Hollandais le fixe à 5 grammes mais le système hollandais ne fonctionne pas ! Si on suspend les poursuites jusqu'à 5 grammes et qu'on inflige une petite contravention…
- On le fait en matière d'excès de vitesse ! Le problème est l'absence de sanction immédiate : ne conviendrait-il pas d'instituer une échelle de sanction plus facilement applicable ?
- Une sanction, dans ce domaine, s'assied sur une base pénale. On est obligé de respecter le principe de la légalité pénale : il faut donc une qualification qui ne soit pas alternative. On peut le faire, comme avec l'alcool au volant à une certaine époque mais je ne suis pas sûr que cela ait produit de bons effets en la matière.
D'autre part, on peut également interpeller une personne qui a 2 grammes sur elle afin d'asseoir une procédure destinée à établir les éléments matériels de la constitution d'un réseau. Or, pour ce faire, il va falloir qu'on la retienne, que l'on fasse le cas échéant une perquisition, qu'on l'entende. Une qualification contraventionnelle ne permet pas de le faire !
Je comprends votre souci et le trouve parfaitement légitime mais il n'est pas dit que ces cas intéressent la police et que celle-ci mette en oeuvre une procédure pour si peu ! Vous risquez de créer des situations difficilement lisibles. C'est pourquoi le système hollandais me paraît critiquable. On pourrait imaginer qu'on légalise l'usage d'un gramme ou deux…
- Ce n'est pas ce que j'ai dit ! Il faut faire bouger le curseur car nous sommes actuellement dans une situation où la consommation continue à augmenter, avec des taux de principe actif de plus en plus importants. Or, les petites quantités ne sont pas aujourd'hui sanctionnées.
Vous présentez un tableau idyllique des mises en garde à vue et de la prise en charge des mineurs avec soins immédiats. Malheureusement, votre théorie est difficilement applicable !
- C'est une question de lisibilité de l'ensemble. Il ne faut pas risquer d'aboutir à une situation moins grave, voire tolérée, alors que le produit reste néanmoins complètement interdit. Ce n'est pas ce qui va donner sa licéité au produit stupéfiant. A partir du moment où le produit reste prohibé -et il faut qu'il le reste- cela ne diminue en rien le trafic !
On agit dans le cadre du rappel à la loi mais il faut que ce soit bien compris. La différence avec l'excès de vitesse réside dans le fait que la voiture elle-même n'est pas illicite, contrairement à la drogue !
- Certains demandent la dépénalisation du cannabis pour ramener le calme dans les quartiers difficiles -ce qui n'est pas ma vision des choses. Il manque un échelon intermédiaire pour les petits utilisateurs !
- C'est pourquoi le fait de parler encore aujourd'hui de dépénalisation m'étonne ! Au cours de ma carrière, j'ai entendu certains avocats affirmer que seul le tabac provoquait le cancer du poumon. Or, on sait qu'à quantité égale, les substances nocives sont sept fois plus importantes dans le cannabis que dans le tabac !
Il a fallu, sur la base de procédures à caractère judiciaire, que l'on fasse un certain nombre d'analyses à la suite d'accidents de la route inexpliqués pour se rendre compte du danger que cela représente. Ce genre de position a cessé d'être soutenue devant les chambres correctionnelles il y a une dizaine d'années mais apparaît à nouveau. Ce n'est pas normal !
- L'usage pourrait être automatiquement répréhensible dès lors qu'il met des tiers en danger. Il existe pour l'alcool une forme de tolérance en matière de circulation routière ; on pourrait admettre que l'utilisation de toute substance hallucinogène ou autre soit gravement sanctionnée dès lors qu'elle est consommée avant de prendre la route. Tout ce qui constitue un danger vis-à-vis des tiers en raison de l'inhalation ou de la prise d'une quelconque substance reste selon moi du domaine délictuel.
- Le système de la réponse immédiate, sur lequel, au moins depuis 1997, les parquets axent leur politique pénale dans le cadre du traitement en temps réel, est à mon sens tout à fait bon mais il faut que la politique pénale soit lisible. Dans son principe, la contraventionnalisation ne me choque pas. La question relève de la lisibilité de la politique globale non seulement à l'égard du stupéfiant, mais aussi vis-à-vis de ses répercussions sur la sécurité des citoyens. Fumer un « joint » équivaut à 1,20 gramme d'alcool dans le sang. Or, un « joint » pèse un ou deux grammes…

- Pouvez-vous revenir sur l'expérience que vous avez développée à Boulogne-Billancourt -injonction thérapeutique, alternatives à une peine ? On a le sentiment que celle-ci ne s'est pas généralisée à l'ensemble du territoire. Pour autant, c'est une des solutions qui pourraient être apportées…
- A Boulogne-Billancourt, cela concernait les mineurs. Une antenne dirigée par un pédopsychiatre réalisait un débriefing et utilisait ce contact pour asseoir une action éducative ou une thérapie familiale le cas échéant.
Certains actes délinquants traduisent une souffrance. L'usage de stupéfiants peut s'expliquer chez le jeune par une souffrance ou un embrigadement.
Ce type de démarche n'est pas mis en pratique partout et je dois dire que cela ne s'est pas fait sur la totalité du ressort dont j'avais la responsabilité. Il a fallu trouver à l'époque des gens de bonne volonté dépendant de services ayant accepté que l'on décloisonne leur structure. Faire travailler ensemble des policiers, une équipe éducative sous la coordination du parquet, avec l'appui de la mairie, ne se gère pas aisément.

- Je suis d'accord avec vous à propos du fait que la contraventionnalisation va finir en timbre-amende. Qui va s'en acquitter ? Si c'est un mineur ou un jeune qui a peu de moyens, ce seront les parents. Cela n'a pas grand sens car ils finiront par ne plus payer. On ne va pas employer de contrainte par corps pour un timbre-amende !
En revanche, l'inscription au casier judiciaire me paraît un peu lourde dans la mesure où un certain nombre de jeunes, quelques années plus tard, peuvent postuler pour un emploi public, voire d'agent de sécurité dans un aéroport. Ressortir une telle affaire quelques années après, alors qu'ils ont tout abandonné depuis longtemps, est parfois injuste. Ne pensez-vous pas que l'on pourrait donner une seconde chance en n'inscrivant rien au casier mais en étant plus sévère en cas de récidive ?
- C'est une position que je rejoins avec une nuance qui peut ne pas constituer un obstacle : quand on confie un camion de vingt tonnes à quelqu'un ou la conduite d'un TGV ou d'un TER, il est légitime que l'employeur puisse bénéficier d'un certain nombre de garanties et qu'on ne lui cache pas quelque chose qui peut être à l'origine d'un drame.
Cela étant, je ne trouverais pas choquant que l'employeur exige une analyse -mais je ne sais pas si la loi le permet.
Sous réserve que l'on puisse assurer la sécurité de nos concitoyens dans de telles hypothèses, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas stigmatiser les gens.

- L'aviation civile américaine exige des analyses d'urine et de cheveux avant toute embauche pour savoir s'il existe des consommations récentes. Je crois que cela vaut la peine d'y réfléchir…
- Je vous remercie au nom de nous tous d'avoir apporté votre vision juridique et sociologique du problème.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Marc Moinard, expert auprès de l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants
- Nous recevons M. Marc Moinard, membre de l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants dont les treize membres, élus par le Conseil économique et social des Nations-Unies, siègent à titre personnel et non en tant que représentants de leur pays.
- Personne ne siège comme représentant d'un État. Tous les membres sont totalement détachables et indépendants.
- Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à nos travaux pour nous éclairer sur le contexte juridique international dans lequel s'inscrit la politique française en matière de toxicomanies.
Vous avez la parole.
- Merci. C'est un honneur de venir déposer devant vous.
L'OICS -que l'on appelle « l'Organe »- est née des traités qui ont prévu l'organisation permettant de vérifier la mise en place des clauses de ces traités.
Il s'agit d'une institution qui n'est rattachée à rien sinon aux traités. Elle ne dépend pas de l'ONU, même si celle-ci la finance. Il n'y a aucun doute sur son indépendance : les membres sont élus par le Conseil économique et social des Nations-Unies et signent un document attestant l'absence de rapport avec l'État d'origine. Cette indépendance est jalousement gardée, à bonne raison.
Cette indépendance a toutefois amené cet organe à peu communiquer. Il est peu connu et ne tient pas tellement à l'être. Seul le Président communique. Lorsqu'on reçoit une convocation du Parlement, on est cependant tenu d'y déférer. On m'a donc autorisé à parler au nom de l'Organe, toutes les questions que vous avez posées ayant été débattues par celui-ci.
Cet Organe est né en même temps que les conventions et a deux fonctions, l'une clairement définie et l'autre établie dans son principe général mais dont les contours sont assez souples.
En premier lieu, l'Organe est là pour éviter tout détournement du marché licite des drogues. Qu'il s'agisse de stupéfiants ou de substances psychotropes, on a besoin des drogues dans la vie courante, sous forme de médicaments par exemple. Tant que ce commerce n'a pas été contrôlé, il a été l'occasion de détournements considérables.
Le premier objectif est de mettre en place un système qui contrôle notamment les importations et les exportations. Dans ce système, l'Organe, avec les moyens qui étaient les siens, a à peu près réussi. Quand un pays exporte, on est certain à 99 % que la drogue part d'un endroit et arrive bien à un autre.
Cela ne règle pas tout le problème : une fois la drogue arrivée dans le pays où l'autorisation d'importation a été donnée, il n'y a pas toujours de contrôle par l'État national des sociétés qui ont besoin de cette drogue pour des raisons médicales, pharmaceutiques, voire industrielles.
Les détournements se font parfois à partir du marché national mais davantage à partir du marché international. Même s'ils ont diminué, ils existent encore.
Lorsqu'un précurseur est vendu d'un État à un autre, on vérifie auprès des deux États si les sociétés existent ; la drogue ou le précurseur arrivent alors dans la société qui l'a demandé -souvent l'industrie pharmaceutique. Certains États répertorient très mal ces produits, ne donnent pas de licence de fabrication ou d'importation. On ne sait alors plus ce que le produit devient. Les trafiquants connaissent bien ces États. Nous aussi et nous travaillons avec eux pour mettre en place des structures de surveillance de ces sociétés mais beaucoup d'États ont peu de moyens.
On a parfois du mal à voir naître ce que l'on met en place, non parce que les États ne le veulent pas mais parce qu'ils n'ont pas de moyens, comme en Afrique par exemple.
Il n'existe quasiment plus de détournements de pays à pays mais énormément à l'intérieur des pays. Nous sommes actuellement en pourparlers avec la Commission européenne pour que certains pays mettent en place un encadrement de ces sociétés. Il ne sert à rien d'encadrer le commerce international si des détournements doivent ensuite avoir lieu !
Le blocage qui a été réalisé au plan international est toutefois une réalité et les détournements n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait auparavant mais ils existent cependant -et pas seulement dans les pays émergents. On connaît ce problème dans le cadre de l'Union européenne. On demande donc instamment à la Commission de produire des règlements face aux groupes de pression.
Comment en est-on arrivé là ? Les États ont l'obligation, tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du type de drogues ou de substances psychotropes, de nous tenir informés de tout ce qui touche à la fabrication, la culture, la consommation, l'exportation, l'importation et les stocks en ce domaine. On a ainsi une idée de ce qui se passe dans un pays.
En second lieu, les États doivent nous communiquer chaque année une évaluation de leurs besoins. Certains États le font correctement, d'autres n'en ont pas les moyens. Nous devons confirmer ces évaluations et effectuer des missions dans ces pays. Nous nous rendons parfois compte que tel pays a triplé ses besoins par rapport à l'année précédente. Il faut alors qu'il s'explique. S'il ne peut le faire, nous ne confirmons pas les évaluations. Les autres États ne peuvent alors pas commercer avec ce pays. Parfois, l'explication tient à de simples erreurs.
L'informatique a rendu plus aisé le suivi des exportations et des importations. Un contrôle très important est exercé sur les produits précurseurs -héroïne, acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide acétique, etc.- qui ne constituent pas des drogues mais qui sont nécessaires aux trafiquants pour passer de la morphine à l'héroïne. Tous les pays doivent disposer d'un système d'autorisation préalable et nous transmettre informatiquement les demandes d'importation qu'ils adressent à telle ou telle société exportatrice. Le pays exportateur doit vérifier si la société importatrice est autorisée à faire entrer de tels produits sur son territoire et vérifier l'utilisation de ceux-ci.
Ce système, qui était initialement mis directement en oeuvre entre les pays, passe maintenant par nous. Il est toutefois beaucoup moins performant pour les substances psychotropes ou pour les stupéfiants -mais on est en train d'avancer dans ce domaine. Il ne s'agit que d'un problème informatique. Le seul problème réside dans le fait que tous les États ne sont pas informatisés.
Une dizaine d'États n'ont pas signé les conventions -Samoa, etc.- mais bon nombre, faute de moyens, sont incapables de nous fournir des indications informatiques. Dans un certain nombre de pays -nous ne donnons jamais de noms- le ministère de la justice ne dispose que d'un seul ordinateur -par ailleurs en panne. Il ne s'agit pas forcément de fraudeurs : tout le problème est de faire en sorte qu'ils puissent se mettre à notre niveau pour pouvoir travailler avec nous.
Ce n'est pas parfait -il s'agit d'une grosse machine- mais le marché international est sur la bonne voie. Cependant, les trafiquants sont très inventifs. Ce qui caractérise cette délinquance, c'est la souplesse, la capacité d'organisation des trafiquants, qui trouvent toujours des solutions et ont un jeu d'avance sur nous !
Sur le plan international, on a tout de même empêché que la drogue ne passe là où elle ne le devait pas.
Une autre obligation des traités est de répondre aux besoins des pays en matière médicale et scientifique. Il faut donc que la drogue y parvienne. On en est loin ! Personne n'utilise la morphine en Afrique alors qu'il existe des gens qui souffrent et qui en auraient besoin. On pourrait penser qu'il s'agit de raisons financières. Il n'en est rien. Au Ghana, par exemple, qui n'est pas un pays riche, on a initié des transformations législatives, formé les médecins et les infirmiers afin qu'ils prescrivent de la morphine : ils ne le font pas ! Ces États ne constituent par ailleurs pas de stocks. 80 % des analgésiques sont consommés par l'Europe et les États-Unis contre 3 % en Afrique.
Nous ne sommes donc pas parvenus à une répartition équilibrée pourtant tout aussi importante que le travail sur la drogue ! En tant que magistrat, je n'imaginais pas ce second volet. Il faut que la drogue existe en quantité suffisante dans certains pays pour soigner la population ! Tel n'est pas le cas…
Il y a à cela des raisons financières mais pas seulement : hésitations à prescrire, mauvaise information des médecins, peur de l'addiction, absence de stocks, législation trop restrictive. Il s'agit là d'un champ qui reste à couvrir. C'est un échec car le problème, qui suppose des efforts considérables, concerne deux cents États dotés de niveaux très différents.
Notre autre vocation, plus large, est d'être gardiens des textes et de veiller à la façon dont les États remplissent leurs obligations.
S'agissant de la question de la légalisation pour consommation personnelle, les traités ne le permettent pas. L'article 3 de la convention de 1988 dispose que « sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque partie adopte les mesures nécessaires (…) à la consommation personnelle ». On en pense ce que l'on veut mais la loi est la loi. Si on veut légaliser la consommation personnelle, il faut changer la loi. On peut en discuter, infraction pénale ne signifiant pas « pénalité ».
On m'a posé la question de savoir si la contraventionnalisation des sanctions respecte le traité. Je n'ai pas posé la question à l'Organe mais, à titre personnel, je répondrai oui, bien sûr ! Il s'agit bien d'une incrimination. Peu de pays appliquent des peines en la matière. En France, les peines de prison prononcées pour consommation personnelle sont liées à un vol, à une agression…
En 1970, la Suède avait choisi la libéralisation de l'héroïne. Elle est revenue à un État sans drogues et à une certaine répression. En fait, les plus gros efforts portent sur les traitements, dont certains sont obligatoires.
Le Portugal a abandonné la condamnation pénale mais a conservé la pénalisation administrative et a surtout mis en place -ce que j'approuve- des commissions de dissuasion interdisant la pratique de certaines professions, la rencontre avec certaines personnes et le fait de se promener dans certains lieux. Ce sont des pouvoirs considérables qu'un tribunal n'oserait du reste pas utiliser !
La politique portugaise en la matière est bien plus dirigiste. Je parle là en mon nom propre mais je ne pense pas, en dehors de ces annonces fortes, que l'on puisse se dispenser de l'une ou de l'autre.
J'en reviens à la qualification pénale, qui peut prendre la forme d'une contravention. L'Organe est allé jusqu'à conseiller de conserver la qualification tout en dispensant la consommation personnelle de peine ; dans le cas contraire, il faut changer tout le système !
Changer les textes qui concernent deux cents États est compliqué. On n'est pas près de le faire ! La Bolivie a émis des réserves à propos de la mastication de la feuille de coca lorsque le traité est devenu effectif. Ces réserves courraient jusqu'en 1989. La Bolivie a récemment demandé une modification des textes, toujours possible s'il n'existe pas d'objections. Vingt-cinq objections ont été émises !
Le problème vient de ce que la loi pénale représente quand même un interdit qui joue son rôle. Il existe cependant des dispenses de peines, des non-poursuites -je ne parle pas là du problème français…
Il en va de même pour les salles de soins. Si vous ne pouvez pas légaliser la consommation personnelle, on ne peut légaliser les salles de soins. On devient même complice de cette infraction ! Les gens y viennent avec leur drogue, qui provient de trafics, alors qu'on nous demande de le combattre.
On peut en discuter longuement. Tous ces problèmes ont été évoqués depuis 1992 et le sont régulièrement, soit du fait de cas nouveaux, soit parce qu'il faut préciser la doctrine.
- Vous avez quasiment répondu à toutes les questions fondamentales que nous souhaitions vous poser. Vous avez apporté un éclairage fort intéressant concernant les éléments juridiques que nous n'avions, pour certains, pas encore évoqués au cours de ces auditions.
La parole est aux parlementaires…

- La France a légalement institué une politique de réduction des risques et mis en oeuvre l'échange des seringues. Or, la loi française n'interdit aucunement de prolonger cette politique. Les salles de consommation ne sont donc pas hors-la-loi : il s'agit simplement d'un prolongement de la politique de réduction des risques !
Certes, l'héroïne est une substance interdite mais on ne refuse pas de soigner un blessé de la route sous prétexte qu'il a 4 grammes d'alcool dans le sang ! Nous n'arrêtons pas de faire de la réduction des risques. Le médecin n'a pas à se demander si ce qu'il fait est permis : il doit soigner et prévenir un danger plus grand.
Je comprends bien la rigueur d'un traité mais, finalement, l'engagement médical n'est pas moins rigoureux !
- Je ne le conteste pas ! On me demande la position de l'Organe : je la donne. Il se trouve que c'est la mienne.
En second lieu, cette position constitue une analyse qui est juridiquement incontestable.
La République tchèque a pris le pas de l'Espagne et du Portugal en dépénalisant la consommation personnelle des drogues en dessous de certaines doses.
Nous avons fait valoir que l'article 3 de la convention de 1988 ne le permettait pas. On nous a opposé une décision-cadre du conseil de l'Europe -à l'écriture de laquelle j'ai d'ailleurs participé- qui, afin d'harmoniser les politiques judiciaires des États en matière de répression, fixe des peines planchers pour les infractions les plus graves. Certes, les États peuvent faire ce qu'ils veulent pour les autres infractions, mais cela ne les fait pas disparaître pour autant !
- En Suisse, la détention et l'usage du moindre gramme de cannabis sont interdits. Pour autant, il existe une dizaine de salles de consommation supervisée sur lesquelles la justice et la police ferment bizarrement les yeux !
- C'est ce qui se passe en Hollande : ce pays n'a pas dépénalisé l'usage mais a décidé de ne pas appliquer la loi -ce qui est assez hypocrite ! En Hollande, ce sont les procureurs généraux qui définissent la politique pénale. Ils ont donc donné des instructions en ce sens.
Le problème de la qualification pénale n'est pas traité : si l'on n'obéit plus aux lois que l'on s'est données, je ne vois pas comment les appliquer aux autres ! Le système de la contravention me convient fort bien. Il existe du reste une contravention administrative au Portugal : c'est libéral mais très encadré !
Je n'ai pas à me prononcer sur le fond de la politique pénale mais on ne peut pas dire qu'ils laissent se faire les choses. Du reste, je crois que cela a réussi, tout comme en Suède…
- Je l'ignore…
La consommation de cannabis chute un peu partout mais, de manière étonnante pour des pays aussi différents l'un de l'autre, le Portugal et la Suède ont le même problème avec l'héroïne et la cocaïne.
En la matière, on constate également que tous les pays qui n'étaient que des pays de transit deviennent aujourd'hui des pays consommateurs. Le Bénin ou le Niger ne disposent d'aucun moyen judiciaire. Je n'ai jamais vu un trafiquant dans les tribunaux africains, où je me rends souvent ! Les intermédiaires sont payés en cocaïne !
- Vous avez parlé des pays producteurs de morphine, que vous contrôlez. Quelle est la politique de l'OICS vis-à-vis des producteurs de substances illicites, notamment le Maroc, et quels sont vos moyens ?
- Nous travaillons par session de quinze jours, durant lesquelles nous voyons cinquante à soixante pays.
Nous disposons de moyens de deux ordres, injonctions et missions. La grande peur des pays est de voir leur nom étalé dans le rapport. Ces pays ne veulent pas être stigmatisés. C'est un argument dont nous nous servons ; si aucun autre ne prévaut -mais ce n'est jamais arrivé- on peut aller jusqu'à mettre un pays en quarantaine.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Cédric GROUCHKA, membre du collège de la Haute Autorité de santé, et M. Dominique MAIGNE, chef de cabinet.
- Nous recevons M. Cédric Grouchka, membre de la Haute autorité de santé, accompagné de M. Dominique Maigne, chef de cabinet.
M. Grouchka a également été praticien hospitalier en santé publique.
Monsieur Grouchka, quelles sont les missions de la HAS dans le domaine de la toxicomanie et des stupéfiants ?
- La HAS est la seule institution scientifiquement indépendante, par la volonté du législateur, au service des trois entités que sont les usagers, les professionnels et les pouvoirs publics. La triple mission de la HAS consiste à faire en sorte que les professionnels soignent mieux, à aider les pouvoirs publics à mieux décider et les usagers à mieux s'informer. La toxicomanie vient s'intégrer dans l'ensemble de ces éléments.
L'objectif opérationnel de la HAS est avant tout d'évaluer les dispositifs et les médicaments liés au problème de la substitution, de recommander les bonnes pratiques au plan professionnel mais aussi au plan organisationnel. Elle a bien entendu des missions de certification des hôpitaux et des établissements de santé ainsi que d'accréditation des médecins pratiquant un exercice à risque. Une de nos missions récentes porte également sur l'évaluation médico-économique, que vous nous avez confiée.
Nous n'avons pas pour l'instant de documents de synthèse intégrant la totalité de nos travaux, qui restent ponctuels au fil des années ; en outre, un certain nombre de sujets ne sont pas couverts.
Nous ne produisons pas de données scientifiques comme l'INSERM ou le CNRS. En revanche, nous synthétisons l'ensemble des données au sens large, les analysons par des méthodes transparentes, les validons et apportons aux décideurs publics, qu'il s'agisse de l'État ou de l'assurance-maladie, les éléments pertinents à l'appui de leurs décisions.
Nous avons, au fil des années, travaillé sur un certain nombre de sujets et en premier lieu sur les opiacés. Une conférence de consensus, en 2004, a traité des stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes aux opiacés et de la place des produits de substitution.
Nous avons également travaillé, en 2004, sur une recommandation des pratiques cliniques portant sur la réduction de la mauvaise utilisation des médicaments de substitution.
Enfin, nous avons, dès 1998, dans le droit fil des recommandations de l'ANAES, travaillé sur les modalités de sevrage des dépendances aux opiacés.
Nos premiers travaux sur la cocaïne, quant à eux, remontent à 2010 et sont constitués par une recommandation des pratiques cliniques en matière de prise en charge des consommateurs de cocaïne.
S'agissant de la poly-consommation, nous avons récemment publié des recommandations suite à une audition publique sur les abus et les dépendances en la matière.
Nous travaillons actuellement sur la labellisation d'une recommandation de la Société française de médecine du travail à propos du dépistage et de la gestion du mésusage des substances psychoactives, principalement l'alcool.
Nous avons également mené des travaux sur l'alcool et le tabac, ainsi que sur les benzodiazépines.

- Je reconnais que la HAS a un rôle très particulier. Néanmoins, nous avons relevé un certain nombre de manques, que vous avez par ailleurs pointés -cocaïne, enfermement dans la substitution… Je sais que vous avez commencé à y réfléchir.
Que font les autres pays, en matière de délivrance sous strict contrôle médical d'héroïne ou de morphine, pour les personnes qui n'ont pas réussi à se sortir de la toxicomanie grâce à la substitution ?
Par ailleurs, quel est votre avis sur le cannabis, dont la dangerosité -quelles que soient les querelles que nous avons toujours entre nous- semble s'accroître et qui constitue une porte d'entrée pour beaucoup d'autres substances ?
S'agissant de l'organisation sanitaire, il nous a semblé que le dispositif est extrêmement diffus.
Nous avons été séduits par les services d'addictologie mais il existe également des services avec ou sans hospitalisation, des services psychiatriques. Peut-être faut-il établir un guide en matière d'addictologie -sevrage, consultation, etc.
Enfin, avez-vous déjà travaillé sur les salles de consommation supervisée ?

- On a l'impression qu'il existe un certain nombre de structures qui s'occupent de toxicomanie mais que les moyens ne couvrent peut-être pas l'ensemble des problématiques. Je pense qu'il faut évoluer.
Vous avez réalisé une photographie de tout ce qui existe : avez-vous déjà évalué les bénéfices et les risques des politiques qui sont menées ?
- Ma réponse risque de vous frustrer. Je ne puis vous répondre que dans le cadre de ce que la HAS a déjà publié et recommandé. Nous ne pouvons exprimer nos convictions sur un certain nombre de sujets. Je puis simplement vous parler de ce que nous avons fait, de ce que nous pouvons trouver utile de faire et répondre à vos propositions, contrairement à la MILDT, qui peut avoir son appréciation propre. Notre légitimité tient au fait de ne jamais dire ce que nous ne savons pas étayer.
Je puis vous donner un sentiment personnel mais ce ne sera pas au nom de la HAS et encore moins au nom de son Président !

- Dites-nous ce que vous pouvez et ce que la HAS pourrait faire… On peut peut-être vous aider !
- On a presque envie de vous le demander sur certains sujets polémiques ! La HAS a la capacité, au vu d'un certain nombre de méthodes, de décrisper des sujets à fortes capacités polémiques et même à fortes divergences d'opinions.
J'en veux pour exemple les recommandations que nous publierons probablement fin juin en matière de majorité psychiatrique. Quand la HAS a été saisie, personne ne pensait que nous arriverions à ce qui ressemble plus à un consensus qu'à un compromis.
Nous y sommes parvenus grâce à une méthode développée à partir des conférences de consensus, devenues aujourd'hui des auditions publiques, qui confrontent l'expertise -avec une gestion des conflits d'intérêt assez rigoureuse- l'avis des patients, des usagers et l'opinion publique.
Il nous semble que cette méthode pourrait être utile à la collectivité nationale pour faire émerger les positions au-delà des postures, tout en respectant les idées voire les idéologies de chacun. Les marges de progression demeurent assez fortes dans l'ensemble des domaines que vous avez évoqués.
Deux sujets sont, me semblent-ils, fortement porteurs. Le premier concerne le cannabis. Peut-être faut-il cibler la question sur l'usage thérapeutique ou l'élargir à d'autres prises en charge. Tout cela est à voir mais l'absence de réflexion de la HAS et de ses structures antérieures en la matière signifie bien que le sujet n'a pu être mis en première ligne. Je pense que l'on peut être capable d'y remédier.
S'agissant des salles de consommation supervisée, l'expertise collective de l'INSERM est pour nous un élément d'analyses, de données et d'informations parmi d'autres. Elle ne saurait être résumée comme la seule source d'informations sur le sujet. Pour nous, l'expertise de l'INSERM ne correspond pas à une recommandation. Ses travaux sont très intéressants mais sans la moindre gestion de conflits d'intérêt. Ils n'ont été confrontés à aucune analyse profonde de la littérature internationale, même s'ils ont travaillé sur 700 articles.
Nous avons présenté en début de semaine un guide destiné à aider les professionnels des hôpitaux à annoncer un accident médical à leur patient : ce travail, qui a duré plus de quatorze mois, a nécessité plus de quarante experts. 1 400 articles internationaux ont été analysés. Le travail que l'on peut réaliser sur l'existant va très au-delà de la simple réunion d'experts. Nous ne sommes donc pas capables de porter un jugement de valeur, n'ayant pas travaillé sur le sujet.
La HAS, si vous le préconisez, peut fort bien s'autosaisir d'une analyse exhaustive de la littérature très au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous pouvons également réaliser une audition publique sur les salles de consommation supervisée et recueillir un consensus ou un compromis qui permette de faire avancer la société sur ce sujet, quel qu'en soit le résultat. Ce n'est pas facile mais c'est faisable.
- La transparence et la confrontation ne constituent pas un risque mais une chance ! Parallèlement à cette audition publique, nous pourrons vous fournir des éléments d'appréciation sur l'évaluation médico-économique de ces salles de consommation supervisée.

- Les salles d'injection supervisée sont un aspect mineur par rapport à l'ensemble de la prise en charge de la toxicomanie. Les évaluations économiques de notre prise en charge ne doivent pas uniquement porter sur ce point.
- Je faisais là une réponse ponctuelle à une question ponctuelle. Nous sommes capables, si vous le souhaitez, d'être plus ambitieux.
Un sujet à forte potentialité polémique peut trouver une réponse grâce à certaines de nos méthodes. Nous pouvons évaluer la prise en charge globale de notre politique de réduction des risques non par des auditions publiques mais grâce à des méthodes organisationnelles plus classiques.

- L'AFSSAPS a évoqué un taux élevé de décès par overdoses. Il y aurait là une évaluation à faire entre le bénéfice et le risque.
Nous avons recouru depuis des années à la substitution sans imaginer d'autres voies. D'autres pays ont des palettes de prise en charge des toxicomanes plus larges. On commence à admettre qu'il faut élargir la prise en charge sociale et la regrouper avec le médico-social…
On voit par ailleurs que la prévention a des portées mesurées ; son évaluation ainsi que vos propositions en la matière pourraient également être intéressantes. Avez-vous déjà travaillé sur ces problématiques ?
- Non. Nos travaux sont partiels, ponctuels et liés à nos saisines.
Nous avons la capacité de nous autosaisir mais nous ne pouvons le faire sur tous les sujets simultanément. Votre mission m'a amené à me poser la question de savoir s'il n'était pas nécessaire de combler les lacunes évoquées par ailleurs et de réaliser un travail intégratif de l'ensemble des éléments.
Cela ne répond pas totalement à votre question sur l'évaluation de la gestion des risques en tant que tels. Ce pourrait être un travail pertinent mais il nécessitera un temps assez long. On ne peut imaginer une recommandation de la HAS -même en essayant de réduire le temps d'un tiers comme nous le faisons actuellement- avant neuf mois ou un an minimum, même si nos outils sont adaptés à vos demandes.
- Il est naturel que l'AFSSAPS se pose des questions en termes de sécurité sanitaire, les médicaments substitutifs aux opiacés ayant une classe thérapeutique particulière. Nous avons quant à nous la capacité d'intégrer le bénéfice-risque dans une approche plus globale et transversale.
Par ailleurs, nous bénéficions d'un dispositif qui nous permet de travailler en collaboration avec les établissements médico-sociaux ; ils relèvent d'une approche qui n'est pas uniquement sanitaire et disposent d'une agence d'évaluation, l'ANAES, avec laquelle nous arrivons à coproduire des recommandations.
Nous pouvons, sur le champ qui va du court séjour au dispositif de la psychiatrie de secteur, en passant par le champ médico-social, avoir une approche intégrative bien au-delà des produits de substitution, mais produire de telles recommandations demande du temps et de l'énergie. Les groupes que nous mobilisons sur ce type de sujets ont également besoin d'un temps d'appropriation.
- Concernant la commission de la transparence, envisagez-vous de donner des directives qui pourraient intéresser les médecins en matière de prescriptions de psychotropes ? Il semble qu'il existe de plus en plus de mésusages dans ce domaine. Comment la HAS aborde-t-elle ce problème ?
– Certes, il faudra intégrer les problèmes de mésusage, de dangerosité ou de substitution à la substitution dans la comparaison des différentes stratégies de prise en charge -pour ne pas dire de stratégies thérapeutiques.
C'est ce qu'est capable de faire la HAS, au-delà de la commission de la transparence, dans le cadre de ce type de recommandations relatives aux pratiques organisationnelles ou cliniques.
- Par ailleurs, la commission de la transparence dispose de trois niveaux d'appel : inscription, réinscription et réévaluation des classes.
Il ne vous a pas échappé que nous sommes en pleine refondation et que nous allons, via un accord avec l'AFSSAPS, à travers la pharmacovigilance, prioriser les rappels de classes thérapeutiques.
Nous ne sommes pas en état de vous indiquer les priorités mais la volonté de la commission de la transparence -qui va sûrement changer de nom demain et intégrer les notions d'intérêt et de stratégie thérapeutique- sera de réévaluer toutes les classes thérapeutiques. On le fait aujourd'hui au fil de l'eau mais un travail de mise en place sera réalisé. Les problèmes de mésusage et de service médical rendu se poseront

- L'expertise de l'INSERM, qui s'est basée sur un certain nombre de publications, est-elle selon vous critiquable ou fiable ? A-t-elle été exhaustive dans la prise en compte de ces publications ?
- Je ne puis porter de jugement en la matière, je vous l'ai dit ; après une lecture rapide, l'expertise semble assez rigoureuse. C'est là une appréciation très subjective mais on ne peut s'en servir pour faire reposer une politique ou pour prendre une décision de santé publique : ce n'est pas le métier de l'INSERM. Ils n'y a aucune méthode, aucune gestion de conflit d'intérêt. Cette étude ne comptait que quatorze experts, ce qui est assez peu.
Je ne sais comment ont été sélectionnés les 700 articles. Tout cela répond à des méthodes qui expliquent le temps que la HAS doit y passer. Nous travaillons assez vite mais notre charge de travail est très lourde. Nous essayons d'aller au bout des choses. C'est ainsi que l'on assoit notre crédibilité vis-à-vis des professionnels et des pouvoirs publics.
- L'INSERM, par construction, mobilise la compétence de ses unités de recherche. C'est donc une vision d'expertise clinique, épidémiologique ou de sciences humaines et sociales, mais dans des unités de recherche. L'expertise collective de l'INSERM serait intégrée dans une approche qui pourrait être la nôtre comme un élément parmi d'autres.
- Si, demain, le ministre demande à la HAS s'il faut ou non dépénaliser le cannabis, que répond-elle ?
- Notre mission est de fournir des expertises dans le domaine de la prise en charge. La question de la dépénalisation du cannabis peut peut-être, au détour de l'analyse, avoir des impacts sur les modalités de prise en charge mais nous ne sommes pas qualifiés pour répondre…
- La dépénalisation a une incidence sur la santé publique !
- Nous ne sommes pas capables, au vu des éléments dont nous disposons, de répondre à votre question.
- Si l'examen du cannabis venait devant la HAS, l'ensemble de ses usages seraient étudiés. Il s'agirait donc d'une vision large qui ne répondrait pas nécessairement aux questions sous-jacentes mais qui permettrait peut-être de faire avancer le sujet.
- Lorsque vous émettez des recommandations, comme en 2004, mesurez-vous ensuite une évolution des pratiques médicales ?
- C'est une interrogation majeure qui dépasse largement la toxicomanie ! C'est une question que le nouveau collège vient de se poser dans la perspective de la rénovation de la HAS.
Il s'agit là du concept de responsabilité élargie -peut-être inapproprié puisqu'il vient de l'industrie. Notre travail, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer jusqu'à présent, ne se restreint pas au fait de dire avec le plus de crédibilité possible ce qu'il convient de faire en matière de pratiques professionnelles ou d'organisation, mais de mesurer si ce que l'on a préconisé a été mis en place et si cela a eu un impact sur les modifications évoquées dans le cadre de nos préconisations.
Jusqu'à présent, à part quelques éléments sur lesquels des indicateurs nouveaux ont été créés par la HAS, il n'y a pas eu de systématisation du suivi de l'ensemble des éléments. A la décharge de la HAS, on en est à plus de 180 ou 200 recommandations ! Le premier défi de la recommandation concerne l'actualisation. Dans un certain nombre de spécialités, il faut se poser tous les cinq ans la question de savoir si l'on a besoin ou non de réactualiser le sujet. C'est un défi majeur.
Le second défi, pour un certain nombre de recommandations ciblées en fonction de leur importance ou de la plus-value que peuvent apporter nos recommandations dans l'organisation ou sur l'impact sur la santé, est d'être capable de mettre en place un suivi réel avec les opérateurs responsables de la mise en oeuvre de nos préconisations, et de le mesurer avec les éléments que l'on peut avoir. Nous ne pouvons assurer le suivi des recommandations dans la mesure où nous n'en disposons pas systématiquement.

- Avez-vous un référentiel ou allez-vous contribuer à en créer un en matière de prise en charge hospitalière des toxicomanes ? J'ai le sentiment que les pratiques sont très diverses…
- Nous n'avons pas de système qui nous permette de le mesurer mais nous disposons d'éléments qui nous laissent penser qu'une certaine partie des recommandations de 2004 n'a pas été mise en oeuvre. Il serait bon, dans le cadre de la responsabilité élargie, d'utiliser notre devoir d'interpellation pour obtenir la mise en oeuvre d'un certain nombre d'éléments qui ne l'ont pas été, dans une démarche de communication publique exprimant le fait que l'exécutif n'a pas mis en oeuvre ce que nous préconisions.
On peut utiliser ce devoir d'interpellation à propos de ce que l'on a fait ; on ne peut l'utiliser à propos d'éléments sur lesquels nous n'avons pas émis de recommandations.
Faut-il travailler sur un référentiel de la prise en charge ? Ce serait peut-être un élément fédérateur mais il ne pourrait s'agir d'un référentiel purement hospitalier car il porterait aussi sur la prise en charge médico-sociale et ambulatoire.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante.