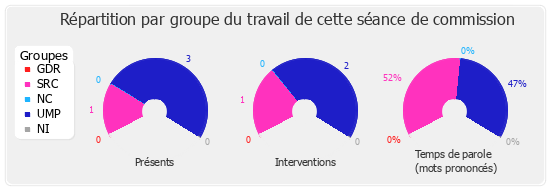Commission des affaires européennes
Réunion du 17 décembre 2008 à 16h45
La séance
COMMISSION CHARGEE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Mercredi 17 décembre 2008
Présidence de M. Pierre Lequiller, Président de la Commission
La séance est ouverte à 17 heures.

Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, notre commission se félicite de votre nomination. Nous serons heureux de travailler avec vous.
Quel premier bilan tirez-vous de la présidence française de l'Union européenne ? Au Parlement européen, où vous vous êtes rendu hier avec le Président de la République, les députés de droite comme de gauche ont salué la réussite de cette présidence et le volontarisme politique du Président.
Mes questions porteront plus précisément sur trois points.
Premièrement, les relations franco-allemandes. Je le répète souvent : l'Europe consiste à écouter et à essayer de comprendre nos partenaires, tous nos partenaires. La crise que nous traversons peut évoquer chez eux des souvenirs différents des nôtres. Les réformes de M. Schröder et de Mme Merkel ont permis à l'Allemagne de se remettre « dans les clous » et l'on peut comprendre la réticence de ce pays à s'engager dans une relance comparable à celle que nous menons. Pensez-vous toutefois qu'une évolution soit possible ?
Deuxièmement, le passage de relais à la présidence tchèque (puis à la présidence suédoise). Une récente mission à Prague nous a permis de mesurer le manque d'enthousiasme de nos partenaires. Les prises de position du président Václav Klaus, notamment, sont préoccupantes.
Troisièmement, les aspects institutionnels. Les prochaines élections européennes se dérouleront sur la base du traité de Nice, avec 72 députés pour la France. Si le traité de Lisbonne est ratifié par tous les pays de l'Union, il entrera en vigueur au cours de la prochaine législature et la France bénéficiera alors de 74 sièges. Quel sera le mode de désignation des deux députés supplémentaires ? Surtout, avez-vous bon espoir que le président polonais signe le traité et que les Tchèques le ratifient ? Dans un tel cas de figure, le référendum irlandais se présenterait sous un tout autre jour puisqu'il interviendrait en dernier.
Avant de vous répondre, monsieur le Président, je tiens à souligner que c'est pour moi un grand honneur d'être entendu par votre commission. Le travail accompli directement entre le ministre et les parlementaires est à mes yeux vital pour trouver les bonnes solutions. Je ne prétends pas avoir la science infuse sur quelque sujet que ce soit. Les membres de la commission chargée des affaires européennes sont tous de très bons connaisseurs de l'Union et des défis que nous aurons à relever. Leurs propositions et leurs idées seront toujours bienvenues.
Je souhaite également saluer le travail accompli par mon prédécesseur, M. Jean-Pierre Jouyet. Il a permis de faire progresser l'idée européenne de façon très concrète en France et dans les autres États membres. M. Jouyet tenait à ce que son action se place sur un plan strictement technique. Je serai pour ma part un secrétaire d'État politique au sens le plus consensuel que peut revêtir cette qualification.
Le Conseil européen des 11 et 12 décembre a abouti notamment à l'adoption du paquet « énergie-climat ». Pourtant, le succès était loin d'être acquis. Le travail de négociation conduit par M. Jean-Louis Borloo et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet a permis de rapprocher les points de vue et de trouver un compromis sur les principaux textes proposés par la Commission : la capture et le stockage du carbone, le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), le partage des efforts de réduction des émissions dans les secteurs non couverts par ce système.
Des voix se sont élevées, notamment parmi les députés français, pour regretter que l'on n'ait pas été assez exigeant. Je crois au contraire que l'essentiel réside bien dans ce compromis qui prend en compte les deux questions politiques auxquelles nos partenaires étaient confrontés.
Face au risque encouru par l'industrie allemande, tout d'abord, nous avons dû faire des concessions. Comment pourrait-on nous le reprocher, alors qu'une réduction drastique des émissions de CO2 se serait traduite par des délocalisations et par des destructions d'emplois ? L'objectif est maintenu, il sera atteint, mais les dérogations permettront de garder l'industrie allemande sur le sol allemand, ce qui me semble vital dans la période que nous traversons. J'assume pleinement la nécessité de concilier les impératifs économiques et le développement durable. Le département dont j'étais l'élu jusqu'à une date récente compte de nombreuses entreprises sous-traitantes du secteur automobile : je me serais mal vu leur expliquer l'application brutale de contraintes qui menacent leur existence même !
Je conviens que certains pays, en particulier la Pologne, ont bénéficié de dérogations. Mais, pour moi, l'Europe n'est pas un ensemble de normes et de règlements imposés brutalement : c'est avant tout la capacité à prendre en compte l'histoire de chaque État. Or, l'histoire de la Pologne est celle d'un pays qui n'a pas choisi son développement économique et dont plus de 80 % de l'électricité proviennent de centrales à charbon. J'estime que cela justifie un accompagnement.
L'essentiel, je le répète, est d'être parvenu à ce compromis qui nous met dans la meilleure position possible pour préparer la conférence de Copenhague et pour faire de l'Europe un continent exemplaire. Cette exemplarité qui se manifeste dans les domaines de l'environnement, des droits, de la culture, des échanges universitaires, est précisément ce qui fait la force de l'Europe.
L'accord auquel le Conseil européen est parvenu au sujet du Traité de Lisbonne repose sur trois éléments : la Commission pourra continuer de comprendre un national de chaque État membre ; des garanties seront apportées à l'Irlande en matière de politique fiscale, sur sa neutralité, sur des questions familiales, sociales et éthiques ; en contrepartie, le gouvernement irlandais s'engage à rechercher la ratification du traité de Lisbonne avant la fin du mandat de l'actuelle Commission.
L'idée d'une réduction des effectifs de la Commission était dans l'air depuis plusieurs années : on estimait que c'était un moyen de gagner en efficacité, mais aussi de dissocier chaque commissaire des intérêts de sa nation d'origine. Sur ce dernier point, je considère que la configuration actuelle ne présente pas d'inconvénient : l'expérience prouve que la tendance des commissaires –on va jusqu'à la leur reprocher ! – est bien plus de défendre le domaine dont ils ont la responsabilité que les intérêts de leur pays d'origine. Il serait d'ailleurs paradoxal que les parlementaires français, qui ne sont pas les représentants des intérêts de leur circonscription mais les élus de la nation, contestent ce fait !
Reste que, pour que le dispositif fonctionne, il faut que la Commission soit dotée d'une présidence forte, capable de faire émerger des doctrines et des lignes de force.
Il serait également paradoxal de s'offusquer du rééquilibrage qui s'opère entre les États, la Commission, le Parlement européen, mais aussi les parlements nationaux dont les pouvoirs seront renforcés. En donnant aux États un rôle plus important et à la Commission une place moins essentielle qu'auparavant, on aboutit à une Europe moins technocratique et plus accessible aux citoyens.
S'agissant de la relance, je crois inutile de consacrer de grands développements à un sujet que vous connaissez tous parfaitement. Je constate simplement que la modestie du « pilier » communautaire nous renvoie à un vrai problème, celui du budget européen. Nous ne pourrons défendre la construction européenne que si elle se traduit par des résultats concrets dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Or l'Europe n'obtiendra pas ces résultats si elle ne dispose pas des moyens de financer des politiques communes. Le budget actuel, qui correspond à 0,89 % du produit intérieur brut de l'Union, n'est pas à la hauteur des attentes des citoyens européens. On veut par exemple renforcer les échanges de jeunes, les relations entre les universités, le programme Erasmus : tout cela représente de l'argent !
Cela dit, nous avons vu que l'Union européenne est capable d'écouter ce que les citoyens ressentent et de ne pas rester claquemurée dans ses dogmes. La présidence française a obtenu que l'on relève le seuil de minimis des aides de 200 000 à 500 000 euros et que l'on modifie les conditions dans lesquelles les collectivités publiques sont autorisées à accorder des prêts bonifiés. Rien n'aurait été plus dommageable qu'une Commission ou un Conseil sourds aux attentes des peuples et aux angoisses des familles et des salariés.
En matière de défense européenne, nous avons effectué de réels progrès. Je regrette d'ailleurs la discrétion du Président de la République sur ce point dans sa conférence de presse, tant les résultats concrets que nous avons obtenus étaient presque inenvisageables il y a quelques mois. Ils concernent aussi bien les capacités que les opérations (EULEX au Kosovo, Atalante dans l'océan Indien, les opérations au Tchad) et les institutions : même si l'on en est à un stade encore embryonnaire, la capacité de planification opérationnelle est un élément très important pour la structuration de l'Europe de la défense.
J'en viens plus précisément aux questions du président Lequiller.
S'agissant des relations franco-allemandes, il ne faut pas se tromper de diagnostic. La qualité des liens personnels entre Mme Merkel et M. Sarkozy n'est nullement en cause : il n'y a pas de difficulté entre eux. Je vous invite du reste à relire l'excellent ouvrage que Maurice Vaïsse a consacré aux relations entre le général de Gaulle et Willy Brandt. Dans la période de transition où le second, encore ministre des affaires des étrangères, allait succéder à Kiesinger à la chancellerie et où le premier était à la fin de son mandat, on était dans l'affrontement direct. Ainsi Brandt affirma-t-il en 1968 qu'il était impossible pour l'Europe qu'un dictateur soit à la tête de la France. C'était le jour même où devait avoir lieu à l'Élysée un dîner d'État entre le Général de Gaulle et le Chancelier Kiesinger. Le général fit annuler la moitié des invitations des convives allemands ! Et lorsque le Général de Gaulle déclara en Pologne que la ligne Oder-Neisse était une frontière stable et intangible et que tous les États d'Europe devaient la reconnaître, il touchait à un symbole très fort pour les Allemands.
On ne peut nier cependant que nos deux États se soient récemment éloignés, parce qu'ils ne partagent plus nécessairement les mêmes intérêts économiques, parce qu'ils ont adopté des stratégies industrielles différentes et pas forcément compatibles. Nous devons donc nous employer à prouver aux citoyens des deux pays que nous sommes capables d'un minimum de coordination : ils ne pourraient comprendre, par exemple, que nous nous affrontions sur un sujet aussi vital que l'automobile, qui est un fleuron de l'industrie allemande et qui représente 780 000 emplois en France. Je ne serai pas le ministre d'une relation franco-allemande perdue dans les nuées et les grandes déclarations de principe ! Je souhaite aller au fond des choses et obtenir des résultats tangibles. Cela demandera beaucoup de temps et de patience. Cela supposera aussi que l'on retrouve des relais : de part et d'autre du Rhin, on ne sait plus à qui s'adresser. Il faut bien reconnaître qu'une certaine envie a disparu des deux côtés.
N'oublions pas que les Allemands ont le sentiment légitime d'avoir accompli un travail considérable – travail de mémoire mais aussi réduction des déficits et remise à niveau en Allemagne de l'Est – dont ils souhaitent aujourd'hui toucher les bénéfices. Nous devons le comprendre si nous voulons retrouver une relation saine et constructive.
Ne nous faisons pas d'illusions : même s'il nous faut nous ouvrir à d'autres États et penser différemment, il n'y aura pas d'Europe politique sans entente entre nos deux pays.
Deuxième question : le passage de relais. J'ai déjeuné aujourd'hui avec le vice-premier ministre tchèque, qui est un très bon connaisseur des sujets européens, et je l'ai senti un peu inquiet de la responsabilité qui incombait à son pays. Les Tchèques sont bien conscients que leur première présidence de l'Union européenne est une charge très lourde et qu'elle doit être couronnée de succès. Ils n'ont qu'une peur : ne pas en avoir les moyens administratifs et politiques, mais aussi le poids économique et culturel. La seule solution est de leur tendre la main et de les aider concrètement. Le vice-premier ministre a d'ailleurs été sensible à cet état d'esprit, et nous avons même échangé, lui et moi, nos numéros de portables afin de nous consulter rapidement dès que cela serait nécessaire. Surtout, ne nous focalisons pas sur les réactions de Václav Klaus et sur les histoires de drapeau ! C'est ce qui fait la une des médias mais ce n'est pas ce que le peuple tchèque pense et souhaite construire avec nous.
Dernier point : les questions institutionnelles. La ratification tchèque devrait avoir lieu en février. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter mais notre attitude aura une grande importance : si nous mettons en exergue les éléments « irritants » et le comportement irresponsable de certains dirigeants, nous ne faciliterons guère les choses ! Nos partenaires ont bien conscience qu'une non-ratification ruinerait leur présidence.
Le président polonais refuse de signer le traité avant que celui-ci soit ratifié par l'Irlande. En ce qui concerne ce pays, le choix opéré était le seul raisonnable : permettre au peuple irlandais de se prononcer à nouveau sur le traité de Lisbonne. Nous avons essayé de mettre toutes les chances de notre côté en prenant en compte des revendications essentielles, notamment celle qui porte sur les commissaires européens. Mais ce qui sera décisif, c'est la façon dont nous nous comporterons d'ici à septembre ou octobre, date du référendum en Irlande. En aucun cas nous ne devons nourrir l'euroscepticisme ou le populisme de certains responsables. Même si c'était à mon sens le seul qui pût être tenté, cela reste un pari. Un référendum n'est jamais gagné d'avance.

La période récente a mis en évidence le déséquilibre dont souffre la relation franco-allemande. J'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que vous étiez vous-même une partie de la réponse, mais je pense comme vous que l'on ne peut s'arrêter à des questions de personnes. Vous soulignez à juste titre que l'Allemagne a consenti beaucoup d'efforts et considère que ces efforts, qui ont eu un coût social important, ne doivent pas être ruinés par la solidarité qu'on lui demande envers d'autres pays. À cet égard, la position de la France serait plus forte si elle s'était astreinte à respecter les mêmes critères.
De plus, depuis l'élection de M. Sarkozy, nous donnons l'impression de penser qu'il existe une stratégie alternative – et à mon sens illusoire – à l'axe franco-allemand. Jamais le Président de la République n'a cherché à lever l'ambiguïté. Hier encore, il déclarait devant le Parlement européen que l'axe franco-allemand est un devoir absolu mais qu'il ne peut plus être de même nature que dans une Europe des Six, des Neuf ou des Douze. Qu'est-ce que cela signifie ?
On a également le sentiment que la présidence française a renforcé le poids des États et des relations intergouvernementales par rapport au poids de la Commission. Celle-ci a semblé très en retrait et sans initiative. N'assistons-nous pas à l'émergence d'une méthode intergouvernementale au détriment d'un fonctionnement plus communautaire et fédéral ? Dans la négociation avec l'Irlande sur les commissaires européens, c'est bien la réalité des États qui s'est imposée. Cette marque de réalisme n'est-elle pas aussi un frein aux évolutions de demain, dans la mesure où les compromis trouvés sont généralement a minima ? Le plan de relance reste prisonnier des intérêts de chacun des États membres. Je remarque que la Grande-Bretagne dispose d'une grande latitude pour abaisser la TVA – ce qui se traduira par un creusement significatif de son déficit budgétaire. Les États de la zone euro peinent à afficher un tel volontarisme.
Enfin, si je peux comprendre que le compromis était la seule solution pour le paquet « énergie-climat », je remarque aussi que la méthode démontre ses limites. Le plan aurait été sans doute plus ambitieux s'il avait été adopté à la majorité qualifiée.
Pour moi, la question majeure de la construction européenne, dans les prochaines années, est celle de la transcription fidèle de la volonté des peuples. C'est une des leçons du « non » français : lorsque les peuples ont le sentiment que les choses se jouent sans eux et que le pouvoir s'exerce sans légitimité, ils envoient tout balader. Mais il est insupportable que des responsables politiques, de gauche comme de droite, ne cessent de répéter : « Ce n'est pas nous, c'est Bruxelles ». Bruxelles, c'est qui ? C'est quelle légitimité ? Quel mode de désignation ? En tant qu'élu, j'estime qu'il est essentiel de pouvoir répondre en face au citoyen et d'assumer pleinement une décision parce qu'elle est bonne pour le pays et bonne pour l'Europe. Laisser entendre qu'une mesure a été imposée par Bruxelles, ce n'est plus possible. C'est un des mérites du Président de la République que d'avoir soutenu cette idée.
Comme vous, monsieur Caresche, je suis persuadé que la position de la France aurait été plus forte si nous avions mieux respecté les critères auxquels nous avons nous-mêmes souscrit. Ceux qui, en face, se donnent le mal d'arriver à l'équilibre – et l'on sait combien cela a été douloureux pour l'Allemagne – trouvent les Français bien sympathiques de donner des leçons à tout le monde alors que leur déficit pour 2008 s'élève à 2,8 % ! Pour mémoire, le déficit budgétaire allemand, qui atteignait encore 2,5 % en 2005, a été ramené à l'équilibre en moins de trois ans. De ce point de vue, la France a un véritable problème de légitimité et de crédibilité.
Comme vous, je ne crois pas qu'il existe de stratégie alternative à la relation franco-allemande. Ce n'est pas ce que le Président de la République a à l'esprit. Il a seulement compris que cette relation ne pouvait plus être exclusive et qu'il fallait faire place aux autres États. Il nous faut nous ouvrir presque instantanément à nos partenaires de tout accord trouvé au préalable avec les Allemands. Le « G4 », le « G6 », etc., sont autant de formules que nous expérimentons à tâtons. J'en parlais hier encore avec M. Martin Schulz : il faut définir une formule où la France et l'Allemagne sont au coeur de l'élan européen, mais en étant entourées des autres États. Les grand-messes franco-allemandes au terme desquelles on dictait les décisions aux partenaires européens, cela ne marche plus. Nous avançons vers une redéfinition qui n'oublierait pas les autres États, notamment les plus petits.
Vous avez enfin évoqué les « stratégies alternatives ». J'éprouve un respect immense et une profonde affection pour le pays auquel vous avez fait allusion, la Grande-Bretagne. Reste que l'Europe ne s'est pas construite, à l'origine, avec elle. Je crois à la mémoire et ne pense pas que l'on puisse rayer d'un trait de plume des décennies de construction européenne. La Grande-Bretagne est un partenaire plus récent que l'Allemagne. Elle ne fait pas partie de la zone euro. Elle tient à sa relation privilégiée avec les États-Unis, ce qui n'est pas sans lui poser certains problèmes dans le domaine de la défense et ce qui lui interdit d'aller trop loin sur certains sujets. Pour être clair, il n'existe pas de stratégie alternative d'alliance avec la Grande-Bretagne pour prendre l'Allemagne à revers. Ce sont des billevesées ! En revanche, les discussions en matière de défense ou d'économie peuvent se révéler intéressantes. Plus nous pourrons associer la Grande-Bretagne à la construction d'une Europe politique, mieux cela sera. Lorsque le Président de la République indique que la relation avec l'Allemagne n'est plus de même nature, il ne fait que constater qu'il faut l'ouvrir à d'autres États et procéder un peu différemment.
Tout l'intérêt de la période actuelle est que nous sommes à la croisée des chemins – en toute matière : institutionnelle, politique, de défense… Les décisions que nous prenons jour après jour vont fixer un modèle pour les décennies à venir. Nous n'avons pas le droit à l'erreur et il faut donc le maximum d'écoute et de dialogue pour aller dans la bonne direction.
Il est vrai qu'un mode de fonctionnement intergouvernemental s'impose pour l'instant, au détriment du modèle fédéral. Nous l'assumons, parce que c'est sans doute aujourd'hui la meilleure façon de faire progresser l'Europe. Tout le défi de l'année à venir est que les États gardent cette capacité d'impulsion politique mais qu'en même temps les institutions européennes en assurent la cohérence dans l'ensemble de l'Union. On ne peut pas en rester à l'unique volonté des États – d'abord parce que chacun n'a pas un dirigeant aussi dynamique que Nicolas Sarkozy, et ensuite parce que, quoi qu'on en dise, une présidence lituanienne pèsera toujours moins qu'une présidence allemande.
Après cette période d'affirmation des États qui aura ravivé la démocratie dans le fonctionnement européen, qui aura remis les peuples au coeur des décisions européennes, nous devrons réfléchir à la façon dont les institutions européennes pourront garantir que ces décisions seront bien appliquées. Par exemple, si tout le monde admet que nous avons besoin d'une gouvernance économique et si nous pouvons avancer en la matière sur la base de la décision des États, nous aurons aussi besoin que des institutions garantissent qu'elle s'applique à tout le monde – l'Eurogroupe pourrait remplir ce rôle pour commencer.
Nous sommes à un moment de transition dans la vie du continent. C'est une idée politique qui avait fondé la construction européenne mais, trop ambitieuse, elle avait cédé le pas à une politique des petits pas et des solidarités de fait. C'est allé tellement loin que les décisions ont fini par manquer de légitimité aux yeux des peuples, ce qui a conduit à des échecs politiques tels que celui du référendum français de 2005. Nous repartons donc dans la direction d'une politique des États assortie de l'indispensable intervention des institutions européennes. C'est ce qui est en train de se jouer.

Comment intéresser de nouveau les citoyens à l'avenir de la construction européenne ? L'opinion publique juge de façon très positive l'action du président Sarkozy lors de la première phase de la crise financière, mais peut-on intéresser nos compatriotes à des sujets plus quotidiens et leur donner une nouvelle image de l'Europe – le tout dans la perspective de la prochaine élection du Parlement européen ? Ensuite, qui veut encore de l'Europe politique au sens où l'entendent les Français, qui sont peut-être un peu seuls en Europe à défendre leur conception ? Enfin, quelle vision le futur président des Etats-Unis Barack Obama a-t-il de l'Union ?

Je me réjouis moi aussi du résultat de la présidence française, qui a donné du corps à l'Union. Le rôle plus significatif des États, que certains critiquent, est peut-être une bien meilleure voie de construction européenne que le rêve des années cinquante. On est en train de tirer enfin la conséquence de la chute du mur de Berlin et donc de passer à l'idée d'une Union à bientôt trente États. Ce réalisme entraîne pour la première fois une adhésion des peuples, dont il n'est cependant pas dit qu'elle persiste pour la prochaine élection européenne.
L'élan donné par la présidence française ne risque-t-il pas de retomber dans la superbe indifférence de l'abstention ? C'est important notamment en Irlande : les élections européennes y scelleront peut-être le sort du nouveau référendum. Avez-vous des idées pour déminer le terrain, sachant que l'un des leaders de l'opposition irlandaise s'agite beaucoup pour créer une internationale – et trouve d'ailleurs des relais du côté de la Tchéquie ? À ce propos, pouvez-vous nous en dire plus sur les « comportements irresponsables de certains responsables tchèques » – dont, pour ma part, je ne suis pas certain que les positions ne soient pas partagées par une grande partie de l'opinion tchèque ? Là encore, les élections européennes seront déterminantes. Si nous ne les préparons pas bien, la déconvenue risque d'être grande.
Dans la période de transition actuelle, tout est fragile. On avance jour après jour et l'Europe politique peut soit se construire, soit s'écrouler très vite. Dans le plus positif des enchaînements, la campagne électorale permet d'apporter la preuve de l'utilité concrète de l'Europe. Le débat démocratique est intéressant, le taux de participation aux élections européennes s'améliore et le peuple irlandais en conçoit le sentiment que l'Europe est utile et adopte l'indispensable traité de Lisbonne.
Dans le scénario le plus noir, qui n'a rien d'impossible, la présidence tchèque – ou plus précisément, si vous y tenez, Vaclav Klaus – prend de nouvelles décisions symboliques qui créent beaucoup d'émoi, le taux de participation baisse parce que les gens sont préoccupés avant tout par la crise économique, seuls les extrêmes vont voter, et le traité n'est pas adopté.
Je suis incapable de vous dire lequel de ces scénarios l'emportera. En revanche, je suis déterminé à tout faire pour que ce soit le premier, et donc pour mettre en valeur le débat européen.
Ce qui m'amène à l'autre question : comment intéresser les citoyens à l'Europe ? La réponse est assez simple : il faut leur apporter la preuve que l'Europe change leur vie dans le bon sens. En période de crise économique, cela revient à les protéger. Notre système de protection sociale par exemple, s'il donne lieu à bien des critiques et des questions, à commencer par son financement, n'en suscite pas moins un consensus social inattaquable parce qu'il protège les Français lorsqu'ils vont mal. Bon vent à celui qui voudrait le supprimer !
Si l'Europe n'apporte pas dans les mois à venir la preuve qu'elle protège ses habitants aussi bien, mais dans le domaine économique – si une entreprise automobile ferme ses portes en France, en Allemagne, en Espagne ou en Italie, nous aurons du mal à convaincre de son utilité. Nous devons arriver à nous coordonner pour défendre nos emplois et nos sites industriels. Le salarié de base ne doit pas pouvoir penser que la France prend ses décisions nationales sans la moindre concertation avec sa prétendument grande amie l'Allemagne.
Ensuite, il faut rendre les citoyens européens fiers de l'Europe. Il n'est que de considérer le renversement de l'opinion sur l'euro : certes il a coûté cher, mais il nous protège contre une inflation galopante ou des dérèglements économiques trop brutaux, et nous donne une certaine force en matière commerciale. Ainsi l'Islande, après avoir fait faillite, commence à trouver urgent de rejoindre la zone euro ! Et nos concitoyens sont fiers de constater que contrairement aux Etats-Unis, qui connaissent un krach complet, l'Europe résiste à peu près.
Enfin, l'Europe doit être en mesure de faire adopter un certain nombre de ses conceptions au reste de la communauté internationale. La construction européenne est fondée sur les normes. Si nos positions en matière de paradis fiscaux, de règles prudentielles du domaine bancaire ou de contrôle de l'activité bancaire sont traduites en droit au prochain G 20, nous aurons marqué des points parce que ces sujets inquiètent chaque foyer européen. Si c'est aussi le cas dans le domaine de la protection de l'environnement par exemple, si l'Europe peut influer sur la détermination des règles mondiales même si elle n'est pas une superpuissance, ce sera un motif de fierté et d'adhésion au projet européen. Les choses se jouent à ces deux extrêmes : prouver que l'Europe est capable de défendre concrètement les intérêts de ses habitants, et montrer que son modèle de développement politique peut s'imposer au reste du monde.
Quant à Barack Obama, il ne faut surtout se faire aucune illusion : il défendra les intérêts des États-Unis d'Amérique et rien d'autre. Tout ce que nous pouvons espérer est qu'il considère comme avantageux de favoriser l'émergence d'une défense européenne afin de partager le fardeau de la responsabilité militaire. Un des problèmes de la présidence tchèque sera d'éviter que certains États de l'Union courent à la Maison blanche pour obtenir un bon point. L'Union doit rester unie.
Je terminerai avec la question de l'Europe politique, qui se construit bon an mal an. Bon an parce que nous commençons à déterminer ensemble des règles qui s'imposent de façon démocratique et légitime à nos concitoyens, dans tous les domaines – environnement, économie, social… – et à les faire comprendre et accepter. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes en chemin. Mais mal an parce que dans le domaine de la défense par exemple, si l'esprit européen n'est pas aussi pacifiste que certains auteurs américains le décrivent, il montre une réticence évidente à dépenser de l'argent pour le secteur militaire et à assumer le rôle de puissance politique. C'est pourtant décisif pour l'affirmation d'une Europe politique. La présidence française a réussi à obtenir le maximum de ce qui était possible en matière de défense, mais elle s'est heurtée à la réalité, c'est-à-dire la capacité et la volonté des États de dépenser de l'argent pour les armées.
Le débat sera donc passionnant. Nous devrons nous voir souvent, car les choses vont évoluer au jour le jour. Dans six mois, nous nous ferons une meilleure idée de ce que deviendra l'Europe.

Merci, Monsieur le ministre. Nous sommes très heureux de cette première rencontre et en organiserons une autre dès le début de l'année prochaine.
La séance est levée à 18h10.