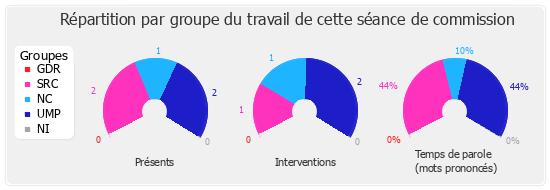Commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies
Séance du 3 novembre 2010 à 17h00
La séance

Monsieur le président, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la commission d'enquête. Depuis maintenant dix-huit mois, vous êtes président-directeur général de la Société Générale. Votre établissement est un acteur majeur sur les marchés financiers. Aussi êtes-vous pour nous un témoin précieux, notamment au sujet de certaines pratiques des salles de marché.
La crise financière et plus particulièrement la crise grecque a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur la sensibilité des marchés financiers aux rumeurs, sur les conflits d'intérêt affectant certains opérateurs, sur le mécanisme des Credit Default Swaps, les CDS, et sur les effets déstabilisants des outils permettant les ventes à terme et à découvert de certains produits financiers.
La spéculation, au sens originel du terme, n'est pas une activité étrangère à votre profession. Mais selon vous, où s'arrête la bonne spéculation, celle qui est nécessaire à l'équilibre et à la liquidité des marchés ?
Comment la contribution des activités pour compte propre a-t-elle évolué, depuis 2007, dans le produit net bancaire de la Société générale ?
Il est difficile de ne pas faire allusion à l'affaire Kerviel. Serait-elle encore possible aujourd'hui ? Quelles ont été les mesures prises en interne, en particulier au niveau de la supervision ?
Partagez-vous les conclusions de nombreux observateurs, selon lesquelles les récentes crises financières sont dues, en partie du moins, aux insuffisances de la régulation nationale, européenne et mondiale ?
Qui se livre aux attaques spéculatives, et à partir de quelles zones ou marchés ? Quel est le rôle des hedge funds ? Quelles relations la banque que vous présidez entretient-elle avec ce type de fonds ? Ont-elles changé depuis la crise financière ?
Pratiquez-vous le High Frequency Trading, le HFT, consistant à automatiser les décisions de vente ou d'achat, dont on affirme parfois qu'il amplifie les mouvements spéculatifs et peut, nous ont expliqué certains de ceux qui vous ont précédé ici, échapper à tout contrôle, a priori et en cours de séance - voire a posteriori, puisqu'il aura fallu plus de six mois pour savoir ce qui s'était passé le 6 mai dernier à Wall Street.
Devant notre commission, M. Jouyet a regretté la fragmentation du marché des actions résultant de la directive MIF. Quelle est à cet égard la pratique de la Société générale ? Autrement dit, recourez-vous aux dark pools ? Quelle est votre position sur la révision de cette directive ?
Quel est le rôle des agences de notation dans les prises de position de vos salles de marché ? Que pensez-vous du fonctionnement actuel de ces agences ?
Comment votre pratique a-t-elle évolué en matière d'octroi de stock-options ? Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Enfin et surtout, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour assainir le fonctionnement des marchés financiers ?
M. Frédéric Oudéa prête serment.
Vos questions balaient un domaine très large. En préalable, permettez-moi quelques mots sur la Société Générale et les activités qu'elle développe.
Créée en 1864, la Société Générale est présente dans quatre-vingt-trois pays et emploie 160 000 collaborateurs. Environ 60 000 personnes travaillent en France, où nous sommes l'un des principaux recruteurs du secteur privé. Nous avons tout d'abord des activités de banque de détail, à travers nos agences en France, mais aussi notre réseau à l'étranger, principalement en Europe de l'Est, en Afrique et dans le bassin Méditerranéen. Nous avons aussi des activités de services financiers d'assurance, de gestion d'actifs, de services titres et de banque privée. Enfin, notre banque de financement et d'investissement, qui représente à peu près le tiers de nos revenus et de nos capitaux, a elle-même différentes activités. Le financement, d'abord : nous aidons les entreprises à financer des projets d'infrastructure, à exporter, à investir. Les activités de marché, ensuite : nous aidons les entreprises à accéder aux marchés en servant d'intermédiaire entre elles et les investisseurs. Nous sommes ainsi, à ma connaissance et à date, le premier acteur pour les émissions d'actions d'entreprises françaises ; nous aidons également les entreprises à émettre des obligations. Et lorsqu'il n'y a pas de marché organisé, nous servons aussi d'intermédiaire entre les investisseurs en leur offrant de la liquidité quand ils veulent acheter ou vendre des actifs de toutes sortes – matières premières, devises… Nos activités de marché dans leur ensemble occupent 2 800 collaborateurs en front office dans le monde, et les activités pour compte propre stricto sensu représentent à peu près 3 % du revenu du groupe Société Générale.
Sur les marchés financiers, les banques ne sont que des acteurs parmi d'autres. Interviennent principalement des investisseurs de toutes sortes : les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs qui collectent l'épargne dans les différents pays et les fameux hedge funds. Ces derniers, sans collecter systématiquement de l'épargne, disposent de capitaux qu'ils placent selon des stratégies d'investissement à plus ou moins court terme.
J'en viens à votre première question : où s'arrête la bonne spéculation ? Il est très difficile de répondre, surtout avec des chiffres. On connaît les volumes quand il y a des marchés. En revanche, on en est réduit, s'agissant des opérations OTC, de gré à gré, à des estimations faites à partir de statistiques pas forcément fiables. Spéculer, c'est anticiper, notamment un mouvement de prix, et prendre en conséquence une certaine position ; je ne vois donc pas comment vous apporter une réponse rationnelle et précise à cette question.

Le rapport entre le PIB mondial et le volume des opérations OTC, c'est-à-dire 60 000 milliards contre 700 000 milliards selon la Banque des règlements internationaux, soit douze fois plus, est-il un critère pertinent ?
Je ne sais déjà pas vérifier le second chiffre, la BRI a plus d'informations qu'une banque isolée. Prenons l'exemple des CDS, qui sont des contrats de protection contre le risque de crédit. En l'absence de marché organisé, c'est-à-dire de place centralisant les achats et les ventes, ils ont été conclus de manière bilatérale. Une banque A, se jugeant trop exposée à un risque sur une entreprise, mais ne souhaitant pas mettre fin à ses relations avec elle, se protège en passant un contrat de CDS avec une banque B. Si celle-ci accumule les contrats de ce type, elle pourra décider à son tour de se protéger en passant un contrat avec une banque C. C'est ainsi que la multiplication des contrats bilatéraux a abouti à une estimation de 60 000 milliards de dollars, bien supérieure à la somme des crédits sous-jacents. Car il n'existe pas de marché pour annuler les opérations de sens inverse, ce qui gonfle artificiellement « la bulle » apparente.
Y a-t-il trop de CDS ou pas assez ? Je ne sais pas juger. Pour notre part, nous soutenons l'idée de créer des places de marché, afin d'avoir une meilleure vision des volumes en question, de comprendre l'ensemble des risques et d'assurer une compensation entre les risques et les différents acteurs. La Société Générale n'est pas un acteur important en matière de CDS : nous ne vendons pas de la protection, nous n'assurons pas les autres. Nous avons tout intérêt à avoir moins de contrats bilatéraux et plus de standardisation, en passant par une place de marché.
Bref, je ne sais pas définir la bonne ou la mauvaise spéculation, mais je sais qu'il faut de la transparence, laquelle peut être assurée par le développement de plates-formes permettant une compensation entre les risques des différents acteurs.
Je sais aussi que nous avons été parfois victimes de rumeurs de marché, ce qui nous a conduits à demander à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'enquêter. Certains acteurs peuvent être tentés de faire circuler des rumeurs pour provoquer ne serait-ce que des petits mouvements de cours. Mais encore une fois, la frontière entre bonne et mauvaise spéculation n'est pas facile à tracer.
Quant aux activités pour compte propre, déjà marginales chez nous, il est très clair que, compte tenu des changements réglementaires qui interviennent, et notamment de l'augmentation considérable de capital – trois à quatre fois plus – qui va être demandée par les régulateurs pour exercer des activités de marché, elles vont se réduire encore.
Un bref rappel sur l'affaire Kerviel. M. Kerviel a pris des positions totalement en dehors de son mandat et les a masquées par de fausses transactions. Des contrôles étaient effectués mais ils portaient les positions nettes, s'agissant d'opérations d'arbitrage. Il y avait eu des alertes, mais cela n'avait pas conduit à détecter la fraude avant le fameux week-end du début janvier 2008. Nous avons donc, en totale transparence, renforcé nos contrôles. Premièrement, nous avons instauré des limites sur les nominaux portant sur chacun des arbitrages, et non plus seulement sur la position nette. Deuxièmement, nous avons créé un département spécial de lutte contre la fraude, opérant de manière transversale : Jérôme Kerviel faisait basculer ses fausses opérations d'une entité à l'autre, si bien que les incidents n'apparaissaient pas de manière récurrente dans un même département ; le département que nous avons créé examine tous les incidents de manière transversale, en essayant à chaque fois de « tirer les fils », au-delà de notre structure d'organisation. Troisièmement, nous avons réorganisé nos back-offices en créant un département appelé product control group, qui regroupe des acteurs d'horizons différents – middle office, finance, back-office – pour comprendre la constitution du résultat dans ses moindres détails, alors que jusque-là tout était noyé dans la masse des opérations ; désormais, nous pouvons avoir une vision quotidienne fiable de nos résultats. J'ajoute que le nombre d'auditeurs et d'inspecteurs n'a cessé d'augmenter depuis trois ans ; 1 700 personnes, soit environ 1 % de nos effectifs, se consacrent aujourd'hui exclusivement au contrôle de second niveau, effectué périodiquement, en plus du contrôle de premier niveau exercé de façon permanente par chaque opérateur ou manager.
Une autre affaire Kerviel est-elle possible ? À mon avis, non. La fraude existe, dès lors qu'il y a manipulation d'argent – sur les marchés financiers, mais aussi bien dans une agence pour détourner 1 000 euros – et nous ne sommes pas capables de l'éviter totalement. En revanche, à mon sens, une fraude de cette ampleur et de cette durée ne peut se reproduire à la Société Générale.
J'en viens à la question de la régulation, et d'abord à l'analyse de la crise – car si on ne fait pas le bon diagnostic, on risque d'apporter de mauvaises réponses et de provoquer de graves désillusions.
Pour moi, il s'agit d'une crise de compétitivité, profonde, des économies développées. À partir des années 2000 surtout, les économies développées sont entrées dans une compétition nouvelle avec les pays émergents ayant des populations éduquées avec un accès aux technologies. Elles ont préservé des modèles de croissance fondés sur la consommation des ménages et le surendettement. Le meilleur exemple, ce sont les États-Unis, dont le PIB était constitué à 70 % de consommation avec, à la clé, un endettement considérable des ménages à travers le crédit immobilier et les cartes de crédit. Mais il est un autre exemple, beaucoup plus près de chez nous : l'Irlande. L'endettement des ménages et des entreprises y est passé d'environ 120 % du PIB en 2004 à environ 220 % du PIB en 2008-2009. Autrement dit, il a quasiment doublé en cinq ans. Avant la crise, l'Irlande était le pays en Europe où le PIB par tête était le plus élevé ; mais c'était une fausse richesse, fondée sur l'immobilier commercial et le crédit. Et la bulle a explosé. La situation est très variable selon les pays européens : la France n'a pas connu la même spéculation immobilière que l'Irlande ou l'Espagne. Il reste que d'une manière générale, pour les pays développés, le défi à relever est de trouver un modèle de croissance s'appuyant sur l'innovation, la compétitivité des entreprises et la réduction de l'endettement, tant public que privé – on doit en effet considérer la somme des deux comme le meilleur indicateur de l'effort à réaliser.
Il est évident que les acteurs financiers, maillon-clé de la chaîne, ont collectivement une part de responsabilité ; mais là encore, la situation est très variable d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, des pans entiers du système financier échappaient totalement à la régulation. Il n'y avait ainsi absolument aucun contrôle sur les subprimes : des courtiers, aux origines professionnelles diverses et variées, démarchaient des particuliers pour leur proposer des prêts, en leur disant de ne pas se soucier du remboursement du capital ni même du paiement des intérêts puisqu'il leur suffirait de revendre le bien deux ans plus tard avec une plus-value. Des gens ont ainsi acheté quatre ou cinq propriétés, en pensant devenir riches ; et on sait ce qu'il est advenu. Quant aux courtiers, ils se sont tournés vers des banques d'investissement qui ont titrisé les actifs et les ont protégés comme on sait. En Irlande, il n'y avait pas de subprimes, pas de produits de marché ; mais une petite banque, l'Anglo Irish Bank, qui ne faisait que de la banque de détail, va coûter à l'État irlandais 35 milliards d'euros. Il est donc clair qu'un système de régulation fragmenté ou défaillant, qu'il s'agisse de mécanismes de marché ou d'activités de crédit très classiques, peut conduire à la catastrophe.
C'est pourquoi il faut évidemment renforcer la régulation. Pour que celle-ci fonctionne, trois conditions sont nécessaires, mais aucune n'est suffisante. C'est en agissant sur les trois volets du triptyque qu'on peut assurer la solidité du système. Les exemples français, mais aussi canadien, australien, ou même italien, montrent que l'on parvient ainsi à surmonter les crises sans trop exposer le contribuable.
Premièrement, la distribution du crédit doit être elle-même contrôlée et saine. Avant d'accorder un prêt, nous nous assurons de la capacité du bénéficiaire à rembourser sur ses revenus. Aux États-Unis, les crédits étaient accordés sur la base de la valeur de l'actif : on partait de l'idée que le prix de cet actif ne cesserait de monter et que le crédit serait remboursé par la plus-value. L'outil informatique des courtiers américains, m'a-t-on dit, ne comportait pas de case où inscrire le salaire des clients. C'est ainsi que l'on crée des bulles et que, lorsque le prix s'effondre, la capacité de remboursement disparaît.
Il faut des lois et des contrôles par des régulateurs appropriés, de sorte que les banques et l'ensemble des intermédiaires aient des pratiques saines, c'est-à-dire vérifient la capacité de remboursement de l'emprunteur, laquelle ne doit pas reposer sur des anticipations spéculatives sur des actifs.
Le deuxième élément est la qualité du régulateur. À cet égard, le régulateur français peut être pris en exemple, la crise ayant clairement montré qu'il existait deux types de régulation. Il y a celle qui conduit à mener un travail en profondeur dans les banques, à travers des audits et des inspections impliquant des moyens humains : notre régulateur passe fréquemment du temps au sein des établissements pour décortiquer un sujet donné. D'autres régulateurs ont une approche plus distante : ils posent des principes, sans aller nécessairement vérifier dans le détail s'ils sont respectés. La tendance est aujourd'hui au renforcement des moyens et des vérifications, eu égard aux défaillances observées face à la situation de certains établissements et aux risques systémiques. En France, le régulateur est resté confiant dans la nature des risques pris par les banques.
Troisième volet du triptyque : les ratios de capital et de liquidité. C'est un enjeu déterminant. Désormais, les banques vont être « corsetées » par trois paramètres, dont la combinaison déterminera leur capacité à prêter et prendre des risques. Le premier, le tier one ou plutôt core tier one, consiste à rapporter le capital de la banque aux risques qu'elle prend, mais en les pondérant – car dans le système de Bâle, prêter à une collectivité locale ou faire du crédit immobilier ne revient pas au même que de s'engager sur un pays émergent ou de financer une PME. Le deuxième, appelé ratio de levier (ou leverage ratio) un rapport entre le capital et les engagements financiers globaux, indépendamment de leur nature, nous a été imposé de facto par les États-Unis, où il n'a pourtant pas empêché la catastrophe ; pour notre part, nous considérons qu'il n'est pas pertinent de traiter ainsi tous les types de risque de manière uniforme. Enfin, les ratios de liquidité, qui sont en cours de discussion, peuvent jouer un rôle essentiel. La grande leçon de la crise, c'est en effet que la liquidité, comme le capital, est une ressource rare et doit être gérée comme telle. Le monde où la liquidité était abondante et bon marché est révolu. La liquidité va conditionner notre capacité de prêt ; les ratios de liquidité peuvent être assez contraignants dans un paysage financier « désintermédié », comme en France, où sont proposés des SICAV monétaires, des produits d'assurance-vie, etc. Nous devrons résister à des crises et veiller à avoir dans notre bilan suffisamment de ressources longues pour prêter.
Entre 2007-2008, c'est-à-dire avant la crise, et début 2013, moment où le dispositif Bâle III entrera en vigueur, l'exigence minimale de capital va être multipliée par quatre ou cinq. Avant la crise, la Société Générale était au-dessus du seuil requis, mais nous allons néanmoins devoir multiplier par deux environ le montant de nos fonds propres : pour un même risque, il nous faudra en moyenne deux fois plus de capital. C'est un vrai changement et cela induira, à mon avis, des transformations fondamentales du système bancaire.
Ce n'est pas à cela que je pense. On s'interroge beaucoup sur la taille critique des banques ; je considère pour ma part que les grandes entreprises européennes ont besoin de banques européennes d'une certaine taille pour les accompagner : si, paradoxalement, l'Europe décidait de fragmenter son système bancaire, face aux banques américaines qui sont désormais gigantesques, aux banques chinoises qui sont numéro un dans le monde, aux banques brésiliennes qui sont elles aussi très grandes, l'industrie bancaire européenne risquerait de ne plus être compétitive. Un exemple : nous accompagnons Sanofi dans son acquisition de Genzyme ; le pool est composé de trois banques, une américaine et deux françaises, pour 5 milliards de dollars chacune. Pour s'engager, il faut avoir une certaine taille ; si aucune banque européenne ne pouvait le faire, je ne suis pas sûr que Sanofi trouverait trois banques américaines. Il y a donc là un enjeu de compétitivité très fort pour l'économie européenne.
Quand je parle de transformations, je pense plutôt à la discipline financière, aux contraintes qui vont s'imposer à nous dans le futur, notamment en matière de liquidités. La collecte de dépôts est, durablement, un enjeu essentiel.
Mais les systèmes financiers ne se résument pas aux banques, et il faut continuer à avancer sur les autres sujets : les plates-formes de compensation, la transparence. Il faut avoir au moins une sorte d'entrepôts de données sur les transactions – ce que l'on appelle en anglais des repositories – auxquels le régulateur ait accès. Dans ce domaine, on a plutôt moins avancé que dans celui de la régulation bancaire. S'agissant des CDS, l'un des enjeux est de créer une plate-forme dans la zone euro – car s'il est bien de concentrer un risque sur une plate-forme, il faut aussi que celle-ci soit suffisamment robuste ; le garant en dernier ressort de la liquidité de cette plate-forme serait, pour les produits en euros, la Banque centrale européenne. Encore faut-il être en mesure de proposer ce type de services, et certains enjeux industriels ne sont pas réglés.
Qui se livre à des attaques sur les marchés ? Ne disposant pas d'informations statistiques permettant de vous répondre, je ne peux que vous livrer mon témoignage de praticien.
En juin, à un moment de turbulence pour la zone euro, nous étions aux États-Unis pour présenter notre stratégie à nos actionnaires. Ce ne sont pas des hedge funds, mais de grands fonds de pension français, anglais, américains, qui gèrent les retraites des épargnants. De réelles inquiétudes se sont manifestées quant à la capacité de certains États à rembourser leur dette, et les craintes étaient encore plus fortes aux États-Unis car les mécanismes qui ont permis de sauver le système ont été un peu longs à mettre en place ; pour les Américains, qui ont une monnaie unifiée, la problématique de construction de l'euro est un peu difficile à comprendre. Comme me l'a dit un investisseur, « on a toujours davantage peur de ce qui est loin et on est souvent trop confiant dans ce qui est proche ». De fait, au vu des interrogations sur les statistiques budgétaires de la Grèce et du temps mis à régler la crise, les fonds américains – qui ont des devoirs fiduciaires envers leurs clients – se sont demandé quel crédit ils pouvaient accorder à la dette grecque. Au cours de l'été, le phénomène s'est inversé : les craintes se sont focalisées sur l'économie américaine et le dollar ; les craintes concernant l'Europe se sont estompées dès lors que les mécanismes ont été mis en place. Les réactions de ce genre vont et viennent, elles sont difficiles à canaliser mais elles découlent d'interrogations fondamentales.
En ce qui concerne la zone euro, je pense que la situation n'est plus ce qu'elle était auparavant : désormais, la question de la solvabilité des États va demeurer dans la tête des investisseurs. Si la Grèce a été particulièrement affectée, c'est parce que sa dette est pour l'essentiel dans la main de non-résidents, l'épargne domestique étant faible – à l'inverse du cas du Japon, par exemple ; les étrangers qui ont le choix entre plusieurs dettes souveraines passent de l'une à l'autre selon les circonstances. La question de la solvabilité des États sera désormais omniprésente.
Quant aux hedge funds, il y en a de toutes sortes, du plus gros – probablement autour de 30 milliards de dollars sous gestion –, aux plus petits, qui ne dépassent pas 500 millions. Vous trouvez là des gérants ou d'anciens traders qui ont créé leur entreprise. Leurs stratégies sont extrêmement variées : à court ou à long terme, fondées sur des arbitrages, ou n'intervenant que sur une classe d'actifs. Je n'ai pas non plus de statistiques sur le sujet. Beaucoup ont disparu avec la crise, dont, j'y insiste, ils ne sont en rien responsables. D'autres se créent à nouveau. Le hedge fund peut avoir un fonctionnement risqué en raison de l'effet de levier : il peut investir dans un marché non pas seulement avec du capital, mais aussi en empruntant. Mais cet effet de levier s'est réduit : les pratiques sont devenues plus rigoureuses, l'endettement est moins utilisé pour financer les investissements – mais là encore, il est difficile d'avoir des statistiques. La nouvelle réglementation européenne devrait améliorer l'information dans ce domaine.
Pour notre part, nous n'avons pas d'activité de hedge fund, mais nous avons des hedge funds pour clients : comme tout gestionnaire d'actifs, ils peuvent acheter et vendre des actions par notre intermédiaire ; à certains d'entre eux, nous accordons des crédits, mais c'est une activité modeste chez nous ; enfin, nous avons une plate-forme de managed account. En effet, le principal inconvénient d'un hedge fund, pour un investisseur, est le manque de liquidité : l'investisseur n'a pas beaucoup de visibilité sur la performance, le hedge fund donnant une indication trimestrielle ; et il n'est pas sûr de pouvoir sortir à tout moment. Nous passons donc des contrats avec des hedge funds, en leur demandant de nous exposer leur stratégie, dont nous vérifions ensuite qu'elle est bien appliquée. Nous leur offrons une plate-forme technique, et dès lors que nous contrôlons, nous apportons aux investisseurs une plus grande visibilité ; si, au vu de l'information hebdomadaire, un investisseur veut sortir, nous offrons la liquidité – que nous trouvions ou non un autre investisseur.
J'en viens au trading haute fréquence (HFT).
Il présente des avantages et des inconvénients. On a mesuré les seconds, le 6 mai, sur le marché américain, mais je doute que l'erreur d'un seul gestionnaire de fonds ait pu avoir de telles conséquences ; d'autres paramètres ont nécessairement joué. Par ailleurs, le HFT apporte de la liquidité, ce qui est fondamental sur un marché : un investisseur ne va acheter un actif que s'il est assuré de pouvoir le vendre à tout moment. C'est d'ailleurs un problème pour les obligations d'État, dont on a pu se rendre compte qu'elles ne restaient pas toujours liquides. Sans doute le HFT pourrait-il être plus contrôlé, peut-être faudrait-il assurer plus de transparence sur les volumes, mais je n'ai pas de proposition technique à vous faire. On peut imaginer des règles de capital, ou des limitations à l'engagement des banques ou d'autres acteurs, mais je n'ai pas connaissance de dispositions en ce domaine, en particulier du côté des États-Unis.
Autre sujet sur lequel vous m'interrogez : la fragmentation des marchés d'actions.
Depuis quelques années, on a vu la création de différentes places de marché : il n'y a plus de monopoles boursiers, mais une concurrence entre les institutions traditionnelles et d'autres acteurs qui offrent de la liquidité – c'est la conséquence de la directive MIF. Les banques peuvent rapprocher les offres de vente et les offres d'achat formulées par leurs clients ; mais en la matière, la Société Générale n'est pas un très gros acteur dans le monde, notamment du fait qu'elle n'est pas présente aux États-Unis, où 50 à 60 % des volumes mondiaux d'actions sont échangés. Je ne crois pas que l'on puisse revenir à un monopole, à une place unique où convergeraient tous les ordres. En revanche, je pense nécessaire d'éviter une fragmentation trop forte. Des réglementations exigeant un certain niveau de capital et un certain niveau de technologie paraissent souhaitables ; de plus, il convient d'obtenir de ces plates-formes plus de transparence sur les ordres.
J'en arrive aux agences de notation.
Chez nous, leurs appréciations servent à notre département des risques : les dispositifs Bâle II et Bâle III nous imposant de noter nos contreparties, nous avons notre propre système de notation, mais nous confrontons nos résultats à ceux des agences ; c'est en quelque sorte un contrôle de qualité de notre propre système. Il me semble tout à fait nécessaire de ne pas nous reposer exclusivement sur notre appréciation interne. Il reste que plusieurs questions se posent au sujet des agences de notation.
En ce qui concerne les instruments subprime, les agences, en se fondant sur des modèles de perte, ont manifestement failli dans l'appréciation du risque. Elles n'ont pas été les seules, et je n'en suis pas surpris : étant mathématicien de formation, je n'oublie pas qu'un modèle repose sur des hypothèses ; dès lors que les hypothèses de corrélation des pertes sur différents actifs n'étaient pas les bonnes, fatalement le modèle a produit des informations erronées, lesquelles ont conduit les agences de notation à se tromper sur la résistance des outils en question. Peut-être y a-t-il eu par ailleurs des problèmes de conflits d'intérêt, mais ceux qui ont enquêté sont plus capables que moi d'en juger.
S'agissant de la dette des États, les agences de notation, d'une certaine manière, sont arrivées après la bataille : celle-ci était perdue dès lors que les chiffres du déficit public n'étaient pas les bons et que les mécanismes de solidarité de la Zone euro mettaient du temps à se mettre en place. Le scepticisme qui s'est manifesté aux États-Unis tient à cette double cause – et il demeure : un certain nombre d'acteurs de marché ont des doutes sur la capacité de la Zone euro à poursuivre son développement ; ils s'interrogent sur la possibilité d'avoir des taux de croissance différents et une politique monétaire commune, ainsi que sur le degré de solidarité entre les pays les plus solides et ceux en difficulté. Au total, donc, je ne pense pas que les agences de notation soient la cause des problèmes ; elles peuvent tout au plus accroître ponctuellement le stress, en dégradant une note.
Venons-en aux stock-options, sujet fort différent puisqu'il s'agit de la rémunération des dirigeants des banques.
Je ne pense vraiment pas.
Quelques mots d'abord sur la rémunération des opérateurs de marché. Les dispositions qui ont été prises vont dans la bonne direction ; mon seul souhait est que les règles s'appliquent à tous, et avec la même rigueur qu'en France. Pour ma part, en tant que patron de banque, agissant pour le compte de mes clients et de mes actionnaires, je n'ai absolument aucun intérêt spécifique à verser des rémunérations très élevées aux opérateurs. Les dispositifs visant à différer la rémunération, à la verser pour partie sous forme d'actions ou, si une prise de risque inconsidérée est décelée, à pouvoir remettre en cause la rémunération différée, vont dans le bon sens. Mais, il ne suffit pas de régler la question de la rémunération pour régler celle du risque : chez Lehman, les collaborateurs étaient payés quasiment exclusivement en actions Lehman ; le fait qu'ils soient si directement exposés à l'évolution du cours de l'action n'a pas empêché la faillite.
S'agissant de la rémunération des dirigeants, les stock-options constituent-elles un outil efficace ? Elles sont à mon sens une assez bonne incitation, en ligne avec l'intérêt des actionnaires, dès lors que l'on s'inscrit dans la durée. On est loin de gagner à chaque fois : les stock-options de la Société Générale accordées au cours des années 2004 à 2008 ont des prix d'exercice qui reviennent à leur ôter leur valeur aujourd'hui. En outre, en ce qui concerne les dirigeants, l'exercice des stock-options est soumis à une double condition de performance : non seulement il faut, pour qu'il y ait rémunération, que le cours de l'action soit supérieur au prix d'exercice, mais il faut aussi que l'entreprise satisfasse à un critère de performance – par exemple, concernant la Société Générale, se trouver dans le premier quartile des banques européennes.
Par ailleurs, les dirigeants sont tenus de conserver un nombre important d'actions. J'ai moi-même l'obligation de conserver une fraction importante des actions levées dans le cadre du mécanisme de stock-options, et au total je dois garder un stock de 30 000 actions Société Générale. Mon patrimoine serait donc très directement exposé en cas d'accident sur l'action.
En pratique, en 2009 et en 2010, les mandataires sociaux de la Société Générale n'ont eu ni part variable en espèces ni stock-options. En ce qui me concerne, je suis un dirigeant sans filet de sécurité puisque j'ai appliqué strictement les règles du code AFEP-MEDEF : j'ai démissionné de mon contrat de travail. Je n'ai pas de retraite chapeau – c'est à moi d'épargner pour financer mon complément de retraite. Je pense qu'il serait sain, indépendamment de mon cas personnel, que je retrouve une incitation financières inscrite dans la durée, que ce soit sous forme de stock-options ou d'actions gratuites.
Enfin, vous me demandez mes propositions pour assainir les marchés financiers.
Au-delà de ce que j'ai déjà indiqué, il me paraît important d'avoir une vision exhaustive du sujet. Les banques ne sont pas les seuls acteurs. Enlever des activités aux banques, que l'on sait contrôler, pour qu'elles se déploient ailleurs ne me paraît pas être le meilleur moyen de renforcer la sécurité du système. Si l'on retient cette logique, il faut au moins faire en sorte que l'univers qui se développe hors des banques soit un peu contrôlé.
En ce qui concerne les banques, la réglementation qui se met en place est, je l'ai dit, extrêmement contraignante. Elle conduit la Société Générale à de profondes transformations, comme toutes les banques européennes. Il ne faut pas aller trop loin pour ne pas trop peser sur leur capacité à financer l'économie et pour ne pas aboutir, paradoxalement, à les pénaliser davantage alors que l'Europe s'en est mieux sortie que les États-Unis. Une stabilisation de la réglementation est en tout cas souhaitable, afin de redonner aux banques la visibilité nécessaire.
Enfin, il faut traiter le sujet des plates-formes de compensation et des mécanismes de transparence sur les transactions. La question prioritaire est celle des CDS, mais on peut s'intéresser aux swaps et à d'autres instruments. Encore une fois, il ne faut pas s'occuper seulement des banques.
Je ne partage pas ce point de vue parce que ce type de CDS peut servir. Imaginez que nous souhaitions aider une entreprise française à construire un pont dans un pays lointain. L'opération nous expose à trois types de risque : un risque d'exécution – il faut savoir construire le pont – ; un risque d'exploitation – il faut que le projet soit rentable – ; enfin, le risque attaché au pays. Il peut nous être utile de conclure un CDS sur le pays concerné pour nous protéger de ce troisième risque et de lui seul. Mais ce CDS va-t-il être qualifié de nu ? Je doute que le régulateur puisse distinguer les CDS vraiment nus des autres. Le CDS peut ne pas être corrélé directement à un actif sous-jacent, mais être néanmoins parfaitement légitime.
Les CDS ne sont pas à l'origine de la crise grecque. Dans le cas de la dette privée, le volume des CDS est très supérieur au crédit, mais pour la dette publique, c'est l'inverse.
J'avais plutôt en tête une fourchette de 20 à 30 milliards de CDS. Le CDS est le symptôme d'une crainte sur un segment de marché. Dans le cas de la Grèce, il y a eu de vraies craintes quant à la capacité du pays à rembourser.

La crise a provoqué une série de propositions en matière de régulation. Considérez-vous qu'elles vont à l'essentiel, ou bien qu'il faudrait s'intéresser à certaines autres ? Je pense notamment à ce que vous avez dit sur les contrats bilatéraux, en évoquant la possibilité de constituer plutôt des places permettant d'identifier les intervenants.
Avez-vous le sentiment que l'on s'achemine, au niveau mondial, vers une régulation différenciée, aboutissant à fausser, au détriment de l'Europe, la concurrence avec les États-Unis ou la Chine ?
Enfin, qu'attendez-vous du G20 et de la présidence française ?
En matière de régulation européenne, un compromis a été trouvé, des chantiers ont été lancés. Sans aller jusqu'à la création d'un régulateur européen, on améliore la coordination entre régulateurs nationaux et l'anticipation du risque systémique.
En ce qui concerne le secteur bancaire, le chantier est très avancé. Il reste à traiter le cas des institutions dites « systémiques ». À nos yeux, la crise a clairement montré qu'on ne peut pas lier taille et risque : certaines grandes banques ont très bien résisté. Il ne faudrait donc pas « surtaxer » les grandes banques en termes de capital. L'Europe a besoin de banques puissantes, capables d'accompagner ses entreprises. Si pour un projet en Chine, en Afrique ou en Amérique latine, une entreprise européenne se trouve en concurrence avec une entreprise américaine, une banque américaine aura tendance à privilégier la seconde, pour des questions d'intérêts ; pour la compétitivité future des entreprises européennes, il faut donc un secteur financier fort en Europe. Réduire à néant les avantages – en termes d'économies d'échelle et de sécurité des contrôles, notamment – que procure la taille, en imposant des exigences supplémentaires en capital, risque fort de conduire à une fragmentation du secteur bancaire européen et d'avoir des conséquences négatives.
La liquidité est elle aussi un enjeu clé. Permettez-moi de démentir l'idée fausse, mais pourtant largement répandue dans la presse, que nous empruntons à la Banque centrale à 1 % à 3 mois pour financer des prêts immobiliers à quinze ans ou des prêts aux entreprises à cinq ans : c'est une absurdité. Pour accorder ces prêts, nous avons besoin de ressources longues – dépôts, parce qu'ils sont stables, et emprunts pour une durée de trois à sept ans que nous contractons sur le marché et qui coûtent, croyez-moi, autrement plus cher. Une banque comme Northern Rock a fait faillite non pour un problème de capital, mais parce qu'elle finançait des prêts immobiliers avec des ressources à trois mois : en cas de crise, quand arrive l'échéance, les investisseurs ne veulent plus prêter – et c'est la faillite. Tout l'enjeu de la liquidité est l'équilibre entre la durée des prêts et celle des ressources. Mais il ne faut pas aller trop loin dans la contrainte, faute de quoi, en obligeant les banques à se procurer des ressources très longues et très chères, on les dissuadera de prêter. D'ores et déjà, ce qui a été décidé va changer le paysage et les pratiques bancaires.
En matière de rémunérations des opérateurs de marché, le G20 a fixé des règles et la Commission européenne aussi. La réglementation des hedge funds vient d'être votée à Bruxelles.
S'agissant enfin de la constitution de chambres de compensation, nous progressons. Les Américains sont en avance parce qu'ils avaient déjà des plate-formes avec des outils informatiques disponibles. L'Europe doit se montrer capable de se doter de ce type de plate-forme, avec une sécurité suffisante, assurée probablement in fine par la Banque centrale européenne.
Si l'on va jusqu'au bout de la démarche, on aura, en très peu de temps, bouleversé la réglementation. Il serait alors sain de faire le bilan après deux ans d'application, pour éventuellement compléter ou amender le dispositif.
La concurrence entre banques, que vous évoquiez dans votre deuxième question, est un sujet fondamental. Aujourd'hui, dans les dix principales banques mondiales, vous trouvez trois banques chinoises et une banque brésilienne. Dans dix ans, vous aurez probablement encore plus de banques chinoises, peut-être deux banques brésiliennes, et il n'est pas impossible qu'il y ait une banque russe. L'Europe bancaire sera ce que sera l'Europe : je suis partisan, en tant que citoyen, d'une plus grande intégration européenne car c'est à mes yeux la seule façon pour l'Europe de peser politiquement et économiquement ; et si l'Europe va vers plus d'intégration, on devrait aller aussi vers une plus grande intégration bancaire. À l'inverse, si l'Europe se fragmente, on n'assistera sans doute pas à un mouvement de consolidation car la banque restera un outil de souveraineté nationale. La manière dont la nouvelle régulation sera appliquée peut éventuellement compliquer encore la position des banques européennes.
Aux États-Unis, la réforme adoptée est très ambitieuse mais il demeure des interrogations sur l'application des accords de Bâle III, au vu de certaines incohérences entre les textes. Peut-être, pourrait-on conditionner l'application de ces règles en Europe à l'assurance d'une réciprocité ? Quant aux pays émergents, ils sont dans des logiques très variées et, pour le moment, voient tout cela d'assez loin. La réglementation chinoise est assez spécifique. De toute façon, les marchés des pays émergents sont peu accessibles aux banques étrangères, et les banques chinoises, sollicitées par la croissance de leur pays, ne sont pas pour le moment dans une logique de développement international poussé – la question pourrait se poser ultérieurement.
Je le répète, il faut cesser de stigmatiser les banques. D'une part, la crise ne peut être résumée à une crise bancaire. D'autre part, une industrie bancaire solide est une force pour la compétitivité d'un pays.
Enfin, pour répondre à votre dernière question, sur le G20 et la présidence française j'en attends principalement deux choses. Tout d'abord, que les règles bancaires soient stabilisées, afin que nous puissions nous y adapter : il n'est pas bon de rester dans l'incertitude. Ensuite, que l'on parvienne aussi à régler la question des changes : la valeur de l'euro par rapport au dollar et par rapport aux monnaies asiatiques sera décisive dans la croissance à venir. Il ne faut pas que nous soyons pénalisés par un euro trop fort, et il ne faut pas qu'il y ait trop de volatilité, ingérable pour les entreprises. Tout ce qui ira dans le sens d'une meilleure coordination des politiques des banques centrales sera donc bienvenu. Les autres sujets sont la mise en oeuvre des réglementations et la définition d'une stratégie de développement pour chacun des pays.

Vous avez raison de lier la spéculation à la liquidité, qui est la condition de son développement. C'est l'excès de liquidité qui provoque les bulles spéculatives. Or les États-Unis se lancent dans une seconde vague de quantitative easing. La Fed va créer 1 000 milliards de dollars en achetant des bons du Trésor américain à long terme, en vertu de la théorie du portefeuille, selon laquelle cela va nécessairement entraîner une réallocation des portefeuilles au profit d'obligations à long terme ou d'actions ; mais cette théorie, si intéressante qu'elle soit, ne se vérifie jamais complètement.
S'agissant du financement d'emplois longs par des ressources courtes, on connaît le cas d'AIG, dont la filiale d'activités sur dérivés refinançait des encours à dix ans au jour le jour : le désastre se compte en centaines de milliards de dollars. Quant à Freddie Mac et Fannie Mae, le rapport de la Federal Housing Finance Agency conclut qu'après avoir reçu 148 milliards de dollars du Trésor public, il leur faudra encore entre 221 à 363 milliards de dollars. Autrement dit, ces deux organismes publics, audités par le Congrès des États-Unis, vont coûter au total au moins 500 milliards de dollars aux contribuables américains !
En ce qui concerne les ratios, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est une banque. En France, nous avons une loi bancaire qui, en schématisant, prévoit que si l'on prête de l'argent on est une banque. Aux États-Unis, les banks ne sont pas forcément des banques : une grande partie d'entre elles dont l'activité les conduirait, en France, à être condamnées pour exercice illégal de la profession de banquier, brassent des centaines de milliards de dollars sans que personne ne dise rien. Le Comité de Bâle fixe de nouveaux ratios extrêmement exigeants, pleinement satisfaisants, qui vous obligeront soit à augmenter votre capital – et donc à répondre aux exigences des actionnaires –, soit à restreindre vos crédits. Mais si on n'applique pas les mêmes règles aux États-Unis, et si l'Europe continue à réglementer les banques sans se préoccuper de ce qui se fait en dehors d'elles – et qui tient d'ailleurs une place beaucoup plus importante hors d'Europe –, son action n'aura abouti qu'à punir les plus vertueux et à encourager ceux qui le sont le moins ! En Europe en général, et en France en particulier, nous ne nous défendons pas assez. Il faut dire aux Français que parce qu'ils ont voulu réglementer les banques, ils auront moins de crédit ou un crédit plus cher, sans avoir pour autant enrayé la spéculation – car une masse de liquidités qui ne s'emploie pas dans l'inflation alimente nécessairement la spéculation.
Restons optimistes, c'est la condition pour agir. Néanmoins, je partage votre avis. En Europe, les banques financent les trois quarts de l'économie et le développement des marchés est assez limité ; si bien que ce qui affecte les banques en Europe a davantage d'impact sur l'économie réelle qu'aux États-Unis, où la proportion est inverse.
Quelques précisions supplémentaires sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas aller trop loin sur les exigences de capital.
À la Société Générale, nous avons dit à nos actionnaires que nous avions devant nous trois ou quatre années de discipline financière très rigoureuse, pendant lesquelles nous allions mettre en réserve l'essentiel de notre résultat, pour respecter les rendez-vous réglementaires ; nous allons distribuer un tiers du résultat, mais en proposant à nos actionnaires un paiement en actions. Dans la plupart des secteurs économiques, les actionnaires attendent du capital investi un rendement de 13 % à 15 %. Nous sommes tous d'accord pour augmenter le capital sur les activités de marché ; mais faut-il exiger beaucoup plus de capital, par exemple, pour financer les prêts immobiliers en France ? En Suisse, le régulateur a imposé 10 % de core tier one à deux grandes banques, qui sont avant tout des banques d'investissement et qui prêtent très peu en Suisse, où les besoins sont faibles. Appliquer la même règle aux bilans des banques françaises, alors qu'il y a une concentration, à hauteur de 50 à 80 %, sur le financement de l'économie française – à travers des prêts aux PME, des prêts immobiliers ou l'accompagnement des grandes entreprises à l'international – n'a pas de sens ; le risque constaté à l'occasion de la crise ne le justifie en aucune manière.
Nous sommes d'accord pour renforcer le système, mais si l'on va trop loin, nous serons bien obligés, pour nous adapter aux nouvelles règles, soit de prêter moins, soit de prêter plus cher – les deux pouvant être combinés.
Permettez-moi de profiter de ma présence devant vous pour évoquer la question du livret A. Le nerf de la guerre, pour nous, ce sont les ressources longues et le livret A en fait partie. À ma connaissance, aujourd'hui la Caisse des dépôts connaît plutôt un excès de liquidités. L'idée d'immobiliser des liquidités là où elles abondent, au détriment des banques qui en ont besoin pour financer l'économie, me paraît contre-productive. Nos prêts à l'économie française progressent de 4,9 % à fin septembre et il est utile d'avoir des dépôts pour y parvenir. Je souhaitais faire passer le message.

Comment, alors que la croissance est faible, peut-on exiger un rendement du capital compris entre 13 et 15 % ?
Pour calculer le taux de rendement attendu par les actionnaires, on part du taux sans risque – aujourd'hui 2 ou 2,5 %, mais il devrait augmenter – ; on ajoute la prime de risque attachée à l'investissement en actions – 4 à 4,5 % au moins – ; on multiplie par un facteur β, représentant le risque spécifique d'une activité par rapport à l'ensemble du marché. On aboutit ainsi au rendement minimum de 10 à 12 % pour les activités bancaires ; les actionnaires attendent généralement un peu plus.
Nous avons parfaitement intégré que le monde bancaire serait nettement moins rentable demain qu'hier. Les rendements pouvaient atteindre 18 à 20 %. Désormais, on attend entre 12 % et 15 % selon les modèles. Mais si nous descendions trop bas, nous aurions des problèmes avec nos actionnaires.

Le changement d'époque est réel. D'une part, on a découvert que les grandes banques étaient mortelles, ce que personne n'imaginait il y a dix ans – l'affaire du Crédit Lyonnais n'était qu'un épiphénomène. D'autre part, on s'était habitué à une croissance, sur longue période, de la valeur des actions ; ce que l'on ne récoltait pas des résultats de l'entreprise, on l'obtenait en plus-value sur le cours – le CAC est allé jusqu'à frôler les 7 000 points, alors que nous sommes aujourd'hui en dessous de 4 000 points.
Au-delà des questions de concurrence avec les autres systèmes bancaires, on a le sentiment que l'Europe est sérieuse, la France en particulier, mais que les États-Unis le sont moins – les pays émergents, quant à eux, étant en général prêteurs et moins exposés au risque d'illiquidité du système bancaire, véritable déclencheur de la crise. Pour l'adoption des règles de Bâle III, leur mise en oeuvre et la surveillance de leur application, les États-Unis n'ont pas encore fait leur révolution culturelle. De fait, l'Europe a toujours régulé, de manière plus ou moins efficace, tandis que les États-Unis s'en sont plutôt gardés – et on m'a dit, à propos des défaillances d'organismes faisant des CDS, que parfois le rapport entre le capital et le risque pris était de 1 à 1 000…
Je vous ai trouvé plutôt confiant à propos des échanges de gré à gré, pour lesquels vous faites état de réels progrès dans la surveillance. Il me semble que nous sommes encore loin du compte et que, faute de règles, l'emballement peut reprendre à tout moment. Je m'étonne que les pays européens et leurs banques ne disent pas plus fort que l'on n'est pas sorti de ce monde extrêmement dangereux qui a provoqué une déflagration et qui coûte des centaines de milliards aux États, donc aux contribuables. Est-on suffisamment alarmiste dans le discours ? Les intérêts de votre entreprise sont en jeu, l'intérêt collectif l'est aussi.
Enfin, si l'Europe se dotait de règles véritablement harmonisées, pensez-vous qu'elle parviendrait à convaincre le reste du monde de la suivre dans son comportement vertueux ?

Il est à souhaiter que les choses évoluent dans le bon sens en matière de régulation, même si l'on a l'impression que, comme d'habitude, les Européens veulent être « les meilleurs », ce qui peut nuire à la compétitivité de leur secteur bancaire.
La crise a aussi été l'occasion de s'interroger sur le rôle des paradis fiscaux. S'ils subsistent en l'état, c'est-à-dire en tant que zones de non droit – par lesquelles transite une grande partie de la finance mondiale, hors de toute régulation –, les efforts dont nous parlons auront-ils encore un sens ? En ce qui la concerne, la Société Générale a-t-elle des liens avec les paradis fiscaux ?
Monsieur Goulard, je me suis sans doute mal exprimé. Les États-Unis affichent aujourd'hui leur volonté politique que les instruments du type CDS s'échangent sur des plates-formes. Techniquement, ces plates-formes existent déjà ; nous verrons si les actes sont conformes aux déclarations.
En ce qui concerne la nécessité de se faire entendre, je considère qu'en France le dialogue fonctionne bien entre le Gouvernement, le régulateur et les banques sur les enjeux de compétitivité, lesquels me paraissent très bien compris par le pouvoir politique. Faut-il que nous fassions plus ? Je ne sais pas, mais ces sujets sont régulièrement abordés dans les enceintes professionnelles. Une des difficultés vient de ce que, parmi les Vingt-sept, très peu de pays ont des banques très actives dans les grands métiers internationaux – la Grande-Bretagne, la France et, dans une moindre mesure, l'Espagne et l'Italie.
Pour répondre à votre dernière question – mais vous êtes beaucoup mieux placés que moi pour juger –, il me semble que, dans une période de contraintes et de croissance limitée, chacun se détermine en fonction de ses propres intérêts ; je ne suis pas sûr qu'il suffise de donner l'exemple pour entraîner les autres.
Enfin, je ne pense pas que les paradis fiscaux aient joué un rôle significatif dans la crise, au vu des masses qui ont été en jeu ; ils ne sont pas pour grand-chose dans ce qui s'est passé sur le marché des subprimes, en Irlande, ou encore en Espagne. En revanche, il me paraît parfaitement légitime de développer une logique de contrôle et de justice fiscale. Sachez que depuis dix-huit mois, nous nous sommes clairement engagés à mettre fin à nos activités dans ces zones, et nous respectons cet engagement.

Monsieur le président, merci pour vos explications et pour l'éclairage que vous nous avez apporté.
L'audition s'achève à 18 h 40.