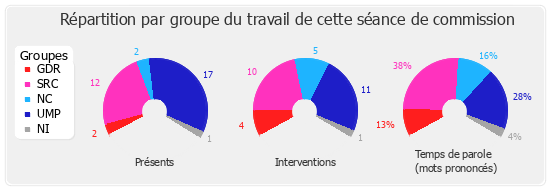Commission des affaires étrangères
Séance du 14 septembre 2010 à 16h15
La séance
Audition de M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l'actualité internationale (Proche-Orient ; Afghanistan ; Iran)
La séance est ouverte à seize heures quinze.

Je vous prie d'excuser l'absence du président Poniatowski, qui est en déplacement officiel au Mexique pour assister aux cérémonies du bicentenaire de l'indépendance.
Nous avons le plaisir de recevoir M. le ministre des affaires étrangères, avec qui nous aborderons successivement trois thèmes : la reprise des pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens ; la situation en Afghanistan, où, dans quelques jours, doivent se dérouler des élections législatives, et où notre présence fait l'objet d'interrogations ; la situation en Iran, enfin, où le sort épouvantable de Mme Sakineh Mohammadi Ashtiani ne doit nous faire perdre de vue ni le durcissement du régime ni le dossier du nucléaire.
Un temps sera ensuite réservé pour les collègues qui souhaiteraient poser des questions sur d'autres sujets.
Après les pourparlers indirects de ces dernières semaines, des pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens se sont engagés le 3 septembre à Washington. En ce moment même, une deuxième séance de pourparlers indirects a lieu à Charm-el-Cheikh. Les ministres des affaires étrangères européens devaient se rendre dans la région le 3 septembre pour tenter d'obtenir des concessions, mais M. Netanyahu et M. Abou Mazen se trouvant alors à Washington auprès de Mme Clinton, cette visite n'a pu avoir lieu.
La situation générale n'a guère évolué ; la question de la poursuite du gel des implantations reste posée. Les Israéliens continueront-ils, après le 26 septembre, de geler les colonisations ? S'ils les reprennent, dans quels secteurs le feront-ils ? Les Palestiniens ont déclaré qu'en cas de reprise des implantations, ils quitteraient les pourparlers directs.

Le dossier est sensible, beaucoup d'espoirs ayant été déçus. Quel est votre sentiment, monsieur le ministre ? La France joue un rôle, même s'il est indirect. Mon principal souci concerne Gaza, devenue, selon l'expression d'Hervé de Charette, une « prison à ciel ouvert » : ce territoire, dont dépend à mon avis la solution du conflit israélo-palestinien, fait-il partie de la négociation, ou celle-ci se limite-t-elle à la colonisation en Cisjordanie ? La construction du mur s'est-elle arrêtée ? Dernière question : qu'en est-il du prisonnier israélien Gilad Shalit et des prisonniers palestiniens ?

L'Europe pourrait jouer un rôle important, notamment en matière d'éducation : qu'en est-il ?

Les États-Unis ont manifestement repris la main. Lors de notre visite à Jérusalem et à Ramallah dans le cadre d'une mission sur la Turquie, les responsables ont d'ailleurs souligné le manque de réactivité de l'Europe.
Que vous inspire le référendum qui s'est tenu en Turquie dimanche dernier, eu égard, notamment, au rôle que ce pays entend jouer dans les négociations au Proche-Orient ?

Pour engager de véritables négociations, le gel complet des colonies en Cisjordanie aurait été indispensable. Je suis très dubitatif sur le rôle de la France, surtout quand les États-Unis sont le chef d'orchestre. Enfin, je suis scandalisé par la situation à Gaza et le peu que nous y faisons.
Les yeux dans les yeux, monsieur le ministre, y croyez-vous ? Moi, je n'y crois plus.

Votre porte-parole, monsieur le ministre, a fait une déclaration un peu sibylline au sujet du résultat du référendum turc, indiquant que le Gouvernement français en avait « pris note ».
La réforme constitutionnelle qui en découlera bouleversera l'équilibre des pouvoirs en Turquie. Y a-t-il vraiment lieu de s'en réjouir ? Derrière le formalisme des avancées démocratiques, cette réforme affaiblira les composantes qui, jusqu'à présent, garantissaient la nature laïque du régime, sans toucher à la barrière « anti-kurde » des 10 % aux élections législatives.

Quelles sont les chances de succès d'un accord entre une autorité palestinienne affaiblie et un gouvernement israélien disparate ? Que vaut un accord non validé par le Hamas, lequel gouverne Gaza et progresse de façon inquiétante en Cisjordanie ?

L'Union européenne et la France n'ont pas été associées aux pourparlers. Quelle est donc la place des diplomaties française et européenne ? Le sommet de l'Union pour la Méditerranée, prévu fin novembre à Barcelone, peut-il être l'occasion pour elles de revenir sur la scène internationale ? Des initiatives vont-elles être prises ?

En juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté des résolutions au sujet du nucléaire en Iran, où l'AIEA est interdite de séjour. Comment le Gouvernement français peut-il les faire respecter et plus généralement faire appliquer les résolutions des Nations unies ?
Il est un peu tôt pour parler de déception, monsieur Rochebloine. Pour vous livrer mon sentiment profond, j'espère un succès même si les espoirs sont minces. Cela dit chacun se félicite de la reprise des pourparlers directs, et fera tout pour qu'ils soient fructueux.
J'espère d'abord que ces pourparlers iront plus loin que ceux de Charm-el-Cheikh, ce qui n'est pas sûr. On peut imaginer que le gel soit maintenu dans la plus grande partie des territoires occupés mais pas dans certaines zones limitées. Les Palestiniens accepteraient-il cette solution, qui n'a d'ailleurs pas été proposée à ce jour ? Tout cela n'est qu'hypothèse.
J'ai été le premier à déplorer l'absence de l'Union européenne à Washington, et les 27 ministres des affaires étrangères l'ont fait après moi. Comment espérer que l'Europe participe au processus de paix si elle n'est pas représentée ? Je n'y insisterai pas, mais c'est un mauvais signe, même si nous sommes tenus informés par M. George Mitchell.
Cette situation est d'autant plus regrettable que la Conférence de Paris pour l'État palestinien avait été un succès ; l'argent que nous avons récolté a été fort bien utilisé par M. Salam Fayyad, Premier ministre palestinien. Il était question d'une deuxième conférence ; nous verrons bien. Mais je le dis sans acrimonie : nous ne pouvons être seulement des bailleurs de fonds ; nous devons aussi peser politiquement.
Quant à Gaza, les tunnels sont de plus en plus nombreux. Les trafics, qui sont d'une certaine façon payés par la communauté internationale, sont importants. Il serait faux de dire que l'on meurt de faim à Gaza : environ 400 camions entrent chaque jour du côté israélien. Au terminal de Rafah ne passent que les personnes.
L'autorité palestinienne elle-même, il faut le rappeler, refuse de parler avec le Hamas, avec lequel nos contacts ne peuvent donc être qu'indirects : nous ne pouvons être plus royalistes que le roi ! Aussi bien l'autorité palestinienne représente théoriquement l'ensemble du peuple palestinien, Hamas inclus. Ce dernier n'a par ailleurs pas montré beaucoup de signes encourageants.
Une évolution favorable est-elle possible dans les prochains jours ? Je l'espère, mais je l'ignore.
La négociation au sujet de Gilad Shalit, qui interviendrait peut-être après la libération de deux groupes de prisonniers palestiniens, dont l'un du Hamas, n'a pas progressé. Nous faisons tous nos efforts en faveur de Salah Hamouri, et entretenons le contact avec sa famille, comme avec celle de Gilad Shalit.
Madame Fort, les Égyptiens, qui se sont arrêtés à Paris sur la route de Washington, ont manifesté leur souhait de nous inviter à Charm-el-Cheikh ; mais ils n'ont apparemment pas pu le faire. Néanmoins c'est à Mme Ashton, Haute représentante aux affaires étrangères de l'Union, qu'il revenait d'être présente aux pourparlers, même si les pays européens qui pèsent davantage auraient pu être invités. Les Américains n'ont pas voulu choisir : ils n'ont invité personne. Je le regrette sincèrement.
Vous m'avez demandé, monsieur Kucheida, si j'y croyais. J'ai le sentiment que c'est la dernière chance et qu'Israël ne devrait pas la négliger. Mais nul ne peut prévoir l'issue des négociations à ce stade.
Afin de ne pas entraver les pourparlers directs, le sommet prévu à Barcelone entre les ministres des affaires étrangères, monsieur Bascou, n'est plus à l'ordre du jour : seul celui de l'UPM du 23 novembre l'est encore, s'il y a des avancées.
J'en viens à la Turquie. La participation au référendum a été élevée et le résultat très positif pour l'AKP, parti de M. Erdogan. La France est évidemment favorable à toute avancée démocratique. Le parti qui fut autrefois islamique était peu satisfait de l'équilibre des pouvoirs, et la place de l'armée, garante historique de la laïcité mais accusée de corruption, a été battue en brèche. La réforme doit maintenant être mise en oeuvre et les pouvoirs doivent trouver un juste équilibre.
Devait-on par ailleurs s'attendre, après l'épisode douloureux de la flottille, à une rupture des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie ? Je ne le crois pas. Au demeurant l'influence réelle de la diplomatie turque ne se mesure pas à ses succès – car elle s'est attaquée à des problèmes particulièrement difficiles –, mais à la grande pugnacité de ses entreprises, de l'Afghanistan aux Balkans et du Moyen-Orient à l'Afrique. En termes de personnel, la diplomatie turque, en pleine expansion, est désormais l'égale de celle de l'Espagne, et mon homologue, M. Davutoglu, se montre très actif.
Il est difficile, monsieur Mathus, d'envisager un accord sans le Hamas, c'est-à-dire sans l'ensemble du peuple palestinien. Mais comment voulez-vous que la communauté internationale impose aux deux parties ce qu'elles rejettent toutes deux, d'autant que l'Égypte refuse elle aussi tout dialogue avec le Hamas ? Mais un accord serait soumis à un référendum auquel participeraient tous les Palestiniens.
Le service diplomatique européen est encore balbutiant…
…mais il ne doit pas constituer une vingt-huitième diplomatie. Mieux doté que chacune des diplomaties nationales, il devra faire entendre une réelle voix politique.
L'AIEA, monsieur Destot, n'est pas interdite de séjour en Iran, même si certains de ses inspecteurs n'ont pas été autorisés à y entrer au cours de ces derniers jours, ce qui est très inquiétant. Elle doit en effet pouvoir contrôler la centrale de Bousher, actuellement surveillée par la Russie. En gros, l'Iran a enrichi 2 800 kg d'uranium à 3,5 % et 22 kg à 20 %.

S'agissant du Moyen Orient, on ne peut qu'approuver les positions gouvernementales que vous avez exprimées, monsieur le ministre. Faut-il néanmoins continuer de se lamenter sur le rôle médiocre de l'Europe et le mépris aimable des Américains ? Le moment n'est-il pas venu de reconsidérer la politique française dans cette partie du monde, aussi bien à l'égard des Israéliens que des Palestiniens ? Après tant d'échecs, l'Europe ne devrait-elle pas retenir son carnet de chèques et s'interroger sur ses positions ?

Nous n'attendons pas seulement, monsieur le ministre, une description de la situation, mais aussi de l'action ; or, les diplomaties française et européenne paraissent aux abonnés absents. Il faut agir et peser ! L'épisode de la flottille a été l'occasion d'un appel aux gouvernants et aux peuples pour qu'ils boycottent les produits israéliens : une députée palestinienne à la Knesset nous a expliqué, à la Fête de L'Humanité, l'utilité de ce type d'action.
Monsieur de Charette, vous avez fait la navette entre les parties pour oeuvrer à la paix : vous n'allez pas vous arrêter en si bonne voie !
Que pourrions-nous changer ? M. Lecoq nous reproche l'immobilisme. Le coup des peuples, je l'entends souvent ! Mais ils sont face à face, et les partisans de la paix semblent des deux côtés moins nombreux ou moins visibles, comme s'ils étaient résignés. On voit en revanche de plus en plus de partisans d'un État binational : nous en avons rencontrés.
Par ailleurs nous parlons désormais à la Syrie…
…et Israël a changé d'optique sur la position française. Quant à la Palestine, bien qu'elle n'ait pas d'État, nous nous y sentons chez nous. Nous avons de grands projets industriels, y compris dans la zone de Bethléem, et la conférence de l'industrie privée palestinienne, avec 3 000 participants, a été un succès. Il est de bon ton de dire que le ministère n'en fait pas assez ; mais il en fait beaucoup plus que naguère, même si ce n'est jamais suffisant. J'ajoute que le seul centre culturel ouvert à Gaza est celui de la France, et que beaucoup de médecins français y travaillent.
Nous avons négocié pour acheminer les matériaux nécessaires, et nous y oeuvrons avec les Qataris. Nous fournissons le matériel médical.
Qui en fait plus que nous ? Personne.

Je ne vous reproche pas d'être inactif, monsieur le ministre. Je pense seulement qu'il faut reconsidérer les positions européennes.
J'en accepte l'idée ; mais faut-il pour autant s'agiter aujourd'hui au prétexte que nous ne participons pas aux négociations ? L'Union européenne, qui est de loin la première donatrice, ne doit pas être seulement un tiroir-caisse : je l'ai dit et répété, au risque de sembler discourtois car nous ne donnons bien sûr jamais assez.
Quant au Quartet – il était représenté par Tony Blair que l'on a pris pour un Européen, mais la Russie n'était guère ravie, elle non plus, de n'être pas invitée à Washington.
La France pèse d'un grand poids diplomatique et politique – comme en témoignent les discours de la Knesset et de Ramallah –, mais elle ne peut agir sans l'Union européenne.

Ne s'accommode-t-on pas, du côté israélien comme du côté palestinien, d'un conflit de basse intensité qui permet de tenir les troupes ?
Cette réflexion n'est ni inutile, ni isolée ; mais elle n'est guère efficiente : que faire, une fois que l'on a dit cela ? Voyez ce livre que je viens de terminer, Voyage d'un Européen à travers le XXe siècle du journaliste hollandais Geert Mak : les Européens ont mis soixante ans à construire l'Europe. Tout cela est très long. La tentation de changer de position sur le Moyen-Orient existe ; mais qu'adviendrait-il si les Européens le faisaient ?
Il n'est pas d'un spécialiste, et la critique n'est guère constructive. Certes, les Américains négocient sans nous. Mais que faire ?

Puisque nous parlons de livres, je vous conseille la monumentale Question de Palestine d'Henry Laurens, dont la publication se poursuit chez Fayard.

Depuis que vous êtes ministre des affaires étrangères, monsieur Kouchner, vous n'avez eu, paraît-il, aucun entretien en tête-à-tête avec l'ambassadeur d'Iran en France. Notre ambassadeur à Téhéran est traité de la même façon. Vous n'êtes pas là pour parler dans le vent mais pour agir. Ne croyez-vous pas qu'il serait utile qu'un membre du Gouvernement s'entretienne directement avec le Gouvernement iranien de cette femme menacée de lapidation ou d'autres sujets ?
J'ai déjà rencontré M. Velayati, M. Larijani et M. Mottaki, ministre des affaires étrangères. Certes, la France n'entretient plus, pour l'instant, de contact diplomatique avec M. Ahmadinejad. Mais nous avons des échanges fréquents avec les Iraniens.
Le Guide. Sauver Mme Sakineh Mohammadi Ashtiani de la lapidation est un devoir. Si nous y parvenons, nous débloquerons grandement nos relations avec les Iraniens qui, j'en suis sûr, sont sensibles à la pression mondiale. J'ai reçu l'avocat de cette femme, M. Mohammad Mostafaei, actuellement réfugié en Norvège. Selon lui, qui a sauvé de la lapidation huit condamnées, l'opinion internationale a un grand poids. J'espère d'ailleurs faire condamner cette pratique par les 27 ministres des affaires étrangères de l'Union. Je rappelle qu'une femme est récemment morte lapidée en Afghanistan.
La lapidation de Mme Sakineh Mohammadi Ashtiani est-elle seulement différée ? Un autre procès aura-t-il lieu ? Nous ne le savons pas très bien. Bref, les banderoles et les manifestations ne suffisent pas, mais elles ont aussi leur importance.

Qu'en est-il du programme nucléaire iranien et des éventuelles sanctions ? Où en sont les relations économiques du groupe Total avec l'Iran ?

En évoquant Mme Sakineh Mohammadi Ashtiani, M. le ministre a fait la transition avec l'Afghanistan. Comment concevoir nos relations avec le Gouvernement de ce pays ? Pourquoi notre réaction à la lapidation d'une femme afghane n'est-elle pas aussi forte ?
En Afghanistan, c'est une justice tribale qui a condamné, pas le Gouvernement ! La Constitution afghane respecte les droits de la femme : la communauté internationale y tient beaucoup.
Quant à Total, il a cessé ses investissements en Iran il y a deux ans, et ne joue plus aucun rôle d'intermédiaire. Les importations européennes de produits raffinés en provenance d'Iran ont diminué de 40 %. Les exportations de voitures de Corée du Sud ont elles aussi cessé.
Mais le jour où les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ont déposé la résolution contre l'Iran, le Brésil et la Turquie ont signé un accord avec les Iraniens : c'est là un signe majeur que des grands pays tels que l'Inde, la Chine ou le Brésil ne se reconnaissent plus dans le partage du monde traditionnel.

Il y a quelque temps, un général français a critiqué la stratégie américaine, tandis que naissait, aux États-Unis, une tension entre le pouvoir exécutif et l'armée. Rappelons que l'engagement en Afghanistan visait à réduire le pouvoir des talibans et, ce faisant, à lutter contre le terrorisme international. Or, on a le sentiment d'un enlisement. Récemment, une enquête a révélé que les aides internationales ne faisaient que renforcer le pouvoir des talibans et alimenter leur trésor de guerre. Quelle stratégie la France poursuit-elle ? Celle-ci a évolué depuis le début de notre engagement ?

Que pensez-vous de la stratégie américaine de contre-insurrection ? Quelles sont les implications politiques du changement de commandement à la tête des troupes américaines et les incidences sur la présence actuelle et future de nos troupes ?

À quand le retrait de nos troupes ? Quid de la situation au Pakistan, qui est directement liée ? Quel est l'impact politique, notamment au regard du renforcement de l'idéologie talibane, de l'insuffisante présence des Occidentaux dans la catastrophe naturelle que ce pays a connue ? Quelle action engager pour y remédier ?

Les élections législatives prévues prochainement en Afghanistan pourront-elles avoir lieu ?

La guerre pourrait s'arrêter si l'on tarissait les ressources des talibans. Avec l'argent de l'opium – qui représente 10 à 15 % des revenus des talibans, selon un rapport publié à la fin de 2009 par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime –, le racket est une grande source de leur enrichissement. Que pouvons-nous faire contre ces phénomènes ?

Depuis que nous avons mis les pieds en Afghanistan, la situation n'a jamais cessé d'empirer : auparavant, seul le Sud était gangrené ; aujourd'hui, même les provinces du Nord le sont. La politique menée dans ce pays, où l'on n'a jamais produit autant d'opium que l'an dernier, est un échec total. Il est donc urgent que nous partions.
Par ailleurs, qu'en est-il de nos deux compatriotes journalistes retenus en otage par les talibans ?

Les perspectives en Afghanistan ne peuvent être séparées des choix que nous avons faits, choix qu'il faut au besoin remettre en cause.
Le haut commandement militaire français a décrit une situation ingérable. Aux États-Unis, du vice-président Joe Biden à Robert Gates, en passant par le général Rodriguez, les propos sont tout aussi alarmistes.
Notre assemblée a eu deux débats sur ces questions : le premier portait sur l'engagement de troupes supplémentaires ; François Hollande en avait alors posé les limites et les conditions. Qu'en est-il ?
Le second débat portait sur la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Laurent Fabius avait alors averti qu'il n'y aurait pas de contrepartie et que la France ne serait pas écoutée par les Américains dans la définition des stratégies. Quelle évaluation pouvons-nous faire à cet égard ?
La liste de nos soldats morts s'allonge cruellement. Je veux bien que l'on intervienne pour des raisons essentielles sur des théâtres extérieurs, mais je refuse que l'on expose la vie de nos soldats en pure perte et sans espoir de succès.

La question est simple : quand partons-nous ? Il n'y a aucune solution militaire en Afghanistan ; quant aux solutions politiques, ce sont les Afghans eux-mêmes qui les trouveront. Il faut donc réinvestir l'Afrique et quitter l'Afghanistan.

Les journalistes Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, avec leurs trois accompagnateurs, sont toujours aux mains des talibans. A-t-on des nouvelles de leur état de santé ? Où en est-on ?

Je ferai un constat simple : ni la France ni l'Europe n'ont été conviées aux pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens ; mais en Afghanistan, les troupes françaises et européennes sont bien utiles. Il y a donc deux poids, deux mesures, et l'on a parfois le sentiment de jouer le rôle de supplétifs, d'autant que le mirage de l'OTAN s'est dissipé, la réintégration de la France n'ayant pas modifié la donne.
Quand préparerons-nous les conditions d'un retrait d'Afghanistan ? La France peut le décider seule ; mais pourquoi pas une initiative européenne ?
Je m'associe d'autre part aux questions sur les deux journalistes retenus en otage.
L'aide internationale est-elle un renfort pour les talibans ? C'est tout le problème des aides aux pays en guerre. Les familles doivent-elles supporter, en plus du poids de celle-ci, l'absence de récoltes et de soins ? Je ne le crois pas.
La stratégie de la France, définie lors de la Conférence de Paris – à laquelle furent associés les représentants de la société civile afghane –, repose sur la notion d'afghanisation. À défaut de victoire militaire, nous devons assurer la sécurité afin que l'aide parvienne aux familles, non seulement à Kaboul mais aussi dans les vallées où se trouvent nos soldats.
Je ne puis vous faire d'autre réponse quant à la stratégie : nous ne pouvons pas informer nos ennemis de la date éventuelle de notre retrait ! Nous avons fait beaucoup de progrès : les Afghans le reconnaissent, notamment les femmes.
Rien n'est moins sûr : songeons à l'alphabétisation des enfants et aux hôpitaux, sans parler de la représentation politique des femmes : les élections de la semaine prochaine permettent d'espérer près de 80 députées, soit proportionnellement bien plus qu'en France. Les femmes représentent le courage et l'avenir.
Très longtemps, je l'espère, y compris après notre départ. Quoi qu'il en soit nous ne parions pas sur une illusoire victoire militaire mais sur les changements profonds de la société afghane. « Il n'y aura pas d'élections, M. Karzaï est corrompu », n'a-t-on cessé de nous dire : ces assertions ont été démenties par les faits. Bref, nous souhaitons aider les paysans dans les vallées et confier aussi vite que possible la direction des provinces aux Afghans.
Quant à la stratégie de contre-insurrection du général Petraeus, monsieur Gaymard, elle n'est pas la même qu'en Irak : elle ne revient pas à s'appuyer sur un groupe contre les autres. Les Pachtounes, ethnie dominante chez les talibans, participent à la mosaïque afghane.
Le général Mac Chrystal estimait que les opérations menées à Marjah ou à Kandahar réussiraient si l'armée afghane remplaçait rapidement les troupes alliées, sachant par ailleurs que plusieurs pays européens n'ont pas envoyé de combattants sur le terrain. Soit dit au passage, nul n'imaginait que la conférence sur la stratégie, qui s'est tenue en juin dernier à Kaboul, pourrait avoir lieu. En tout état de cause, après la parution de son article et la juste sanction du Président Obama, le général Mac Chrystal s'est, semble-t-il, montré plus réaliste.
À la Conférence de Londres, le Président Karzaï et Mme Clinton ont évoqué l'échéance de 2011. Certains pays se retireront-ils à cette date ? Ce sera sans doute le cas du Canada et de la Hollande. Mais en dehors du retrait, aucune stratégie alternative n'est proposée. Théoricien de la contre-insurrection et partisan de solutions plus proches du terrain, le général Petraeus est arrivé à la tête des troupes alliées avec l'aura de ses succès en Irak. Or, il envisage désormais surtout des opérations de forces spéciales, lesquelles, hélas, risquent de provoquer des dégâts collatéraux parmi les populations civiles. Cela dit, l'objectif de la stratégie américaine reste identique au nôtre : rendre aussi vite que possible le pouvoir aux Afghans après un retrait des troupes, fût-il partiel – on a parlé de 30 000 hommes. Un retrait complet n'est pas à l'ordre du jour car il signifierait l'abandon de la population afghane. De toute façon, il n'y aura pas de retrait séparé : comme l'a dit le Président de la République, l'engagement doit être commun, même si l'on peut discuter de ses conditions avec nos partenaires européens.
Avez-vous lu, monsieur Lecoq, le récent article de M. Spanta, mon ancien homologue afghan devenu conseiller du Président Karzaï ? Notre ennemi, affirme-t-il, est le Pakistan. Ce n'est un secret pour personne : le mollah Omar est à Quetta, sinon à Karachi. Le Pakistan est donc devenu un abri pour les chefs talibans, et c'est dans l'optique de permettre un retrait rapide des troupes internationales de son pays que le Président Karzaï essaie d'obtenir un accord avec le gouvernement pakistanais.
Cette situation explique en partie la faible mobilisation internationale auprès des populations pakistanaises suite aux événements tragiques de cet été. Quant à la générosité privée, à l'exception de quelques ONG, elle ne s'est guère manifestée. Pourtant, 20 millions de personnes sont toujours sans abri : nous devons les aider.
Pour l'heure, le mollah Omar n'a pas donné beaucoup de suite aux sollicitations du président Karzaï. Mais les partis nationalistes ont déjà répondu : l'interview de Gulbuddin Hekmatyar, parue dans Libération ce matin, n'est guère encourageante. Le jour où a été mise en place, à Kaboul, la commission pour la réconciliation, les talibans ont publié un communiqué indiquant qu'ils tueraient les candidats aux prochaines élections. Je pense que celles-ci auront lieu à la date prévue, mais on peut craindre qu'elles soient extrêmement meurtrières. Il faut donc saluer le courage des hommes et des femmes qui s'y présentent.
Quant au racket, monsieur Remiller, les chiffres que vous avez cités sont sans doute en-dessous de la réalité. Entre 30 et 40 % de l'aide internationale, voire plus, ne parviennent pas sur le terrain.
C'est vrai. Les talibans en profitent aussi indirectement. Il faut s'intéresser au trafic d'opium, non seulement dans les zones surveillées par les Nations unies mais aussi dans celles où l'on cultive désormais le haschich, qui rapporte autant.
La situation militaire est ce qu'elle est, monsieur Kucheida, mais, en termes de niveau de vie, on ne peut pas dire que la situation empire.
Je ne suis pas en train de vous dire que nous avons gagné la guerre mais, du point de vue de l'éducation comme de l'accès aux soins, beaucoup de progrès ont été faits.
Le haut commandement français, monsieur Janquin, n'a pas tenu les propos que vous lui prêtez : il est aux côtés de nos soldats, qui sont aussi courageux qu'inventifs dans leurs contacts avec la population.
Cela dit nous n'enverrons pas de troupes supplémentaires : nous avons tenu, et continuerons à tenir nos engagements en matière de formation des troupes afghanes.
Il y a eu des contreparties sur l'OTAN : le général Abrial, qui en est le numéro 2, définit sa future stratégie, et c'est aussi un Français qui est à la tête du commandement régional de Lisbonne responsable de l'Afrique. Les officiers français sont désormais mieux informés des futures opérations ; bref, nous pesons davantage. Le sommet de Lisbonne sera l'occasion de définir la nouvelle stratégie et d'évoquer les futurs investissements.
Monsieur Myard, nous n'avons pas vocation à rester indéfiniment en Afghanistan.
Vendredi dernier, monsieur Lecou, nous avons rencontré les familles des deux journalistes retenus en otage et leur avons fourni des preuves de vie. Malheureusement, les contacts ont été interrompus par le ramadan : ils doivent reprendre prochainement, et je reste confiant. Je rencontrerai à nouveau les familles dans deux jours.
Il est vrai, monsieur Dufau, que nous n'avons pas été invités aux pourparlers de paix pour le Moyen-Orient et que l'on a par ailleurs demandé aux troupes européennes de s'engager davantage en Afghanistan. Cela dit, si la Conférence de Paris avait permis de mobiliser beaucoup d'argent, nous n'avions pas non plus participé aux pourparlers ayant suivi le processus d'Annapolis, des contacts directs ayant été alors noués entre les parties.
Les échanges entre les ambassadeurs européens à Kaboul sont nombreux : ils l'ont notamment été avec celui de Grande-Bretagne et, si le ton a quelque peu changé, ils devront reprendre car nos deux pays sont, dans l'Union européenne, les plus engagés sur le terrain. Qu'un pilier européen émerge au sein de l'OTAN, et partant une défense européenne, est mon voeu le plus cher.

Monsieur le ministre, c'est vous qui soumettez à la signature du Président de la République la nomination des ambassadeurs. Pourquoi le général Emmanuel Beth a-t-il été nommé, le 4 août dernier, à la tête de l'ambassade de France du Burkina-Faso, pays dont on sait qu'il vient de signer des accords avec la Côte-d'Ivoire ? La nomination d'un militaire à ce type de poste est plutôt rare ; en outre, le général Beth a dirigé l'opération Licorne du 1er octobre 2002 au 30 mai 2003, puis le Centre de planification et de conduite des opérations ; depuis 2009, il est le directeur de la coopération de sécurité et de défense. Pour ceux qui connaissent la région, cette nomination est étrange et suscite des interrogations.

Il est tout à votre honneur, monsieur le ministre, d'avoir fait part de votre malaise quant à la stigmatisation du peuple des Roms par le Gouvernement, laquelle a porté atteinte à l'image et au rayonnement moral de la France à travers le monde. Comment analysez-vous les dégâts de cette politique ? Comment rétablir l'honneur de la France dans le monde ?

Je m'associe à ces observations. On peut ériger tous les murs que l'on veut, on n'empêchera jamais les plus pauvres d'aller chercher l'Eldorado là où il se trouve. Les politiques sécuritaires ne sont donc pas une réponse.
Je m'interroge néanmoins sur les politiques roumaine et bulgare. La Roumanie a reçu 4 milliards d'euros du fonds social européen pour mieux insérer ces populations, mais n'y a apparemment consacré que 0,4 % de cette enveloppe. Il y a donc une responsabilité, non seulement des dirigeants roumains, mais aussi de la Commission européenne. Celle-ci a adressé des remarques à la France, mais que fait-elle pour assurer l'insertion des Européens les plus pauvres dans leur pays ?
La nomination d'un militaire au poste d'ambassadeur n'est pas exceptionnelle : souvenez-vous, par exemple, de l'amiral Lanxade ou du général Gilles. J'ajoute que le général Beth, comme vous l'avez rappelé, a dirigé au quai d'Orsay la direction de coopération de sécurité et de défense et se trouvait professionnellement dans le milieu diplomatique. Du reste, sa nomination n'a fait aucune difficulté pour le président Compaoré. Quant à la Côte-d'Ivoire, j'espère que les élections s'y tiendront à la date prévue. Le fait est que le président Compaoré a joué un rôle très positif dans la région. J'ai également rencontré Alain Yoda, le ministre des affaires étrangères du Burkina-Faso, il y a quelques jours. Cela fait longtemps que le général Beth avait fait acte de candidature, et c'est tout naturellement que j'ai proposé sa nomination au Président de la République.
Si l'application de la loi ne me pose pas de problème, monsieur Vauzelle, je déplore les dérapages et la mayonnaise verbale. Je n'accepte aucune stigmatisation, et le discours de Grenoble, que j'ai relu trois fois, n'en comporte aucune. La circulaire du 5 août était en revanche mauvaise: aussi a-t-elle été annulée et remplacée.
Suite aux réactions internationales, nos ambassadeurs ont expliqué aux différents gouvernements la position française. Ainsi mon ami Karel Schwarzenberg, ministre tchèque des affaires étrangères et ancien compagnon de route de Vaclav Havel, s'est laissé aller à évoquer un « soupçon de racisme » au sujet de la politique française ; mais il a aussi rappelé que la France était l'héritière des droits de l'homme, propos qui n'ont pas été repris dans la presse. Cela dit, nous devons réparer ces dégâts par notre engagement en faveur des droits de l'homme.
Je ne polémiquerai pas avec Mme Reding, qui nous accuse d'enfreindre une directive européenne. Je connais la question des Roms depuis longtemps. Avec Médecins du monde, j'avais ouvert des consultations en faveur des gens du voyage. Puis, dans le gouvernement de Michel Rocard, secrétaire d'État à l'action humanitaire, je me suis efforcé de scolariser les Roms. Leur tradition est de passer les frontières, et ils continuaient de le faire même à l'époque du rideau de fer.
Quant à l'utilisation des fonds européens par les pays concernés, elle est en effet très insuffisante. Le problème est européen, mais aussi roumain, bulgare ou slovaque. J'ai beaucoup travaillé en Roumanie en tant que médecin – d'où, peut-être, la spontanéité de ma réaction. En effet, monsieur Asensi, 17 milliards d'euros n'ont pas été utilisés comme ils auraient dû l'être, par exemple en faveur de l'éducation. Ainsi, les jeunes Roms qui viennent en France, souvent, ne savent pas lire.
J'ai tenté d'élaborer un texte avec mon homologue roumain. Il prévoyait que la France respecte ses obligations, comme ce fut d'ailleurs le cas avec la tentative de scolarisation des enfants Roms ; mais ces obligations, avais-je ajouté, doivent d'abord être remplies dans « leur pays d'origine ». Ils ont refusé ce singulier, lui préférant le pluriel : « leurs pays d'origine ». Est-ce acceptable ? Ils refusaient même l'appellation de « citoyen roumains ».
Bien sûr que si : ils ne sont pas nés de parents inconnus ! Nous avons même proposé, en vain, de remplacer le terme de « citoyens » par celui de « ressortissants ».
Certes, les fonds européens sont explicitement destinés à l'intégration, non à l'éducation ; mais comment envisager la première sans la seconde ? Vos chiffres sont exacts, monsieur Asensi : cela ne saurait nous exempter de nos responsabilités, mais les choses doivent évoluer, d'autant que la situation ne sera pas sans poser divers problèmes au regard de l'espace Schengen, que la Roumanie devrait prochainement intégrer.
J'ai personnellement beaucoup de projets, notamment de fondations, pour les Roms ; et je vous rappelle que c'est sous la présidence française de l'Union qu'a été organisée la première conférence sur les Roms – la seconde s'étant tenue il y a deux mois à Cordoue.
M. Lellouche a tenu à s'occuper de ce problème, ce que nous avons fait ensemble. Quoi qu'il en soit, je le répète, il ne faut jamais stigmatiser une population pour ce qu'elle est.

Le responsable français du contre-espionnage a fait part, la semaine dernière, de ses inquiétudes quant aux risques d'attentat terroriste sur notre territoire, notamment de la part de la branche saharienne d'Al Qaïda au Maghreb islamique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Le 22 août dernier, depuis sa résidence d'été de Castelgandolfo, le pape Benoît XVI, qui est aussi chef d'État, a tenu des propos dont la presse a estimé qu'ils s'adressaient à la France. Il devrait d'ailleurs rencontrer bientôt le Président de la République. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ces propos ?
Par ailleurs, alors qu'il a théoriquement cédé le pouvoir il y a quatre ans, Fidel Castro est intervenu à deux reprises au cours des jours dernier. Je ne vous interrogerai pas sur les paroles désobligeantes qu'il a prononcées à l'endroit du Président de la République française, mais sur son étonnante déclaration selon laquelle « le système cubain ne marche plus à Cuba ».

Qu'en est-il de la situation de Florence Cassez au Mexique ?
Ma seconde question porte sur le Haut-Karabagh. Malgré l'action de la France et du groupe de Minsk, le protocole signé en Suisse entre la Turquie et l'Arménie a été suspendu sur pression de l'Azerbaïdjan. À l'invitation de Dmitri Medvedev, une rencontre a eu lieu à Moscou entre les Présidents Sarkissian et Aliev, au terme de laquelle un accord a été conclu. Or le Président Aliev, aussitôt rentré à Bakou, a déclenché de nouvelles hostilités. Depuis plusieurs semaines, les incidents sont presque quotidiens, ce qui inquiète beaucoup les députés arméniens que nous avons rencontrés la semaine dernière dans le cadre du groupe d'amitié.
La menace terroriste est réelle, monsieur Boucheron ; les événements récents en apportent la sinistre preuve. Nos services, notre armée et notre diplomatie sont totalement mobilisés. Nous avons renforcé nos postes dans les pays concernés, notamment en Mauritanie, au Mali et au Niger et nous aidons, à divers degrés, leurs armées à se défendre. Une coopération a été mise en place, avec un état-major à Tamanrasset, que l'Algérie veut rendre pleinement opérationnel.
Je me suis rendu en Mauritanie, au Mali et au Niger aussitôt après l'assassinat de M. Germaneau, et j'ai recommandé la plus grande prudence aux communautés françaises de ces pays. J'ai également demandé aux différents gouvernements de surveiller nos établissements scolaires et nos centres diplomatiques.
L'organisation AQMI représente un danger réel mais qui ne se mesure pas au nombre de ses membres – de 150 à 500 personnes, diversement entraînées et décidées. Néanmoins la pauvreté peut entraîner des jeunes gens vers un faux idéal. La France propose donc des pôles de développement et de sécurisation : deux sont en construction au Mali ; d'autres sont prévus en Mauritanie et au Niger. M. Germaneau travaillait à la construction d'un dispensaire, que nous achèverons et que j'irai inaugurer.
Le danger terroriste est donc réel, mais je ne veux pas séparer cette question des projets de développement, que nous devons mener en partenariat avec d'autres pays européens. C'est déjà le cas avec l'Espagne, et j'ai écrit à mes 27 homologues de l'Union au sujet du Sahel. Ils ne m'ont pas tous répondu, mais Mme Ashton approuve le principe de tels projets.
S'agissant de populations longtemps négligées, le message que le pape a adressé au nom de la communauté chrétienne ne m'a pas étonné. Je ne crois cependant pas qu'il ait visé la France. Notre dialogue avec le Saint-Siège est très régulier, notamment par l'intermédiaire de notre ambassadeur au Vatican. Si l'agenda du Président de la République est trop chargé, c'est très volontiers que j'irai expliquer la position française au Saint-Siège, dont j'admire beaucoup la diplomatie, qui fut la première à reconnaître le droit d'ingérence.
Quant à la résurrection de Fidel Castro, saluons la médecine ! Ses déclarations au sujet de « l'holocauste racial » que mènerait la France ont retenu mon attention : il ne semble pas avoir retrouvé toute sa tête. Et, il est bien sûr inacceptable qu'il ait insulté le Président de la République ou formulé quelque critique que ce soit au sujet des droits de l'homme, qu'il a tant de fois violés. Pour ce qui concerne le système cubain, je crois en effet qu'il peut difficilement aller plus mal, et la libération des 32 prisonniers montre que Fidel Castro est sans doute encore un peu assoupi ; c'est en tout cas un grand succès pour la diplomatie espagnole et celle du Saint-Siège.
Quant à Florence Cassez, son dossier contient des zones d'ombre, monsieur Rochebloine. Florence Cassez a fait appel auprès de la Cour suprême mexicaine. Nous recevons régulièrement sa famille, le Président de la République lui téléphone souvent et M. Axel Poniatowski, qui se trouve actuellement au Mexique, doit la rencontrer.
S'agissant du Haut-Karabagh, l'ambassadeur Bernard Fassier, le groupe de Minsk et le Président Medvedev ont beaucoup travaillé pour débloquer la situation ; mais des propos inacceptables pour l'une des parties prenantes ont de nouveau envenimé la situation. Les Azerbaïdjanais sont intervenus dans l'accord accepté par les Arméniens et par les Turcs, accord que Mme Clinton, M. Lavrov et moi-même avions incité les Arméniens à signer.

Mais des préalables sont aussitôt apparus sur pression de l'Azerbaïdjan, si bien qu'aujourd'hui une étincelle peut tout déclencher.
J'en suis convaincu. Je connais bien le problème du corridor de Latchine et la façon dont le Haut-Karabagh a été découpé par Staline ; je ne vois pas comment on pourra parvenir à un accord sans une bonne volonté de part et d'autre.
Nous fondions beaucoup d'espoirs sur la dernière réunion au Kazakhstan en juillet dernier, mais nous nous sommes heurtés au refus – peut-être explicable – des Arméniens. Bernard Fassier poursuit donc sa mission avec un grand dévouement ; mais le fait est que la situation est difficile.
Nous avons rencontré les Arméniens et les Azerbaïdjanais ; pour l'heure, aucune issue n'est en vue. Nous ne pouvons malheureusement pas forcer les peuples à signer un accord dont ils ne veulent pas.
La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq.