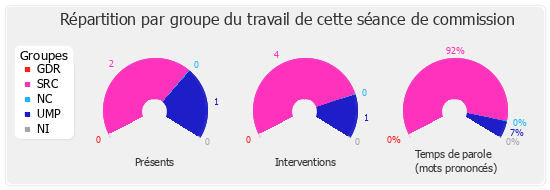Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances
Séance du 11 juin 2008 à 11h30
La séance

Je souhaite la bienvenue à M. Christian Margaria, président de la Conférence des grandes écoles, ainsi qu'à MM. Alain Storck et Pierre Aliphat, membres du bureau.

La Conférence des grandes écoles – CGE – regroupe des établissements publics et privés. Leurs modes de financement ne sont donc pas homogènes. À cet égard, la CGE partage-t-elle le constat inquiétant selon lequel le système actuel de répartition des moyens serait fondé sur des financements inégalitaires et sur une absence de transparence ? Plus généralement, la Conférence aborde-t-elle sa réflexion, en matière de financement de l'enseignement supérieur, de manière globale ou défend-elle une spécificité ?
Si les modes d'allocation des moyens de l'État sont différents selon les établissements, il convient pour autant d'aborder le problème du financement de l'enseignement supérieur dans son ensemble. En effet, l'intensité critique, c'est-à-dire les moyens d'un établissement divisé par le nombre de diplômés de niveau master, enregistre une différence de 5 à 10 entre les plus riches établissements français et leurs grands concurrents internationaux.
Les grandes écoles réunies au sein de la CGE forment chaque année 27 000 ingénieurs de niveau master contre 18 000 dans les universités, pour les mêmes champs disciplinaires, soit près des deux tiers des diplômés. Pour autant, le problème du calcul de la dotation ne se pose pas seulement par rapport au nombre d'étudiants, de diplômés ou encore de présents aux examens, mais également au regard de certaines spécificités exigées des établissements d'enseignement supérieur, telle une plus grande diversité sociale. Or la formation des étudiants concernés demande, aussi bien pour l'université que pour les grandes écoles, des moyens pédagogiques importants.
Quant à la réforme du système de répartition des moyens, la norme San Remo – système analytique de répartition des moyens – elle donne une prime bien trop importante au quantitatif par rapport au qualitatif. Et outre que le raisonnement est fondé sur le nombre d'étudiants et non sur celui des diplômés, les moyens nécessaires à l'entretien du patrimoine sont très différents selon l'ancienneté des bâtiments.
Le coût du diplômé au sein du dispositif universitaire par rapport à celui de l'ingénieur diplômé n'a jamais été analysé finement par mêmes catégories. Cependant, selon nos estimations, le coût des deux formations, dans le domaine des sciences et des technologies, serait proche.
L'INSA de Lyon, que je dirige, et qui est à la fois l'un des trente-huit établissements d'enseignement supérieur régis par le système San Remo et la plus grande école d'ingénieurs française avec 1 400 diplômes délivrés, reçoit une dotation de 45 millions d'euros pour 4 200 étudiants, soit 1 300 euros par étudiant – sachant que le coût de formation réel d'un ingénieur est de l'ordre de 10 000 à 11 000 euros en moyenne. Pour ne prendre que l'un de ses grands concurrents du classement de Shanghai, l'École polytechnique fédérale de Zurich – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich –, d'où sortent 2 000 diplômés par an, celle-ci dispose d'un budget huit fois supérieur avec une gouvernance – un conseil d'administration de douze membres – aux capacités de réactivité et d'adaptabilité très fortes. Sachant que, au sein des contrats quadriennaux, la plupart des crédits que nous recevons sont fléchés, ce n'est donc qu'à la marge que nous pouvons dégager une capacité de manoeuvre, par exemple en matière d'ouverture sociale.
Absolument.
S'agissant de l'ouverture sociale, il ne suffit pas de mettre en place, comme nous l'avons fait, des filières accessibles aux titulaires du baccalauréat technologique, série sciences et technologies industrielles – STI. Encore faut-il accompagner les étudiants jusqu'à la sortie de nos filières spécifiques de vingt-quatre élèves chacune, qui coûtent très cher.
Lorsque l'on parle d'augmenter les moyens de l'université au sens large, c'est-à-dire de tous les établissements d'enseignement supérieur, il ne faudrait donc pas que des décisions soient prises qui conduisent à une diminution de certains moyens.
Pour une école d'ingénieurs, la formation pratique coûte cher en termes de personnels et d'acquisition, de maintenance et de sécurité des matériels, de même qu'en termes de logique de projets et d'ouverture sociale, sans oublier le caractère multidimensionnel de cette formation professionnalisante.
À cet égard, le modèle San Remo n'est pas totalement satisfaisant, s'agissant notamment du nombre de classes de formation – sans qu'il faille pour autant passer de 43 à 3.
Dans le domaine de la recherche, le nombre de personnels IATOS est affecté en fonction du nombre de « thésards ». Or, si l'on compte 70 000 doctorats en cours, seulement 10 000 sont acquis chaque année, ce qui ne signifie pas que la durée moyenne d'une thèse soit de sept ans, mais que nombre d'étudiants abandonnent en cours d'étude. Sur ce nombre de doctorats en cours, 11 000 thèses sont en préparation dans les grandes écoles, pour 2 500 acquises chaque année, soit 25 % des doctorats de recherche délivrés au total pour 10 % des moyens du système San Remo – les statistiques sont d'ailleurs éloquentes quant à l'employabilité de nos doctorants en termes de durée moyenne de recherche d'emploi, de salaire d'embauche et de statut, CDD ou CDI.
Toute évolution du modèle devra donc reconnaître certaines spécificités de formation sans que des décisions brutales soient prises qui risqueraient de casser des mécanismes qui fonctionnent bien. On estime ainsi qu'il faudrait former de manière durable 10 000 ingénieurs de plus que les 27 000 actuels.

Il ne s'agit pas pour nous de casser quoi que ce soit, mais de comprendre afin d'avancer des propositions.
La Conférence conduit-elle des négociations avec le ministère sur les dotations, et la « commission Philip » aborde-t-elle ce sujet ?
La moitié des établissements publics qui relèvent de la Conférence dépendent d'autres ministères que celui de l'éducation nationale. Il n'existe donc pas pour nos établissements tant privés que publics de position transversale liant tous les ministères.
Le système San Remo s'applique à 39 écoles d'ingénieurs, alors qu'un total de 117 écoles ou établissements formant des ingénieurs sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou sous contrat avec lui.

Ces établissements doivent-ils, selon vous, relever d'un régime général ou d'un dispositif spécifique ?
Le régime général convient très bien, à condition que l'affectation des moyens tienne compte, premièrement, du nombre de diplômés et non de celui des étudiants, deuxièmement, de l'employabilité des diplômés et, troisièmement, des différenciations de coût entre les niveaux licence, master et doctorat ainsi qu'entre les grandes thématiques – les coûts de formation ne sont pas les mêmes en sciences humaines et sociales qu'en ingénierie.

Concernant la formation, quels critères, outre l'ouverture sociale, faut-il selon vous retenir pour la part à l'activité ?
Les critères devraient prendre en compte le nombre de diplômés, corrigé par l'employabilité, le niveau de la formation – en distinguant licence, master et doctorat – et les thématiques.
Concernant les licences et les masters, la moitié des étudiants en écoles d'ingénieurs ont une formation intégrée – sans qu'il soit donc besoin d'identifier un premier cycle –, organisée sur cinq ans, avec un nombre d'heures par élève, ou ratio HE, égal à 40 heures. C'est là une spécificité qu'il faut reconnaître.

Pensez-vous opportun d'appliquer la loi sur l'autonomie des universités aux 39 établissements relevant de San Remo et à ceux placés sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ?
Il n'appartient pas à la Conférence d'imposer à ses membres d'opter pour l'article 50 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités.
Je demanderai à mon conseil d'administration d'opter pour cet article, mais il n'est pas certain que je serai suivi.

La question du financement de l'enseignement supérieur est-elle inscrite à l'ordre du jour de la « commission Philip » ?
La commission s'est réunie pour la première fois hier après-midi en séance plénière, et la question n'a pour l'instant été qu'évoquée.

Concernant la recherche, quels critères doit-on prendre en compte pour la part à l'activité et pour la part variable ?
Sans qu'il soit question de les opposer les unes aux autres, les thèses menées dans les grandes écoles le sont souvent dans le cadre de conventions CIFRE - convention industrielle de formation par la recherche – ou de partenariat avec des entreprises. En outre, je rappelle la meilleure employabilité de nos doctorants. Prendre en compte ce critère d'employabilité est essentiel.

Existe-t-il, selon la Conférence, des inégalités financières importantes entre les établissements en question ?
Il existe des différences selon les établissements, mais, s'agissant de la recherche, trois indicateurs doivent être pris en compte dans l'évaluation et donc dans les moyens alloués aux établissements : le nombre de doctorats soutenus, le niveau de recherche partenariale et les publications dans les revues de rang A.
La recherche en ingénierie présente certaines spécificités que l'on ne peut réduire à la recherche partenariale. Elle s'inscrit en effet non plus dans un schéma linéaire quelque peu dépassé, allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, mais dans un schéma beaucoup plus circulaire où les problématiques socio-économiques sont prises en compte à tous les niveaux.
Pour évaluer l'activité d'une recherche partenariale en ingénierie, un prochain rapport proposera, au-delà simplement des publications dans des revues de rang A, de prendre en compte les brevets ou encore la création d'entreprises.

Quel regard portez-vous sur l'évaluation que fait l'État des dotations attribuées aux grandes écoles ?
Tout dépend du type d'établissement considéré. Pour celui que je dirige, qui dépend du ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, l'évaluation se fait annuellement en fonction des objectifs fixés lors de l'élaboration du budget précédent. Non seulement nous rendons des comptes, mais nous sommes également appelés à reverser des éléments budgétaires si les objectifs n'ont pas été atteints.
Pour ce qui est de mon établissement, il est encore soumis à un régime transitoire après la mise en place de la LOLF.

Quelles évolutions souhaiteriez-vous des missions de la nouvelle Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur – l'AERES – et du dispositif d'évaluation ?
L'Agence devrait être plus ouverte – comme la commission des titres d'ingénieurs et, dans une moindre mesure, la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion – aux acteurs socio-économiques. En effet, pour évaluer la qualité d'un diplôme, il est indispensable d'intégrer dans le processus les « clients » de la formation.
Pour autant, il ne faudrait pas tomber dans une évaluation des établissements à longueur d'année, alors qu'ils sont déjà soumis quotidiennement à nombre d'enquêtes et de questionnaires.
En ma qualité de président de l'Union des grandes écoles indépendantes – UGEI – je tiens à souligner combien le dispositif San Remo conduit à des déviances. Les universités ont en effet tout intérêt à accumuler les inscriptions afin de bénéficier d'un meilleur calcul de l'allocation. Pour prendre l'exemple des 10 000 à 12 000 étudiants de l'Union des établissements d'enseignement supérieur catholiques – UDESCA –, autre fédération représentative de l'enseignement supérieur privé, ceux d'entre eux qui préparent des diplômes nationaux sont obligés de s'inscrire dans l'université voisine. C'est ainsi que celle-ci non seulement perçoit des frais d'inscription individuelle de 30 à 300 euros, mais les comptabilise également en tant qu'étudiants.
Cette double comptabilisation des étudiants vaudrait également, si l'on n'y prenait garde, pour ma proposition de prendre en compte dans l'évaluation le nombre de diplômés des grandes écoles, car ceux-ci sont aussi diplômés de l'université.