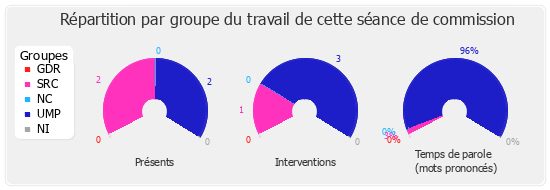Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances
Séance du 28 mai 2008 à 10h30
La séance

Nous vous remercions, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de la mission. Je vous donne la parole pour présenter vos réponses aux questions que les Rapporteurs vous ont fait parvenir par écrit.
Un premier constat que l'on peut faire, et qui est unanime, est que les universités françaises souffrent de sous-financement et d'un manque de moyens. La répartition des sources de financement n'est pas équilibrée entre le public et le privé. La DGF représentant une forte proportion du budget des universités, ces dernières manquent d'autonomie dans leur gestion et leur financement propre est très faible. Il y a entre elles une grande disparité dans la recherche d'autres financements publics, notamment européens, ou de financements privés. Depuis la loi LRU, certaines universités ont fait preuve de beaucoup de détermination alors que d'autres sont plus attentistes.

La politique des universités a souvent consisté à maximiser leur dotation globale de fonctionnement – la DGF. Celle-ci étant fondée sur des critères essentiellement quantitatifs, cela a induit des effets pervers, comme l'inflation de certains diplômes ou le fait de garder longtemps les étudiants inscrits administrativement, même en cas d'échec. Au lieu de conseiller à un étudiant de changer d'établissement ou de filière pour aller là où il pourrait mieux réussir, certaines universités lui proposent, selon une logique propriétaire, une réorientation interne. Cela conduit au bout du compte à une grande complaisance et à une utilisation des étudiants comme une variable d'ajustement budgétaire. C'est ainsi qu'il y a trois ou quatre ans, afin de franchir un seuil dans la répartition de la DGF, une université bordelaise a fait venir des étudiants étrangers. Un autre phénomène récurrent est ce que les présidents d'université appellent les « étudiants fantômes » : il y a entre 20 et 30 % de différence entre les inscriptions administratives et les inscriptions pédagogiques, sans parler de la présence aux examens…
Une réforme des règles de financement s'impose donc afin de limiter ces effets pervers, même si nous sommes conscients que tout système en comporte forcément. Il faut parvenir à un système mixte qui permette de combiner une part de ressources à l'activité - laquelle devra, selon nous, aller en diminuant – et une part plus importante de ressources variables.
L'UNI considère qu'il ne peut y avoir comme critère que le nombre d'étudiants présents aux examens, modulé très fortement par le cursus et le cycle. En effet, on ne peut pas raisonner uniquement par rapport au nombre d'étudiants puisque les différences de coût sont grandes selon les filières et les cycles. En montrant que la mission des universités est véritablement de les amener jusqu'aux examens, une telle réforme marquerait une vraie révolution en faveur des étudiants. Elle apporterait un fort soutien au plan licence, lancé cette année par le Gouvernement, pour encourager et accompagner les étudiants, puisque les universités auraient tout intérêt à ce que les étudiants réussissent, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui – en tout cas d'un point de vue comptable.
Cursus particuliers engendrant des coûts différents, les IUT et les écoles d'ingénieurs doivent être traités séparément.
Pour prévenir d'inévitables effets pervers, une augmentation de la part variable permettrait un financement plus important.
Est-il possible d'élaborer un petit nombre d'indicateurs consensuels pour évaluer la réussite des universités ? L'important est que les mêmes indicateurs s'appliquent partout en France. La majorité des indicateurs de performance du budget de l'État prévus par la LOLF pourrait être appliquée aux établissements, permettant l'évaluation transparente sur l'ensemble du territoire qui fait aujourd'hui défaut. L'UNI s'est beaucoup mobilisée, ces dernières années, sur l'évaluation des taux d'insertion professionnelle. Or, parmi les rares - moins de cinq – universités qui ont mis en place des systèmes d'évaluation, les critères retenus sont très différents, souvent parce qu'elles choisissent ceux qui donnent une image favorable. Si des dotations sont liées à ces critères, il faudra veiller à les définir de manière objective et nationale afin qu'ils permettent une véritable comparaison.
Comment être équitable tout en prenant en compte des situations différentes ? Le meilleur moyen d'éviter de bâtir une « usine à gaz » et de fixer des indicateurs différents selon les universités est de s'intéresser davantage aux progressions qu'aux valeurs absolues. Cela répond à beaucoup de questions, y compris sociales. Savoir qu'en une année le taux de réussite d'une université est passé de 10 à 15 % tandis qu'il chutait de 50 à 48 % dans une autre fournit une vraie indication et permet d'être plus équitable en favorisant, comme nous le souhaitons, les établissements qui visent véritablement la réussite de leurs étudiants.
Dernier élément à propos de la part variable : l'ensemble des missions de l'université doit être évalué pour permettre une meilleure allocation au sein de la dotation globale. Du fait des nouvelles compétences qui leur ont été confiées, les universités sont aujourd'hui des acteurs à part entière de la vie étudiante, aussi bien pour l'accompagnement que pour le logement des étudiants. La politique de vie étudiante, inexistante il y a peu, devient d'ailleurs de plus en plus importante dans les contrats d'établissement. Or, il n'y a, en la matière, aucun moyen d'évaluation. La seule instance d'évaluation est l'AERES - l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur –, qui ne s'intéresse pas à cet aspect. L'Observatoire de la vie étudiante, quant à lui, n'a qu'une vision nationale et non établissement par établissement. On pourrait envisager de l'intégrer à l'AERES.
La contractualisation doit être encouragée. Beaucoup d'acteurs demandent à ce que les contrats soient plus longs, mais il ne faudrait pas que leur durée dépasse celle des mandats des présidents. Les présidents actuels, liés par les contrats de leurs prédécesseurs, disposent de peu de marge de manoeuvre, d'autant que les contrats État-régions durent sept ans, comme les contrats d'objectifs européens.
L'appel à projets s'est récemment développé. Dans le cadre de l'autonomie, c'est un moyen pour l'État d'impulser des politiques précises sur des thèmes particuliers comme l'égalité des chances ou l'insertion professionnelle, les projets étant dotés d'enveloppes budgétaires spécifiques. C'est une démarche moderne, qui permet d'être très réactif sur des sujets extérieurs à la logique quadriennale et de récompenser les établissements innovants. Le dispositif Campus entre dans cette logique.

Trois questions très brèves : quel regard portez-vous sur les inégalités de dotations entre universités ? Quelle devrait être, selon vous, la part de la dotation globale ? Sur le plan du financement, y a-t-il une spécificité du tronc commun de la licence ?

Nous raisonnons moins en termes d'inégalités que de possibilité pour les universités d'avoir une allocation optimale au titre de leurs étudiants. C'est pourquoi la notion de coût par étudiant est importante. Les universités scientifiques sont celles qui parviennent à mobiliser le plus de contrats de recherche et de ressources privées, ce qui est heureux puisque ce sont aussi celles où les études sont les plus onéreuses. Les établissements littéraires mobilisent le moins de contrats de recherche et ce sont aussi ceux dont les infrastructures pour les études sont les moins chères. Il ne serait donc pas juste que toutes les universités reçoivent la même dotation, quelle que soit la discipline. Il faut toutefois veiller à ce que leur soit alloué le montant nécessaire pour une poursuite efficace des études, ce qui suppose une analyse fine du coût d'études par rapport au cursus.
Il y a une différence importante entre la licence et le master. En licence, on a besoin de plus de cours en petit nombre et d'un développement massif des supports pédagogiques, tandis qu'en master, on a besoin de plus de professeurs invités étrangers et de professeurs associés afin d'offrir une vision plus large des sujets. Ces deux spécificités ont des coûts différents. Pour nous, imaginer un tronc commun et un financement identique des licences quelles que soient les disciplines serait donc une erreur.
Nous ne proposons pas de taux précis pour la part de la dotation globale : l'objectif est qu'elle diminue et que la part variable augmente. Certaines universités ont besoin, au moins dans une période transitoire, de disposer de ressources « mécaniques » et la dotation globale présente cet avantage. Mais les effets pervers de la politique quantitative sont tels qu'il faudra la diminuer. La dotation globale varie aujourd'hui entre 36 et 60 %, tandis que le contrat représente 10 % et les ressources propres 20 %.

Quand on retraite la masse salariale et qu'on se place dans le budget global, le contrat représente tout juste 3 % des moyens d'État.