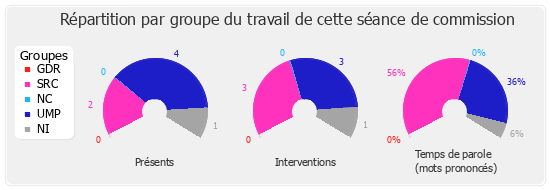Mission d’information sur les questions mémorielles
Séance du 4 novembre 2008 à 17h00
La séance
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze
La mission d'information sur les questions mémorielles a procédé à l'audition de M. Robert Badinter, sénateur, ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel.

Je donne tout d'abord la parole à Catherine Coutelle, qui souhaite s'exprimer au sujet de la dernière séance, dont elle assurait la présidence.

En tant que présidente de séance, en effet, je n'avais pas voulu réagir aux propos tenus par le ministre de l'éducation nationale. Comme je l'ai dit au nom du groupe socialiste et républicain dans un communiqué, il a fait une mauvaise proposition en suggérant que le Parlement prescrive ce qui doit être enseigné aux élèves. Cela risquerait de nous ramener à un régime dont nous ne voulons pas. Il existe une commission des programmes, composée de spécialistes ; si nous, députés, qui n'avons pas tous la même vision de l'histoire – nos débats le montrent – devions fixer les programmes, sans doute les modifierions-nous à chaque changement de majorité parlementaire ! Ce n'est pas le meilleur service à rendre à l'Éducation nationale. Je tenais donc à élever une vive protestation contre ces propos – mais le ministre lui-même est un peu revenu en arrière quelques jours après.

Merci.
Je remercie Robert Badinter d'avoir accepté de venir partager ses réflexions avec les membres de notre mission. Monsieur le ministre, l'éminent juriste, l'homme de lettres, l'ancien président du Conseil constitutionnel et l'élu de la Haute assemblée que vous êtes a certainement beaucoup de choses à nous dire sur les questions mémorielles.
Nous souhaiterions avoir votre éclairage sur les rapports que le Parlement doit entretenir avec l'histoire. Au-delà du sujet de la mémoire nationale, en effet, la période récente a été marquée par le vote de lois mémorielles qui peuvent conduire à une judiciarisation de l'histoire et qui posent le problème de la liberté d'opinion.
Nous aimerions également connaître votre position sur l'intervention du Parlement en matière de programmes scolaires, sujet évoqué par Mme Coutelle. Il semble qu'il y ait un large accord sur l'idée de respecter la répartition actuelle des rôles, le Parlement conservant les compétences de contrôle a posteriori qu'il a toujours eues.
Enfin, nous souhaiterions entendre votre point de vue sur la décision-cadre européenne concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie, qui a donné lieu à un accord politique unanime au Conseil des ministres de l'Union en avril 2007. Cette décision a suscité un appel de l'association Liberté pour l'histoire le 11 octobre dernier, à l'occasion des Rendez-vous de l'histoire à Blois. Fait-elle peser un risque sur la liberté d'expression des historiens ? Pensez-vous que sa transposition en droit interne conduirait à durcir le cadre fixé par la loi Gayssot ?
C'est un honneur, pour un membre d'une Assemblée, que d'être appelé à tenter d'éclairer les membres d'une autre Assemblée. Je le fais avec beaucoup de plaisir, d'autant que la question des lois mémorielles, que j'ai toujours considérée comme très importante, me touche doublement. Au-delà des considérations juridiques sur lesquelles je vais revenir, j'ai toujours pensé, en effet, qu'il y avait dans ces lois une expression très profonde de la souffrance humaine.
C'est d'ailleurs pourquoi, plutôt que de « lois mémorielles », j'ai parfois envie de parler de « lois compassionnelles ». Il faut en effet mesurer, et pour ma part la vie me l'a appris, ce que peut signifier, pour les descendants de victimes de crimes contre l'humanité, un déni de mémoire. Ce refus de l'existence de ce qui fut, frôle l'intolérable. Et c'est bien une compassion devant des souffrances qu'a exprimée le Parlement français au moyen des quatre lois qu'il a votées au cours des dernières années, et qui se rapportaient au génocide juif perpétré par les nazis, au massacre des Arméniens par les Turcs, à la traite transatlantique et à l'esclavage, enfin à la douleur particulière ressentie, au regard de certaines attitudes, par les pieds-noirs et les harkis.
Mais l'émotion et la compassion que l'on peut éprouver devant ce que Jaurès appelait « le long cri de la souffrance humaine » n'empêchent pas le juriste de faire preuve de distance. Comme vous tous, j'ai constaté que ces lois avaient suscité des réactions négatives.
Celles des historiens ont été extrêmement vigoureuses ; pour en connaître personnellement certains, j'ai pu mesurer à quel point leur émotion était vive. Elle n'était pas de nature corporatiste, mais exprimait le sentiment que tout ce qui peut paraître relever d'une histoire officielle est incompatible avec ce qu'est, dans une démocratie, la démarche de l'historien, dont le propre est le questionnement constant. Si j'avais été un historien autre que du dimanche, j'aurais certainement signé l'appel de Blois et les textes qui l'ont précédé.
Plus remarquable encore a été à mes yeux la protestation des juristes. Un certain nombre de collègues professeurs de droit, et non des moindres, ont signé un appel à l'initiative de M. Mathieu, professeur de droit constitutionnel à Paris I, pour dénoncer un dévoiement de la loi. Cela m'a frappé car les juristes, s'ils s'associent volontiers à des pétitions générales, pétitionnent rarement en tant que juristes. Je ne l'ai pas signé quant à moi, car j'ai fait mien ce principe que m'avait enseigné Pierre Mendès-France : « Quand on est parlementaire, on ne signe pas de pétition concernant des sujets qui sont susceptibles de venir devant le Parlement ». Je l'ai néanmoins regardée avec beaucoup d'attention, et je voudrais maintenant m'efforcer, dans ce débat franco-français extrêmement passionné, de faire devant vous un point de la situation juridique.
Je suis tout à fait favorable à la commémoration, c'est-à-dire à la conservation d'une mémoire aussi vivante que possible. La mémoire est nécessaire, c'est un devoir vis-à-vis des morts. Il est bon qu'une communauté nationale ou que des communautés particulières conservent le souvenir de souffrances qui ont eu lieu. Livres, colloques, monuments – il faut penser à ces derniers, ils ont à mes yeux une importance extrême – font partie des multiples possibilités qui existent pour rappeler ce qui s'est passé, afin que chacun en ait conscience et puisse en tirer les leçons.
Mais une chose est la commémoration sous ses formes multiples, autre chose est le recours à la loi. Il est un principe constitutionnel fondamental, que le Conseil a été amené maintes fois à rappeler : la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Dès lors, quelle qu'ait été l'excellence des motivations, la question à laquelle il faut répondre est la suivante : les quatre textes législatifs dont j'ai parlé sont-ils conformes à la Constitution ?
Il est intéressant d'observer que la première décision du Conseil constitutionnel qui serait à mon sens transposable aux quatre lois dites « mémorielles » est postérieure à la dernière de celles-ci : c'est la décision du 21 avril 2005, rendue sous la présidence de M. Mazeaud sur la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dite loi Fillon. Le Conseil y a souligné que « la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ». Ce principe était en lui-même connu, mais il est frappant que le Conseil l'ait énoncé à un moment où l'on s'interrogeait déjà sur la portée des lois mémorielles. En l'espèce, il l'a conduit à écarter des dispositions dépourvues de toute portée normative relatives à la vocation de l'école.
Au vu de cette décision du 21 avril 2005, il n'est pas étonnant que dans celle du 31 janvier 2006, le Conseil constitutionnel ait considéré que l'article 4 de la loi du 23 février 2005 ne relevait pas du champ de la loi. Les dates sont importantes : pour avoir présidé le Conseil, je sais que, comme toutes les juridictions constitutionnelles, il a volontiers tendance, lorsqu'il voit se profiler une question dont il pourrait être saisi, à préparer sa décision. Dans celle du 31 janvier 2006, donc, considérant que « le contenu des programmes scolaires ne relève ni des principes fondamentaux de l'enseignement que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine », il a décidé que le deuxième alinéa de l'article 4 avait le caractère réglementaire. Se trouve d'ailleurs ainsi réglé, et je n'y reviendrai donc pas, le problème soulevé par les propos tenus par le ministre de l'éducation nationale : les programmes scolaires sont hors du domaine de l'article 34.
Qu'en est-il des autres lois mémorielles ? Je ferai un sort particulier à la loi Gayssot, qui a fait l'objet de décisions importantes de la Cour européenne des droits de l'homme, et considérerai d'abord les deux autres, qui n'ont été soumises ni au contrôle du Conseil constitutionnel ni à celui de la Cour européenne.
S'agissant de la loi sur le génocide arménien, beaucoup se sont interrogés sur la compétence du Parlement français à légiférer sur un événement historique – à mes yeux indiscutable – qui est survenu il y a près d'un siècle dans un territoire étranger, sans qu'on ne connaisse ni victimes françaises ni auteurs français. Mais l'important est ailleurs : c'est que rien dans l'article 34, et plus généralement dans la Constitution, ne permet au Parlement de disposer ainsi. C'était également l'opinion du doyen Vedel, dont j'ai eu le privilège d'être l'élève et avec qui j'ai noué des liens d'amitié lorsqu'il siégeait au Conseil constitutionnel. Il a consacré à cette loi l'un de ses tout derniers articles, écrit dans les Mélanges en l'honneur du professeur François Luchaire, ancien président de Paris I et lui aussi ancien membre du Conseil constitutionnel. S'exprimant avec autant de bonheur que de clarté, il y posait un diagnostic impitoyable. La question de savoir si la loi du 29 janvier 2001 est entachée d'inconstitutionnalité est simple, écrivait-il. « La simplicité ne vient pas seulement de ce que la loi en question méconnaît des dispositions constitutionnelles claires et précises. Elle vient aussi de ce qu'aucun effort juridique sérieux n'est venu au secours de la loi, notamment dans le cours des débats parlementaires ». La loi est inconstitutionnelle parce que, à l'évidence, l'article 34 de la Constitution ne permet pas au Parlement de se prononcer ainsi sur un événement historique.
Au vu, d'une part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel quant à l'exigence d'une portée normative de la loi, d'autre part de l'analyse faite dans cet article remarquable, et quels que soient les sentiments que l'on puisse éprouver au sujet du génocide arménien, force est de conclure que le Parlement n'avait pas compétence pour voter un tel texte.
Qu'en est-il de la loi qui a suivi immédiatement, c'est-à-dire de la vôtre, Madame Taubira ? Je mesure très bien ses motivations. Je me souviens même d'avoir dit il y a longtemps, au cours d'une soirée à Epinay, la ville dont Gilbert Bonnemaison était le maire, qu'on ne pouvait pas, à notre époque, qualifier l'horreur, l'infamie de la traite et de l'esclavage autrement que de crime contre l'humanité. De nos jours, ce n'est pas discutable.
Mais nous parlons ici d'une loi relative à des faits anciens, constituant un moment dans l'atroce histoire de l'esclavage, ce véritable fil rouge qui court à travers toute l'histoire de l'humanité. Souvenons-nous de la Bible, songeons aux civilisations dont se réclament les Européens ; les trois piliers de la culture européenne, disait Paul Valéry, sont la philosophie grecque, la religion chrétienne, elle-même appuyée sur l'Ancien Testament, et le droit romain : quelles que fussent leurs splendeurs, ces civilisations pratiquaient l'esclavage.
Dire que la traite transatlantique était un crime contre l'humanité, c'est projeter un concept actuel sur une réalité qui, à l'époque ignorait cette qualification : les négriers avaient bonne conscience – atrocement au regard de notre sensibilité. Si donc le Parlement doit faire preuve de la dernière fermeté contre tout ce qui, aujourd'hui, pourrait constituer une forme quelconque de trafic d'êtres humains ou d'esclavage, il ne peut pas proclamer, contre le principe fondamental de non-rétroactivité, qu'il y a eu crime contre l'humanité à une époque ou cette notion juridique n'existait pas.
Je pense que si cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel, son article premier, dépourvu de toute portée normative, n'aurait pas subsisté. Quant à son article 2 relatif aux programmes, la jurisprudence de la décision rendue à propos de la loi sur la colonisation lui aurait sans doute été appliquée. J'expose là les arguments qui fonderaient une décision de non-conformité à la Constitution ; mais pour avoir présidé le Conseil constitutionnel pendant neuf ans, je tiens à souligner qu'il ne faut jamais voir dans ses décisions un jugement de valeur : il ne fait que rappeler les exigences de notre État de droit.
J'en viens à la loi Gayssot.
Il se trouve que lorsqu'elle a été votée, j'étais au Conseil constitutionnel. J'ai toujours respecté scrupuleusement l'obligation de réserve : je mets au défi quiconque de trouver à l'époque un propos de moi concernant la vie parlementaire ou politique française ; cette ascèse s'impose quand on est membre du Conseil, et plus encore quand on le préside. Mais je me disais à l'époque qu'il serait extraordinairement intéressant pour le Conseil d'être saisi de ce texte. Il ne l'a pas été, mais faites attention : il pourrait l'être désormais à la faveur de l'exception d'inconstitutionnalité. Ayant pu mesurer l'ardeur procédurale de ceux qui, bien qu'ils le soient, ne veulent pas être dénommés révisionnistes ou négationnistes, j'imagine qu'à la première application qui sera faite de la loi Gayssot, ils utiliseront cet instrument.
Je veux souligner pourtant, ayant relu très attentivement cette loi avant de venir devant vous, que ce qu'elle a pour objet d'interdire, sous peine de sanctions pénales, c'est la contestation de la chose jugée, à savoir la contestation de crimes jugés par le tribunal militaire international de Nuremberg. Elle renvoie au statut annexé à l'accord de Londres, à l'établissement duquel la France a évidemment participé, avant de participer aussi à la procédure de jugement.
L'article 9 de la loi Gayssot, qui a inséré un article 24 bis dans la loi de 1881 sur la presse, dispose que « seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale » : il s'agit bien de crimes qui ont été, d'une part, définis dans le statut de Londres, et d'autre part, commis par une organisation ou une personne reconnues coupables par le tribunal.
Évidemment, cela ne va pas sans poser des questions, dont le Conseil constitutionnel sera sans doute un jour saisi. Il se trouve que la dernière affaire que j'ai plaidée, le 2 juin 1981, opposait des organisations humanitaires comme la LICRA et la Ligue des droits de l'Homme à Robert Faurisson. Nous mettions en cause sa responsabilité civile. Nous disions que la négation de l'existence des chambres à gaz ne pouvait être considérée comme un travail historique et que Robert Faurisson avait manqué aux devoirs de l'historien. J'avais été plus loin, j'avais en plaidant quelques raisons personnelles pour cela, en disant qu'il était un « faussaire », un faussaire de l'histoire. Le tribunal l'a condamné pour manquement aux devoirs de son métier d'historien.
La voie civile peut être utilisée, donc. Faut-il avoir recours à la loi pénale ? La question se pose. Ce qui est certain, c'est que la loi Gayssot n'est pas une loi mémorielle : le Parlement n'a bien évidemment pas décidé de l'existence du génocide juif ; il a facilité la répression de propos niant l'existence de faits revêtus de l'autorité de la chose jugée, en votant une loi pénale.
Qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme ?
Elle a d'abord été saisie d'une affaire Isorni, à la suite d'écrits de Jacques Isorni visant à réhabiliter le maréchal Pétain et présentant l'entrevue de Montoire comme une habileté suprême. La condamnation dont Jacques Isorni avait fait l'objet par les juridictions françaises méconnaissait-elle la liberté d'opinion reconnue par la Convention européenne des droits de l'homme ? La Cour a estimé que l'interprétation de la rencontre de Montoire – suprême habileté ou trahison suprême – relevait des débats toujours en cours entre historiens. Mais elle a ajouté ceci : « A ce titre, cette question échappe à la catégorie de faits historiques clairement établis, tel l'holocauste, dont la négation ou la révision se verraient soustraites par l'article 17 à la protection de l'article 10 » – l'article 10 posant le principe de la liberté d'opinion et l'article 17 énonçant les réserves fondées sur les valeurs fondamentales de la démocratie. Les mots « tel l'holocauste », nullement nécessaires au soutien du dispositif, constituent un orbiter dictum qui prépare l'avenir, lequel est évoqué par le conditionnel dans la suite de la phrase. La Cour prévenait ainsi clairement que, s'agissant du négationnisme, les faits étant établis, il ne serait pas possible d'invoquer la liberté d'opinion.
Elle a été amenée à se prononcer sur le sujet dans sa décision Garaudy du 24 juin 2003, dans laquelle elle s'est montrée d'une extrême sévérité. J'en relève un considérant important : « La contestation de crimes contre l'humanité apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard ». Quand les négationnistes ou les révisionnistes, explicitement ou implicitement, nient l'existence des chambres à gaz et de l'Holocauste, en les présentant comme une invention des Juifs eux-mêmes pour fonder l'État d'Israël au détriment du peuple palestinien et sans doute, avec leur rapacité légendaire, pour obtenir des dommages et intérêts substantiels, que font-ils ? Selon la Cour, la négation ou la révision de faits historiques de ce type « remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l'ordre public ».
L'argumentation est claire, et elle nous ramène à la loi Gayssot. Sous couvert de prétentions historiques, le négationnisme n'est rien d'autre que l'expression d'un antisémitisme multiséculaire et, comme l'a dit la Cour, une incitation à la haine raciale.
Je rappelle que ces lois résonnent de toute la souffrance humaine. Mais la règle de droit est la règle de droit. Sauf délire – telle, par exemple, la démonstration, dans un ouvrage de 1827 que vous pouvez trouver à la bibliothèque du Palais-Bourbon, que Napoléon n'a jamais existé ! –, la négation de faits historiques a en effet toujours une motivation, et l'incitation à la haine raciale est celle que la Cour européenne des droits de l'homme a relevée. C'est dans cette voie que le Parlement peut continuer à travailler ; l'entreprise est importante, mais nous devons respecter les limites que nous impose notre Constitution.

Monsieur le ministre, vous m'avez fait penser à Pascal : vous avez allié l'esprit de finesse, en évoquant le caractère compassionnel des quatre lois – que vous êtes le seul à avoir souligné au sujet de l'article 4 de la loi du 23 février 2005, qui n'était pas du tout une apologie de la colonisation, comme certains ont voulu le dire, mais bel et bien l'expression d'une reconnaissance –, et l'esprit de géométrie par la rigueur de votre démonstration juridique.
Celle-ci me conforte dans l'idée que l'une des lois est à conserver. Pour le reste, il m'apparaît que le tri qui a été fait s'est fondé davantage sur l'opportunité politique que sur des raisons juridiques : le fait que le déclassement opéré par le Conseil sur cet article 4 n'ait pas touché les trois autres lois n'a, bien évidemment, rien à voir avec le droit.
Mais puisqu'une loi doit avoir une portée normative, quelle place pensez-vous que pourraient prendre, pour donner corps aux intentions que le Parlement avait cru pouvoir exprimer par la voie législative, les résolutions qu'il a désormais la possibilité d'adopter ?
Par ailleurs, comment fonder la citoyenneté des jeunes générations sur des principes solides ? Considérant qu'on ne peut jamais résumer un siècle d'histoire en une page dans un livre de classe, les politiques aspirent à un dialogue avec les historiens, afin que la place nécessaire soit donnée à l'enseignement de nos valeurs. Quelle est votre position sur ce thème ?
Si j'avais appartenu à l'éminente corporation des historiens, j'aurais, je le répète, eu la même attitude qu'eux car l'idée d'une histoire officielle est tout simplement insupportable. Je conçois parfaitement que l'idée de légiférer à propos du contenu de l'enseignement les fasse immédiatement sursauter.
Quant aux résolutions, dont le texte constitutionnel qui a été voté en juillet encadre étroitement l'usage, elles ont une fonction tribunitienne – celle qui reste quand on n'a pas d'autre pouvoir. Le Parlement ne pouvant formuler des injonctions à l'égard du Gouvernement, que pourrait-il écrire dans une résolution ? Il pourrait témoigner de sa sollicitude à l'égard de victimes, à travers une sorte de motion de compassion, exprimant la solidarité humaine devant le malheur. Ce n'est pas rien. Mais toute la difficulté sera de savoir jusqu'où l'on peut aller, sans tomber dans l'injonction, et sans non plus dire l'histoire ni proclamer l'existence d'un événement historique. La voie de la résolution est ouverte, mais elle est étroite c'est un champ dans lequel il ne faudra pénétrer qu'avec une extrême prudence, en ayant toujours à l'esprit qu'il ne s'agit pas de proclamer l'existence d'un fait, mais de prendre en considération les souffrances qui découlent d'un fait indiscutable.

Monsieur le ministre, vous nous avez bien éclairés, mais au moment où nous approchons de la conclusion de nos travaux, vous nous laissez au milieu du gué en nous lançant cet appel à la prudence quant à l'usage des résolutions. Elles nous paraissaient être en effet le meilleur moyen de donner aux victimes la reconnaissance à laquelle elles aspirent.
Par ailleurs, s'agissant des célébrations ou des commémorations, nous souffrons à la fois d'un trop-plein d'événements et du désintérêt du public. Comment, à travers elles, faire oeuvre de pédagogie et construire la citoyenneté, comme on l'avait entrepris sous la Révolution, ainsi que l'a très bien montré Mona Ozouf dans La Fête révolutionnaire ?
Je ne crois pas que trop de commémorations tuent la commémoration. Ce qui use les commémorations, c'est le temps. La commémoration de la guerre de 14-18, qui a entraîné tant de sacrifices et tant de morts, en particulier de jeunes hommes, était dans ma jeunesse un moment très important de la vie nationale. La célébration de l'Armistice se faisait dans la cour du lycée. Mais au cours des années, j'ai vu s'effilocher la foule réunie autour du monument aux morts. S'il n'y avait pas eu d'autre guerre, je ne sais pas où en serait la commémoration. Qui honore encore ceux qui sont morts en 1870-71 ?
Il appartient aux communautés elles-mêmes, et à la communauté nationale au premier chef, de conserver vivante la mémoire dont elles sont dépositaires. Faut-il déclarer férié tel ou tel jour, c'est un débat dans lequel je n'entrerai pas aujourd'hui. Mais – et vous avez entendu M. Nora – la mémoire s'inscrit aussi dans certains lieux. Quand on va à Gorée, d'où les esclaves partaient vers les Amériques, il est impossible de ne pas être bouleversé. Pourtant les siècles ont passé. Quiconque a visité un camp de concentration ou d'extermination comprend aussi l'importance des lieux de mémoire.
La mémoire peut être entretenue de multiples façons. Au mémorial de la Shoah, la communauté juive française a élevé un mur, sur lequel sont gravés les noms de tous les Juifs déportés morts en camp de concentration – 76 000 – avec l'indication de leur âge, ce qui permet de prendre conscience du nombre d'enfants parmi eux.
Au Mont Valérien, qui se trouve dans ma circonscription, j'avais été frappé, lors d'une cérémonie, par le fait que nulle part ne figurait le nom des résistants qui avaient été fusillés là. Il n'était pas possible que ces noms fussent ainsi escamotés. J'ai donc déposé une proposition de loi pour l'édification d'un monument. Maurice Schumann a prononcé à cette occasion sa dernière et sublime intervention, et la proposition a bien sûr été votée à l'unanimité. Le nécessaire a été fait pour retrouver les noms, qui sont désormais inscrits. Leur absence était un péché contre la mémoire.

J'ai toujours un immense bonheur à vous écouter, Monsieur le ministre. Permettez-moi cependant quelques interrogations.
Le Conseil constitutionnel, vous l'avez rappelé, a fondé sa décision relative à l'article 4 de la loi de 2005 sur le partage des compétences entre le Parlement et le Gouvernement, tel qu'il est défini par les articles 34 et 37 de la Constitution. Mais la raison pour laquelle ce texte a été déféré au Conseil était d'une autre nature : la contestation portait sur le contenu. La technique juridique est donc une chose, mais elle ne fait pas tout. Il faut se demander pourquoi l'on peut être amené à voter une loi sur ces sujets. Le Parlement n'est pas sourd aux interrogations qui traversent la société. Au demeurant, s'il faut s'incliner devant le partage entre domaine législatif et domaine réglementaire, l'on aimerait aussi que le pouvoir exécutif cesse de vampiriser le pouvoir législatif.
Vous avez dit par ailleurs que l'esclavage constituait un fil rouge dans l'histoire de l'humanité. Mais l'esclavage tel qu'il se pratiquait dans l'Antiquité, celui qui a donné lieu par exemple à la révolte de Spartacus, était-il fondé sur le rapt ? Il ne me semble pas qu'on puisse le comparer sans nuances à un système organisé par des États, qui sont allés jusqu'à se doter du sinistre Code noir.
Je suis toujours surprise quand on met sur le même plan l'article 2 de la loi de 2001 et l'article 4 de la loi de 2005. L'un demandait d'enseigner les bienfaits de la présence française outre-mer, l'autre dit qu'il faut introduire dans les programmes scolaires l'histoire de la traite et de l'esclavage et encourager la recherche : la différence d'approche me semble considérable.
Vous avez dit aussi que ceux qui pratiquaient l'esclavage le faisaient avec une parfaite bonne conscience, mais la contestation est apparue avant même le siècle des Lumières, qui fut fécond, vous le savez mieux que personne, en récits et engagements d'une grande profondeur de réflexion. Des voix se sont élevées pour dire qu'il s'agissait d'un « crime de lèse-humanité », d'un crime contre l'homme, donc, même si le concept de crime contre l'humanité n'a été établi que pour le tribunal de Nuremberg. C'est un « attentat contre la dignité humaine », a dit Victor Schoelcher en 1848. L'abbé Grégoire a parlé de « crime », Proudhon de « meurtre ». La bonne conscience des négriers n'était partagée ni par les grands esprits, ni par les petites gens, comme en témoigne le cahier de doléances des villageois de Champagney. À la même époque, 13 % de la population masculine d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles ont signé des pétitions contre l'esclavage. La pétition de Birmingham, en 1792, dit bien que « la traite est un commerce contraire à notre expérience commune de l'humanité ».
Je voudrais faire valoir aussi, avec mille précautions, que le concept de crime contre l'humanité a été établi après la Shoah. Que le concept soit postérieur aux faits n'empêche donc pas de s'interroger sur la qualification des faits.
Il faut, j'y reviens, comprendre pourquoi l'on parle de ces sujets, pourquoi en 2001, l'on a voulu voter une loi disant qu'il fallait enseigner l'histoire de la traite et de l'esclavage et promouvoir la recherche dans ce domaine. J'ai le plus grand respect pour les historiens, mais force est de constater que certains thèmes ne font pas l'objet d'enseignements ou de travaux. Dire qu'il faut enseigner ce qui s'est passé, ce n'est pas dire comment il faut l'enseigner : cela fait toute la différence avec la loi de 2005. En ce qui concerne l'esclavage et le commerce triangulaire, il ne s'agit pas de la mémoire d'un groupe de personnes, mais bien d'une histoire qui a profondément bouleversé le monde, dans tous les domaines – économie, philosophie, rivalités entre puissances européennes, frontières africaines ou démographie des Amériques.
Si j'avais eu le privilège d'être un compagnon des Encyclopédistes, j'aurais très vraisemblablement, compte tenu de mes affinités électives avec Condorcet et l'abbé Grégoire, été membre de la Société des amis des Noirs – dont je ne vous apprendrai pas que les personnalités les plus connues ont été pendues en effigie dans les Caraïbes.
Bien entendu, il faut poursuivre avec toute la vigueur possible la recherche sur ce qu'a été l'esclavage. Et ne pas pratiquer une histoire sélective : il y a eu aussi des négriers noirs, le trafic d'esclaves a continué de ravager l'Afrique après les lois d'abolition de l'esclavage. Tout, dans ce processus global, doit être étudié et mis en pleine lumière. C'est un objet d'étude de première importance.
Caïn fait partie de l'humanité, et je l'ai rencontré. Il continuera à faire partie de l'humanité. Il nous appartient de mettre son visage à nu, et d'apprendre à tous les enfants ce dont il est capable à l'égard de son frère, partout.
Mais nous, parlementaires, sommes tenus par la Constitution. La loi, je le répète, n'existe que dans le respect de la Constitution. C'est la limite de notre action, elle est contraignante, mais nous avons d'autres moyens d'agir que la voie législative.

Ce qui me paraît important, et qui pourra peut-être passer par l'adoption de résolutions, à l'instar de celles que vote le Parlement européen, c'est la reconnaissance du fait.
Par ailleurs, je m'interroge sur l'évolution de la manière dont on commémore la Grande Guerre. Je suis originaire du Nord, entre Fromelles et Ypres, région où tant de villages ont été entièrement détruits. Cette année, dans ma commune, pour le quatre-vingt-dixième anniversaire, il a été décidé de lire les lettres qui étaient envoyées aux Poilus par leurs familles. N'y a-t-il pas, là aussi, une réinterprétation d'un fait historique par notre sensibilité d'aujourd'hui ?
Enfin, les commémorations ne doivent-elles pas servir à remettre à l'honneur les valeurs fondamentales dont nous observons la déliquescence, et par là même à faire acte de prévention ? L'année dernière, aux lycéens à qui j'avais lu la lettre de Guy Môquet, j'avais ensuite demandé qui et où, aujourd'hui dans le monde, pouvait être un Guy Môquet. Le plus important, dans la commémoration, n'est-il pas d'en tirer des conséquences dans sa propre vie ?

Monsieur le ministre, votre très brillant exposé a achevé de me convaincre. La constitutionnaliste Anne-Marie Le Pourhiet avait eu des propos plus durs que les vôtres, en nous disant que beaucoup de parlementaires sont moins les représentants de la nation que ceux de lobbies en tout genre, tirant la couverture publique vers leurs intérêts catégoriels. Si nous continuons sur la voie des lois mémorielles, nous donnerons de plus en plus l'impression de nous complaire dans un pathos doublé d'une certaine vacuité de la pensée. Demeure toutefois l'absolue nécessité de préserver la mémoire, mais ce que vous avez dit en évoquant votre cas personnel est certainement beaucoup plus frappant que toutes les lois que l'on pourrait écrire. Je rejoins ma collègue pour dire que cette mémoire doit nous aider à transmettre des valeurs fondamentales afin de préparer l'avenir.

J'ai assisté hier à une cérémonie à Reims : pour la première fois, on a rendu hommage à l'armée noire. Il y avait eu un monument, que les nazis se sont empressés de détruire quand ils ont occupé Reims. La décision a enfin été prise d'en reconstruire un. Qui connaît l'histoire de ces tirailleurs sénégalais, qui ont défendu Reims de toutes leurs forces ? Cela aussi, c'est bien peu enseigné.
Et qui parle des batailles de la Somme, de ces hommes de quarante-trois nationalités, tous volontaires, venus défendre le pays des droits de l'Homme ? Il faut faire quelque chose pour que cela se sache.
Le temps efface la mémoire, mais le devoir de mémoire existe. C'est pourquoi il appartient à ceux qui, pour des raisons diverses, ont un lien fort avec les événements de maintenir la flamme de la mémoire et d'éviter une concurrence des mémoires.
Le passage de la mémoire à l'histoire est ce moment où ceux qui ont vécu les événements ne sont plus. Quant à la transmission, c'est au premier chef un problème pédagogique et culturel.
Les crimes du passé éclairent le présent. C'est pourquoi je suis partisan – sans qu'il s'agisse de voter une loi ! – d'un enseignement qui dise l'histoire des crimes contre l'humanité. Cela saisit les enfants, mais ils le projettent sur le monde actuel, ils le vivent dans leur imaginaire comme une possibilité qu'il faut combattre.
De plus, je ne crois pas qu'on puisse se réconcilier sans qu'ait été fait le travail de mémoire. Il s'agit aussi d'un travail d'autocritique, et non pas seulement de la reconnaissance de souffrances. Jamais nous n'aurions pu construire l'Europe, réussite historique de notre génération, si les Allemands n'avaient pas accepté le travail fait notamment à Nuremberg. La mémoire n'est pas seulement revendication et rappel des crimes subis, elle est aussi prise de conscience de ses torts. S'agissant de nos amis arméniens, je continue à souhaiter qu'un Livre blanc puisse être établi avec les Turcs sous les auspices de l'Union européenne ou de l'UNESCO. Le « vivre ensemble » de Renan est aujourd'hui à l'échelle des peuples ; il suppose un travail de mémoire et d'histoire.
Quand on passe dans les cimetières du Nord de la France, on est saisi. Sans doute est-il difficile d'emmener les enfants dans les cimetières. Pourtant, à Rome, après avoir visité les hauts lieux de l'Antiquité et de la chrétienté, il est dommage de ne pas montrer le cimetière militaire français. Dans quatre tombes sur cinq reposent des musulmans, d'autres sont marquées de noms espagnols ou italiens ou juifs caractéristiques de la population d'Afrique du Nord.
Pour en revenir à notre sujet, le Parlement ne doit pas se laisser emporter par l'émotion, même si nous la comprenons parfaitement. Quant aux résolutions, c'est à l'occasion de la discussion de la loi organique que nous imaginerons l'usage que nous pourrions en faire. Il faudra les tenir hors du champ des confrontations politiques. Et en matière de reconnaissance nationale, il faudra se méfier de ce qu'une demande peut en appeler une autre. Soyons donc attentifs et prudents !

Au nom de tous les parlementaires de la mission, je vous remercie de nous avoir fait bénéficier de votre expérience et de votre expertise uniques sur le sujet qui nous occupe. Elles nous seront extrêmement utiles pour faire progresser notre réflexion et, je le souhaite ardemment, aboutir à des propositions. Nous vous en sommes très reconnaissants.
La séance est levée à dix-neuf heures dix.