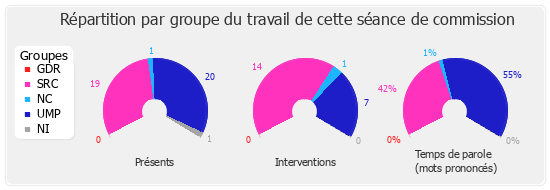Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
Séance du 8 juillet 2009 à 10h00
La séance
La séance est ouverte à 10 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission examine le rapport de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice (M. Étienne Blanc, rapporteur).

Lorsque la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale m'a confié ce rapport d'information sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice, je dois avouer que je ne m'attendais pas à découvrir un sujet aussi vaste, mais combien passionnant. Face à l'ampleur d'une telle problématique, mon ambition, tout au long de cette mission, a été d'analyser les conditions dans lesquelles le soin et la peine interagissent afin de lutter efficacement contre les différentes pathologies et addictions à l'origine de la récidive. J'ai, pour ce faire, décidé de m'intéresser plus spécifiquement à trois thèmes.
Dans la première partie de mon rapport, j'ai souhaité porter un regard concret et objectif sur la question de la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées. Nombreux sont les faits divers à rappeler l'urgence sanitaire en prison. Ainsi, en janvier 2007, un prisonnier atteint de troubles mentaux avait tué son codétenu à la maison d'arrêt de Rouen avant de dévorer certains de ses organes. En septembre 2008, c'est dans cette même maison d'arrêt qu'un autre prisonnier a également tué son codétenu, relançant le débat, d'une part, sur la présence des pathologies psychiatriques en prison et, d'autre part, sur la collaboration entre personnels pénitentiaires et équipes médicales, afin de sécuriser les conditions de vie et de travail de chacun en détention. Au-delà de l'émotion et de la passion que peut susciter un tel débat, mon souci a été double : rappeler les indéniables progrès qui ont été accomplis depuis une quinzaine d'années ainsi que les difficultés qui font aujourd'hui obstacle à une prise en charge sanitaire globale et cohérente en prison.
Avant toutes choses, force est de reconnaître que la prison est un lieu de maladies. Le constat est sans appel. Sur le plan somatique, la population carcérale française reste une population surexposée au VIH, aux hépatites et à la tuberculose, une population fortement touchée par différentes formes d'addiction (alcool, cannabis, héroïne, cocaïne) et à la santé bucco-dentaire profondément dégradée. Sur le plan psychiatrique, le taux de pathologie est vingt fois supérieur en détention à celui observé en population générale et le recours aux soins de santé mentale y est dix fois supérieur. Quelques chiffres permettent d'illustrer une telle affirmation : près de la moitié des détenus présentent un état dépressif majeur et un quart des personnes incarcérées est aujourd'hui atteint de troubles psychotiques (schizophrénie, bouffée délirante aiguë, paranoïa…).
Face à cette situation, d'importants progrès ont d'ores et déjà été accomplis : la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a permis l'entrée de l'hôpital dans les prisons grâce à la mise en place d'un système de conventions entre hôpitaux et prisons, afin que la qualité et la continuité des soins dispensés aux détenus soient équivalentes à ceux de l'ensemble de la population. La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a prévu la création des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, afin d'améliorer sensiblement les conditions d'hospitalisation complète des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Les difficultés faisant obstacle à une prise en charge globale et cohérente en détention persistent toutefois. Quatre points de blocage me semblent devoir être signalés.
Première difficulté : l'offre de soins en milieu carcéral souffre tout d'abord d'un manque de pilotage stratégique tant au niveau national que régional. Alors que seize thématiques ont été arrêtées comme devant obligatoirement être traitées dans le cadre de l'élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire, les soins aux personnes détenues n'y figurent pas en tant que tels. C'est pourquoi, je propose de confier aux futures agences régionales de santé, les ARS, la double mission d'identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et de réguler l'offre de soins en milieu pénitentiaire. Pour ce faire, il convient de prévoir l'inscription dans l'ensemble des schémas régionaux d'organisation sanitaire d'un volet thématique sur la « santé en prison ».
Deuxième difficulté : la coopération entre les différents acteurs intervenant en prison trop souvent défaillante. Les relations entre les services médicaux et l'administration pénitentiaire restent fréquemment marquées par la méfiance et l'incompréhension, l'implication et la bonne volonté des acteurs étant déterminantes.
Troisième difficulté : la continuité des soins, notamment psychiatriques, à la sortie de prison, qui demeure un des points de blocage majeur que nous avons identifié, le plus souvent à cause du manque de coordination entre les équipes médicales d'une part, et les services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que les juges de l'application des peines d'autre part. Pour éviter que la libération ne signifie l'interruption brutale des soins psychiatriques, je propose que les consultations post-pénales en milieu ouvert soient généralisées. En effet, les expériences menées, notamment à l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif à l'initiative de Mme Christiane de Beaurepaire, présentent des résultats remarquables en matière de prévention de la récidive et permettent de combler les lacunes de la sectorisation psychiatrique en fonction du lieu de domicile, largement inadaptée aux sortants de prison.
Quatrième difficulté et non des moindres : le secret médical qui cristallise les tensions entre personnels soignants et administration pénitentiaire. La prison est un lieu où tout se sait et dans lequel le secret médical est difficile à préserver. En effet, le secret médical est le motif le plus fréquent de conflits entre administration pénitentiaire et le personnel médical. Au cours des divers déplacements et des auditions, j'ai toutefois pu constater que le partage de l'information entre professionnels de santé et personnels pénitentiaires s'est imposé dans la pratique quotidienne de la détention. Bien que n'ayant aucune base légale ou réglementaire, le secret professionnel partagé est une réalité dans beaucoup d'établissements pénitentiaires, permettant ainsi d'assurer une meilleure continuité des soins et de sécuriser les conditions de vie et de travail en détention.
Après la santé en détention, j'ai souhaité dans la deuxième partie de ce rapport m'intéresser aux soins pénalement ordonnés et plus particulièrement au dispositif de suivi socio-judiciaire. En effet, l'arsenal législatif prévu pour contrôler les criminels dangereux, lors de leur sortie de prison, et ainsi limiter les risques de récidive, s'est développé au fil des années : parmi ces mesures successives, le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins, instaurés par la loi du 17 juin 1998, occupent une place centrale.
Mesure originale et porteuse d'efficacité pour lutter contre la récidive, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire, qui consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures d'assistance et de surveillance. Au nombre de ces mesures, la juridiction peut prononcer une injonction de soins : se met alors en place une interface santé-justice originale : le médecin coordonnateur, qui intervient afin de mieux renseigner le juge de l'application des peines quant au déroulement des soins engagés entre le condamné et son médecin traitant.
Or, l'application du suivi socio-judiciaire, avec injonction de soins, se heurte actuellement à une difficulté de taille : le manque de médecins coordonnateurs. En effet, 40 tribunaux de grande instance et 17 départements en sont actuellement dépourvus. Au final, le rôle d'interface original que le médecin coordonnateur assure entre santé et justice est aujourd'hui le plus souvent virtuel en raison de la pénurie de médecins et les injonctions de soins ne peuvent être mises en oeuvre, de façon satisfaisante, dans plus de la moitié des juridictions françaises. Face à cette pénurie de médecins, j'avance dans mon rapport quelques propositions, comme la suppression du numerus clausus qui limite à vingt le nombre de condamnés que peut suivre chaque médecin coordonnateur et la possibilité pour l'expert qui, missionné par le tribunal ou par le juge d'instruction, a étudié un dossier, de pouvoir être ensuite nommé médecin coordonnateur dans le même dossier.
Autre source d'inquiétude : l'extension du suivi socio-judiciaire, motivée par l'intérêt constant que porte le législateur à cette peine, qui risque de lui faire perdre une grande partie de son efficacité, faute de moyens adéquats. Alors qu'il avait été initialement créé à destination des auteurs d'infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a progressivement été étendu à l'essentiel des infractions violentes (meurtres, assassinats, viols, enlèvement ou séquestration). Or, le suivi socio-judiciaire, par l'articulation qu'il exige de tous les acteurs, suppose un temps de suivi plus important que tout autre mesure. Afin que ce dispositif ne soit pas saturé et ne perde de son efficacité, je propose donc que, dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, le suivi socio-judiciaire ne puisse être prononcé qu'à titre exceptionnel pour les cas de violences conjugales et délits d'incendiaires les plus graves, l'obligation de soins devant être privilégiée le reste du temps.
Je souhaite également un suivi socio-judiciaire plus souple et plus réactif, seul capable de faire face à la montée en charge du dispositif. Le suivi socio-judiciaire est en général prononcé pour des durées relativement longues (six ans en moyenne), alors même que les efforts entrepris par la personne condamnée en vue de sa réinsertion sociale peuvent avoir produit leurs effets avant la fin de la mesure. Il faut donc permettre au juge de l'application des peines, après audition du condamné, de mettre fin de manière anticipée à un suivi socio-judiciaire, y compris lorsqu'il est prononcé à titre de peine principale. Une double condition devra pour ce faire être remplie : le reclassement du condamné devra être acquis sur rapport du conseiller d'insertion et de probation et les soins pénalement ordonnés ne devront plus être nécessaires, sur rapport du médecin coordonnateur. De même, alors que le juge de l'application des peines peut actuellement modifier ou compléter les obligations imposées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, il ne peut en revanche lever l'injonction de soins, quand bien même les soins ne s'avéreraient plus nécessaires. C'est pourquoi, le juge de l'application des peines doit pouvoir, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, mettre fin de manière anticipée à l'injonction de soins ordonnée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
Enfin, dans la troisième partie de mon rapport, j'ai souhaité traiter un thème fondamental, celui de la prise en charge des infractions liées à l'alcool. Troisième cause de mortalité en France et première cause de décès chez les jeunes, l'alcool fait aujourd'hui l'objet de consommations problématiques chez plus d'un tiers des adultes. Or, le coût social de l'alcool était estimé à 37 milliards d'euros en 2000, soit près de 3 % de la richesse nationale. Il s'agit pourtant là d'une estimation basse, ne tenant pas compte des crimes et délits commis sous l'emprise de l'alcool. Or, force est de constater que la prévalence de l'alcool, si elle varie fortement suivant le type d'infractions, reste globalement marquée. Quelques chiffres : l'alcoolisation occasionnelle ou chronique est un facteur retrouvé chez plus d'un tiers des auteurs de violences. Un quart des auteurs d'agressions hors de la famille et plus du tiers des auteurs d'agressions au sein la famille avaient consommé de l'alcool dans les deux heures précédentes. En ce qui concerne d'autres formes de délinquance, un tiers des destructions intentionnelles étaient précédées d'une consommation d'alcool.
Or, si l'alcool est souvent associé à la commission d'infractions, les rencontres avec la justice constituent autant d'occasions manquées de prévenir et de prendre en charge les troubles liés à l'alcool. Prenons l'exemple de l'injonction thérapeutique. Initialement réservée aux personnes faisant usage illicite de stupéfiants, elle a été étendue, par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, aux personnes ayant commis une infraction dont les circonstances révèlent une addiction à l'alcool. Or, parce que les actes réglementaires nécessaires n'ont toujours pas été publiés à ce jour, l'injonction thérapeutique est restée « lettre morte » depuis deux ans pour les infractions liées à l'alcool, alors même que les besoins sont immenses.
Trois axes de réformes me semblent devoir être privilégiés pour faire de la rencontre avec la justice une opportunité réussie de prévention et de prise en charge des troubles liés à un mésusage d'alcool.
Premier axe de réforme : donner sa pleine mesure à l'injonction thérapeutique. Pour ce faire, il revient tout d'abord au Gouvernement de prendre sans délai les actes réglementaires d'application de l'injonction thérapeutique, telle que réformée par la loi du 5 mars 2007. Je suis également favorable à ce que l'injonction thérapeutique pour les infractions liées à l'alcool puisse être mobilisée à tous les stades de la procédure judiciaire, tant en pré-sentenciel (alternatives aux poursuites, composition pénale, obligation ordonnée par le juge d'instruction) qu'en post-sentenciel (comme modalité d'exécution d'une peine).
Deuxième axe de réforme : délivrer de plus amples informations et de plus fortes incitations aux soins aux personnes placées sous main de justice. Plusieurs moments de la procédure judiciaire – alternatives aux poursuites, application et exécution des peines – sont propices à ce que le passage devant la justice puisse se transformer en prise de conscience, dont on sait qu'elle est une étape importante dans une éventuelle prise en charge. Lors des auditions de la mission, il a notamment été fait état d'une expérimentation très originale menée au Havre en matière de prise en charge des problèmes de mésusage d'alcool après la commission d'une infraction : la réalisation d'entretiens d'alcoologie en garde à vue. Cette action s'adresse aux personnes mises en cause dans des affaires en lien avec une consommation d'alcool et poursuit un double objectif : d'une part, permettre aux prévenus, au cours de cet entretien, de revenir sur leurs actes et, d'autre part, les sensibiliser à une démarche personnelle de prise en charge de leurs conduites addictives, au besoin avec le soutien d'un thérapeute. Afin d'apprécier plus largement l'efficacité de ce dispositif sur la prévention de la récidive des infractions liées à une consommation habituelle et excessive d'alcool, je propose que ces entretiens d'alcoologie en garde à vue, à destination des auteurs d'infractions sous l'empire d'un état alcoolique au moment des faits, soient expérimentés pour une durée de deux ans dans plusieurs départements volontaires. Au terme de cette expérimentation, qui fera l'objet d'une évaluation précise, la décision pourra alors être prise, au regard des résultats obtenus, de généraliser ou non ces entretiens en garde à vue.
Troisième axe de réforme : accroître les mesures de soins alternatifs aux poursuites et ne recourir aux interventions pénales classiques qu'en cas d'échec ou de refus, notamment pour les conduites en état alcoolique. Dans cette perspective, je souhaite mentionner l'expérience innovante qu'a menée le tribunal correctionnel de Besançon entre 1998 et 2003 : les primo délinquants routiers pouvaient bénéficier, dans le cadre d'un ajournement de peine d'un an, d'un programme d'intervention spécifique, sous forme de stages. Cette stratégie – intervention groupale, sous forme de stages – a permis une division par quatre de la récidive à trois ans des conducteurs en état d'alcoolémie primo délinquants. Au regard de l'efficacité de ce dispositif en matière de prévention de la récidive des conduites en état alcoolique, je préconise un recours plus important aux ajournements de peines avec mise à l'épreuve pour les primo délinquants routiers ainsi que le développement, dans le cadre de ces ajournements de peines, des interventions groupales sous forme de stages. L'objectif est double : débanaliser chez le justiciable sa primo conduite en état d'alcoolisation et prévenir la réitération de ces conduites à risque.
À côté des conduites en état alcoolique, il est également important d'agir sur les ivresses publiques et manifestes ou IPM. Chaque année, les mesures d'ivresses publiques et manifestes concernent en moyenne 70 000 personnes par an et représentent environ 50 000 visites médicales. Le champ de procédure de l'ivresse publique et manifeste est également important par la gravité potentielle du phénomène pour les personnes impliquées, puisqu'entre 80 et 90 % des manifestations d'IPM sont à relier à des pathologies chroniques de l'alcool.
Actuellement, l'ivresse publique et manifeste n'est passible que d'une contravention de deuxième classe, qui ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Le contrevenant peut ainsi accumuler un très grand nombre d'IPM, sans qu'il soit possible de constater, à partir du casier judiciaire, la situation de récidive et donc sans que ne puissent être envisagées l'aggravation de la peine ainsi que l'obligation de soins. C'est pourquoi, je propose d'adopter la procédure de l'amende forfaitaire tout en l'aménageant pour favoriser une prise en charge sanitaire adaptée : cet aménagement pourrait consister en la création d'une exemption automatique du paiement de l'amende forfaitaire, à condition que le contrevenant justifie auprès de l'agent verbalisateur avoir pris contact avec une structure spécialisée en addictologie. Si le contrevenant justifie avoir satisfait à la visite, l'action publique sera alors éteinte. Cette visite sera l'occasion pour le contrevenant d'une prise de conscience d'un éventuel mésusage d'alcool et pourra donner lieu, si le contrevenant le souhaite, à une prise en charge adaptée et volontaire.
Mais, ces propositions n'ont un sens et une portée que si elles s'inscrivent dans le cadre plus global d'une véritable politique de santé publique en direction des personnes sous main de justice présentant une addiction à l'alcool. En effet, une fois la phase judiciaire achevée, les personnes placées sous main de justice, présentant une dépendance à l'alcool, bénéficient d'une prise en charge sanitaire, qui se heurte à d'importantes difficultés. En premier lieu, l'actuelle mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie – les CSAPA – qui doivent fusionner les centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) tend à privilégier la prise en charge de la toxicomanie au détriment de l'alcool. En deuxième lieu, la prise en charge sanitaire est très inégale sur l'ensemble du territoire en raison d'une grande hétérogénéité de moyens. Ainsi, les délais de prise en charge par les structures médico-sociales adaptées vont de quelques semaines pour les plus courts à huit ou neuf mois, voire un an, pour les plus longs. Enfin, les structures de soins et les associations rencontrent d'importantes difficultés de financement pour mener à bien leurs actions « alcool et justice ».
Afin de remédier à ces obstacles, je préconise la promotion d'une réponse sanitaire ciblée et adaptée associant départements et nouvelles sources de financement.
Les départements tout d'abord. Par leurs compétences élargies, ils sont concernés au premier chef par la prévention qu'il s'agisse des conduites addictives entraînant des handicaps, des liens entre grande précarité et consommation d'alcool (faible revenu, RMI, allocation parent isolé, aide sociale à l'enfance). Ainsi une partie non négligeable des dépenses départementales d'actions sociales – qui s'élèvent en 2008 à plus de 20 milliards d'euros – est consacrée à réparer les dommages sociaux causés par les mésusages et autres addictions à l'alcool. Si les départements s'engageaient au cas par cas et suivant les contextes locaux dans une démarche volontariste de prévention des dangers de l'alcoolisation, les dépenses sociales destinées à réparer en aval les dommages sociaux de l'alcool pourraient être utilement réaffectées en amont à la prévention. C'est pourquoi, je propose que, la santé restant une compétence de l'État, à qui il revient de fixer la ligne opérationnelle, les départements prennent, sur la base du volontariat, des initiatives complémentaires dans ce domaine.
Nouvelles sources de financement ensuite. La pérennisation des financements des professionnels de santé menant des actions « alcool et justice » auprès des personnes placées sous main de justice est aujourd'hui un enjeu réel qui appelle une réponse forte et adaptée. En effet, la fragilité des financements est aujourd'hui un véritable handicap à un suivi de long terme des personnes présentant une addiction à l'alcool. Dans un contexte budgétaire fortement contraint, il convient de trouver une ressource budgétaire nouvelle, répondant à un objectif clair de santé publique et ne pénalisant pas l'activité économique du pays. Afin d'assurer la pérennité de toute politique publique de prise en charge et de prévention du risque lié à l'alcool, je préconise d'augmenter les droits perçus sur les alcools de plus de 25 % en volume, dont la consommation est la plus nuisible, notamment chez les jeunes. Ainsi, une hausse de seulement dix centimes d'euros par litre (soit une augmentation de 5 %) permettrait de dégager 20 millions d'euros. C'est pourquoi, j'ai l'intention, avec votre accord, de demander au Gouvernement d'inscrire cette mesure dans le prochain PLFSS. En contrepartie de cet effort budgétaire, la pérennisation des financements implique un fort contrôle de l'État ainsi qu'une évaluation régulière des actions menées par les professionnels de santé auprès des personnes placées sous main de justice, l'objectif étant de s'assurer de la bonne allocation des ressources au regard de l'objectif de santé publique poursuivi.
Pour conclure, je suis convaincu que la réinsertion et la prévention de la récidive sont des enjeux tels pour la liberté et la sécurité de nos concitoyens que, si nous voulons lutter plus efficacement contre les pathologies et addictions à l'origine de la récidive, nous devons mettre en place un partenariat ambitieux et durable entre Santé et Justice.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Je voudrais féliciter le rapporteur pour la qualité de ce rapport qui honore notre Commission. Il s'agit en effet d'un travail sans complaisance. Au moment de commencer à étudier cette question, nous nous doutions qu'il s'agissait d'une carence lourde du système : le rapport montre que c'est effectivement le cas et il fait de nombreuses propositions très justifiées, dont beaucoup n'appellent pas des modifications législatives, mais plutôt des changements dans l'organisation. Enfin, je trouve remarquable, en ces temps de contrainte budgétaire, que la mission d'information propose une recette nouvelle pour financer les dépenses qu'elle suggère.

Je laisserai mes collègues, notamment Serge Blisko, aborder le fond de ce rapport très intéressant sur un vrai sujet de société.
Mon intervention a trait à l'organisation de nos travaux. Je dénonce en effet une distorsion dans l'application du règlement : alors que la matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions, un texte fondamental sur le travail dominical est examiné en séance publique. Cela crée une difficulté pour l'organisation de notre travail qui augure mal de la suite de la mise en oeuvre du nouveau règlement. J'émets donc les plus vives protestations sur cette organisation et je souhaite que vous en fassiez part au président de l'Assemblée nationale.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Je ne peux que constater la situation que vous dénoncez, mais celle-ci n'est pas de mon fait. En effet, les travaux de commission ont normalement lieu le mercredi matin. La réunion de la séance publique au même moment résulte d'une décision de la conférence des présidents. Comme vous l'avez demandé, je ferai part de vos remarques au Président de l'Assemblée nationale.

J'observe qu'en réponse à nos rappels au règlement, la présidence a indiqué que cette organisation avait été décidée avec l'accord des présidents de commission.

Avez-vous voté contre cette décision en conférence des présidents, M. le président ? En effet, on nous dit que cette décision a été prise à l'unanimité.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Lorsque cette question a été abordée, il est vrai que personne n'a fait de remarque, ni les présidents de commission, ni les présidents de groupe d'ailleurs !

Il nous a également été indiqué que c'était aux présidents de commission de tenir compte de l'organisation de la séance publique.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Ce n'est pas mon analyse : cette réunion sur un sujet important était programmée depuis longtemps. La situation n'est pas parfaite, mais il fallait tenir compte de la demande de votre président de groupe d'un temps législatif programmé exceptionnel de 50 heures.

Quant à moi, j'ai choisi d'être avec vous plutôt qu'en séance pour écouter l'excellent rapport de la mission d'information.
Le rapport aborde de nombreux manques et insuffisances que nous pressentions. J'insisterai principalement sur deux points. Tout d'abord, je regrette la faible implication du ministère de la santé dans ces questions, notamment en termes d'allocation de moyens.
Ensuite, le rapport insiste à juste titre sur l'insuffisance de la psychiatrie en prison et sur la nécessité d'un suivi très sérieux à la sortie de prison, comme cela est pratiqué à Fresnes avec la mise en place d'une consultation post-pénale. En effet, la rupture de la chaîne de soins ne peut qu'aboutir à un retour en prison et alimenter un cercle vicieux, coûteux et désespérant ! Cette question pose, comme l'a dit le rapporteur, le problème de la sectorisation psychiatrique en fonction du lieu de domicile, en partie inadaptée aux sortants de prison.
La loi de 1998 sur le suivi socio-judiciaire est une excellente loi mais elle est mal appliquée, à cause d'un manque de médecins coordonnateurs. J'hésite sur les solutions préconisées par le rapporteur pour y remédier. Il suggère de permettre de désigner comme médecin coordonnateur l'expert qui a étudié le dossier : je ne suis pas convaincu par cette idée, même si nous serons peut-être contraints de suivre cette voie. De même, le rapporteur propose de supprimer le numerus clausus qui limite à 20 le nombre de condamnés que peut suivre un médecin coordonnateur : il s'agirait un peu d'un constat d'échec, si on augmente le nombre de patients suivis par un même médecin, le suivi sera moins bon !
À cet égard, je rappelle que Mme Dati avait multiplié les promesses sur le sujet, annonçant la création au 1er janvier 2009 de 250 à 300 postes de médecins coordonnateurs que nous attendons toujours.
Par ailleurs, il est impératif d'inciter les psychiatres à s'intéresser davantage à ces populations souffrantes. Par rapport au reste de l'Europe, la France a un ratio de psychiatres par habitant très élevé. Dans ces conditions, il n'est pas normal que tant de personnes ne soient pas suivies ; il y a manifestement là une mauvaise adéquation des moyens, à laquelle il nous faudra trouver des solutions.
Il y a dans le rapport une comparaison sur la prise en charge des personnes dépendantes à l'alcool et aux drogues. Je remarque que l'alcoolisme touche beaucoup plus de monde que la toxicomanie alors que cette addiction est beaucoup moins bien accompagnée. Pourtant, l'alcoolisme est une forme de « toxicomanie » : il s'agit d'une addiction lourde, destructrice et au total très coûteuse pour la société. J'appelle à un effort de réflexion sur ce sujet.
Enfin, il me semble indispensable que la commission assure un suivi de la mise en oeuvre des propositions du rapport.

J'estime que notre pays fait fausse route sur sa politique carcérale et de santé mentale. À chaque fait divers, comme à Pau ou plus récemment à Aubenas, on insiste surtout sur la nécessité d'enfermer ceux qui ont commis ces actes. Pourtant, il est indispensable de ne pas mélanger politique d'incarcération et politique de santé mentale.
La Mission d'appui en santé mentale insiste sur le problème de la démographie médicale en santé mentale, qui se manifeste notamment dans le domaine des urgences psychiatriques. Face à cette situation, aucune réponse satisfaisante n'est apportée. Il ne faudrait pas que nous nous retrouvions dans la situation de l'Italie qui a décidé, il y a cinq ans, de ne plus prendre en charge les personnes atteintes de troubles mentaux, lesquels se retrouvent aujourd'hui « dans la nature ».
Le nombre de personnes incarcérées atteintes de troubles psychiatriques est très important, il peut même atteindre 40 % dans certains établissements : il est vrai que le coût de l'internement en hôpital psychiatrique est quatre fois supérieur à celui de l'emprisonnement… Or, pour des problèmes de démographie médicale, la présence psychiatrique est totalement insuffisante en prison. Le secteur libéral, par exemple, ne répond pas aux demandes des directeurs de prison.
Je voudrais insister sur la proposition n°6 qui suggère l'organisation de conférences nationales rassemblant l'ensemble des référents « santé en prison ». Cela sera sûrement très utile, mais cette démarche devrait également être suivie au plan local où une multitude d'acteurs — ARS, Conseil général, Justice, administration pénitentiaire — interviennent sans véritable articulation. En tant que président de conseil général, je peux vous dire qu'il est difficile d'assurer le suivi médico-social des personnes incarcérées, qui ne sont pas le plus souvent issues du département mais viennent d'autres prisons.

Permettez-moi tout d'abord de souligner la qualité du travail du rapporteur, qui m'inspire quatre considérations.
Tout d'abord, le rapport met en évidence que la course à l'aggravation de la réponse pénale est parfois contre-productive. C'est ainsi que le suivi socio-judiciaire s'applique bien souvent à des cas qui ne le méritent pas, ce qui ne doit pas manquer d'interpeller le législateur.
Ensuite, les expériences menées à Besançon et au Havre démontrent que la lutte contre la récidive passe par un contrôle et un suivi le plus en amont possible.
Par ailleurs, le document illustre l'importance de l'alcool dans la commission d'actes violents, ce que l'on a trop tendance à passer sous silence. À ce titre, un tel rappel est bienvenu.
Enfin, l'idée de taxer les alcools de plus de 25° me semble une idée pertinente mais elle gagnerait à s'appliquer à d'autres alcools qui, telles les bières à 8,5° en cannettes par exemple, causent des ravages tout aussi notables.

Je souhaite moi aussi saluer le travail du rapporteur, qui doit nourrir notre réflexion dans la perspective, encore incertaine si j'en juge le silence évocateur du Président de la République à ce sujet lors de son intervention devant le Parlement réuni en Congrès, du futur examen du projet de loi pénitentiaire.

Je saisis l'opportunité de l'évocation de ce texte important pour indiquer à notre commission que son examen pourrait intervenir en octobre prochain.

Très bien ; ainsi, notre collègue Jean-Paul Garraud ne restera pas indéfiniment le rapporteur de notre commission détenant le record de la nomination la plus ancienne.
Pour en revenir au rapport d'information qui vient de nous être présenté, j'observe que les indications qu'il présente corroborent le ressenti de nombreux parlementaires à l'occasion des visites qu'ils réalisent de maisons d'arrêt ou d'établissements pénitentiaires. Il fait apparaître des besoins criants, auxquels sont apportées des réponses bien lentes.
J'ai personnellement été effaré par les chiffres évoqués, notamment ceux qui font état de 40 % de détenus en état dépressif et de 20 % souffrant de pathologies mentales. Je suis également surpris par l'appréciation du rapporteur sur l'évolution des suicides, dans la mesure où j'ai le sentiment inverse de la diminution qu'il annonce. Enfin, il est question de difficultés liées au respect du secret médical et, dès lors que des règles déontologiques s'imposent au corps médical, il me semble que le problème s'apparente avant tout à un dysfonctionnement de la médecine. En tout état de cause, j'aimerais avoir des précisions sur ce point ainsi que sur les préconisations faites pour y apporter une réponse.

Cet excellent rapport fait référence à une expérimentation menée par le tribunal correctionnel de Besançon au sujet de la lutte contre la récidive concernant les infractions routières sous l'emprise de l'alcool. En ma qualité d'élu local, j'ai suivi de près cette expérience et je pense être à même d'en tirer des conclusions avisées.
Pour mémoire, le tribunal passait un contrat avec chaque primo délinquant débouchant sur une reconnaissance puis une déclaration de culpabilité. L'intéressé devait s'engager à faire l'objet d'un suivi et à réaliser des stages de sensibilisation et de désintoxication. Au terme de ceux-ci, il comparaissait de nouveau devant le tribunal qui prononçait des peines adaptées. Une évaluation de cette démarche a montré qu'elle diminuait très sensiblement les cas de récidive. Pour autant, elle a été abandonnée en raison de son coût supposé, avant même que des solutions, en partenariat avec les collectivités territoriales, puissent être envisagées, ce que je regrette.
Je ne peux donc qu'être heureux que le rapporteur reprenne à son compte ce dispositif qui a fait ses preuves.

Le rapport qui vient de nous être présenté est intéressant et concrétise un travail considérable. Je forme le voeu qu'à la différence de bien d'autres documents consensuels ayant trait à la justice et aux questions pénitentiaires, il trouve une traduction politique et budgétaire concrète. Je crains malheureusement que cela ne soit pas le cas.
Les cinq propositions les plus opérantes, portant les n°s 1, 2, 8, 9 et 13 nécessitent toutes des crédits. Pour juger de leur mise en oeuvre, notre commission doit d'ores et déjà prendre rendez-vous lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010. C'est à ce moment-là que nous verrons si le Gouvernement a pris en considération ces propositions et entend les appliquer.
Encore une fois, on peut en douter. Il y a trop longtemps que la justice est le parent pauvre de l'État.

À mon tour, je souhaite saluer le travail du rapporteur. Comme cela a été dit, il conviendra de veiller à l'articulation de ses propositions avec le contenu du projet de loi pénitentiaire et avec les moyens alloués à l'administration pénitentiaire.
Je pense que nous sommes tous d'accord sur le constat de la surpopulation carcérale dans les prisons. La santé mentale des détenus, qui affecte également les conditions de travail des gardiens surveillants, est naturellement une source de difficultés supplémentaires.
Pour autant, il me semble que la question ne se résume pas obligatoirement à plus de crédits. À cet égard, nous aurons certainement à demander des comptes, lors du prochain budget, à l'administration pénitentiaire sur l'usage des crédits qui lui sont alloués, lesquels, je le rappelle, ont augmenté de 10 % ces cinq dernières années.

Ce rapport est utile et intéressant. Ayant moi-même activement participé aux travaux d'une mission d'information sur la récidive il y a quelques années, je suis bien obligé de constater qu'un certain nombre de sujets et de préconisations ne sont pas nouveaux. C'est dire que le consensus trouvé alors, appelé à se renouveler aujourd'hui, n'a pas produit les résultats escomptés.
Deux propositions du rapport appellent plus particulièrement des observations de ma part.
La première, figurant sous le n° 12, consiste à permettre que l'expert qui a étudié un dossier puisse ensuite être nommé médecin coordonnateur dans le même dossier. Je crains que cela ne conduise la personne condamnée à voir dans cet expert un intervenant partial et ne soulève, par la suite, bien des problèmes.
La seconde proposition, figurant sous le n° 42, vise à créer une taxe sur les alcools forts. Sans contester que ceux-ci provoquent parfois des addictions, je ne suis pas certain qu'ils engendrent les cas d'alcoolisme les plus fréquents. Ne pourrait-on donc pas taxer les alcools qui, tels la bière ou le vin, entrent dans les addictions habituelles des personnes alcooliques ?

Avant que le rapporteur ne réponde, je tiens à préciser que le précédent rapport d'information de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures a donné lieu à l'adoption de dispositions de nature législative. Il en ira de même pour les préconisations de nature législative du rapport présenté aujourd'hui.
Il reste que certaines propositions ne sont pas de nature législative, ce qui amoindrit naturellement la prise que le législateur a sur leur mise en oeuvre. Notre commission ne se dessaisira pas pour autant de son travail, l'examen du projet de loi de finances pour 2010 ainsi que celui d'autres textes d'initiative gouvernementale nous offrant l'occasion d'interroger les ministres en charge de ces questions.

Bien qu'il soit difficile de répondre à l'ensemble des remarques qui viennent d'être faites, je souhaiterais faire quatre observations.
En premier lieu, la prison est aujourd'hui devenue, dans certains cas, un hôpital psychiatrique, où on enferme nombre de personnes. Lorsque nous nous sommes rendus en prison lors des déplacements de la mission, nous avons pu constater les cris et les comportements des surveillants à l'égard des détenus. Alors que nous étions présents, un détenu, au moment du portage des repas, a frappé un de ses gardiens. Ces derniers nous ont indiqué qu'ils n'envisageaient pas de le sanctionner, dans la mesure où il s'agissait de faits itératifs et habituels de la part de ce détenu, faits sur lesquels il ne leur était pas possible d'agir. Nous estimons que la présence de ces détenus en prison doit être l'occasion de se faire rencontrer santé et justice. Or, le partenariat en détention entre ces deux administrations ne fonctionne pas ou de manière très imparfaite. À titre d'exemple, alors qu'un médecin, chargé de suivre les questions sanitaires en prison, est présent au ministère de la justice, aucun haut fonctionnaire de la justice n'a été détaché auprès du ministère de la santé, le poids des habitudes de travail étant déterminant. Ce manque de coordination entre santé et justice peut notamment expliquer l'absence dans les SROS d'un volet spécifiquement dédié à la question de la médecine en prison, volet qui permettrait de poser un constat partagé et d'identifier les moyens adéquats. En définitive, nous avons deux administrations, santé et justice, qui s'ignorent et peinent à travailler ensemble. Il faut qu'à l'avenir, le ministère de la santé soit plus impliqué sur la question de la santé en prison. Nous avons d'ailleurs fait dans ce rapport des propositions afin que santé et justice prennent l'habitude de travailler ensemble.
En deuxième lieu, s'agissant des infractions liées à l'alcool, nous savons que, sur le plan statistique, 70 % des crimes de sang sont commis sous l'emprise de l'alcool. Mon sentiment est qu'il s'agit là d'un sujet sensible, qui touche aussi bien à l'aménagement du territoire qu'à des pans entiers de notre activité agricole. En matière d'alcool, nous devons mettre en place une véritable politique publique de prévention et d'accompagnement. Actuellement, lorsque sont commis des faits délictuels ou contraventionnels (comme les ivresses publiques et manifestes) qui révèlent un problème d'alcool, le système de santé et d'accompagnement est nettement insuffisant et présente certains dysfonctionnements. Il intervient notamment trop tardivement, alors qu'il devrait être actif dès lors que les infractions sont constatées. Plus la prise en charge (groupes de parole, psychiatres, psychologues) est précoce, plus la prévention de la récidive est aisée. Comme l'a souligné Marcel Bonnot, l'expérience du recours, en pré-sentenciel, aux ajournements de peines, couplés à des interventions groupales sous forme de stages, au tribunal correctionnel de Besançon entre 1998 et 2003, a permis de diminuer très sensiblement la récidive des conduites en état alcoolique. En définitive, les problèmes d'alcool doivent bénéficier d'une intervention précoce en pré-sentenciel et d'un accompagnement plus adapté par les centres d'alcoologie. À ce stade, les départements, en raison de leur rôle déterminant en matière de prévention, doivent également accompagner ce dispositif.
En troisième lieu, s'agissant du secret médical, nous avons constaté l'existence de divergences de fond. Si certains experts psychiatres estiment que le secret médical ne pose pas problème, des pratiques s'étant mises en place au cas par cas, d'autres en revanche jugent nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation en la matière. Ma conviction est qu'il n'est nul besoin d'un texte nouveau sur le secret médical. Il existe des échanges de bon sens, qui se pratiquent d'ores et déjà au quotidien : lorsqu'un détenu va mal, il doit pouvoir en parler avec le psychiatre, ce dernier, après avoir traité les informations, devant pouvoir échanger librement avec l'administration pénitentiaire. Les équipes médicales et les personnels pénitentiaires ont trouvé d'eux-mêmes les limites du secret médical. Aussi n'est-il pas nécessaire de légiférer.
S'agissant enfin du rôle joué par le médecin coordonnateur, il présente l'avantage de lever le problème du secret médical. En effet, il informe le juge de l'application des peines des éléments qui sont à sa disposition et qui relèveraient théoriquement du secret médical, s'il était le médecin traitant de la personne suivie. Parmi les mesures pour remédier au manque de médecins coordonnateurs, rien ne fait obstacle à ce qu'un expert soit nommé médecin coordonnateur dans le même dossier. En effet, le médecin coordonnateur n'est pas un médecin traitant, mais un simple relais entre le soin et l'institution judiciaire. Ainsi, dans certains départements, les juridictions disposent d'experts, mais pas de médecins coordonnateurs : si les premiers pouvaient également exercer les fonctions des seconds, le problème de la pénurie serait en partie résolu.
En conclusion, je partage les analyses faites par mes collègues sur le budget de la Justice. Nous constatons cependant qu'il est en progression régulière chaque année. Notre rapport vise également à souligner que la réponse à apporter à ces problèmes ne réside pas uniquement dans le budget de la justice, mais également dans celui de la santé et des départements.

Je souhaiterais savoir si vous vous êtes intéressé au suivi des enfants nés en milieu carcéral ainsi que de leurs mères et si vous avez formulé des préconisations à ce sujet.

Dans mon rapport, je n'ai pas abordé ce thème qui devrait l'être dans le cadre du rapport sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes mineures placées sous main de justice.
Conformément à l'article 145 du Règlement, la Commission autorise le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.
La Commission examine le rapport d'information budgétaire de M. Bernard Derosier sur les formations internationales des agents publics.

Le 16 décembre 2008, sur proposition du président Jean-Luc Warsmann, la commission a désigné des rapporteurs d'informations sur l'exécution budgétaire.
Lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2009, j'avais remarqué que les crédits des formations internationales diminuaient de 550 900 euros, soit une baisse de 22 %. J'avais donc souhaité en savoir plus.
C'est ce qui m'a amené à m'intéresser plus spécifiquement aux formations internationales, qui s'adressent aussi bien aux fonctionnaires français qu'aux fonctionnaires internationaux. On connaît généralement les formations de l'ENA, mais il en existe d'autres en Europe, que la France contribue à financer.
Je voudrais vous faire part d'un premier constat : la difficulté à réunir des informations sur ces formations internationales des agents publics. Il n'existe pas de ministère dédié à ce domaine. Certaines formations sont financées par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'autres par le ministère des affaires étrangères et d'autres encore par les budgets de formation propres aux différents ministères. Il est donc difficile, voire impossible d'avoir une vision globale, d'autant plus que les ministères que je viens de citer ne considèrent pas ce sujet comme prioritaire. Il ne fait pas l'objet d'une stratégie d'ensemble, par exemple, alors même que dans un contexte budgétaire tendu il pourrait être de bonne méthode de chercher à déterminer des priorités. Je tiens d'ailleurs à saluer la collaboration établie avec le directeur de l'ENA pour l'élaboration de ce rapport car ils ont répondu de manière très complète et détaillée aux questions que je leur ai adressées.
Je vous présenterai, dans un premier temps, les différents acteurs en matière de formation internationale puis, dans un deuxième temps, les types de formations proposées et, enfin, l'intérêt de maintenir une présence française significative sur le marché des formations internationales.
S'agissant des acteurs, on observe depuis plusieurs années une simplification du paysage français. La France comptait il y a quelques années pas moins de trois grands organismes en matière de formation internationale : l'ENA, qui accueille des fonctionnaires étrangers dans sa scolarité depuis 1949, l'Institut international d'administration publique, qui dispensait des cycles de formation continue aux fonctionnaires étrangers, et le Centre des études européennes de Strasbourg, qui est spécialisé dans les questions européennes.
Ces formations internationales sont désormais regroupées sous l'égide de l'ENA. Cette dernière a fusionné avec l'Institut international d'administration publique en 2002 et avec le Centre des études européennes en 2005. On a donc, désormais, un seul grand pôle de formations internationales en France, ce qui est préférable pour atteindre la taille critique pour ce genre d'actions. Cela permet aussi de profiter de la renommée de l'ENA à l'étranger pour valoriser les différents produits de formation.
Le budget de l'État finance également des organismes étrangers de formation des fonctionnaires. C'est le cas de l'Institut européen d'administration publique de Maastricht ou du Collège d'Europe de Bruges. Le fait de leur verser une subvention forfaitaire, parfois modeste, de l'ordre de 55 000 euros, donne le droit de présenter des élèves français – sachant que la formation reste malgré tout payante – et surtout de siéger au conseil d'administration et ainsi d'avoir de l'influence sur les programmes et le choix des enseignants.
L'État finance enfin une formation unique en son genre : le Master européen de gouvernance et d'administration. Il s'agit d'une formation franco-allemande, diplômante dans les deux pays, qui s'adresse principalement à des hauts fonctionnaires français et allemands mais qui peut accueillir des élèves d'autres pays européens. Elle dure un an et se déroule en alternance en France et en Allemagne. C'est une formation assez généraliste, un peu sur le modèle de celle de l'ENA. C'est cette formation qui avait subi une suppression de ses crédits dans le projet de loi de finances, avant qu'ils ne soient rétablis.
Pour compléter ce panorama des formations financées par l'État, les organismes de formation des fonctionnaires territoriaux font également de la coopération administrative en matière de formation des agents publics locaux. Le CNFPT ou l'INET ont conclu des partenariats avec des écoles étrangères et accueillent des stagiaires étrangers. L'INET, qui est implantée à Strasbourg, coopère de plus en plus avec l'ENA et propose des modules communs de formation.
En deuxième lieu, cette variété d'intervenants signifie une grande variété de formations proposées.
L'offre de formation est très riche. Même en se limitant aux formations de l'ENA, on voit un catalogue d'une diversité que l'on ne suppose pas. L'ENA propose des formations de toutes durées, allant de quelques jours à 18 mois. Certaines formations sont prédéfinies – ce sont les « cycles internationaux », d'autres sont dispensées « sur mesure » quand l'ENA répond à des appels d'offres d'États étrangers ou de la Commission européenne. Certaines formations sont à dominante académique, avec une scolarité, d'autres sont beaucoup plus opérationnelles avec des ateliers d'échanges de bonnes pratiques ou des stages en responsabilité dans une administration française ou étrangère. Rien que pour les questions communautaires, il existe six catégories différentes de formations.
L'importance de l'offre de l'ENA s'explique largement par les fusions successives que j'ai évoquées et lui permet d'avoir une place de premier rang sur le marché international des formations des fonctionnaires. C'est un point important, car contrairement aux formations initiales des fonctionnaires français, les formations internationales se déroulent dans un cadre concurrentiel qui impose d'être attractif et compétitif. L'ENA forme aujourd'hui des agents publics en provenance de 120 pays, de tous les continents, y compris l'Océanie ! En Europe, elle fait partie des quatre grandes écoles de fonctionnaires et forme donc un nombre très important de fonctionnaires de l'Union européenne. Son programme de préparation aux concours communautaires est d'ailleurs le plus performant en Europe. Au vu de ces résultats, la constitution à l'ENA d'un pôle français de formation internationale peut donc être considérée comme un succès.
C'est d'ailleurs ce succès qui a permis à l'ENA de maintenir une offre de formation importante malgré les restrictions budgétaires imposées depuis plusieurs années. L'ENA a en fait tout simplement développé ses formations payantes, notamment les réponses aux appels d'offres étrangers, pour compenser la diminution des crédits versés par l'État pour la coopération. Concrètement, cela signifie une réorientation vers les clients les plus « solvables », notamment les pays d'Europe ou la Commission européenne. Mais ces recettes sont malheureusement des recettes fragiles, qui fluctuent au gré de la demande.
Il me paraît important de ne pas fragiliser les formations internationales en réduisant de manière trop systématique leur budget, ce qui m'amène à mon troisième et dernier point : pourquoi est-il important de développer les formations internationales ?
Pour les fonctionnaires, c'est bien sûr une source d'ouverture. En côtoyant des fonctionnaires étrangers ou en découvrant le fonctionnement d'autres administrations, ils peuvent comparer les différents systèmes et les différences de conduite des politiques publiques. Cela leur donne du recul par rapport à nos propres pratiques et c'est incontestablement un « bol d'air » pour l'administration française. Cela peut notamment fournir des pistes de réforme. Cela permet également de disposer de fonctionnaires possédant des compétences pointues sur le fonctionnement des institutions communautaires ou internationales.
Mais l'État tire aussi des bénéfices à long terme des formations internationales. En finançant des écoles étrangères et en accueillant des hauts fonctionnaires étrangers à l'ENA, la France a tissé des liens avec ceux qui seront les décideurs publics étrangers quelques années plus tard. Elle leur fait connaître son modèle juridique et promeut les valeurs auxquelles elles est attachée. La connaissance acquise de la France facilitera ensuite le dialogue et la compréhension mutuelle dans les discussions internationales. Enfin, l'existence de formations prestigieuses est un élément de promotion de la francophonie. Par exemple, l'excellence de la préparation aux concours communautaires incite des ressortissants des nouveaux États membres à apprendre le français avant de passer les concours, et cela participe ensuite à l'utilisation du français dans les institutions communautaires. Les répercussions sont donc plus importantes que ce que l'on pourrait croire.
Par conséquent, sacrifier certaines formations internationales pour des motifs budgétaires pourrait remettre en cause la place de la France au niveau international, et surtout au niveau communautaire, et il serait difficile de la retrouver ensuite.
Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas faire d'économies sur le budget de ces formations. On peut certainement continuer à rationaliser le fonctionnement des différentes formations pour réaliser des économies d'échelle, comme on l'a fait avec le regroupement au sein de l'ENA. Les coûts de fonctionnement pourraient être maîtrisés, par exemple en supprimant les déplacements de courte durée des promotions à l'étranger, qui coûtent très cher pour un intérêt assez relatif. S'agissant du Master européen de gouvernance et d'administration, que le ministère envisage de supprimer alors qu'il s'agit d'une des seules formations authentiquement internationales, on peut certainement trouver d'autres solutions pour le dynamiser. Je pense notamment à une augmentation du nombre de stagiaires. Avec des promotions d'une vingtaine de personnes, il est probable que le seuil de rentabilité n'est pas atteint.
En conclusion, je voudrais insister sur l'importance pour l'État de mieux prendre en compte les formations internationales et de définir une stratégie globale en la matière. Aujourd'hui, l'éparpillement des différentes formations ne permet peut-être pas une efficacité optimale. Il serait préférable de penser à une réorganisation pour rendre ces formations plus efficaces plutôt que de se désengager complètement de certains secteurs.

Je remercie notre collègue pour la qualité de son travail. À travers un tel sujet, ce sont des questions aussi importantes que celle du rayonnement de notre pays, de sa capacité d'influence, qui transparaissent. Je crois qu'un suivi sera nécessaire, et pourra notamment être assuré par le rapporteur lors de l'examen budgétaire.

Dispose-t-on de statistiques sur les fonctionnaires d'origine française au sein des institutions européennes ? Je me souviens en effet que M. Michel Barnier expliquait que les Français étaient sur-représentés au niveau des postes de direction, mais sous-représentés à l'échelle de l'ensemble de la fonction publique européenne.
Par ailleurs, un suivi des carrières des personnes qui ont bénéficié d'une formation internationale en France est-il assuré ?

La Suisse, voisine de ma circonscription, abrite un certain nombre d'organisations internationales, dont l'ONU. Des formations spécifiques sont-elles dispensées en France aux fonctionnaires internationaux de cette organisation ?

Le suivi d'une formation internationale est lié à la maîtrise de langues étrangères. Comment ce préalable est-il pris en compte dans les différentes filières de formation ?

Il existe sûrement des statistiques sur le nombre de fonctionnaires français dans les institutions communautaires mais je ne dispose pas de ces chiffres puisque mon rapport portait exclusivement sur les formations.
Pour répondre à M. Étienne Blanc, lorsque l'ONU a besoin de formations pour ses fonctionnaires, l'ENA fait partie des organismes pouvant être retenus pour délivrer ces formations.
S'agissant des problèmes de langue, l'ENA propose aussi des formations en anglais ou en espagnol. De plus, dans le cadre européen, la question de la langue est liée à la politique du Secrétariat général aux affaires européennes en matière de promotion de l'influence française dans les nouveaux États membres de l'Union européenne. Comme la présidence française de l'Union européenne a été reconnue comme efficace par les autres États membres, la préparation française à la présidence est devenue une référence. Les États qui vont assurer la présidence font donc souvent former leurs fonctionnaires par l'ENA. Tout cela montre que la langue ne constitue pas un problème, d'autant plus que l'on observe une revitalisation de l'usage du français.
Enfin, s'agissant du suivi des élèves, nous sommes encore dans une première phase. Il serait souhaitable de désigner un pilote, éventuellement auprès du Premier ministre ou du ministre des affaires étrangères, pour assurer une meilleure coordination et instaurer un suivi qui aujourd'hui n'existe pas. Pour les fonctionnaires français, le fait d'avoir suivi une formation internationale est souvent un plus dans leur carrière, mais n'est pas pris en compte en tant que tel dans la gestion des ressources humaines.
Conformément à l'article 145 du Règlement de l'Assemblée nationale, la Commission autorise le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.
Le Président Jean-Luc Warsmann, informe ensuite la Commission que le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, a finalement renoncé à proposer une disposition législative supprimant les classements de sortie dans les écoles de la fonction publique. En réponse à une demande de M. Bernard Derosier, il souligne que cette question ne pourrait revenir au stade de la commission mixte paritaire.
Informations relatives à la Commission