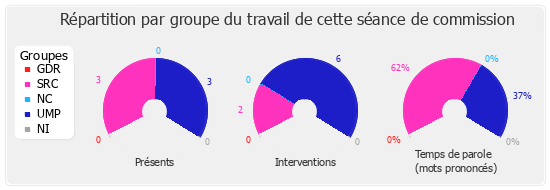Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 25 mai 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 25 mai 2011
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. Serge Blisko, député, coprésident et de M. François Pillet, sénateur, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies entend M. Michel Gaudin, préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, M. Thierry Huguet, chef de la brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire, et M. Renaud Vedel, directeur-adjoint de cabinet du préfet de police.

Monsieur le préfet, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je précise, monsieur Michel Gaudin, que vous êtes également membre du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et que vous avez été chargé de la préparation d'un livre blanc sur la sécurité publique.
Messieurs, pourriez-vous nous présenter les enseignements que vous tirez de votre expérience en matière de lutte contre les toxicomanies ? Le dispositif existant vous semble-t-il adapté ou mériterait-il des ajustements ? Enfin, au vu de votre expérience sur le terrain, quels sont les grands enjeux et les particularités de la lutte contre les toxicomanies dans les quatre départements qui constituent en quelque sorte le « Grand Paris » de la police et qui forment une zone urbaine très dense ?
Merci de nous recevoir pour évoquer cette problématique essentielle de la délinquance dans l'agglomération parisienne.
La fonction de la préfecture de police n'est pas de commenter la loi mais de l'appliquer – d'autres institutions de la République devraient peut-être s'en inspirer…. Or, la consommation de drogues est interdite en France. Aussi, si nous ne sommes bien sûr pas ignorants de la réalité de la consommation, nous luttons essentiellement pour éviter les trafics.
Des parallèles sont effectués entre les drogues et d'autres substances comme l'alcool et le tabac. Il reste que, quelque néfastes que puissent être parfois les effets de ces substances, elles sont légales.
Mon expérience dans la police m'a amené à la conviction que la drogue est un « cancer » pour la région parisienne ; j'ai déjà eu l'occasion de le souligner lorsque j'étais directeur général de la police nationale. Lors de mon arrivée à Paris, en 1987, j'ai veillé à ce que l'ensemble des services de la préfecture de police s'attaque, dans le cadre d'une organisation coordonnée et d'un plan d'ensemble, à cet objectif primordial de la lutte contre la délinquance. En octobre 2007, nous avons mis en place un plan de lutte contre la drogue.
Nous avons conservé la même démarche lorsque l'agglomération de police a été créée, le 9 septembre 2009. Nous disposons, dans les quatre départements, de plans de lutte contre la drogue, qui montrent l'ampleur du phénomène. Ainsi, l'an dernier, nous avons traité 2 890 affaires, qui se sont traduites par 5 619 interpellations. L'action répressive a abouti à la saisie de 392 kilos de cocaïne, 3,276 tonnes de résine de cannabis, 1 001 kilos de crack et d'importantes quantités de Subutex pour un montant total de 7 millions d'euros, tandis que 400 000 euros ont été bloqués sur des comptes bancaires. Depuis le début de cette année, le rythme est resté le même, avec 1 279 affaires et 2 281 interpellations. Nous poursuivons résolument nos opérations, avec de plus en plus de succès.
Cette partie répressive de notre métier s'accompagne d'un volet de prévention que nous ne négligeons en aucune façon. Le phénomène est trop préoccupant sur le plan sanitaire comme en termes d'organisation de l'économie souterraine. Il nous faut donc sensibiliser nos concitoyens, notamment les jeunes, à cette problématique.
À Paris, notre action de prévention est conduite dans le cadre du contrat de prévention et de sécurité que nous avons signé avec le maire de Paris, qui est parfaitement conscient des difficultés. Mes trois collègues de la petite couronne travaillent également dans le cadre de tels contrats.
Nous disposons, intra muros, de vingt-six policiers formateurs antidrogue. Chaque année, nos interventions touchent 14 000 écoliers et collégiens et 11 000 lycéens.
Depuis deux ans, nous complétons ce travail par des colloques ou séminaires car, même si cela ne fait guère partie de la culture de la préfecture de police, il faut faire davantage pour sensibiliser la population aux dangers encourus. Un premier séminaire s'est tenu à la Sorbonne, avec l'ensemble des intervenants potentiels et des témoignages non pas de policiers mais de psychologues, de sociologues et de pédopsychiatres. Réédité à deux reprises, le document final porte sur les effets du cannabis sur la santé et l'intégration sociale des jeunes. Notre seconde séance a pris la forme d'une soirée sur la cocaïne à la Conciergerie.
L'action qui est conduite à Paris dans une perspective sanitaire est de taille et nous nous y associons pleinement car elle vise également à réduire les risques.
Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes et les centres de cure ambulatoire en alcoologie ont été regroupés au sein de dix-neuf centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, dont douze sont généralistes, cinq dédiés spécifiquement aux drogues et deux à l'alcool.
On compte également neuf centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, dont l'existence est un élément très important du débat sur les salles de consommation contrôlées à moindres risques. Pour une articulation intelligente des politiques, nous avons demandé aux policiers de faire preuve de beaucoup de discernement et nous n'appliquons guère notre politique répressive aux alentours de ces centres. Ainsi, nous avons accepté, en accord avec la Ville de Paris et en concertation avec les mairies d'arrondissement, de retirer les caméras là où l'on pouvait nous suspecter d'utiliser des images de toxicomanes venant se faire soigner. Travailler avec discernement est pour nous essentiel et cette démarche va bien au-delà de la déontologie.

La situation dans l'agglomération parisienne est-elle sensiblement différente de celle d'autres capitales ou grandes agglomérations, en Europe et aux États-Unis ?
Je ne dispose pas d'éléments de comparaison très précis. Il reste qu'il ne faut pas exagérer le caractère catastrophique de la consommation de drogues en région parisienne. Depuis dix ou quinze ans, la drogue est aussi présente dans les communes rurales les plus reculées.
En France, la drogue est interdite. Pour autant, un dispositif de réduction des risques a été instauré, depuis 1987 pour les seringues et depuis les années 1990 pour les produits de substitution. Cela n'existe évidemment pas dans les pays qui ont légalisé la consommation.
Le débat tourne en effet autour de la légalisation. Dans mes anciennes fonctions, j'étais assez peu apprécié des représentants de la police néerlandaise, d'autant que je reprenais souvent une expression du Président de la République Jacques Chirac : je persiste à penser que les Pays-Bas sont un « narco-État », un loup dans la bergerie européenne. Aujourd'hui, il circule plus de drogue dans les capitales des pays où la consommation a été libéralisée que chez nous.
Au-delà de la simple bienveillance de la police aux abords des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, l'expérimentation de centres d'injection supervisés serait-elle adaptée à la situation parisienne ? Quelles difficultés soulèverait-elle, notamment au regard des poursuites ?
Accepter un tel système serait faire un pas vers la légalisation. Il ne s'agirait plus de tolérance de la police, mais de consommation légale de drogues.
La première difficulté tiendrait au positionnement de la police par rapport à ces centres. Quelle est la pratique au regard de ceux que je persiste à appeler les toxicomanes ? Les salles de consommation seraient destinées aux personnes les plus touchées, ce qui renvoie à la problématique du crack. Si le sort des personnes dépendantes ne peut que nous émouvoir, il faut aussi penser aux problèmes liés aux sites de consommation, tel celui de la place de Stalingrad, dans le XIXe arrondissement de Paris. Nous avons réalisé des opérations policières contre ce site, en particulier avec le groupe local de traitement de la délinquance. Le site s'est alors déporté vers la porte d'Aubervilliers, puis, compte tenu de la vigueur de l'action de la préfecture de police, vers la gare de Saint-Denis. Depuis la mise en place de la police d'agglomération, Paris a été un peu réinvesti. Les interpellations réalisées il y a trois semaines dans le XIXe arrondissement se sont traduites par vingt emprisonnements ; la police est aussi très présente sur le site de Stalingrad.
Un dispositif renforcé de maraude serait au moins aussi efficace qu'un lieu fixe, dans lequel les usagers de drogues n'iraient pas forcément, et qui serait une légalisation de fait non seulement de la consommation, mais aussi du transport de drogues illicites : outre qu'un porteur de drogues un peu informé expliquera qu'il allait justement vers la salle de consommation, même s'il en est très éloigné, il faudra accepter qu'une personne puisse se déplacer jusqu'à la salle avec un produit qu'elle aura acheté frauduleusement. Sur place, le produit devra être testé car un dispositif institutionnalisé ne peut pas prendre le risque de permettre la consommation de produits frelatés, qui peuvent provoquer surdoses et décès.
Mais je n'exprime ici que mon sentiment et il est légitime d'entendre tous les arguments autour de la proposition de M. Jean-Marie Le Guen.

Organisez-vous des présences policières régulières dans des établissements scolaires où peuvent se dérouler des trafics d'autres produits que le cannabis ?
Le plan permettant de surveiller les lieux où la drogue peut être consommée a été bien préparé en 2007 ; il a ensuite été étendu aux départements de la petite couronne. En revanche, la surveillance des établissements scolaires ne va pas beaucoup plus loin que la surveillance scolaire normale. On sait que des trafics s'y déroulent, essentiellement autour du cannabis, mais aussi d'autres substances. Je rappelle que le plan ne visait pas de simples consommateurs, alors que notre objectif n'est en rien de nous attaquer à eux pour accroître notre volume d'affaires élucidées.
Les problèmes des établissements scolaires sont réels. Vendredi prochain, dans un établissement de Saint-Ouen, les enseignants organiseront une « journée morte » pour protester contre un trafic de drogue devenu insupportable. Avant-hier, une opération d'envergure organisée avec le préfet de Seine-Saint-Denis a permis des saisies importantes.
Depuis trois ou quatre ans, nous disposons d'une carte de l'ensemble de l'agglomération et le plan est structuré par zones prioritaires : nous savons que, boulevard Ney, nous devons procéder tous les deux ans à des démantèlements de systèmes de distribution de drogue.
À Paris, nous devons aussi faire face à la problématique des lieux festifs. Nous sommes très vigilants. J'ai reçu l'an dernier les gérants de discothèques pour leur expliquer que le trafic de drogue n'y serait plus toléré. Nous sommes très actifs.
Indépendamment du plan de lutte contre les stupéfiants, la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les établissements scolaires est une préoccupation particulière de tous les services spécialisés. Tout trafic qui touche une école acquiert une sensibilité particulière et exige une réaction immédiate.
Le caractère pénal que notre législation confère à la consommation de stupéfiants a entre autres avantages celui d'aboutir à ce que, dans l'immense majorité des cas, les services de police apprennent que leur enfant a commencé à consommer des produits stupéfiants aux parents, qui ne sont pas, loin s'en faut, les mieux placés pour observer les premiers signes d'une telle consommation.
Nous sommes régulièrement alertés de l'émergence de trafics par des associations de parents d'élèves, des responsables d'établissements scolaires ou des élus locaux. Une surveillance policière est immédiatement mise en place. Dans la majorité des cas, nous procédons à l'identification du ou des revendeurs qui approvisionnent ces établissements et à leur interpellation.

Je ne peux que dire du bien du travail du préfet de police et de la brigade des stupéfiants au service de la loi.
Mais, si votre tâche est d'appliquer la loi, la nôtre est d'examiner si elle est adaptée ou s'il faut la faire évoluer.
Le constat commun des membres de notre mission d'information est que notre pays – il n'est certes pas le seul – est en situation d'échec au regard de la consommation de drogues. Alors que nous souhaiterions tous que la demande disparaisse et que l'offre se tarisse, la réalité, c'est que la demande ne diminue pas et que l'offre s'adapte.
Vous avez eu raison d'évoquer le cannabis, mais il n'est pas la priorité de notre mission. Alors que la chasse à la « fumette » mobilise beaucoup de moyens, je crois savoir que la consommation de cannabis des Néerlandais est en net recul, notamment chez les jeunes. C'est l'absence d'harmonisation des législations européennes, pourtant hautement souhaitable, qui crée un effet d'aubaine et fait des Pays-Bas le fournisseur de l'Europe. Les Néerlandais revoient du reste aujourd'hui leur politique.
Le XVIIIe arrondissement de Paris est confronté au retour du crack. Nous avons d'ailleurs organisé les « États généraux du crack ». Le plan anti-crack a-t-il donné des résultats, ou est-il abandonné ?
La création de Coordination toxicomanies 18, que notre mission d'information a auditionnée, a été vécue très positivement non seulement par les toxicomanes, mais aussi par la population de l'arrondissement qui ne supportait plus l'environnement qui lui était imposé. Elle correspond à l'idée que devenir dépendant de la drogue n'arrive pas qu'aux autres et que des prises en charge sont nécessaires. Faut-il améliorer le nombre et la qualité des prises en charge, ou ne produisent-elles que des résultats décevants ?
Il y a eu des tentatives pour faire évoluer la loi du 31 décembre 1970. Mme Simone Veil, ministre chargée de la santé, s'y était attelée. L'actuel Président de la République avait lui-même envisagé, en 2003, la contraventionnalisation de la consommation de cannabis, donc une forme de dépénalisation qui, pour moi, n'est pas la bonne solution.
S'agissant des salles de consommation sécurisées, ne croyez pas que M. Jean-Marie Le Guen et moi-même sommes mus par le laxisme et la volonté de permettre un libre accès à la drogue. Notre démarche est au contraire sanitaire et vise à protéger les populations, y compris celles qui souffrent de la consommation dans les cages d'escalier ou sous les piles du boulevard périphérique. À Bilbao, une telle politique, mise en oeuvre par une municipalité de gauche, a été poursuivie par une municipalité de droite. Genève a également ouvert de telles salles. Pour moi, le laxisme, c'est le statu quo.
Je suis beaucoup plus sceptique que vous quant à l'évolution de la consommation aux Pays-Bas, dont une partie ne peut être mesurée.
Les études sur le danger du cannabis ont évolué depuis les propositions faites en 2003 par M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur. Depuis le rapport de l'Académie nationale de pharmacie de 2008, je suis convaincu que les drogues sont toutes dangereuses. Un éditorial de Libération concluait même que « le temps de la naïveté est terminé ».
Il est donc essentiel d'informer nos enfants. Le recteur de l'Académie de Paris a bien voulu diffuser sur le site internet du rectorat un document rédigé par la préfecture de police, c'est une première !
Monsieur Daniel Vaillant, le plan que vous avez mis en place a assez bien réussi. Des instructions ont été données aux policiers pour qu'ils laissent tranquilles les gens qui veulent se soigner.
Si les salles de consommation à risques limités n'ouvraient pas la voie à un début de légalisation des produits, j'y serais favorable. Il est en effet impossible sur un plan sanitaire et humainement inacceptable de laisser livrées à elles-mêmes les personnes qui occupent la « scène ouverte » de Stalingrad. En revanche, je répète qu'il me paraîtrait plus efficace de développer les maraudes de contact pour aller au-devant de ces personnes. Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ne disposent pas des moyens suffisants pour cela.
Je suis aussi un ardent défenseur de la brigade d'assistance aux personnes sans abri. La problématique est la même.
Notre arsenal de conventions avec les pays producteurs de drogues – je pense d'abord au Maroc, notre premier fournisseur de cannabis – est-il suffisant ?
La production et la distribution de drogues brasse beaucoup d'argent. M. Brice Hortefeux, lorsqu'il était ministre de l'intérieur, nous avait dit qu'il allait « frapper au portefeuille ». Notre arsenal juridique est-il suffisant pour lutter contre le blanchiment d'argent et les profits qu'il génère ?

Pour moi, le cannabis présente un impact sérieux en termes de santé publique, notamment chez les jeunes. Les consommations précoces, chez ceux qui sont en situation psychologique et sociale difficile et les consommations intenses ont des conséquences. De même, l'alcool tue chaque année 40 000 personnes et le tabac, 60 000. Notre réflexion n'est pas fondée sur le laxisme, mais sur l'efficacité des approches, notamment en direction des jeunes. À quoi bon parler des ravages du cannabis à une classe d'adolescents ? La moitié des élèves en a déjà fumé sans subir ce qu'on lui promet…
La crédibilité des pouvoirs publics et de la parole scientifique est mise à mal par un dispositif trop systématique qui ne permet pas aux jeunes de se focaliser sur les véritables dangers.
L'éducation sanitaire dans une classe – comme l'enseignement du football – est-elle du rôle de la police ? Quelle que soit la qualité du travail de ses fonctionnaires, celle-ci est-elle institutionnellement la mieux placée pour conduire ce type d'action ? Je comprends la problématique du rappel à la loi, ou celle de la peur du gendarme. Pour moi, la police a pris en charge des fonctions qui étaient mal remplies. Voilà seulement cinq ans qu'il est question d'addictologie dans notre pays. Depuis trente ans, la psychiatrie et le secteur de la santé mentale sont véritablement dévastés. Mais la préfecture de police apporte-t-elle, dans ces fonctions, une valeur ajoutée particulière ? Le rôle du policier dans la société n'est-il pas de faire appliquer la loi, de dissuader et de réprimer les contrevenants ?
Mon interrogation est sincère : il ne s'agit pas d'une critique de l'institution policière mais d'une vision plus recentrée de son rôle.
Monsieur le préfet, vous avez distingué drogues et substances licites. Ne faudrait-il pas plutôt exposer aux jeunes qu'il n'y a que des drogues, dont certaines sont licites et d'autres non ? L'alcool fait au moins autant de dégâts que la drogue. Dans ma commune, je vois chaque année, à l'approche de l'été, des élèves de troisième en coma éthylique qu'on emmène à l'hôpital. Le danger spécifique des drogues illicites, c'est la loi, que l'on brave. Mais le danger sanitaire vaut pour toutes les drogues, notamment l'alcool.
Pourriez-vous aussi nous préciser ce que vous entendez par renforcement des maraudes ? S'agit-il d'augmenter les moyens qui y sont affectés, le nombre des maraudes, l'action qui est conduite pendant celles-ci ? Faudrait-il qu'elles disposent de la capacité d'analyser les produits ?
Quelle est la réponse pénale la plus courante en cas d'interpellation ? Une amende contraventionnelle ne serait-elle pas plus appropriée pour toucher les porteurs de petites quantités de cannabis et les primo-consommateurs, notamment les jeunes collégiens ou lycéens, ainsi que leur famille – y compris au portefeuille ? Aujourd'hui, l'interpellation d'un jeune pour consommation mineure d'un « joint » n'aboutit qu'à un classement sans suite ou à un rappel à la loi ; ce n'est pas satisfaisant.
Monsieur Jean-Marie Le Guen, vous l'avez justement dit, l'éducation sanitaire de nos jeunes concitoyens n'est pas forcément de la compétence de la préfecture de police. C'est la première fois que j'entends un élu dire que les policiers ne sont pas ceux qui assureraient le mieux cette formation – c'est aussi mon avis. Que le « croquemitaine » réussisse dans cette tâche mérite réflexion… Je suis un défenseur acharné de la police de proximité, mais je suis d'accord : apprendre aux jeunes à jouer au football ne fait pas partie du métier de policier. Il reste que les policiers formateurs antidrogue effectuent un travail que personne d'autre ne fait.
Vous me permettrez de raisonner par analogie. Il arrive que de nouveaux gardiens de la paix se trouvent en surendettement deux ans après leur première affectation : dans les écoles, ils sont, logés, nourris et payés. Et personne ne leur apprend qu'ils auront ensuite à assumer un loyer, la nourriture et les impôts. De même, dans le domaine sanitaire, c'est la formation de base qui semble faire défaut : dans mon enfance rurale, notre instituteur nous sensibilisait dès la première semaine à l'alcool – le fléau de l'époque – en faisant boire à un lapin une petite cuillère de gnôle : le lapin mourait en un quart d'heure et les esprits en étaient marqués !
Quant à la création des salles de consommation, le pas à franchir n'est pas de la compétence d'une personne dont la fonction est d'appliquer la loi. De plus, les sommes qui devraient y être consacrées pourraient être utilisées au profit du renforcement des maraudes.

Quelle est la différence entre une maraude nomade, et l'équivalent, mais fixe et avec un toit ?
La maraude suppose d'aller rencontrer la personne.
Il faut aussi souligner l'évolutivité très forte des scènes de consommation. Les démantèlements de trafics aboutissent à des déplacements considérables. Un lieu fixe ne pourra jamais s'adapter assez vite.
Les équipes chargées de la prévention dans le XIX e arrondissement m'ont dit que les temps de maraude à Stalingrad étaient de deux fois deux heures pour l'association la plus importante, Coordination toxicomanies 18, deux autres associations intervenant également. La couverture de la principale scène de consommation parisienne est donc très faible, alors que les policiers y mènent tous les jours des opérations de surveillance ou des interventions.
Le coût de fonctionnement d'une salle de consommation est considérable. Celle de Genève ferme à 19 heures. Or, à Paris, le créneau de consommation va de 19 heures à 2 heures du matin. Il faudrait donc aussi du personnel pour sécuriser les agents de la salle contre les petits trafiquants ou les drogués en crise. Les moyens qui y seraient affectés fragiliseraient ceux des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Un système mobile plus réactif me paraît plus pertinent.
Monsieur Yves Pozzo di Borgo, l'arsenal de conventions et de textes législatifs paraît largement suffisant. La difficulté, c'est leur application opérationnelle.
Dans ce domaine, la difficulté en matière de drogue, c'est le cannabis. Il représente le deuxième revenu du Maroc, principal fournisseur de la France. Après être restés longtemps inactifs, malgré nos demandes, les Marocains ont changé d'attitude, à l'époque où le ministre de l'intérieur était M. Nicolas Sarkozy : ils se sont rendu compte que les revenus des trafiquants de cannabis marocains étaient tels qu'ils suscitaient des vocations politiques… À partir de là, nous avons beaucoup travaillé avec les Marocains, et nous continuons. Nous avons aussi passé un accord avec l'Espagne, par où transite le cannabis.
Cela dit, le cannabis ne vient plus majoritairement du Rif, mais des Pays-Bas et celui qui est cultivé sous serre a une teneur en tétrahydocannabinol dix fois supérieure.
La cocaïne est produite en Amérique latine, surtout en Colombie. Pour lutter contre le trafic, les États-Unis ont installé à Key West un dispositif assez sévère.
Toujours à l'époque ou M. Nicolas Sarkozy était ministre de l'intérieur, nous avons créé la première antenne de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants aux Antilles. Cette création a porté ses fruits. Le trafic, ainsi bloqué, s'est détourné vers l'Afrique. Le travail a été poursuivi. Un dispositif a été mis en place au Portugal à l'époque où Mme Michèle Alliot-Marie a été ministre de l'intérieur. Une antenne de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a aussi été installée à Toulon. Nous avons donc continué à progresser.
L'héroïne, quant à elle, nous arrive essentiellement d'Afghanistan via la Turquie, mais quelquefois aussi par les ports néerlandais – comme la cocaïne, du reste. Il y a eu plusieurs phases : les talibans l'avaient éradiquée lors de leur première prise de pouvoir, mais, à leur retour, ils l'ont considérée comme une arme susceptible de nuire aux mécréants. Ils favorisent donc désormais sa culture.
Les Français n'ont pas été inactifs dans la lutte contre l'héroïne. Nous avons mis en place des laboratoires de contrôle des précurseurs en Afghanistan. En revanche, les Allemands et les Turcs, qui en étaient chargés, n'ont pas réussi à installer un « bouclier » antidrogue. De ce fait, il arrive de nouveau beaucoup d'héroïne, de nouveau par les Pays-Bas. Cette évolution est assez préoccupante pour la France.
Enfin, les drogues de synthèse sont fabriquées aux Pays-Bas ainsi que dans quelques laboratoires en Belgique. Les Néerlandais ont démantelé quelques laboratoires, mais ils affirment que si la production ne se fait plus chez eux, elle trouvera refuge en Pologne, ce qui n'est pas faux.
Les outils, conventionnels et juridiques, sont parfaitement suffisants. Nous connaissons tous les circuits. Ce sont les dispositifs opérationnels qui nous font défaut.
Je regrette que les objectifs qui sous-tendaient la création d'Europol n'aient pas été poursuivis. L'objet de cette ancienne « unité européenne antidrogue » a été élargi à l'ensemble de la délinquance, ce qui n'a guère été efficace. De plus, Europol est fondé sur des conceptions anglo-saxonnes, privilégiant les analyses sur l'opérationnel. J'ai toujours plaidé, notamment dans le cadre du G5, quand j'étais directeur général de la police nationale, pour qu'Europol renforce son action en matière de drogue.
La coopération policière n'est pas assez développée. Avec les Néerlandais, nous conduisons des opérations qui ne servent à rien : l'opération « Hazeldonk », qui a mobilisé cent vingt policiers pour la surveillance des trains, a abouti à la saisie de quelques grammes de cannabis ! Il faut revoir les modalités opérationnelles de la coopération policière.
Nous travaillons bel et bien à toucher les réseaux au portefeuille. L'an dernier, nous avons saisi un million d'euros en numéraire. Le dispositif des groupes d'intervention régionaux permet de saisir le patrimoine des trafiquants. Hier, dans le cadre de l'application de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, nous avons saisi, pour la deuxième fois, un fonds de commerce.
Si M. Nicolas Sakozy, alors ministre de l'intérieur, avait envisagé la contraventionnalisation du cannabis, c'est parce que la loi du 31 décembre 1970 est un « sabre de bois » face à l'ampleur de la consommation. Comment condamner à un an de prison un mineur consommateur occasionnel ? Je ne suis pas hostile à la condamnation à une contravention.
C'est déjà le cas en pratique. Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est une alternative aux poursuites prononcée par le parquet. Les stages sont organisés avec une participation financière des usagers, ce qui est une forme d'amende beaucoup plus intelligente qu'une contravention prononcée à l'encontre de personnes insolvables. Le stage comporte pendant un ou deux jours une information concrète effectuée par des professionnels, y compris des policiers. Ce système a désormais pris son rythme de croisière à Paris, où plusieurs centaines de stages sont organisés chaque année.
Une contravention immédiate ne serait-elle pas plus efficace ? C'est à l'immédiateté de la sanction qu'est sensible un jeune pris sur le fait. Ces stages ne sont organisés qu'avec un certain délai. De plus, les parents se trouveraient rapidement informés et ce sont eux qui paieraient l'amende ! Dans bien des cas, la police ou la gendarmerie laisse partir le jeune contrevenant après s'être contentée de lui promettre une convocation au commissariat ou à la brigade, laquelle n'aura en général pas lieu. Une contravention immédiate me semble présenter un effet dissuasif supérieur à la participation à un stage d'information.
Pourquoi pas, en effet, instaurer une contravention pour le primo-consommateur ? Cependant, même le cannabis peut parfois entraîner des phénomènes de dépendance extrêmement forts. Le recours mécanique à la contravention peut avoir l'effet pervers de supprimer pour la police une fonctionnalité qui me paraît indispensable, le recours à l'injonction thérapeutique qui oblige des consommateurs très dépendants à prendre le chemin du sevrage.
Les deux tiers des jeunes qui consomment pour la première fois ne sont pas des toxicomanes mais des consommateurs « par voisinage ». Dans les villes moyennes de province, les policiers les connaissent. Il manque bien une sanction au premier usage d'une substance illicite.
Nous voyons bien, à Paris, que la difficulté vaut non seulement pour la drogue, mais aussi pour la délinquance comprise de façon beaucoup plus large. Dans Paris et sa petite couronne, 10 400 personnes ont été arrêtées plus de cinquante fois par la police. Ce n'est pas une mise en cause de la justice, mais on voit la limite de l'action policière. Une réponse apportée à la multiréitération ferait sans doute baisser dans les deux mois la délinquance de 40 %.
Quant aux jeunes, même s'il faudrait peut-être trouver un autre moyen de réprimande qu'une contravention, une réflexion sur un dispositif pénal intermédiaire me semble mériter réflexion ; la loi du 31 décembre 1970, c'est soit l'impunité, soit un an de prison.
Les jeunes tirent-ils vraiment des enseignements de ces stages de sensibilisation ou les suivent-ils seulement pour éviter une éventuelle sanction pénale ? Mon impression est que les jeunes sont très informés.
Les pharmacologues de l'Académie nationale de médecine ont expliqué que toutes les drogues avaient des conséquences sur les réseaux synaptiques de nos cerveaux. Pourquoi ne le dites-vous pas publiquement ?
Ce n'est peut-être pas le métier du préfet de police…
Les soins dans le cadre de l'injonction thérapeutique ne pourraient-ils pas comporter un module décrivant aux toxicomanes les conséquences dramatiques de l'usage de la drogue pour leur cerveau ?
Quel pouvoir avez-vous par ailleurs sur les prisons ?
Enfin, l'audition de représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nous a permis de constater combien notre pays était un producteur de drogues. Avez vous établi des relations avec cette institution ? Les groupes pharmaceutiques ne produisent-ils pas trop de drogues, légales bien sûr, mais qui, tel le Subutex, peuvent être utilisées de façon détournée ?
À ma connaissance, nous n'entretenons pas de dialogue direct avec cette agence. En revanche, nous saisissons beaucoup de drogues fabriquées en France et qui sont en fait des médicaments.
En effet, nous constatons des détournements réguliers de produits pharmaceutiques utilisés de manière courante. Nous avons tous à l'esprit le détournement des produits de substitution aux opiacés, qui touche en effet beaucoup plus le Subutex que la méthadone. Mais la kétamine est aussi assez régulièrement détournée, notamment dans les milieux asiatiques. Cet anesthésique, du reste aujourd'hui essentiellement prescrit dans le domaine vétérinaire, est utilisé par certains toxicomanes à la recherche de sensations fortes – on parle de sensation de mort imminente.
J'ai l'impression que beaucoup de jeunes sont informés des dangers des drogues, et que leur démarche est d'abord de braver ces dangers, ainsi que l'interdit légal qui pèse sur les drogues.

Alors que des photos horribles figurent désormais sur les paquets de cigarettes, les jeunes n'en ont jamais autant acheté. Si les jeunes n'allaient pas affronter les éléments qu'on leur signale comme dangereux, ils ne seraient sans doute plus des jeunes…
Madame Virginie Klès, je ne suis pas aussi optimiste que vous quant à la bonne information des jeunes sur les dangers des drogues : c'est triste, mais le cannabis est désormais entré dans les moeurs.
Si les stages ne peuvent former la totalité de la réponse, ils me semblent constituer une réponse plus adaptée qu'une amende contraventionnelle. Peut-être faudrait-il instituer cette dernière, mais la coexistence juridique des deux dispositifs paraît très difficile.
Le raisonnement qui a présidé à la création des stages était d'amener certains primo-consommateurs à rencontrer des personnes aptes à leur ouvrir les yeux.
Une politique de communication plus offensive sur les dangers sanitaires des drogues, et aussi créative que celles relatives à la sécurité routière ou au tabac, dont l'impact est beaucoup plus fort, me semble également souhaitable. Bien des jeunes ne savent pas que le cannabis comporte des molécules liposolubles qui se fixent dans le cerveau et y restent très longtemps. Ils ont tendance à considérer que les mises en garde formulées à leur attention ne correspondent pas à la réalité.
Il reste cependant que les effets du cannabis sont très différents selon les organismes. Les effets psychologiques très intenses ne concernent que 10 % de la population.

La Chine, qui copie un nombre de plus en plus important de nos produits, a-t-elle commencé à produire et exporter des substances illégales ?
Nous n'avons que peu d'informations : dans le domaine des produits stupéfiants, le copyright est assez peu développé… Il est donc difficile de différencier la molécule fabriquée clandestinement dans un laboratoire néerlandais de celle qui l'est, dans les mêmes conditions, dans un laboratoire chinois.
En revanche, les Chinois ont importé des types de consommation européens : la consommation de cocaïne se développe beaucoup dans les grandes villes chinoises.
Enfin, traditionnellement, la consommation des milieux asiatiques, notamment ceux qui sont implantés dans les grandes villes européennes, présente un certain nombre de particularités, comme l'usage de kétamine. Les filières de ces produits sont spécifiques et internes à la communauté.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud.

Bienvenue, monsieur le préfet. Dans le cadre de notre mission d'information sur l'état du développement des toxicomanies en France, nous aimerions que vous nous indiquiez comment vous évaluez la consommation de produits stupéfiants. Quelles sont, selon vous, qui avez été de 1994 à 1999 directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, les évolutions qui sont intervenues depuis 1994 ? Enfin, Marseille est à la fois une grande ville où l'usage des stupéfiants s'est développé, mais aussi un port et de ce fait une porte d'entrée majeure pour des produits illicites qui se diffusent ensuite dans l'ensemble du pays. Comment appréciez-vous la situation ?
Quoique je ne dispose pas de toutes les données sur la consommation de drogues en France, je ne pense pas que sa physionomie ait beaucoup changé. L'évolution majeure de ces dix dernières années, comparées aux années 1970, est le passage d'une toxicomanie plutôt centrée sur un produit à une polytoxicomanie. Depuis mon arrivée à Marseille, j'ai constaté que, dans un cadre festif, les mêmes personnes consomment à la fois des drogues légales et illégales : le fumeur de joint ou l'héroïnomane isolé est de plus en plus rare.
À partir du nombre des interpellations, on observe depuis plusieurs années un tassement de la consommation, sans doute parce que la poursuite pénale, notamment pour les usagers de haschich, est de moins en moins répandue : cette consommation n'est plus guère une priorité pour les policiers ou gendarmes en opération sur la voie publique. De ce fait, les statistiques de la répression ne sont pas forcément entièrement représentatives de la réalité ; celles de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies en sont sans doute plus proches.
La polyconsommation influence aussi le trafic. Dans la deuxième partie des années 1970, les trafiquants étaient spécialisés : haschich, cocaïne, héroïne. Aujourd'hui, petits ou puissants, ils se sont adaptés au marché : ils vont où est l'argent. Marseille et ses alentours n'échappent pas à cette évolution. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne comporte pas que le port de Marseille : il faut y ajouter ceux de Toulon et de Nice.
Il existe aussi un trafic routier transfrontalier. Sur les routes reliant l'Espagne à l'Italie, on trouve du trafic de cannabis et de cocaïne. À l'occasion, de l'héroïne circule aussi en sens inverse, depuis la Turquie. Nous effectuons également des saisies sur des voies aériennes et terrestres en provenance du nord de l'Europe. Nous arrêtons cependant moins fréquemment des « mules » à Marseille qu'à Nice, dont l'aéroport présente plus de caractéristiques internationales. De petites saisies peuvent aussi être opérées dans les trains. La voie maritime est également utilisée, soit par des voiliers, soit par des « go-fast » en provenance du Maroc ou d'Espagne. Des ripostes ont été mises en place, notamment grâce au Centre de coordination pour la lutte contre le trafic de drogue en Méditerranée, implanté à Toulon. Phénomène nouveau, nous avons aussi constaté des trafics par voie aérienne – par hélicoptère ou avion – en provenance du Maroc ou d'Espagne.
Si le grand banditisme, implanté à Marseille ou en Corse, continue d'être impliqué dans le trafic, nous observons aussi le même type de trafic de banlieue qu'en région parisienne. Soixante cités sont touchées par ce qui ne peut pas être considéré autrement que de la grande criminalité : des bandes s'entretuent pour le marché, les preneurs de « contrats » étant assez souvent sous l'emprise de la cocaïne ou d'autres produits. Les conditions des règlements de compte relèvent vraiment de la barbarie !
La consommation est proche de celle des grandes régions urbaines françaises : beaucoup de polytoxicomanie, une stabilité de la cocaïne et un retour de l'héroïne, que nous avions prévu : dès lors que la production annuelle en Afghanistan atteint 800 tonnes, il était inévitable d'en retrouver une partie sur les marchés européens. À la différence des années 1980, les usagers fument ou « sniffent » l'héroïne beaucoup plus qu'ils ne se l'injectent.
Sans parler du tabac, une soirée type de certains jeunes commence avec de l'alcool ; ensuite vient la prise d'un « joint », pour être en forme en boîte de nuit, puis d'ecstasy et de cocaïne, pour améliorer ses performances, en boîte puis au lit, enfin, le cas échéant, d'un peu d'héroïne pour se remonter d'un coup de blues. Pendant une soirée, une personne peut ainsi prendre six produits addictifs. Pour prévenir les risques, nous devons donc cibler non pas une drogue, mais un panel de produits.

Marseille connaît-elle aussi ces fameuses « scènes ouvertes », extrêmement mal vécues par les riverains, comme il a pu en exister place de Stalingrad, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, ou aujourd'hui à Saint-Denis ?
Il existe en effet des « scènes ouvertes » de trafic. D'une discussion avec le préfet de Seine-Saint-Denis, M. Christian Lambert, il ressort que les problématiques que nous devons affronter sont les mêmes : ventes dans les halls d'immeubles des cités, systèmes de caches, présence de guetteurs. L'ensemble de la cité est alors touché. Ceux qui ne sont pas impliqués sont surveillés. Cette surveillance va jusqu'à des contrôles de personnes non connues à l'entrée des cités et à l'interdiction de monter dans les cages d'escaliers si les trafics sont en train de s'y dérouler. De l'ascensoriste au médecin, les professionnels qui se rendent dans les immeubles sont suivis et pistés très précisément, jusqu'à devoir subir des contrôles d'identité.
Depuis la mi-novembre – avant même ma nomination – la police a entrepris des descentes régulières dans les cités : nous les conduisons au rythme d'une par jour, en changeant de cité et en nous intéressant à l'ensemble des trafics. Nous recherchons aussi des armes dans les caves – et nous en trouvons beaucoup. En quatre mois, nous en avons saisi deux cents, et souvent des armes de guerre, comme des Kalachnikovs.
Sur les soixante cités à problème, une bonne trentaine présente ce profil.
Nous essayons aussi de mettre en place une riposte supplémentaire en frappant au portefeuille grâce à des opérations réunissant le groupe d'intervention régional et le fisc, de façon à toucher les avoirs criminels : bref, nous essayons d'utiliser toute la palette des outils à notre disposition pour démanteler un réseau.
Ce travail n'est pas sans difficulté. Les trafiquants s'organisent ! Ainsi, les voitures de luxe ne sont plus achetées par les trafiquants mais louées ou prêtées afin d'éviter que la police ne retrouve le trafiquant qui les utilise. Remonter les réseaux financiers est très compliqué. Les trafiquants ne connaissent que l'argent liquide. Ils sont tous bénéficiaires du revenu de solidarité active ou d'autres aides. Il est dont très difficile de saisir leurs avoirs personnels.
Ils sont aussi très mouvants et capables de se réfugier dans d'autres grandes villes ou à l'étranger lorsqu'ils se sentent cernés. C'est une nouveauté par rapport aux habitudes du milieu traditionnel marseillais. Ils sont donc très difficiles à neutraliser.
Nous allons tenter de mener une politique de terre brûlée. Mais pour cela, il faut des moyens. Les enquêtes sont longues. Le groupe d'intervention régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas le plus dépourvu de personnel, ne peut traiter simultanément que trois belles affaires au maximum. Pour peut qu'il soit aussi requis à Avignon ou à Nice, il doit réduire ses moyens consacrés à Marseille.

À l'évidence, résorber la demande réduirait l'offre. Alors que certains collègues souhaitent aller vers une libéralisation et une dépénalisation de certains produits, pour ma part, je me demande s'il ne faut pas, à l'inverse, renforcer la répression et mettre un terme à ce laxisme envers la consommation qui en fait influe sur les trafics et alourdit le travail de la police.
Par ailleurs, vous avez indiqué que, dans les cités, certains de ceux qui se livrent au trafic bénéficient du revenu de solidarité active et qu'il est donc difficile de saisir leurs biens. Mais je sais que, dans ma circonscription, un trafiquant qui vit en apparence des allocations, a en fait une maison luxueuse au Maroc… Avez-vous développé des coopérations avec ce pays afin que de tels avoirs puissent y être saisis ?
Il est évident que la répression n'est plus ce qu'elle était au début de ma carrière, quand la saisie de 5 kilogrammes de cannabis était une grosse affaire qui entraînait une réponse pénale. La loi du 31 décembre 1970 était sans doute inadaptée au traitement des toxicomanes car elle ciblait davantage les héroïnomanes que les consommateurs de haschich. C'est surtout parce que la justice est débordée que l'on observe ce laxisme dont vous avez fait état. Peu à peu, les magistrats ont renoncé à se faire présenter les personnes au-dessous d'un certain seuil de détention de produit et ont même renoncé à toute procédure à l'encontre des usagers de cannabis : au mieux, on les enregistre dans le fichier national des auteurs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, mais il n'y a plus de réponse pénale et médicale. Or, dans le même temps, de nouvelles méthodes de trafic sont apparues et la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) du cannabis, notamment produit en intérieur, a considérablement augmenté : outre que la loi française ne distingue pas drogues « dures » et « douces », les effets d'un cannabis dont la teneur en THC est de 35 % sont comparables à ceux de l'héroïne ou de la cocaïne…
Qui plus est, en dépit de ce laxisme, les « affaires » continuent : on peut acheter sur internet tout le matériel et toutes les graines que l'on veut et, avec un investissement de 15 000 euros, certains produisent une tonne de cannabis en intérieur en une année.
Il est paradoxal que, alors que la drogue sous-tend 70 % de la criminalité en France, on n'apporte pas de réponse suffisante face à l'usager de base, quand bien même c'est lui qui peut nous donner des informations importantes sur les trafiquants.
En trente ans de carrière, je ne puis que constater la chute vertigineuse des poursuites au « petit niveau », dont on voit aujourd'hui les effets négatifs sur le marché clandestin.
S'agissant du Maroc, j'ai été le premier à implanter un officier de liaison dans ce pays. Les choses ont été difficiles au début mais elles ont progressé et on est parvenu à monter des surveillances de livraisons. Récemment, nous avons réussi à remonter, à partir d'un individu qui n'avait aucune ressource en France, jusqu'à la maison d'une valeur de 750 000 euros qu'il possédait en fait au Maroc et à la faire saisir, car les autorités en ont désormais admis le principe. J'ignore si elles ont ratifié l'ensemble des conventions internationales et si elles les appliquent vraiment, mais l'on sent un frémissement sur cette question de la saisie des avoirs criminels.
Cela étant, si les trafiquants originaires du Maroc ou d'Algérie y investissent souvent leurs revenus illicites, ils le font aussi en Thaïlande, endroit « à la mode » en ce moment dans ce milieu. Cela confirme que si l'on veut lutter contre cette économie parallèle, on ne peut se contenter d'intervenir en France. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cet aspect international est très important dans les enquêtes et j'incite les enquêteurs à en tenir le plus grand compte et à ne pas travailler en solitaire mais dans le cadre de coopérations, voire d'un système intégré.
Dans la mesure où la plupart des interpellations ne sont pas suivies de sanctions, l'instauration d'une amende contraventionnelle immédiate pour les petits consommateurs, en particulier les plus jeunes, lorsqu'ils sont pris sur le fait à la sortie du collège ou du lycée, ne permettrait-elle pas de détourner de cette voie les 70 % de jeunes qui ont fumé du cannabis une fois et qui risquent d'être tentés d'aller plus loin ? Le rappel à la loi n'est plus vraiment dissuasif et l'on sait bien que les sanctions prévues par la loi du 31 décembre 1970 ne peuvent pas être appliquées systématiquement.
Vous avez par ailleurs évoqué les cultures en intérieur, mais il semble qu'il existe aussi dans le midi des cultures en extérieur, qui se développent et d'où provient une quantité assez importante de cannabis. Disposez-vous des possibilités de les repérer et d'intervenir ?
Enfin, M. Jean-Claude Gaudin, sénateur et maire de Marseille, avait dans un premier temps répondu favorablement à la proposition d'ouvrir des salles d'injection supervisées, mais il a ensuite fait marche arrière. Êtes-vous pour quelque chose dans ce revirement ?
J'ai d'abord été opposé à la contraventionnalisation de la consommation, car il me semblait essentiel de disposer du témoignage de l'usager pour remonter les filières. Mais il me semble désormais que cette démarche serait utile à l'occasion du premier usage, le deuxième étant considéré comme un délit : cela permettrait de moduler la sanction et n'empêcherait pas les policiers et les gendarmes de mettre en garde à vue des usagers susceptibles de leur donner les coordonnées des revendeurs. L'inconvénient est que cela pourrait pousser ces derniers à faire eux-mêmes du trafic pour payer l'amende sans avoir à se tourner vers leurs parents. À l'inverse, si les parents sont informés, cela pourrait les amener à réagir.
Il n'y a que quatre mois que je suis affecté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je n'ai pas entendu parler de cultures en extérieur. Il est toutefois possible qu'il en existe sous serre, que nous n'aurions pas détectées. À ma connaissance, il n'y a pas eu, ces dernières années, de saisie importante.
S'agissant des salles d'injection supervisées, je n'ai nullement influé sur la décision du maire de Marseille : peut-être faut-il y voir davantage les effets du rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Je participerai aux réunions d'une commission qui a été créée sur ce sujet et qui sera pilotée par la mairie.
À titre personnel, je pense que si l'on installe de telles salles, il faudra ensuite créer des salles de « sniff » voire rouvrir les fumeries d'opium… Certes, faire encadrer par des médecins les toxicomanes qui se piquent éviterait peut-être le recours à des produits de mauvaise qualité, les surdoses et la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, mais je doute que cela facilite le sevrage.
Cela aurait sans doute été efficace dans les années 1970, à un moment où nous étions désarmés face à des gens qui se piquaient cinquante fois par jour, parfois avec de l'eau, pour retrouver leur « lune de miel »…
Pour autant, on ne saurait négliger les effets secondaires d'une telle mesure : n'oublions pas que même avec le Subutex et la méthadone, des trafics se sont développés. Aux Pays-Bas, l'idée de permettre aux fumeurs de cannabis de s'en procurer dans les « coffee-shops » afin d'éviter qu'ils ne se tournent vers d'autres produits était certes généreuse, mais rapidement, des trafiquants sont venus autour de ces établissements pour proposer d'autres drogues, au prix de nombreux désagréments qui ont entraîné plusieurs villes à fermer les « coffee-shops ».
Je n'ai pas non plus l'impression que les expériences menées en Suisse et en Allemagne fassent baisser la consommation. Or, telle est bien la question : veut-on dans notre pays freiner la consommation ou réduire les risques ?
Au total, je ne suis donc pas partisan des salles d'injection supervisées.

Quels sont selon vous les nuisances et les bénéfices liés à la présence d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues à Marseille ?
Comme dans toute structure d'accueil de toxicomanes, la qualité de la prise en charge permet à certains de s'en sortir. À ma connaissance, il n'y a pas de nuisances liées au développement d'un trafic à proximité de ce centre et aucune intervention policière n'a eu lieu récemment. Seul problème : de tels établissements étant implantés dans des quartiers difficiles, on a parfois du mal à distinguer ceux qui les fréquentent de ceux qui traînent alentour.
La communauté comorienne est-elle très touchée par la toxicomanie et par le trafic ?
Forte de 80 000 personnes – contre 40 000 pour la communauté algérienne – cette population est très criminogène et très violente : on compte beaucoup de consommateurs mais aussi beaucoup de trafiquants comoriens dans les cités. La moitié des règlements de comptes intervenus l'an dernier mettait en cause au moins un Comorien, sans parler de toute la criminalité dite « moyenne » : agressions, vols avec violence, etc. Certaines cités, comme le Frais Vallon, sont désormais presque exclusivement comoriennes : on en chasse les blancs et les trafics se développent comme des entreprises commerciales…
Je suis désolé si mes propos ne vous paraissent guère optimistes…

Vous n'êtes pas là pour nous faire plaisir mais pour nous donner le sentiment de l'homme de terrain !
Néanmoins, je suis persuadé que des progrès demeurent possibles, en cessant de jouer aux « babas cool », en repartant des fondamentaux, en reprenant en main les brides que l'on a laissées trop lâches, en poursuivant et en prenant en charge les haschichomanes, d'autant que je suis persuadé qu'avec des taux de THC aussi élevés, on court à la catastrophe en matière de santé, mais aussi de sécurité, en particulier routière.
Nous menons d'ailleurs de plus en plus de contrôles à la fois de prise d'alcool et de stupéfiants, grâce à des tests salivaires : le vendredi et le samedi soir, près de la moitié des personnes testées sont positives, parfois aux deux produits. L'ivresse cannabique existe, et elle frappe aussi les pilotes d'avion et les caristes du port de Marseille… Il ne faut pas lâcher !
La Mission d'information sur les toxicomanies entend ensuite M. Didier Jourdan, coordonnateur du réseau des instituts universitaires de formation des maîtres pour la formation en éducation à la santé et prévention des conduites addictives.

Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons constaté, au cours de nos auditions, que l'entrée dans les toxicomanies se fait à un âge de plus en plus précoce, ce qui ne manque pas de nous inquiéter. De toute évidence, c'est dès l'adolescence qu'il faut intervenir pour alerter et prévenir, mais aussi pour repérer et traiter les dépendances.
Le rôle de la communauté éducative est donc essentiel. Aussi, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les possibilités d'action des enseignants pour mieux prévenir et combattre les toxicomanies ? Comment les intervenants sont-ils formés pour appréhender ce phénomène ? Le système actuel est-il satisfaisant ? Peut-on améliorer la formation en la matière ?
Vous êtes d'autant mieux à même de répondre à ces questions que vous êtes une référence en la matière : professeur en sciences de l'éducation à l'institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne, vous avez été invité à plusieurs reprises à l'étranger et vous êtes l'auteur de plus de deux cents publications et de six ouvrages, en particulier Éducation à la santé : quelle formation pour les enseignants ; Tabac, alcool, drogues : la prévention au lycée et La santé à l'école dans les pays européens.
Merci de vous intéresser à la prévention des toxicomanies à l'école. Je suis ici en qualité de coordonnateur du réseau des instituts universitaires de formation des maîtres, mais celui-ci n'est qu'un élément d'un tripode composé également d'une équipe de recherche – un laboratoire vient d'être classé A+ par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et travaille sur l'éducation à la santé et la prévention des conduites addictives – et un master avec un ensemble de spécialités. L'idée est que, sur ce thème, on puisse disposer au sein de l'université française à la fois d'une recherche de haut niveau, de dispositifs de formation des cadres, notamment des enseignants, et d'un engagement dans des dynamiques de transformation sociale, à travers le réseau et ses partenariats avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, et l'ensemble des acteurs.
Je me propose de resituer le rôle de l'école en matière de prévention des conduites addictives, sous un angle quelque peu différent du vôtre, avant de proposer des pistes d'amélioration.
Je ne reviens ni sur les caractéristiques des conduites addictives ni sur les enjeux d'une politique intégrée – combinant prévention, éducation, accès aux soins, réduction des risques et répression. Je préfère insister sur le rôle du système éducatif qui est aujourd'hui l'objet d'un nombre inconsidéré de sollicitations, étant appelé à remplir un ensemble de missions qui le dépassent largement, comme s'il lui appartenait de compenser tous les manques de la société. Il est donc essentiel, dans le domaine qui nous intéresse, de faire référence à la mission du système éducatif, qui est en premier lieu l'instruction et l'éducation du citoyen – ce qui signifie que la problématique du soin ou de la prise en charge n'intervient qu'en second lieu.
En matière de prévention des conduites addictives, la première intervention du système éducatif est centrée sur la question de la liberté, car on peut bien sûr étendre à la toxicomanie la définition que le Dr Pierre Fouquet donnait en 1951 de l'alcoolisme : « la perte de la liberté de s'abstenir d'alcool ». L'école doit ainsi s'efforcer, d'abord, de donner à chacun des élèves la capacité de conserver sa liberté vis-à-vis des produits, donc d'être en situation de choix.
La seconde intervention de l'école, qui s'approche davantage de l'objet de votre mission, est de donner dans chaque établissement aux enfants la possibilité de trouver des conditions éducatives qui leur conviennent, notamment un environnement exempt de stress, de pression sociale et de produits toxiques.
Pour le reste, la diminution de tel ou tel risque de morbidité ou de mortalité me semble relever d'une dynamique de santé publique dont l'école n'a pas pour mission première d'être un vecteur. Ainsi, elle n'est pas un instrument de prévention des pratiques addictives, mais elle en est un acteur, sous les deux angles que je viens de rappeler.
Le premier axe de travail est le développement des compétences autour de ce que l'on sait de l'addiction, qui lie individu, environnement et comportement. Il convient donc, à l'école, de donner à chaque élève la capacité de connaître les produits, de se connaître lui-même et de connaître la loi – car il n'y a pas d'éducation sans loi.
Le deuxième axe a trait à l'individu : il s'agit de développer chez l'élève les compétences qui lui permettront de résister à la pression et d'être capable de gérer les conflits sans recourir à la violence ou aux psychotropes.
Le troisième axe est celui de l'environnement, autour du développement de l'esprit critique et de la mise à distance de la pression des pairs et des médias : dans 96 % des cas, c'est votre meilleur ami qui vous a donné votre première cigarette, dans plus de 90 % des cas, c'est en famille que vous avez consommé de l'alcool pour la première fois. On est là au coeur de la mission de l'école et du socle commun, et c'est donc par là qu'il faut commencer pour prévenir les conduites addictives.
Pour sa part, la prévention passe par sa présence dans tous les établissements scolaires grâce à des dispositifs centrés sur les produits.
Enfin, la protection suppose la capacité d'identifier les élèves en situation de mal-être ; de créer un environnement social et physique favorable au développement des élèves ; de mettre à leur disposition, en milieu scolaire, des services sociaux et de santé efficaces.
Éducation, prévention et protection, tels sont donc les rôles de l'école en tant que telle et non en tant qu'instrument.
Dans ce cadre, les premiers acteurs sont bien évidemment d'abord les familles, car la santé relève de la sphère privée, puis les acteurs de l'enseignement que sont nos 800 000 enseignants. Pour leur part, les personnels de santé et les experts ont un rôle d'accompagnement, comme les chefs d'établissement et les conseillers principaux d'éducation.
Le cadre éthique est également important : s'il y a de nombreuses façons d'aborder la question des addictions, au sein de l'école, on fait référence à des valeurs spécifiques.
Vous l'aurez compris, j'insiste pour que l'on aborde le sujet non pas par les soins ou par le suivi des élèves mais d'abord en traitant de la mission de l'école, dont l'une des composantes est de veiller au bien-être des élèves.
Vous souhaitez savoir où l'on en est en la matière. Je soulignerai en premier lieu que tous les établissements prennent aujourd'hui en charge la question de la toxicomanie : partout, un enfant pris avec du cannabis entrera dans un dispositif d'accompagnement et de sanction et pourra, en dépit des faiblesses de la santé à l'école, être pris en charge par un médecin, une infirmière et un assistant social. Pour autant, 20 % à 25 % seulement des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui regroupent tous les éléments de cette politique, sont à la hauteur de telles attentes et il faut donc s'attacher à susciter partout des dynamiques favorables.
Mais si l'on compte 7 000 infirmières et 1 800 médecins scolaires, on dispose surtout de 800 000 enseignants. Lorsqu'on demande à ces derniers quelle est leur implication professionnelle vis-à-vis des conduites addictives, 81 % répondent qu'ils interviennent comme éducateurs dans le quotidien de la vie de l'établissement mais 23 % seulement qu'ils prennent place dans des dispositifs de prévention. On est donc encore loin du compte, mais on ne se trouve pas pour autant dans une situation où le souci de la prévention serait totalement absent.
Pour leur part, les chefs d'établissement – auprès desquels une étude très poussée a notamment été conduite après la publication du décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif – réagissent bien davantage par motivation personnelle qu'en réponse à une sollicitation institutionnelle. Nous devons nous interroger à ce propos.
Pour moi, il existe aujourd'hui cinq pistes pour avancer.
La première consiste à réinsérer toutes les dimensions liées à la santé dans le cadre général d'une éducation à la citoyenneté qui prenne place dans le socle commun. Alors que le dernier texte général date de 1998, les instructions se sont accumulées, en particulier dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, à tel point que les missions des enseignants, des médecins et des infirmières ressemblent aujourd'hui à un millefeuille. Il importe donc de tout regrouper dans un texte unique qui précise la mission des acteurs.
Deuxième piste, développer la recherche : si nous voulons former les enseignants, il faut que nous disposions dans les universités de maîtres de conférences et de professeurs qui en soient capables. Or, si la recherche est assez poussée pour ce qui a trait à la prise en charge médicale, elle est en revanche extrêmement déficiente en matière de prévention et d'éducation. Faute de produire suffisamment de docteurs, nous ne sommes pas à même d'alimenter les universités. Il convient de mobiliser les allocations de recherche afin d'y remédier.
La troisième piste est celle de la formation des enseignants. Désormais « mastérisée », elle est passée sous la responsabilité des universités, ce qui signifie qu'il faut permettre à chacune d'entre elles de former à la prévention des conduites addictives. Dans un certain nombre de cas, on dispose de personnes qui y sont aptes et nous mettons à leur disposition l'outil de formation que nous avons construit avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Quant aux universités qui ne disposent pas des moyens nécessaires, nous leur proposons le dispositif de formation à distance que nous avons créé avec le réseau.
Par ailleurs, même si les agences régionales de l'hospitalisation ont permis, en leur temps, des avancées, nous avons du mal à couvrir le territoire pour la prise en charge des enfants et des adolescents. La quatrième piste consiste donc à territorialiser cette dernière, en regroupant protection maternelle et infantile et médecine scolaire au sein d'un grand service de l'enfance et de l'adolescence qui cordonnerait l'ensemble des acteurs, en liaison avec le système éducatif.
Il convient enfin de développer le soutien à l'innovation afin de faire avancer un système éducatif aujourd'hui en souffrance. La prévention des conduites addictives suppose de réaffecter certains moyens, d'appuyer le réseau associatif et de mener des politiques innovantes à l'échelle des académies et des établissements.

La faible part des enseignants engagés dans des dispositifs de prévention et les lacunes de la formation à l'éducation à la santé des futurs enseignants sont préoccupantes. Selon vous, qui avez une grande expérience internationale, s'agit-il d'une spécificité française ? J'ai pour ma part souvenir d'avancées intervenues au Québec dès les années 1970, notamment avec les « sex counselors ».
Il faut prendre garde aux effets d'optique. Au Canada, aux États-Unis, en Irlande ou au Royaume-Uni, le système est extrêmement décentralisé et on y met en exergue le travail particulier que mène telle ou telle école. En France, nous cherchons à faire avancer de concert l'ensemble du système. Pour autant, il n'y a pas d'écart significatif dans la prise en compte de l'éducation à la santé. Mais, alors que le système éducatif de ces pays est centré sur le développement de l'individu dans une approche très « rogérienne », le nôtre est centré sur la citoyenneté au service de la République et distingue clairement sphères publique et privée. Les questions de santé, qui renvoient à l'intimité de l'individu, sont ainsi traitées différemment. On doit donc moins parler de retard que de prise en compte différente. En Irlande, la Social, personal and health education est une discipline scolaire qui traite à la fois de la sexualité et des addictions. Mais, dans les faits, les établissements ne disposent souvent pas des moyens de recruter un enseignant spécialisé et cette matière est donc soit absente, soit assurée par un professeur d'une autre discipline qui ne dispose d'aucune formation pour cela.

Alors que l'on constate des consommations et des conduites addictives dès l'entrée au collège, voire avant, nos auditions nous ont montré les carences de notre dispositif préventif. Vous préconisez d'ailleurs qu'on le restructure et que l'on revoit les textes relatifs au rôle des enseignants comme des médecins et des infirmières scolaires. Quelles sont, pour cela, vos propositions concrètes ?
Certains pays ont institué, dès la deuxième année de cours moyen, des formations à l'ensemble des risques encourus à l'approche de l'adolescence, qu'ils soient liés à la sexualité, à la pédophilie, aux jeux violents, aux substances toxiques ou autres. Chez nous, on commence bien trop tard à informer sur la drogue, en quatrième ou en troisième. Comment susciter l'engagement de l'ensemble des équipes éducatives et médicales dans une nouvelle démarche éducative ?
Enfin, pensez-vous que la visite médicale, qui a été prévue par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires mais qui demeure facultative, pourrait être systématisée, par exemple à partir de l'âge de quatorze ans, afin d'établir un diagnostic de l'état physique et psychique des adolescents ?
Certes, des pays ont développé des stratégies d'information et de prévention, mais les études épidémiologiques montrent que cela ne fonctionne pas. Je pense en particulier à l'Hutchinson smoking prevention project, mené dès 1984 aux États-Unis : vingt ans après, il n'y a aucun écart entre ceux qui ont reçu l'information et les autres ! Ce sont d'abord la vulnérabilité de la personne et la disponibilité du produit qui conduisent à consommer des psychotropes : le fait d'en connaître les caractéristiques n'a guère d'influence. Une excellente étude de l'Organisation mondiale de la santé a montré en 2006 que, même rendus systématiques, les dispositifs d'information ne fonctionnent pas et qu'il est en outre extrêmement difficile de les intégrer dans les programmes.
Les seules solutions efficaces sont donc celles qui reposent simultanément sur les compétences personnelles, sociales et citoyennes – qu'on développe en primaire à partir de la littérature et de l'art – et sur les connaissances. Vous avez raison de prôner que l'information soit délivrée plus tôt dans la scolarité – c'est dès la maternelle que l'on travaille sur la gestion du risque et sur l'estime de soi – et qu'elle le soit effectivement à l'école car elle est différente de celle que l'on reçoit de ses pairs. Mais il faut aussi veiller à ne pas susciter l'intérêt des 49 % de jeunes qui, à dix-neuf ans, n'ont jamais consommé de cannabis – une étude menée en Norvège a montré que le fait d'en parler régulièrement augmentait significativement la consommation de tabac. En revanche, il est bien au coeur de la mission de l'école de donner aux jeunes des moyens de se défendre contre les addictions grâce à la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions et la capacité à gérer le stress et le mal-être. Un enseignant du premier degré le comprend fort bien car il sait qu'il y contribuera simplement en exerçant son métier d'apprentissage de l'écrit ; il est bien plus difficile de le convaincre de dispenser un cours sur le cannabis…
Pour qu'une action soit efficace en termes de santé, il convient qu'elle prenne en compte les trois dimensions – individu, environnement, comportement – et qu'elle touche les enseignants dans ce qu'ils savent faire.
Au-delà de l'information, nous devons bien évidemment nous demander ce que nous pouvons faire en faveur des 7 % à 9 % d'enfants qui ne vont pas bien au collège. Comment les accompagner ? Quels dispositifs médicaux et sociaux mettre à leur service ? Mais, je le répète, vis-à-vis de la population générale, la mission de l'école doit reposer sur son coeur de mission.
La visite médicale obligatoire à quinze ans suscite un vrai débat. Il faut savoir qu'un élève qui consomme du cannabis ou d'autres psychotropes est surmédicalisé, donc pris en charge : il est très rare que l'on constate un défaut de soins, la difficulté tenant bien davantage à un manque de coordination, d'implication de l'ensemble des acteurs et d'établissements permettant de faire le lien entre éducation et soins. Les moyens de généraliser un tel bilan médical nous font en outre défaut et je me demande si un bilan infirmier est véritablement indispensable. En revanche, il est essentiel d'être attentif et de permettre à des enfants d'entrer dans des processus adaptés.

Si les enseignants, notamment les plus jeunes, me paraissent très impliqués en la matière, il me semble que les chefs d'établissement sont bien plus prudents, voire réticents, mettant l'accent sur la réputation de l'établissement dont ils ont la charge, ce qui peut même conduire à garder le silence vis-à-vis des parents.
Pour les chefs d'établissement, de façon tout à fait légitime, l'essentiel est de permettre le fonctionnement quotidien de l'établissement et tout le reste vient après ce que l'on pourrait appeler le « maintien de la paix sociale ». Même si beaucoup le font, il leur est dès lors plus difficile d'entrer dans des stratégies de prévention. Sans doute pourrait-on néanmoins leur montrer, en particulier lors de leur formation, que la politique de l'établissement inclut nécessairement la prise en compte d'une dimension environnementale qui recouvre la qualité de vie et la prise en charge des parcours des élèves en difficulté, en particulier pour éviter la déscolarisation. C'est ainsi qu'ils acquerront une identité professionnelle qui les conduira à un projet d'établissement ouvert sur des partenariats extrêmement solides avec les services sociaux et les équipes médicales et intégrant la dimension préventive.
Il convient également de renforcer les soutiens extérieurs afin que, lorsqu'un chef d'établissement est confronté à un élève en difficulté en raison d'une consommation de cannabis « autothérapeutique », pour reprendre l'expression de MM. Daniel Marcelli et Alain Braconnier, il puisse trouver des dispositifs lui permettant de l'accompagner.
La première consommation ne tient-elle pas fréquemment à une volonté de transgresser un tabou, que l'on risque de stimuler en renforçant l'information ?
Comment par ailleurs renforcer la prise en charge individuelle, notamment par les infirmières scolaires, qui me paraît un des premiers moyens de sortir l'enfant de ses difficultés ?
Il y a deux voies principales pour entrer dans la toxicomanie. La première est celle de la transgression, qui est plutôt le fait de garçons, qui ont une estime très élevée d'eux-mêmes et qui adoptent des conduites à risques pour se poser. C'est pour ce public que trop d'information est source de transgression. Mais n'oublions pas la seconde voie, celle de la gestion du mal-être par les adolescents, qui concerne surtout les filles.
Le fait que la signification de la pratique addictive puisse être différente est aussi une difficulté pour l'école qui doit travailler, en amont, à la fois sur les facteurs de risque et de vulnérabilité et sur les facteurs qui vont permettre de résister.
Le rôle des infirmières scolaires est par ailleurs central, et il faut se réjouir qu'il ait été fortement renforcé ces dernières années, tandis que leur nombre était porté à sept mille. Elles sont aujourd'hui très demandeuses d'une formation et d'une spécialisation et nous travaillons actuellement, avec d'autres universités, à un dispositif de formation qui permettrait d'offrir un diplôme universitaire aux infirmières déjà en place et de proposer à celles qui aspirent à le devenir une licence professionnelle centrée sur le milieu scolaire. C'est ainsi qu'on leur permettra d'assumer l'essentiel des responsabilités liées à la place de l'aspect médical au sein des établissements. Nous avons besoin à la fois d'une médecine scolaire liée à une médecine communautaire et, au sein des établissements, d'infirmières à qui l'on donne des compétences étendues, donc des missions importantes de coordination, mais aussi d'écoute, d'accompagnement individuel et de « mise en lien » avec le système de soins.

Que pensez-vous des tests par prise de sang qui sont actuellement pratiqués dans les collèges en Russie ?
Pour moi, cela n'a pas de sens en tant que tel : dès lors que l'on pratique le dépistage, on véhicule l'image que chaque adolescent est un délinquant potentiel et on entre ainsi dans le risque de dramatisation. Or, en matière de toxicomanies, on est toujours entre la banalisation – « tout le monde consomme du cannabis » – et la dramatisation – « si tu en consommes, dans trois semaines tu passeras à la cocaïne, dans six mois à l'héroïne et dans deux ans tu seras mort »… Or, rien de cela n'est vrai ! Le dépistage n'a pas d'intérêt car il met tous ceux qui ne consomment pas régulièrement en position d'accusés, tandis que les 7 % à 9 % qui sont vraiment concernés entrent dans des stratégies d'évitement ou se voient stigmatisés. À quoi bon utiliser un immense filet pour ne récupérer que quelques menus poissons alors que, à quelques exceptions près, le système éducatif français ne « rate » pas un gamin qui va mal ? Bien évidemment, ceux qui s'intéressent plus particulièrement aux soins voient d'abord les jeunes que l'on n'a pas repérés, mais ils sont bien peu nombreux sur les 15 millions d'élèves, d'apprentis et d'étudiants que compte notre système éducatif. Le dépistage ne se justifie donc pas et il est même contre-productif.

On sait que dans les classes préparatoires et dans les études de médecine, de nombreux élèves, bien qu'ils ne soient pas des consommateurs habituels de drogues, font usage de psychostimulants et se sentent parfois obligés de le faire.
C'est en effet très inquiétant, d'autant que ce public reste, comme d'ailleurs les élèves en brevets de technicien supérieur, très à l'écart de nos services universitaires de médecine préventive. La pression à la performance exercée par l'environnement est très forte et nous devons réfléchir à la qualité et à l'équilibre de vie que nous donnons aux élèves des classes préparant à des concours.
Pour illustrer cette pression, je rappelle qu'alors qu'en première année de médecine 19 % des étudiants fument, ils sont 39 % en dernière année – contre en moyenne 31 % dans les autres filières et 32,7 % dans l'ensemble de la population. Cela montre bien que ce public, que l'on peut supposer particulièrement informé, est soumis à une pression particulière.

La pénalisation a une valeur éducative, ne serait-ce que par la peur du gendarme, et les politiques liées à l'interdit portent leurs fruits puisqu'il y a moins de consommateurs en France que dans les pays environnants où certains produits ont été légalisés. Pourtant, certains proposent aujourd'hui que l'on dépénalise la consommation de cannabis. Qu'en pensez-vous ?
Tout éducateur sait que l'on a un très fort besoin d'interdit et la légalisation est donc impensable. Je ne crois pas que le degré de maturité de notre société soit suffisant pour que les personnes soient capables de garder leur liberté et de réguler elles-mêmes leur consommation de cannabis. Comment pourrions-nous tenir aux élèves un discours sur les psychotropes sans que la loi ne dise clairement qu'ils sont interdits ? Il est donc indispensable de conserver un garde-fou.
La question de la pénalisation est totalement différente et elle n'a absolument pas le même impact pour les éducateurs, dont la très grande majorité des élèves ne présente pas de danger, et pour ceux qui soignent les adolescents véritablement vulnérables. La pénalisation est donc moins liée aux questions éducatives qu'à une dynamique sociale qui prend en compte l'ensemble des sujets, et l'on retrouve là, outre l'école, tout ce qui a trait à la prévention et à la réduction des risques. En tant qu'éducateur, la dépénalisation ne me pose donc pas de problème particulier, mais j'insiste vraiment pour que l'on conserve l'interdit des psychotropes et pour que la consommation d'alcool et de tabac soit très strictement encadrée, afin que nous puissions rappeler sans relâche aux élèves cette interdiction et cet encadrement de produits qui sont susceptibles de leur ravir leur liberté. Vis-à-vis des enfants et des adolescents, c'est un langage qui fonctionne bien mieux que la menace d'effets sur leur santé dans trente ou quarante ans.
La séance est levée à dix-neuf heures quinze.