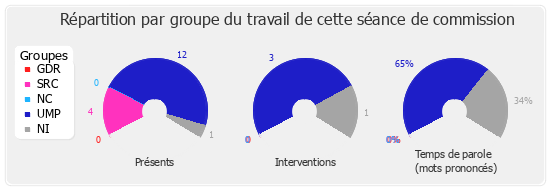Commission des affaires européennes
Séance du 15 juin 2010 à 16h30
La séance
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES
Mardi 15 juin 2010
Présidence de M. Pierre Lequiller, Président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et de M. Jean Bizet, Président de la Commission des affaires européennes du Sénat
La séance est ouverte à 16 h 40
Le Président Pierre Lequiller. Le Président Jean Bizet et moi avons pris l'initiative d'organiser une première dans l'histoire des relations franco-allemandes : l'audition conjointe de M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, et de M. Werner Hoyer, ministre chargé des affaires européennes de la République fédérale d'Allemagne, que nous avons grand plaisir à accueillir.
Nous attachons une grande importance aux relations franco-allemandes. Les parlementaires de nos deux pays se sont investis dans des missions communes, notamment celle en vue de l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne, que j'ai conduite avec Andreas Schockenhoff et qui s'est traduite par des conclusions identiques devant le Bundestag et l'Assemblée nationale. Nous étudions ensemble les questions relatives à la subsidiarité. Dans deux jours, je serai à Berlin avec une délégation de notre Commission pour une rencontre avec la commission des affaires de l'Union européenne du Bundestag, présidée par notre collègue Gunther Krichbaum.
Les thèmes abordés cet après-midi seront sans doute essentiellement axés sur le pacte de stabilité, la gouvernance économique européenne et la coordination des politiques budgétaires, domaines à propos desquels nous sommes prêts à coopérer. Il sera sans doute aussi question de la préparation de la réunion du G20 de Toronto, lors de laquelle sera défendue la proposition franco-allemande de taxe sur les transactions financières.
La construction européenne traverse actuellement une passe un peu délicate. Sans céder à la dramatisation, il faut reconnaître que la solidarité entre les Etats membres et la crédibilité de l'Union sont à l'épreuve. Dans ces moments difficiles, l'axe franco-allemand prend une importance toute particulière : nos deux pays, une fois de plus, sont investis d'une responsabilité spécifique. Il convient de passer outre les commentaires inquiétants et de raisonner avec davantage de recul.
Je faisais partie de la petite délégation qui accompagnait le président du Sénat, le mois dernier, à Berlin, et j'ai pu constater combien le climat des entretiens a été constructif. La volonté de travailler ensemble de manière privilégiée est là, toujours là. Bien sûr, des différences d'approche existent, comme elles ont toujours existé ; nos deux pays sont profondément différents, nous n'avons pas spontanément les mêmes intérêts ni les mêmes conceptions et, depuis quelques années, il nous est arrivé de cheminer séparément sur certains dossiers, notamment dans le domaine économique. C'est du reste ce qui rend le couple franco-allemand si important : lorsque nous parvenons à une position commune, elle devient une référence essentielle pour l'Europe.
Dans la situation difficile où l'Europe se trouve, tout ce qui contribue au dialogue entre nos deux pays lui est utile. Cette réunion commune entre nos deux commissions, initiée par Pierre Lequiller et mon prédécesseur Hubert Haenel, me paraît donc particulièrement bienvenue.
Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre invitation à cette audition conjointe, avec mon collègue et ami Pierre Lellouche, devant vos commissions réunies. C'est pour moi une grande joie et un grand honneur de pouvoir échanger avec vous à propos des relations franco-allemandes et des sujets européens d'actualité.
Les temps sont difficiles et nous avons des problèmes importants à régler ensemble, vous l'avez dit. Le Président de la République et la Chancelière, hier soir, nous ont montré le chemin à suivre. Au sein de l'Union européenne, la France et l'Allemagne ont très souvent des positions de départ différentes, mais, au final, elles se doivent d'élaborer des positions communes, sans quoi l'Europe ne pourrait avancer ; c'est l'oeuvre à laquelle nous nous attelons et, si nous trébuchons parfois, nous persévérons toujours.
Le fait que la position franco-allemande conditionne l'avancement des dossiers contrarie très souvent nos partenaires européens, d'Helsinki à Lisbonne. Pourtant, lorsque la France et l'Allemagne sont en désaccord sur un sujet particulier, tous viennent nous voir, dans les couloirs de Bruxelles ou de Strasbourg, pour nous prier de nous mettre d'accord et de débloquer la situation. Mais tout n'est pas toujours si simple.
Ces derniers mois, nous avons parfois été un peu déroutés parce que nos positions différaient ou parce que nous ne prenions pas nos décisions dans les mêmes délais. Il a même pu arriver que les Allemands donnent l'impression d'avoir perdu leur vocation européenne mais je puis vous assurer que c'est absolument faux. Nous sommes des Européens très fidèles et des partisans convaincus de la coopération franco-allemande.
La réussite de l'entreprise la plus importante des vingt-cinq dernières années – venir à bout de la partition de l'Europe et réunifier notre pays – n'a été possible que grâce à la clarté de notre adhésion aux valeurs démocratiques occidentales et de l'engagement de notre voisin français, ne le perdons pas de vue. Mon mentor, l'ancien ministre des affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, m'a toujours dit : « N'accepte jamais, dans une situation particulière, de mettre en balance les intérêts allemands contre les intérêts européens. » La meilleure façon, pour nous, de défendre les intérêts allemands, et européens, c'est d'agir dans le cadre européen.
Les neuf pays mitoyens de l'Allemagne sont tous ses amis, c'est un miracle de l'histoire, nous en sommes très conscients. C'est pourquoi nous poursuivons notre projet de paix, après un siècle au cours duquel les conflits sont malheureusement souvent partis de l'Allemagne.
L'Allemagne, en outre, profite particulièrement des effets économiques de l'intégration européenne. Nous sommes persuadés que l'intégration européenne ne procède pas de la simple addition arithmétique des simples intérêts nationaux et que son approfondissement est dans notre intérêt. Nous poursuivrons donc dans cette voie.
Cela ne signifie pas pour autant que nous devons nous abstenir de toute critique. Prenons un exemple important. Il m'est arrivé d'entendre un ministre français chargé des affaires européennes – je tairai son nom – déclarer qu'il allait téléphoner à des PDG de l'industrie pour leur dire ce qu'ils devaient faire ; en Allemagne, les industriels auraient déjà agi avant d'être appelés. Nous n'avons donc pas la même culture du management industriel mais cela ne nous a pas empêchés de développer une politique européenne commune.
Ces derniers temps, il est arrivé que les sensibilités nationales jouent un certain rôle pour déterminer des positions.
Lorsque, avec Theo Waigel, notre ancien ministre des finances, j'ai négocié le pacte de stabilité et de croissance, personne ne pouvait imaginer que les gouvernements français et allemand seraient les premiers à prôner sa suspension. Mais, en 2004, ce fut un choc : nous avons dû reconnaître que nous ne parvenions pas à respecter ses règles. En Allemagne, la défense de la monnaie est essentielle. Or il s'agissait tout simplement de sauver l'euro et sa valeur intrinsèque. Il y a deux ans, lorsqu'un gros paquet financier a été injecté sur le marché pour sauver Lehman Brothers, j'ai insisté sur le fait qu'il faudrait un jour ou l'autre trouver le moyen de récupérer ces liquidités, faute de quoi il s'ensuivrait une inflation énorme. Les Allemands ayant connu la surinflation à deux reprises au cours du siècle passé, au point de voir leur monnaie perdre toute valeur ; il est mortel, pour un homme politique de mon pays, de laisser croire qu'il mise sur l'inflation pour régler les problèmes économiques. Nous sommes par conséquent guidés par la nécessité absolue d'assurer la stabilité de la monnaie européenne.
En matière de déficits, notre politique est peut-être différente de celle de la France, mais un changement de paradigme intéressant s'est produit ces dernières semaines. Pendant des années, en France comme en Allemagne, dans nos discours du dimanche, nous déclarions que nous ne voulions pas laisser à nos enfants une dette trop élevée mais nous n'en tirions jamais les conséquences. Nous sommes maintenant rattrapés par la réalité, nous devons agir afin de réduire les dettes publiques. Peut-être est-ce plus facile en Allemagne qu'en France – vous êtes engagés dans un projet colossal de réforme des retraites et je ne peux que souhaiter bon courage à ceux qui y travaillent et je rappelle que ce sont mes collègues chrétiens-démocrates qui ont adopté, au début de cette décennie, les premières mesures tendant à réformer le système allemand. Agir différemment serait un suicide politique et l'enjeu va bien au-delà de la nécessité de respecter les dispositions constitutionnelles très précises qui nous régissent.
Je suis très heureux que le Président et la Chancelière, hier, se soient prononcés en faveur d'une organisation de la gouvernance économique européenne dans le cadre de l'Europe à vingt-sept. Je n'ignore pas l'importance de la zone euro mais, européen convaincu, je pense que la construction européenne ne doit exclure personne. J'aimerais que cette méthode soit appliquée dans d'autres domaines de la politique européenne et qu'une autre orientation ne soit prise que lorsqu'elle ne fonctionne pas. Michel Barnier et moi-même avons été à l'origine des instruments de la coopération renforcée, en 1994 et 1995. Ces prochaines années, nous y aurons beaucoup recours, lorsqu'un groupe de pays sera plus avancé que la moyenne dans tel ou tel domaine, et les autres pourront les rejoindre ultérieurement. Dans les années quatre-vingt-dix, un débat de technologie nucléaire a traversé l'Union, pour déterminer quel était le nucleus, le coeur de l'Europe. A ce sujet, les Allemands se demandent toujours si l'objectif est de provoquer une fission ou une fusion ! Quoi qu'il en soit, il est crucial d'inviter les Vingt-sept à coopérer en matière de gouvernance économique. Mais, pour lever une confusion terminologique tenant également à une différence d'approche culturelle entre nos deux pays, il convient de commencer par définir ce que l'on entend par « gouvernance économique » : s'agit-il de doter une structure d'une autorité particulière ou bien d'imaginer un processus de coordination budgétaire et financière ? À cet égard, le Président et la Chancelière, hier, ont accompli un grand pas en avant.
Je remercie le Président Pierre Lequiller, qui a imaginé de procéder à des auditions communes. Werner Hoyer et moi avons repris cette idée parmi les quatre-vingts propositions que nous avons présentées aux deux chefs d'État et qui, le 4 février dernier, lors de la réunion de nos deux gouvernements, ont pris valeur d'agenda de la coopération franco-allemande.
Qu'un membre du gouvernement français et un membre du gouvernement allemand parlent ensemble devant les parlementaires français, trois jours avant l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle, il y a soixante-dix ans, c'est un événement très émouvant. Je le dis à mon ami Werner Hoyer et à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, tout ce chemin parcouru est important pour nous tous, pour nos enfants et pour l'avenir de l'Europe.
Les décisions prises hier soir trouveront leur traduction, je l'espère, dès jeudi, au niveau des Vingt-sept.
Principe numéro un, quand la France et l'Allemagne ne se mettent pas d'accord sur un sujet, rien ne se passe. Dans l'histoire récente, cela s'est vérifié au début de la guerre en Yougoslavie, avec un drame à la clé, ou encore lorsque Areva et Siemens ont échoué à trouver un accord en matière d'énergie nucléaire. En revanche, quand un accord se fait, cela donne le traité de Lisbonne, le système monétaire européen et nombre d'autres avancées politiques, diplomatiques ou dans le domaine de la défense européenne. La construction européenne repose plus que jamais sur la capacité de la France et de l'Allemagne à transcender leurs différences au nom de l'intérêt collectif européen.
Principe numéro deux, il est toujours difficile de trouver un accord entre la France et l'Allemagne, parce que nos pays sont très différents : l'un est fédéral, l'autre centralisé. Nos systèmes politiques, nos processus de décision et nos cultures économiques sont dissemblables. Toutefois, lorsque nous parvenons à un accord, celui-ci est généralement très solide et tend à entraîner le reste de l'Europe, non pas pour satisfaire des ambitions de dominations ou des exigences de droits supplémentaires par rapport aux autres Etats membres, mais parce que l'histoire nous confère des obligations vis-à-vis du continent. Lors des grands rendez-vous, nombre de pays, européens ou non d'ailleurs, à la recherche de solutions, se tournent vers la France et l'Allemagne. Ce fut encore le cas hier, au Conseil européen de Luxembourg.
La crise est globale et systémique, le Président de la République l'a dit. Elle dure depuis trois ans : elle a commencé avec les subprimes ; elle s'est poursuivie, en 2008, avec une crise bancaire qui a failli tout emporter ; elle a entraîné la dépression de 2009 et nous n'en sommes pas encore sortis. Pour sauver la Grèce, au terme de débats difficiles, la France et l'Allemagne ont d'abord trouvé 110 milliards d'euros, dont elles ont apporté la moitié, le reste provenant du FMI, le Fonds monétaire international. Huit jours plus tard, le 7 mai, nous avons créé un fonds de garantie doté de 440 milliards d'euros – un volume sans précédent dans l'histoire de l'Europe –, plus 60 milliards d'assistance au titre du deuxième alinéa de l'article 122 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans compter des garanties bilatérales apportées, là encore pour moitié, par la France et l'Allemagne. La presse a écrit « le torchon brûle » ou « la France et l'Allemagne divorcent ». Comme s'il était facile de sortir 500 milliards d'euros ! Comme s'il existait une carte bleue franco-allemande dont tout le monde connaîtrait le code afin de se servir !
Le débat a été très dur au Bundestag, moins dur chez nous, mais le consensus s'exprime différemment sur deux versants. En France, nous votons assez facilement la constitution de fonds de garantie en faveur des Grecs, des Espagnols ou des Portugais mais, quand il s'agit de mener des réformes destinées à financer cette solidarité, cela s'avère un tout petit peu plus compliqué. En Allemagne, la solidarité a du mal à passer, mais les réformes internes ont été adoptées le week-end dernier dans une sorte d'unanimité nationale. Nos deux pays ne fonctionnent pas exactement de la même façon et c'est très bien. Leurs histoires sont différentes, l'Allemagne étant marquée par les événements qui ont amené Hitler au pouvoir. Ces dix dernières années, elle a conduit des réformes structurelles que, pour notre part, nous avons reportées. Nous arrivons maintenant à un rendez-vous qui appelle des changements fondamentaux. Des engagements constitutionnels ont été pris par l'Allemagne, et le Président de la République a annoncé une initiative du même ordre en France : nous allons couper drastiquement dans les dépenses et mettre en place les mécanismes institutionnels manquants, qui constituent le corollaire de la garantie de 440 milliards.
Car le jeu consiste à ne pas faire appel à cette garantie, ce qui requiert un renforcement du pacte de stabilité : il faut établir une surveillance mutuelle des budgets nationaux par les chefs d'État, sanctionner ceux qui le violent systématiquement en supprimant leur droit de vote, choisir un cadre de coordination à vingt-sept ou à seize – un compromis a été trouvé hier – et parvenir à élaborer ensemble, Français et Allemands, des mesures de régulation financière que nous porterons conjointement au G20. Tel est le paquet de décisions franco-allemandes obtenues depuis un mois et demi, produit de débats difficiles, entre nous et devant nos assemblées et notre peuple.
C'est difficile mais j'ai confiance. Hier soir, nous avons envoyé au monde un signal très fort et j'espère que nous transformerons l'essai jeudi : nous nous battrons pour la solidité de notre monnaie, l'euro, en mettant sur la table les garanties nécessaires et en présentant le système institutionnel qui va avec. Ce n'est pas si mal ! Je pense que nous avons restauré la crédibilité de l'Europe. Sur cette base, il reste à construire des régulations financières et surtout un programme de croissance économique. L'Agenda 2020 prend là toute sa valeur : Français et Allemands devront proposer des initiatives communes en matière de politique industrielle et de politique de recherche afin de créer des synergies européennes. Ce matin, Werner Hoyer et moi avons visité l'Agence spatiale européenne. L'Europe représente 20 % des dépenses spatiales mondiales, la moitié des investissements étant portés par l'Allemagne et la France, qui portent l'intégralité des programmes importants. C'est dans les domaines du numérique, de l'espace et de l'énergie que nous irons chercher le point de croissance qui manque à l'Europe pour sauver son modèle social et trouver sa voie dans la mondialisation.
Contrairement à tout ce que l'on a pu entendre sur l'Allemagne depuis trente ans, elle ne s'est pas « finlandisée », elle n'a pas cherché à dominer le monde. Elle est européenne et elle est avec la France. Je suis heureux, fier et ému de travailler avec Werner Hoyer ainsi qu'avec la Chancelière Merkel et le reste de son équipe. Nous portons ensemble le destin du continent européen.

L'avenir de l'amitié franco-allemande ne m'inquiète pas car l'Allemagne est devenue un grand pays démocratique et je suis convaincu qu'elle le demeurera. Cependant, face à la crise monétaire que nous traversons, nous ne sommes pas d'accord. Dès lors que la Chancelière refuse que la zone monétaire devienne une union de transfert, il est évident que la Grèce ne remboursera pas ses dettes. L'euro souffre par conséquent d'un problème structurel, et le plan monté à Luxembourg n'est pas à la hauteur. L'Allemagne a d'ailleurs refusé de s'engager à une solidarité financière excédant sa quote-part, et nous ignorons si le fonds de garantie jouira de la notation AAA. Je connais la phobie allemande à l'égard de l'inflation mais, sans monétisation de la dette, nous ne nous en sortirons pas.

Attachés au partenariat franco-allemand, nous nous inquiétons des différends qui, depuis trois ans, se sont dessinés à de nombreuses reprises entre nos deux pays.
Plutôt qu'imposer une démarche à vingt-sept, pourquoi ne pas avoir privilégié la zone euro pour mener des actions communes, quitte à y associer les Etats qui ont immédiatement accepté de participer au soutien de l'euro, comme la Pologne ou la Suède ?
Vous avez évoqué à juste titre la crainte de l'inflation. Nous adhérons tous à l'objectif de retour dans le pacte de stabilité mais l'échéance de 2013 ne fait-elle pas peser un risque tout aussi redoutable, celui de la déflation ? L'effort demandé paraît à bien des égards démesuré.
Nos deux ministres sont manifestement conscients qu'il ne suffit pas de lancer des bouées de sauvetage, aussi efficaces soient-elles. Il nous faut aussi construire le bateau européen capable de tenir dans la haute mer de la mondialisation, entreprise autrement complexe.
Plusieurs niveaux de responsabilité existent et, lorsqu'il est impossible d'agir tous ensemble, il ne faut pas hésiter à le faire à quelques-uns. Cela dit, les institutions européennes sont tellement hostiles aux coopérations renforcées qu'aucune ne peut voir le jour, hormis celle engagée il y a quelques semaines en matière de divorce. Il n'y a en réalité que des coopérations particulières, pour l'euro, pour Schengen, comme pour pratiquement toutes les politiques européennes ; seuls le marché commun et la politique agricole commune rassemblent les Vingt-sept. Si elles sont menées dans un esprit d'ouverture, ces coopérations particulières font avancer l'Europe et pourront nous sauver. Le binôme franco-allemand lui-même n'est rien d'autre qu'une coopération particulière. Il ne faut pas céder à ceux qui, refusant d'avancer, veulent empêcher les autres de le faire.

Nous vivons effectivement une période très particulière. Nos deux pays, comme tous les autres, connaissent des difficultés intérieures diverses et la situation est particulièrement préoccupante en Belgique et en Grèce. Ne craignez-vous pas que cela perturbe l'action de l'Europe, que cela se répercute sur la cohésion de l'Union européenne, malgré la vigueur des engagements réaffirmés hier ? Comment voyez-vous les perspectives à court terme ?
Comment envisagez-vous, au regard des traités européens, que l'Europe puisse priver un État de son droit de vote au Conseil, ou tout du moins le suspendre ? Ce n'est pas une question piège mais une interrogation sérieuse.

La gouvernance économique européenne est nécessaire mais complexe à mettre en oeuvre. Qu'attendez-vous d'une gouvernance mondiale et comment abordez-vous le futur sommet du G20 ?
Dans quels secteurs de la recherche et de l'innovation nos deux pays pourraient-ils oeuvrer ensemble afin de trouver le point de croissance supplémentaire dont parlait M. Lellouche ? Quelles actions sont menées aujourd'hui et quelles actions pourraient l'être demain, dans un contexte de réduction des budgets publics ?
Il a été annoncé, hier, que seront instaurées une taxe sur les transactions financières et une taxe bancaire. Mais comment ce dispositif pourra-t-il fonctionner alors que les autres pays n'y sont pas tous favorables ? La France et l'Allemagne alimenteront-elles ainsi un fonds européen auquel certains autres Etats membres de l'Union refuseront de participer ? L'imprécision de cette annonce nuit à la compréhension du dispositif et nous fait douter de ses chances d'aboutissement.
L'Agenda 2020 comporte beaucoup de points négligeables mais quelques points intéressants, relatifs notamment aux grands projets de recherche. Mais comment l'Europe pourra-t-elle faire face à leur financement, dans un contexte de restriction budgétaire et de maintien du budget de l'Union au taux ridicule de 1 % de la richesse européenne, soit 135 milliards ?
Monsieur Myard, si l'Union européenne devenait une union de transfert, je pense que ce serait la fin de l'euro. Pour ma part, je pense que ce serait une catastrophe car je reste convaincu des avantages de la monnaie commune. L'Allemagne, ces derniers mois, a certes traversé des turbulences, mais n'oublions pas combien l'euro nous a fait gagner, notamment du point de vue de la compétitivité de l'Union européenne en général.
Il convient au demeurant de lever un quiproquo : la compétitivité des Etats européens ne doit pas être mesurée au sein de l'Union européenne ; le bon benchmark est la compétitivité globale de l'Union sur les marchés. Pour répondra au défi de la mondialisation, l'intégration européenne, avec l'euro, constitue l'une des solutions.
Quand j'observe le taux de participation aux élections européennes, j'en déduis que nous n'avons peut-être pas suffisamment convaincu nos concitoyens de la nécessité absolue de bâtir un nouveau projet européen. La réunification fait déjà partie du passé. L'Europe doit s'auto-affirmer, notamment à travers une plus forte intégration européenne.
Il importe aussi que nous préservions notre monnaie européenne. Le démontage de la vis de réglage du taux de change a considérablement réduit notre marge de manoeuvre. Pour maîtriser l'inflation et les déficits, nous devons limiter les risques de volatilité.
Monsieur Garrigue, le risque de déflation dépend de l'action que nous mènerons pour réduire les budgets publics. Je répondrai au passage à plusieurs questions qui m'ont été posées.
Sur quel axe doit-on se concentrer pour accomplir des économies ? La semaine dernière, nous nous sommes mis d'accord, au terme d'une réunion de vingt-cinq heures, sur ces fameux 80 milliards à économiser en quatre ans, et nous n'avons pas renoncé à un centime de dépenses concernant les politiques de recherche et de formation, en faveur desquelles nous avons au contraire prévu d'investir 12 milliards. Nous travaillons ensemble, par exemple, dans le secteur de la recherche sur l'énergie, les Allemands devant continuer de progresser pour combler leur déficit dû à l'absence d'énergie nucléaire. Nous devons nous fixer de nouveaux objectifs, notamment en matière de recherche fondamentale, mais aussi éveiller, stimuler la curiosité de nos jeunes scientifiques. Bien sûr, le risque de déflation existe, mais uniquement si nous négligeons le deuxième volet du PSC, celui de la croissance.
Les Allemands, qui, habituellement, ont tendance à se plaindre, sont d'ailleurs plutôt optimistes actuellement. Le nombre de chômeurs est tombé de 5 millions à 3,5 millions en cinq ans ; cela reste beaucoup trop mais cela représente un progrès très important. Durant ce même laps de temps, nous avons créé un million de postes de travail et nous comptons, cette année, sur une croissance largement supérieure à 2 %. Bref, je ne crois pas que notre politique de stabilité conduira à freiner la croissance, bien au contraire, car elle consolidera la confiance dans notre monnaie. Le danger existe, c'est vrai. Il faut économiser sans nuire à la croissance. Ce n'est pas facile mais c'est le chemin que nous comptons emprunter.
Monsieur Fauchon, pour ne pas être engloutis par la mondialisation, nous avons en effet besoin du bateau européen. Nous devons expliquer à certains de nos amis européens – je ne dirai pas lesquels – que le delta de croissance entre la France et eux provient des écarts de compétitivité sur le marché mondial. À cet égard, le marché domestique est sans doute le plus beau cadeau économique que des pays aient reçus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le processus d'intégration est certes différencié, il ne faut refuser à aucun État la capacité de ne pas participer à une politique donnée, mais il ne faut pas non plus bloquer le processus. Tel est l'esprit des coopérations renforcées ; nous disposons d'un instrument mais il reste à savoir si nous aurons le courage de l'utiliser. La semaine dernière, notre collègue britannique a prononcé une intervention remarquable, qui témoigne de la détermination et de la solidarité de son pays : il a indiqué que la Grande-Bretagne ne rejoindra pas la zone euro dans les prochaines années mais qu'elle ne souhaite pas l'affaiblissement de la monnaie européenne, lequel aurait des répercussions négatives sur son propre marché national.
Monsieur Schneider, si je ne crois pas à l'éclatement de l'Europe, le nationalisme en Europe me rend néanmoins très soucieux. N'étant pas diplomate, je ne me risquerai pas à des commentaires, mais je suis préoccupé par ce qui se passe en Belgique – c'est-à-dire au coeur de l'Europe –, en Hongrie ou en Slovaquie. Sur le dossier croate, la Slovénie a heureusement évité ce qui aurait constitué un recul par rapport à l'esprit de l'intégration européenne.
Monsieur Badinter, parmi les questions qui m'ont été posées, celle du retrait du droit de vote est la plus délicate. Mon avis n'est pas encore tranché car je ne vois pas où est la solution. Des voix s'élèvent, en Allemagne, pour réclamer une modification du droit de vote primaire. C'est peut-être la seule solution mais, soyons réalistes, ce sera impossible à court terme, d'autant que les cours constitutionnelles nationales risquent de s'y opposer. Le processus de modification du droit de vote primaire est difficile, nous l'avons constaté ces dernières années, ce qui me rend quelque peu prudent, peut-être davantage que certains de mes compatriotes.
Monsieur Lecou, monsieur Marc, si les décisions de Pittsburgh relatives à la régulation des marchés avaient été mises en application, nous aurions déjà avancé. Je n'ai pas pris connaissance dans les détails du texte présenté hier mais il y a peut-être une confusion entre deux conceptions très différentes. Je ne parlerai pas des taxes sur les banques, qui existent déjà. S'agissant des marchés financiers, deux options sont envisageables : soit un impôt s'appliquant aux transactions financières, soit une sorte de TVA – taxe sur la valeur ajoutée – sur les produits financiers. Avant de nous rendre à Toronto, il importe que nous nous mettions d'accord sur ce point et que nous convainquions nos partenaires, car nous sommes encore une petite minorité radicale.
Madame Tasca, aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'espace, d'énergie et d'électromobilité, dont il est aussi question dans nos quatre-vingts propositions. En matière de recherche, je le répète, nous devons fixer des priorités et stimuler nos jeunes scientifiques.
L'an prochain, nous allons devoir affronter une lourde bataille sur les fonds structurels. Alors que l'ouverture à l'Est a fait entrer dans l'Union des pays d'Europe orientale à l'économie bien moins avancée que les nôtres, nous ne pouvons pas, à l'Ouest, transformer les modalités d'intervention du jour au lendemain.
La France, comme l'Allemagne, attache une grande valeur à la politique agricole commune.
Certes, nous souhaitons que le budget de l'Union européenne reste limité à 1 % du PIB des pays de l'Union. Mais avec un tel pourcentage, comment faire si nous devons aussi investir dans les technologies du futur ?
Alors que les prévisions économiques ont été réalisées sur la base d'une poursuite de la croissance, celle-ci est aujourd'hui assez faible. Il faut également tenir compte des conséquences de l'évolution démographique.
Enfin, pour que nous puissions atteindre une partie de nos objectifs, ils doivent être fixés de manière ambitieuse.
Messieurs Daniel Garrigue et André Schneider, nous prenons en compte le risque de déflation. Les propos du Président de la République, ceux de la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne et ceux du Premier ministre hier à Oslo – j'étais à ses côtés – en témoignent.
Réduire les coûts nécessite un pilotage très fin, car il faut éviter que le malade ne meure guéri. Nous devons veiller scrupuleusement à ne pas supprimer le peu de croissance dont nous profitons. Les coupes budgétaires ne doivent pas toucher les investissements essentiels. Ainsi, une part sensible des dépenses du ministère de la défense consiste en dépenses d'investissement, qui irriguent les entreprises et les sous-traitants. Pour éviter que notre croissance soit handicapée, nous devons être attentifs à ce que les coupes touchent uniquement les dépenses de fonctionnement. Nous disposons encore de marges pour les réduire. Économiser sans nuire à la croissance, comme l'expose le ministre Werner Hoyer, correspond exactement à la position de la France.
Monsieur Badinter, votre question est à la fois fondamentale et très complexe. Elle touche aux traités, voire à la Constitution, et, probablement, aux limites que nous sommes capables d'accepter. Les Etats membres de l'euro partagent une monnaie. Un fonds de garantie commun a été institué. La zone monétaire de l'euro est une sorte de carte bleue géante ! Dans la mesure où nous votons des crédits, où nous accordons des garanties, n'avons-nous pas le droit d'exiger souverainement que l'argent soit correctement dépensé ?
L'Union européenne est un État de droit. Les Etats membres sanctionnés ne manqueront pas de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne.
Ils saisiront aussi leurs propres Cours constitutionnelles. Cela dit, un État considéré comme en faillite a bel et bien besoin d'être protégé contre les marchés, et donc d'être couvert par la garantie offerte par l'Union. Même si, bien sûr, comme le mentionne le communiqué paru hier soir, des sanctions financières doivent être prévues en cas de violation systématique des règles, elles ne sont d'aucun secours pour régler des difficultés.
Le Président Pierre Lequiller. Messieurs les ministres, au nom du président Jean Bizet et en mon nom propre, je vous remercie.
La séance est levée à 17 h 45