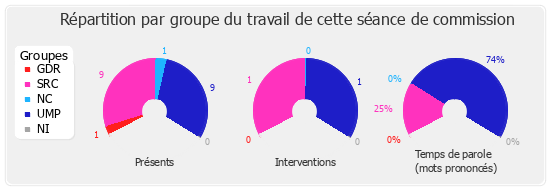Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
Séance du 11 décembre 2007 à 17h00
La séance
La Commission a procédé à l'audition de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice, et a examiné, en application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (MM. Guy Geoffroy, rapporteur, et Serge Blisko, co-rapporteur).
Accueillant Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice, le président Jean-Luc Warsmann a rappelé que la commission des Lois a pris l'habitude de dresser le bilan de l'application d'une loi en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement en entendant le ministre concerné, au cours d'une séance ouverte à la presse, sur le rapport d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition, en l'occurrence, M. Guy Geoffroy, rapporteur de la proposition de loi initiale, et M. Serge Blisko.
Puis il a estimé que la loi du 4 avril 2006 a pris la mesure d'un phénomène longtemps occulté, celui des violences conjugales, en renforçant les règles pénales applicables ; elle s'inscrit dans un mouvement plus large qui tend à mieux prévoir et combattre ce type de délinquance.
La commission des Lois est tout d'abord désireuse de disposer d'informations précises sur la mesure de ce type de violences et sur le premier bilan que l'on peut tirer après l'entrée en vigueur de la loi. Elle sera également attentive aux informations que la ministre pourra lui fournir sur la politique menée par les parquets pour améliorer la réponse pénale en cette matière, au regard de la circulaire prise en avril 2006. Elle souhaitera enfin savoir s'il faut envisager des améliorations du dispositif législatif mis en place.

rapporteur, a tout d'abord souligné que le travail mené de concert avec M. Serge Blisko s'est effectué dans un esprit de très grande ouverture. Tous les interlocuteurs rencontrés ont apprécié la volonté de la commission des Lois de mettre en place un dispositif d'évaluation de l'application des lois qui ne soit pas partisan, même s'il peut être enrichi par la sensibilité de chacun.
Ce sont des séances d'initiative parlementaire qui ont permis à l'Assemblée nationale de débattre d'une proposition de loi – elle-même issue à l'origine de deux propositions de loi sénatoriales – votée à l'unanimité par le Sénat. L'Assemblée a apporté des modifications substantielles à ce texte, suivie en cela par le Sénat et, enfin, par la commission mixte paritaire. Dans chaque assemblée, la proposition de loi a été votée à l'unanimité, ce qui atteste de la volonté partagée de traiter ces problèmes de la façon la plus efficace et la plus large qui soit.
Le rapporteur a souligné la gravité de ces problèmes puisque l'on entend souvent dire qu'« une femme meurt tous les trois jours sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint » ; plus généralement, d'après les chiffres établis en 2000 par l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France – ENVEFF – à partir d'un panel très large et très représentatif, environ une femme sur dix dit avoir été victime de violences au sein de son couple dans l'année qui a précédé l'étude. Si la violence physique est la plus apparente, bien d'autres formes doivent être prises en compte, notamment les violences psychologiques.
Ce texte ayant été inscrit dans des « niches » parlementaires, la commission des Lois de l'Assemblée nationale n'avait pas eu le temps de procéder à des auditions aussi larges que celles qui avaient été réalisées par le Sénat. La préparation du rapport sur la mise en application de la loi aura donc été l'occasion, pour les rapporteurs, d'entendre toutes les personnes qui avaient été entendues par les sénateurs un an et demi auparavant.
M. Guy Geoffroy a ajouté qu'il s'était également rendu, avec M. Serge Blisko, dans le centre médico-psychologique de La Garenne-Colombes, où les rapporteurs ont pu mesurer l'importance du travail réalisé en direction des auteurs de violences, et dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale – CHRS – de Seine-et-Marne, Le Relais de Sénart, qui prend en charge les femmes victimes de violences et les aide à se reconstruire.
Les rapporteurs ont observé que le dispositif législatif mis en place est unanimement salué, tant pour la cohérence juridique des réponses pénales qu'il apporte, que pour sa portée symbolique et sociétale. Même s'il est encore difficile de mesurer l'application de la loi sur un plan quantitatif, celle-ci a sans nul doute contribué, avec les textes d'application qui l'ont accompagnée, à libérer la parole des femmes victimes de violences et à donner plus de poids à l'action menée par les structures associatives ou institutionnelles qui travaillent aux côtés des victimes pour briser le mur du silence qui entoure encore ces questions.
Malgré les progrès accomplis, seulement 8 à 10 % de ces situations de violence font l'objet d'une plainte, et, le cas échéant, d'un traitement pénal. Beaucoup de chemin reste donc à parcourir.
Les acteurs rencontrés ont salué l'ensemble des points forts du texte :
– l'introduction, à l'initiative du sénateur Robert Badinter, de la notion de « respect » parmi les éléments constitutifs du mariage énoncés à l'article 212 du code civil, avant même celles de « fidélité », de « secours » et d'« assistance » ;
– le renforcement des possibilités d'éloigner le conjoint violent, mesure difficile à mettre en oeuvre, tant il est compliqué de trouver des places d'accueil et de mettre en place un dispositif d'accompagnement ;
– la reconnaissance du vol et du viol entre époux ;
– d'une manière plus générale, la reconnaissance comme circonstance aggravante du fait de commettre des crimes et délits dans le cadre d'une relation conjugale ou après la rupture de celle-ci ;
– l'extension de la portée de la loi aux couples non mariés concubins ou liés par un PACS, ainsi qu'aux ex-conjoints, au sens large du terme.
Bien qu'il soit trop tôt pour dresser un bilan quantitatif de l'application des articles de ce texte, le rapporteur a souhaité savoir si la Chancellerie pouvait néanmoins en livrer une appréciation globale. Quels points peuvent être encore améliorés ? Qu'est-il prévu pour y parvenir ?
Le rapporteur a souligné qu'un sujet d'inquiétude a été mis en avant par plusieurs personnes entendues, notamment lors de la visite du Relais de Sénart : la disparité des politiques pénales menées par les parquets, alors même que la circulaire du 19 avril 2006 leur donne tous les outils pour mettre en oeuvre cette loi qui est, par ailleurs, d'application directe. Le législateur s'était à cet égard efforcé de ne pas introduire dans la loi des dispositions relevant du règlement ou de la politique pénale du garde des sceaux.
Dans le cas d'espèce, la même association se trouve confrontée à deux parquets dont les politiques sont diamétralement opposées. On ne saurait rester insensible à de telles disparités, dont la Chancellerie doit se saisir.
A contrario, le procureur de Douai mène, depuis 2003, une politique volontariste de prise en charge globale des auteurs de violences, ce qui montre qu'une forte implication des parquets peut permettre l'amélioration de la situation, en particulier une diminution notable du taux de réitération. À Douai, ce taux a été ramené à 6 %.
Les disparités constatées sont préjudiciables à la crédibilité même du dispositif législatif mis en place et, plus généralement, au traitement des violences faites aux femmes.
Une autre question a trait aux chiffres de la mortalité qui fait suite aux violences conjugales. Le chiffre de 130 morts par an – repris par la presse et cité par Mme Valérie Létard dans sa présentation du plan qu'elle vient de lancer pour les trois prochaines années – n'est pas contesté, mais les chiffres établis à partir des procès en assises sont dix fois inférieurs : 10 à 15 morts par an. Il faut que cet écart soit analysé et expliqué.
La prise en compte de la violence au sein du couple ne saurait toutefois être limitée à la mortalité et aux violences physiques : il faut y adjoindre la violence psychologique. Celle-ci est sans aucun doute beaucoup plus difficile à cerner, mais quiconque s'intéresse à ces phénomènes attestera de la réalité du laminage et de la déstructuration psychologiques qui en sont les effets.
M. Guy Geoffroy a demandé à la ministre s'il était envisagé de s'attaquer à ces problèmes, comme l'ont souhaité de nombreux interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs. Comment définir les violences psychologiques au sein du couple ou après la dissolution de celui-ci, lorsque, bien souvent, les enfants sont pris en otage ? Peut-on envisager d'en inscrire le principe et la définition dans la loi ?
Enfin, les rapporteurs ont été frappés par les discordances pouvant survenir dans le traitement de ce genre d'affaires par les juridictions civiles et les juridictions pénales. Lorsqu'une partie du différend conjugal est traitée au civil alors que des violences font l'objet d'une procédure pénale, les contacts sont, dans le meilleur des cas, réduits ; souvent il n'existe pas d'échange d'informations entre le civil et le pénal. On peut donc assister, dans un même ressort, à des décisions contradictoires, notamment pour ce qui concerne l'éloignement du conjoint et la prise en charge des enfants. La Chancellerie étudie-t-elle des solutions pour améliorer l'articulation entre le civil et le pénal en cette matière ?

, co-rapporteur, s'est associé aux propos de M. Guy Geoffroy et a souhaité les prolonger par trois réflexions.
Tout d'abord, au vu de l'ampleur du phénomène des violences conjugales, il paraît opportun de pratiquer des « piqûres de rappel ». La Chancellerie doit rappeler chaque fois que cela est nécessaire l'existence, la portée et l'intérêt de cette loi. De l'avis général, le premier contact des femmes victimes de violences tant avec les services de police ou de gendarmerie, qu'avec les services sociaux s'est beaucoup amélioré. En revanche, dans le domaine hospitalier, des progrès restent à faire. L'information et la formation des services publics revêtent une grande importance. Il convient également de rappeler que la plainte est de droit et que la simple main courante ne devrait plus être pratiquée en la matière, ce qui éviterait de minorer le phénomène.
En deuxième lieu, la médiation pénale qui est encore trop souvent proposée semble inappropriée aux yeux de tous les spécialistes de ces questions, qui dénoncent une « fausse bonne idée ». Elle paraît en effet établir une forme d'égalité entre la victime et l'auteur des actes, d'autant qu'elle est souvent confondue avec la médiation familiale. Il conviendrait que la Chancellerie poursuive sa réflexion sur cette procédure.
Enfin, si l'éviction des auteurs d'actes de violence est permise, à Douai, par la mobilisation de quelques places d'un CHRS associatif, elle est beaucoup plus compliquée à mettre en oeuvre dans les très grandes villes, en particulier lorsque le bail est au nom du conjoint violent qui fait l'objet d'une mesure d'éviction. La divergence entre le civil et le pénal évoquée par M. Guy Geoffroy peut aboutir à ce qu'une décision pénale éloigne la personne violente de son conjoint tandis que cette dernière garde, au civil, les droits relatifs au logement du couple. Au-delà, l'affaire de Dunkerque a montré que, lorsque des actes criminels ou délictueux sont frappés de prescription, les personnes qui hébergent et protègent la victime peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires, ce qui rend délicates les conditions d'intervention des associations.
Les rapporteurs ont pu constater toute l'importance de la loi pour mettre au jour un phénomène social. De l'avis général, sans la loi et ses mesures d'accompagnement, le nombre d'actes signalés n'aurait pas été multiplié par vingt en dix ans : les choses seraient sans doute restées en l'état. Dans ce domaine comme dans d'autres, le principe selon lequel la loi protège le plus faible se vérifie, ce qui ne peut qu'inciter à poursuivre le travail.
garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué qu'elle avait reçu le 23 novembre les représentantes des associations qui défendent les femmes victimes de violences. Celles-ci ont rappelé, une fois encore, la nécessité de l'application de la loi et du rappel de la loi, tout en reconnaissant que la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple avait marqué une réelle avancée.
Il faut à cet égard saluer l'initiative de Mme Nicole Borvo, dont une première proposition de loi – fusionnée ensuite avec le texte débattu – visait à porter l'âge légal du mariage des jeunes filles à 18 ans.
Cette loi sanctionne davantage les violences conjugales. La qualité de conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ou ex-conjoint au sens large constitue désormais une circonstance aggravante. Est également reconnue l'existence du viol et des agressions sexuelles à l'intérieur du couple.
En outre, la loi renforce les mesures d'éviction du conjoint violent. Introduite par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, la procédure d'éviction du conjoint violent a été utilisée à 350 reprises en 2005 et plus de 1 000 fois en 2006. L'impact de cette mesure fait actuellement l'objet d'une étude. En matière pénale, elle est utilisée dans une procédure de violences graves sur trois.
La loi du 4 avril 2006 a été mise en oeuvre immédiatement : la circulaire d'application, signée dès le 19 avril 2006, préconise un traitement rapide et adapté des procédures relatives aux violences conjugales.
La garde des sceaux a ajouté que, depuis le vote de cette loi, notre arsenal législatif a été complété par deux lois.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a étendu le suivi socio-judiciaire aux auteurs de violences conjugales et instauré une injonction de soin pour les auteurs de violences commises au sein du couple. Celle-ci est obligatoire lorsque les violences présentent un caractère habituel. Afin de mieux identifier les phénomènes de violence, son article 34 prévoit par ailleurs que le médecin n'a pas à recueillir l'accord de son patient pour lever le secret médical lorsque la victime n'est pas en capacité de se protéger. Cette disposition vise à protéger les femmes soumises à l'emprise d'un conjoint violent.
La loi du 10 août 2007 complète ces dispositions en instaurant des peines minimales pour les conjoints violents récidivistes et en renforçant les obligations de soins pouvant leur être imposées.
Le bilan de la loi du 4 avril 2006 fait apparaître des avancées dans trois directions : les victimes sont mieux prises en charge ; les poursuites rapides se sont développées ; les condamnations prononcées sont plus sévères.
La prise en charge des victimes, tout d'abord, est améliorée dès le dépôt de la plainte. Les mains courantes sont devenues de plus en plus rares, de même que les classements sous condition. Pas moins de 168 associations d'aide aux victimes interviennent dans 1 350 lieux d'accueil : maisons de la justice et du droit, tribunaux, hôpitaux, mairies, points d'accès au droit. Elles organisent également des permanences dans 150 commissariats de police ou brigades de gendarmerie. Près de 70 commissariats de police et unités de gendarmerie disposent du concours de travailleurs sociaux. En outre, 28 psychologues interviennent dans des commissariats. Ces professionnels accompagnent les victimes au moment du dépôt de la plainte et au plus près de la commission de l'infraction.
L'étape du dépôt de plainte reste néanmoins difficile. Selon les enquêtes de victimation, seulement 8 % des victimes de violences conjugales osent déposer plainte, d'où l'intérêt d'inciter le signalement par d'autres acteurs, notamment les médecins. Les dispositifs mis en place renforcent la confiance des victimes en les protégeant et en les accompagnant.
Le partenariat en matière d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences a été renforcé par deux conventions signées par le ministère de l'intérieur, la première le 25 mai 2005 avec l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation – INAVEM – et la seconde le 7 mars 2006 avec le Centre national d'information des droits des femmes et de la famille – CNIDFF – et la Fédération nationale Solidarité femmes. Depuis, six conventions locales ont été signées et une trentaine sont en projet pour assurer la prise en charge effective et le suivi de la victime après le dépôt de plainte.
En outre, les procureurs et leurs substituts ont été mieux sensibilisés au phénomène des violences conjugales. En 2006, ils ont été saisis de 52 000 affaires, contre 39 000 plaintes en 2003. Comme M. Guy Geoffroy l'a relevé, les différences entre les données du ministère de la justice et celles de l'Observatoire national de la délinquance sont considérables. À l'évidence, les ministères en charge de la justice, de l'intérieur, de la santé et de la solidarité ont besoin d'un outil statistique commun.
Cependant, ces différences, peuvent être expliquées. Alors que les chiffres fournis par le ministère de l'intérieur reposent sur des faits constatés en 2006, l'outil statistique de la justice repose sur la qualification pénale de l'infraction. Or, jusqu'en avril 2006, l'infraction pénale de « meurtre sur conjoint » n'était pas prévue par la loi. Il s'agissait d'un « assassinat » ou d'un « meurtre ». Il n'y avait donc pas de prise en compte du phénomène en tant que tel. Seules des données partielles ont pu être recueillies. Au surplus, la qualification retenue par le procureur et le juge d'instruction peut influer sur les données statistiques : ceux-ci peuvent choisir de qualifier la mort d'une femme d'assassinat s'il y a préméditation ou de meurtre sur conjoint, l'un et l'autre étant punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Enfin, un certain nombre de situations juridiques ne sont pas prises en compte dans les statistiques du ministère de la justice sur les homicides dans la sphère familiale. Tel est le cas des meurtres suivis du suicide de l'auteur, qui font l'objet d'un classement sans suite du fait de l'extinction de l'action pénale, ou encore des meurtres commis par des auteurs pénalement irresponsables.
En dépit de ces incertitudes, l'augmentation du nombre des procédures transmises au parquet donne une image plus réelle du phénomène des violences conjugales, encore qualifié de « mineur » il y a quelques années. Le taux de réponse pénale a fortement augmenté passant de 76 % en 2005 à 80 % en 2006 et à 83 % pour les trois premiers trimestres de l'année 2007. Cela signifie que les parquets donnent davantage de suites judiciaires aux affaires de violences conjugales. Ils effectuent moins de classements sans suite directs.
La circulaire du 14 mai 2004 présentant la loi du 9 mars et le guide de l'action publique relatif à la lutte contre les violences au sein du couple, publié en septembre 2004, prohibent le recours au classement sec. Cette préconisation est régulièrement rappelée aux parquets. Elle l'a encore été par la circulaire du 19 avril 2006.
Les procureurs ont développé les mesures alternatives aux poursuites. Ces procédures apportent une réponse rapide sans qu'il soit nécessaire de saisir un tribunal. Elles sont parfaitement adaptées aux infractions les moins graves.
Les parquets travaillent avec les associations d'aide aux victimes. Certains ont mis en place des stages pour les conjoints violents ; en ce domaine également, le procureur de Douai a été un précurseur. Au cours de ces stages, plusieurs auteurs de violences sont réunis en présence d'un psychologue et un travail de réflexion sur le passage à l'acte est effectué. L'absence à ces stages expose à des poursuites devant le tribunal.
M. Guy Geoffroy a très justement mis en exergue la notion de « violences psychologiques ». Elles sont une réalité. Bien qu'elles soient moins visibles, elles sont tout aussi graves, d'autant qu'elles ont également des répercussions sur les enfants. Le chapitre du code pénal intitulé « Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne » donne déjà les moyens d'y répondre, même si les atteintes à l'intégrité psychique n'y sont pas détaillées. La jurisprudence prend en compte cette forme de violence, de même que les médecins lorsqu'ils établissent l'incapacité temporaire de travail.
Deuxième évolution depuis 2006 : les poursuites rapides se sont développées.
Pour les faits les plus graves, les parquets ont davantage recours aux poursuites. Même si l'auteur des faits est un primo-délinquant au regard de la justice, la poursuite est quasi systématique si le conjoint indique que les violences sont habituelles. Alors que le taux de procédures ayant fait l'objet de poursuites était de 35 % en 2005, il a été supérieur à 41 % pour les trois premiers trimestres de l'année 2007.
Des directives de politique pénale sont régulièrement adressées aux procureurs généraux. Un guide de l'action publique relatif à la lutte contre les violences au sein du couple a par ailleurs été diffusé en septembre 2004 dans tous les parquets et il appartient aux procureurs généraux de veiller à la coordination et à l'homogénéité de l'action publique au sein de leur cour d'appel. Si des disparités subsistent entre parquets – dans de bien moindres proportions toutefois –, elles s'expliquent par la variété des réponses pénales qui peuvent être apportées : dans une juridiction où existe un fort réseau associatif, les alternatives aux poursuites sont plus nombreuses. Ailleurs, faute d'alternative, on poursuivra davantage.
Les parquets sont encouragés à privilégier des modes de poursuite rapides, soit en comparution immédiate dans les 48 heures pour les faits les plus graves, soit par convocation par officier de police judiciaire, les délais n'excédant pas, dans ce cas, deux ou trois mois suivant l'infraction. Ces poursuites rapides sont souvent associées à une mesure d'éviction du conjoint pour répondre à l'urgence. Ce dispositif facilite l'accompagnement de la victime et la prise en charge de l'auteur. Le juge interdit à ce dernier d'entrer en contact avec la victime. Tout manquement à cette interdiction entraîne une incarcération. De janvier à septembre 2007, 1 222 mesures d'éloignement du domicile conjugal ont été ordonnées, dont 713 de moins de deux mois et 509 de plus de deux mois.
La bonne application de ces dispositions permet d'éviter aux femmes ayant des enfants de devoir chercher un hébergement dans l'urgence et, parfois, d'être placées dans des foyers.
Enfin, les tribunaux se sont montrés plus fermes à l'encontre des auteurs de violences conjugales.
L'emprisonnement, qui est la peine la plus prononcée, devient quasiment le principe ; on relève par ailleurs une progression de la part des emprisonnements fermes. Le quantum moyen de la peine ferme est de six mois. En 1996 près de 5 000 condamnations ont été prononcées. Ce nombre a été porté à 12 000 en 2006. La récidive est davantage sanctionnée : la loi du 10 août 2007 a d'ores et déjà donné lieu à 843 condamnations en matière de violences conjugales. Des peines planchers ont été prononcées pour 67 % des violences sur conjoint ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours et pour 75 % des affaires avec ITT supérieure à huit jours.
Ces chiffres démontrent que les tribunaux ont pris la mesure de la gravité des faits de violences conjugales.
Cependant, si un important travail a été réalisé depuis la mise en oeuvre de la loi du 4 avril 2006, il reste encore beaucoup à faire.
Il faut, par exemple, améliorer la prise en charge des auteurs de violences conjugales. C'est l'un des douze objectifs du plan triennal mis en place par Mme Valérie Létard. Le ministère de la justice est associé à ces travaux. Il conviendra notamment de mettre en oeuvre un accompagnement adapté pour prévenir la récidive, tant les violences conjugales sont souvent associées à l'alcoolisme ou à l'oisiveté.
Les rapporteurs ont également souligné la nécessité d'améliorer l'articulation entre les procédures civile et pénale, ce qui correspond à une demande réelle des associations.
À cet égard la loi du 26 mai 2004 sur le divorce a apporté une première réponse : le juge peut attribuer l'autorité parentale et le domicile conjugal au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Cette mesure, qui est en cours d'évaluation, a été utilisée plus de 1 000 fois en 2006.
En outre, le plan triennal permettra de mieux coordonner les décisions prises au niveau judiciaire. D'ores et déjà, un avant-projet de décret vise à faciliter la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. Cette communication est en effet nécessaire pour éviter les décisions contradictoires et pour mieux apprécier l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agisse de l'attribution de l'autorité parentale, de la résidence de l'enfant ou des mesures éducatives décidées par le juge des enfants.
La Commission a autorisé le dépôt du rapport en vue de sa publication.
La Commission a procédé à l'audition de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (n° 442).
garde des sceaux, ministre de la justice, a observé tout d'abord que le présent projet de loi était attendu depuis longtemps, puisqu'il traite de deux questions essentielles, celle des agresseurs d'enfants – plus précisément des prédateurs sexuels – et celle de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Depuis 1998, les gouvernements successifs ont cherché à améliorer la lutte contre les délinquants sexuels dangereux. Des solutions nouvelles ont été mises en place pour mieux prendre en charge et mieux encadrer ces délinquants. L'objectif est de réduire autant que possible leur dangerosité et le risque d'un nouveau passage à l'acte. La loi Guigou de 1998 a posé le principe des soins en prison pour les délinquants sexuels, instauré le suivi socio-judiciaire et créé le fichier national des empreintes génétiques. En 2004 est établi le fichier national des agresseurs sexuels. Le bracelet électronique mobile, dont l'usage est instauré en 2005, peut désormais être généralisé, aux termes du décret du 1er août 2007. Enfin, la loi du 10 août 2007 renforce l'injonction de soins.
Des réflexions très approfondies ont récemment été conduites sur cette question. Depuis 2005, trois rapports ont été rendus : celui d'une commission santé-justice présidée par Jean-François Burgelin ; le rapport de la mission parlementaire confiée au député Jean-Paul Garraud ; enfin, le rapport parlementaire des sénateurs Philippe Goujon et Charles Gautier. Tous concluent à la nécessité de mettre en place un dispositif permettant d'écarter de la société les délinquants les plus dangereux. Ils préconisent soit des centres fermés de protection sociale, soit des unités hospitalières de long séjour spécialement aménagées.
Le drame du petit Enis, survenu cet été, montre qu'il est temps d'agir. Le texte du Gouvernement concerne à la fois la justice et la santé. Il a été élaboré en étroite coopération avec Mme Roselyne Bachelot et vise à apporter des réponses fortes et concrètes.
Le projet de loi comporte trois volets : des mesures de sûreté pour les auteurs de crimes contre les mineurs ; de nouvelles dispositions pour le traitement judiciaire des personnes déclarées irresponsables pénalement ; des mesures destinées à améliorer la prise en charge des détenus nécessitant des soins.
Après la détention, certains criminels pédophiles sont encore dangereux. Ils peuvent de nouveau passer à l'acte, comme cela a été le cas de Francis Évrard. Avec les nouvelles dispositions, ils resteront sous contrôle de la justice tant qu'ils ne se seront pas soignés et ils seront placés dans des centres fermés.
Sont concernées par cette mesure de sûreté les personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour des crimes commis sur des mineurs de quinze ans. La notion de crime renvoie en effet aux actes les plus graves, comme le meurtre, l'assassinat, les actes de torture, de barbarie ou le viol, tandis que le seuil de quinze ans de réclusion correspond à une lourde peine. De plus, la mesure concerne les auteurs de faits commis sur des mineurs de moins de quinze ans, car ces derniers sont particulièrement vulnérables et sont les principales victimes des pédophiles les plus dangereux.
Dans le nouveau dispositif, le condamné est averti par le président de la cour d'assises le jour de sa condamnation qu'il risque une rétention de sûreté en fonction de sa dangerosité en fin de peine. Un an avant la fin de la peine, il est soumis à un examen médical. L'avis d'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est requis. Créée par la loi sur la récidive du 12 décembre 2005, cette instance est composée d'un magistrat, d'un préfet, de deux experts – un psychiatre et un psychologue –, d'un directeur des services pénitentiaires, d'un avocat et d'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes. Elle est déjà consultée pour les placements sous surveillance électronique des condamnés dangereux à fort risque de récidive. Le projet étend donc sa mission actuelle. Elle se prononcera, comme elle le fait déjà, sur la dangerosité et le risque de récidive – cela fut le cas, à trois reprises, pour Francis Évrard – mais aussi sur la nécessité d'un placement en rétention de sûreté.
Si le risque de récidive est particulièrement élevé, elle propose au procureur général de saisir une commission régionale. Il s'agit d'une instance nouvelle, dédiée à cette mission, qui sera composée de magistrats de la cour d'appel désignés pour trois ans par le Premier président. La commission régionale rend une décision motivée après débat contradictoire. La décision de rétention est valable un an et est renouvelable.
La personne faisant l'objet d'une mesure de rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire sous la tutelle des ministères de la justice et de la santé. Elle bénéficie, de façon permanente, d'une prise en charge médicale et sociale. Sa situation est réexaminée chaque année.
Quand la rétention prend fin, la personne peut être soumise à des obligations particulières. Elle peut être placée sous surveillance électronique mobile. Une injonction de soins peut également être ordonnée. En cas de manquement à ces obligations, la personne pourra à nouveau faire l'objet d'une mesure de rétention. Elle pourra être placée en urgence en centre socio-médico-judiciaire par le président de la commission régionale, le temps de décider d'une rétention de sûreté dans les mêmes conditions que pour un placement initial.
S'agissant de la mise en oeuvre de la loi, deux cas de figure doivent être distingués : les condamnés avertis par le juge le jour de leur condamnation pourront être placés dans une structure fermée à la fin de leur peine s'ils présentent encore une grande dangerosité ; les criminels actuellement incarcérés pourront être placés sous bracelet électronique mobile après la fin de leur peine et bénéficieront d'un suivi médical mais, s'ils méconnaissent ces obligations, ils pourront être placés en rétention de sûreté.
Cette disposition, qui résulte de l'avis du Conseil d'État, rend le projet de loi parfaitement conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État conclut en effet que l'on ne peut pas placer directement en rétention de sûreté un individu à sa sortie de prison sans que la condamnation initiale le prévoie.
Dans le cas de Francis Évrard, la justice aurait eu les moyens d'agir avant le drame. Condamné à vingt-sept ans de prison, il est sorti au bout de dix-huit ans. Dans le système proposé par le Gouvernement, il aurait été placé sous bracelet électronique mobile dès sa sortie de prison. Il aurait été suivi attentivement et n'aurait pas pu changer de région. S'il n'avait pas respecté ces obligations, il aurait été placé en rétention de sûreté.
Ce premier dispositif est efficace et pourra être mis en oeuvre rapidement, dès la promulgation de la loi. Grâce à la bonne coopération entre les services du ministère de la justice et ceux du ministère de la santé, une première structure fermée sera mise en place avant la date initialement prévue de juin 2009. Elle sera ouverte à titre expérimental au sein de l'établissement de Fresnes dès le 1er septembre 2008.
Certains considèrent que le champ d'application du projet de loi est trop restreint, mais il faut avoir conscience qu'il s'agit d'un dispositif totalement nouveau, qui prévoit une mesure extrême qui va priver quelqu'un de sa liberté après sa peine, peut-être même de façon indéfinie. Le dispositif ne peut donc s'appliquer qu'aux atteintes les plus graves. S'il était trop large, il encourrait la censure du Conseil constitutionnel.
Pour ce qui est des nouvelles dispositions relatives aux irresponsables pénaux en raison d'un trouble mental, il convient tout d'abord de décrire la situation actuelle.
Lorsque l'auteur d'une infraction est déclaré pénalement irresponsable, le juge d'instruction rend actuellement une ordonnance de non-lieu. Or cette dénomination est mal perçue par les familles de victimes, car elle donne l'impression que les faits n'ont jamais eu lieu. De plus, l'ordonnance de non-lieu clôture l'instruction et éteint les poursuites judiciaires. Les familles reçoivent un courrier les informant de la décision du juge. Certains juges prennent cependant l'excellente initiative de recevoir les victimes.
Actuellement le non-lieu clôt la voie pénale et les victimes doivent saisir elles-mêmes le tribunal civil ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander une indemnisation. En effet, l'irresponsabilité pénale ne fait pas disparaître la responsabilité civile. L'auteur des faits peut donc être condamné civilement à condition que les victimes engagent elles-mêmes une nouvelle procédure.
Dans la procédure que le Gouvernement propose de mettre en place, le dossier ne s'achèvera plus par la notification d'une ordonnance de non-lieu : il y aura une audience devant la chambre de l'instruction. Cette audience sera publique mais le huis clos pourra être ordonné. Un débat sur les éléments à charge et l'irresponsabilité pénale interviendra avant la décision. L'audience s'achèvera, le cas échéant, par une décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental.
Ce type de procédure s'applique aujourd'hui uniquement en appel, comme dans l'affaire du meurtre des infirmières de Pau. Une audience a eu lieu en novembre, en présence des victimes et de la personne déclarée irresponsable. Ce sera dorénavant la règle, sans qu'il soit besoin de faire appel.
En outre, les déclarations d'irresponsabilité pénale seront inscrites au casier judiciaire, ce qui constitue une avancée majeure.
Une fois la décision rendue, l'auteur des faits peut être hospitalisé d'office en hôpital psychiatrique. S'agissant d'auteurs d'infractions pénales souvent très graves, les conditions qui permettent au préfet de décider une hospitalisation d'office sont presque toujours remplies. La chambre de l'instruction pourra en outre lui imposer des mesures de sûreté, applicables dès l'hospitalisation. Ces mesures – par exemple l'interdiction de se rendre dans certains lieux, de rencontrer les victimes, ou encore de détenir une arme – seront très utiles au moment de la sortie ou lors des permissions de sortie.
La chambre de l'instruction renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les dommages et intérêts si les victimes le souhaitent. Il ne leur reviendra donc plus d'effectuer toutes les démarches. Le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, dans une formation à juge unique, sera saisi automatiquement. C'est le juge délégué aux victimes qui statuera dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles. Les démarches des victimes se trouvent donc largement simplifiées.
Enfin, le projet de loi comporte de nouvelles dispositions pour améliorer la prise en charge des détenus nécessitant des soins. Sans remettre en cause le principe des réductions de peine, il le conditionne beaucoup plus fortement que ce n'est le cas aujourd'hui. En l'état actuel, la loi prévoit que seuls la bonne conduite et les efforts de réinsertion des détenus justifient une réduction de la peine, mais il est apparu que ces remises étaient devenues trop automatiques. Ainsi, son mauvais comportement en détention n'a pas empêché que Francis Évrard bénéficie de remises de peine.
Il faut que les détenus intègrent mieux les conditions posées pour bénéficier de diminutions de peine. Ces conditions sont en effet la garantie d'une meilleure réinsertion ; elles doivent être vérifiées et, si elles ne sont pas respectées, les réductions de peine doivent être écartées, conformément à la loi.
C'est pourquoi, dans le prolongement de la loi du 10 août 2007, le détenu qui refusera des soins en détention pourra se voir retirer toutes ses remises de peine. Le refus de soins sera désormais assimilé à une mauvaise conduite.
Afin de renforcer le suivi médical, l'échange d'informations entre le médecin intervenant en milieu carcéral et le médecin qui suivra le détenu à sa sortie de prison sera amélioré. De même, les soignants devront signaler au chef d'établissement les détenus dangereux, de manière à assurer la sécurité des personnels intervenant en milieu pénitentiaire et celle des autres détenus.
Telles sont les grandes lignes de ce texte tout à la fois protecteur pour nos concitoyens et respectueux des droits des personnes.

, rapporteur, après s'être félicité du fait que le projet de loi comble une faille de notre arsenal législatif concernant les criminels dangereux et réponde ainsi à l'attente des Français en matière de meilleure protection des plus vulnérables, notamment les mineurs, a regretté que le texte limite la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans. L'opinion publique ne pourra en effet comprendre qu'il ne s'adresse pas, par exemple, à l'auteur de viols sur des jeunes filles de seize ans et demi. Ne faut-il pas élargir le dispositif aux criminels dangereux qui s'attaquent à tous les mineurs, sans distinction ?
S'agissant de la décision de rétention, il s'est fait l'écho du souhait, exprimé par certains magistrats, de voir cette compétence confiée non pas à des commissions régionales et à une commission nationale ad hoc, mais à la juridiction pénale ordinaire, telles les chambres d'application des peines. A l'inverse, il a pu être également suggéré de confier le rôle au préfet.
Il s'est ensuite interrogé sur les conditions dans lesquelles seront réalisées les expertises et les enquêtes sur le fondement desquelles la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est appelée à fonder son analyse de la dangerosité d'une personne, compte tenu également du fait que notre pays doit incontestablement faire des progrès en matière d'évaluation de la dangerosité.
Concernant le statut des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, il s'est demandé si la tutelle du ministère des affaires sociales ne devrait pas s'ajouter à la double tutelle des ministères de la justice et de la santé. Posant à cet égard la question des moyens humains et financiers mis à la disposition de la structure ad hoc qui sera créée au sein de l'établissement de Fresnes en septembre 2008, il s'est également interrogé sur les droits qu'auraient les personnes retenues dans ces centres et par leur éventuel alignement sur ceux des détenus.
Quant à la surveillance judiciaire « élargie », il s'est inquiété de savoir s'il n'y a pas un risque d'inconstitutionnalité à la prolonger au-delà de la durée totale des réductions de peine, car, le non-respect des obligations qui l'accompagnent entraînant le placement en rétention de sûreté, on passerait alors de la liberté surveillée à la privation totale de liberté.
Abordant l'irresponsabilité pénale, il a demandé, bien que le projet de loi ne remette pas en cause la loi de 1990, si l'autorité judiciaire, plutôt que l'autorité administrative, ne pourrait pas intervenir à l'avenir en matière d'hospitalisation d'office.
Par ailleurs, il a estimé, en matière de détention provisoire, que, si le délai de six mois accordé à la chambre de l'instruction pour statuer, à compter de la date de l'ordonnance de transmission des pièces, pouvait être concevable en matière criminelle, il pourrait être ramené à quatre mois en matière correctionnelle.
Pour mieux préserver le droit au procès équitable, il a également demandé que, devant la chambre de l'instruction, la personne qui demeure, à ce stade, présumée responsable et innocente puisse comparaître à sa demande et non pas seulement à celle du président, du parquet ou des parties concernées.
Enfin, il s'est interrogé sur les sanctions qui pourraient être applicables dans le cas de non-respect des mesures de sûreté et sur la façon dont ces dernières pourront être notifiées à la personne irresponsable concernée.
La garde des sceaux a d'abord répondu que si le texte limite la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans, c'est parce qu'un champ beaucoup plus large aurait fait courir un risque d'inconstitutionnalité en raison de la difficulté à définir la notion de dangerosité, étant rappelé que 50 % des personnes placées sous surveillance judiciaire aujourd'hui l'ont été en raison d'atteintes sur des mineurs de moins de quinze ans. Cela étant, elle ne s'est pas déclarée foncièrement opposée à élargir le champ de la loi aux mineurs, dans leur ensemble.
Concernant les centres socio-médico-judiciaires, outre naturellement la tutelle du ministère de la justice, celle du ministère de la santé s'explique par l'absence de médecine pénitentiaire. La formation professionnelle et la réinsertion relevant pour leur part de l'administration pénitentiaire, élargir cette double tutelle à celle du ministère des affaires sociales risquerait d'être source de complication.
Pour ce qui est de l'hypothèse de confier aux chambres d'application des peines le soin de décider d'une rétention de sûreté, elle a rappelé qu'il s'agissait d'autorités juridictionnelles, alors que la mesure de rétention constitue non pas une peine, mais une mesure de sûreté. Attribuer la décision de rétention de sûreté à un tribunal ou aux chambres d'application des peines en ferait donc une mesure juridictionnelle, ce qu'elle n'est pas. Quant à accorder au préfet la possibilité de la prendre, outre le fait que le juge est constitutionnellement garant des libertés individuelles, c'est toujours l'autorité judiciaire qui apprécie la responsabilité après expertise. Il est donc naturel qu'il revienne à un magistrat de statuer dans le cadre de ces commissions régionales et de cette commission nationale qui ne constituent ni des autorités juridictionnelles ni des autorités administratives stricto sensu.
En ce qui concerne le respect des droits de la personne retenue, la garde des sceaux a souligné que le texte reprend scrupuleusement l'avis du Conseil d'État en la matière. De même, s'agissant du droit au procès équitable, le projet prévoit la possibilité de comparution devant la chambre d'instruction de la personne présumée responsable, évidemment si son état le permet.
Elle a considéré par ailleurs que la limitation, par la loi de 2000, de la détention provisoire à une période de quatre mois renouvelable ayant été une avancée, elle ne serait pas opposée à accorder un même délai à la chambre d'instruction pour statuer.
Elle a également souligné que l'expérimentation à Fresnes étant déjà possible à moyens constants, elle n'entraînera pas de surcoût, et a indiqué que trente personnes pourront y être accueillies.
Revenant, enfin, sur l'hospitalisation d'office, elle a fait observer qu'il convenait de distinguer les mesures de sûreté prononcées par l'autorité judiciaire des mesures d'hospitalisation d'office, qui ne peuvent être revues sans une remise à plat de la loi de 1990.
Après que le président Jean-Luc Warsmann eut indiqué que la commission sera attentive au coût de l'expérimentation menée à Fresnes puisque la structure mise en place est appelée à être dupliquée, M. Michel Hunault, estimant que l'état du droit en matière de sécurité des personnes n'est pas satisfaisant, a d'abord souligné que légiférer était légitime, même si cela doit apparaître comme étant fait sous le coup de l'émotion, car l'actualité est suffisamment ponctuée de crimes commis par des personnes qui ont déjà tué pour que l'on fasse droit aux souhaits des familles qui, n'étant le plus souvent animées ni par la haine ni par la vengeance, demandent simplement que le risque de récidive soit évité.
Il a ensuite demandé qu'il n'y ait plus de remise automatique de peine pour les récidivistes les plus dangereux. Certes, le refus de se soumettre à une obligation de soins rendra possible une nouvelle rétention de sûreté, mais la garde des sceaux a elle-même cité le cas d'une personne qui, condamnée à vingt-sept ans de prison, avait été libérée au bout de dix-huit ans. Dès lors, comment faire en sorte que la dangerosité soit prise en compte avant toute remise de peine ?

a observé que la récidive pouvait ressortir à deux logiques : l'une prônant, comme dans le projet de loi, la relégation, la mise à l'écart d'individus, peut-être pour le restant de leur vie – ce qui n'est d'ailleurs pas la première tentative en ce domaine – ; l'autre, qu'il défend, favorisant la réinsertion.
Surtout, la façon dont l'obstacle constitutionnel en la matière est surmonté dans l'exposé des motifs du projet de loi – au prétexte que la mesure de rétention n'est pas une peine – n'est aucunement rassurante. Outre le fait que la mesure de rétention ne pourra qu'être considérée comme une peine dans les faits, sa durée indéfinie est disproportionnée eu égard à la limitation habituelle dans le temps des mesures de rétention en France.
Aucune des deux mesures garantissant aujourd'hui la sécurité des personnes ne peut être invoquée à l'appui d'un dispositif aussi extrême que celui proposé. D'une part, si le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles – FIJAIS – oblige les personnes qui y sont inscrites à justifier régulièrement de leur résidence, cette obligation ne constitue en rien une mesure de privation de liberté. D'autre part, si la surveillance judiciaire prononcée par le juge d'application des peines est limitée à une durée égale aux réductions de peines accordées, c'est bien pour ne pas encourir un risque de censure constitutionnelle puisque l'on reste ainsi dans le quantum de la peine prononcée.
En proposant d'appliquer une deuxième peine à un condamné qui a purgé sa peine, le projet de loi montre une fragilité qui ne lui permettra pas de surmonter les obstacles de constitutionnalité majeurs qui seront soulevés à son encontre.

, revenant sur les problèmes de constitutionnalité, a d'abord considéré qu'il n'est pas possible de soutenir que des magistrats, réunis en commission régionale ou nationale et prenant collégialement une décision de privation de liberté, ne prononcent pas en fait une peine.
Il s'est par ailleurs demandé comment, en légiférant sous le coup de l'émotion, on arrivera demain à se limiter aux crimes commis sur des mineurs de quinze ans : les vieilles dames tuées par Thierry Paulin, les jeunes filles violées et assassinées par Guy Georges ou encore les convoyeurs de fonds attaqués au bazooka ne méritent-ils pas la même considération ?
En outre, comment peut-on espérer rassurer l'opinion publique en la matière alors que les dispositions de la loi en matière de rétention de sûreté ne s'appliqueront au mieux que d'ici à douze ou quinze ans, c'est-à-dire lorsque ceux qui auront été condamnés à au moins quinze ans de réclusion sortiront de détention, même si, d'ici là, les mesures prises en matière de surveillance judicaire peuvent, de façon marginale, déjà être appliquées ?
Il s'est par ailleurs inquiété des conditions de réalisation de l'expertise sur le fondement de laquelle pourra être prononcée la rétention alors que notre pays souffre d'un manque cruel d'experts de qualité, contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne, où le rapport des sénateurs Goujon et Gautier a montré qu'une expertise revenait à environ 4 000 euros, qu'elle s'étalait sur quatre à six semaines et, surtout, qu'elle tentait de mesurer la dangerosité de la personne, ce que nos experts nationaux n'ont pas l'habitude de faire.
Il a souhaité que l'on se donne déjà les moyens d'un contrôle sérieux de la loi sur la surveillance judiciaire et sur le suivi socio-judiciaire, d'autant que les médecins coordonnateurs ne sont pas encore en place, plutôt que de modifier notre organisation judiciaire et l'échelle des peines en instaurant une sorte d'objet pénal difficilement identifiable, menaçant pour les libertés publiques, surtout s'il s'étend à d'autres catégories.
Enfin, il a proposé que les irresponsables pénaux comparaissent, en première instance, devant le collège des trois juges d'instruction qui existera à compter de 2010, de façon à préserver le double degré de juridiction en évitant la saisine directe de la chambre de l'instruction.

a souligné que ce projet de loi était un texte très attendu. Il traduit d'autant moins une volonté de légiférer sous le coup de l'émotion que le Parlement travaille depuis des années sur les questions de récidive et d'évaluation de la dangerosité ; cette notion est d'ailleurs apparue au cours des travaux de la mission de lutte contre la récidive qui a conduit à la loi du 12 décembre 2005.
La question principale à laquelle le texte essaie de répondre est celle du traitement des individus les plus dangereux, non celle de la mise en oeuvre d'une politique sécuritaire d'enfermement généralisé. Il faut comprendre qu'il existe des personnes très difficilement réinsérables voire carrément non réinsérables, pour lesquelles une simple politique de réinsertion ne saurait suffire.
Les professionnels de la justice savent que certains individus très dangereux récidiveront à leur sortie. Il est donc du devoir du législateur de trouver des solutions juridiques à ce problème. À cet égard, une première mesure de sûreté, emblématique, a été introduite par la loi du 12 décembre 2005 avec la possibilité d'imposer le port du bracelet électronique mobile après la fin de la peine, surveillance qui n'a pas été déclarée inconstitutionnelle.
M. Garraud a en outre fait remarquer qu'à chaque fois qu'un texte dérangeait, la question d'inconstitutionnalité était brandie. Or, en la matière, le dispositif de rétention proposé s'applique dans de nombreux pays étrangers, notamment aux Pays-Bas où il est en vigueur depuis plus de quatre-vingts ans. De même, le système de centre fermé, utilisé par exemple en Allemagne, n'a jamais été déclaré contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, non plus que l'évaluation de la dangerosité.
En conclusion, après s'être félicité du fait que le projet de loi prenait mieux en compte les victimes, que le prévenu soit déclaré responsable ou irresponsable, il a souligné que le texte proposé allait enfin remplacer la tutelle pénale supprimée en 1981 – qui permettait de garder en prison une personne déclarée dangereuse alors que sa peine était terminée – en imposant à une population, limitée à une cinquantaine de personnes, contre lesquelles il fallait agir, un traitement dans un centre particulier.

a demandé à la ministre qu'elle lui confirme que les centres socio-médico-judiciaires entrent bien dans le champ de compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

s'est inquiété de ce que, pour la première fois, une commission puisse être appelée à rendre une décision fondée non sur un acte, mais sur sa probabilité, en fonction de l'appréciation de la dangerosité de la personne concernée.
Il s'est également demandé combien de temps il sera nécessaire de passer dans un centre fermé si, auparavant, douze ou quinze ans de traitement en milieu carcéral n'ont pas suffi à soigner. Si la commission peut apprécier avec une grande fiabilité la nécessité de soins, ne pourrait-elle pas tout aussi bien être réunie lorsque la peine est prononcée, ce qui permettrait de mettre aussitôt en oeuvre un traitement médical plutôt que d'attendre douze ou quinze ans ?
Pour ce qui est des personnes appelées à être déclarées pénalement irresponsables, il s'est demandé si organiser des audiences publiques avec des prévenus présentant des pathologies très lourdes aiderait vraiment les familles des victimes.
Enfin, il a souhaité que lui soit expliqué comment une personne déclarée irresponsable pourra faire l'objet d'une condamnation pénale de deux années d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende en cas de non-respect des mesures de sûreté.

a d'abord demandé à la garde des sceaux si elle trouvait qu'il caricaturait le projet en déclarant que celui-ci vise à enfermer quelqu'un non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il pourrait peut-être faire.
Après avoir souhaité connaître le nombre de personnes aujourd'hui dans les prisons françaises concernées par le texte, il a demandé si le centre socio-médico-judiciaire – lieu de privation de liberté – relèverait de l'administration pénitentiaire et si les droits des personnes retenues seraient similaires à ceux des détenus. Il s'est en particulier interrogé sur les activités offertes à ces personnes dans ces centres et sur la référence, dans l'exposé des motifs du projet de loi, à l'exercice du culte.
Rappelant que la décision de rétention est valable pour une durée d'un an, il s'est également interrogé sur le caractère hypothétique d'une telle durée en se demandant si un psychiatre, compte tenu de l'état de l'opinion, pourra prendre le risque de déclarer qu'une personne n'est plus dangereuse.
Il a enfin considéré qu'il appartenait précisément à la commission des Lois d'examiner avec attention la constitutionnalité des mesures proposées.
La garde des sceaux, répondant d'abord à M. Michel Hunault, a indiqué qu'il avait eu raison de souligner que l'état du droit n'est pas satisfaisant et qu'un vide juridique doit être comblé. Si l'on ne doit pas nécessairement légiférer sous le coup de l'émotion, il convient néanmoins de prendre, à un moment ou à un autre, des mesures : ce n'est pas parce que les actes de terrorisme n'existaient pas il y a cinquante ans qu'il ne faudrait pas légiférer à un moment ou à un autre en la matière. Le mandat d'arrêt européen, pour sa part, qui se révèle un outil performant, n'a-t-il pas été décidé après les attentats du 11 septembre ? Aussi la ministre s'est-elle déclarée prête à assumer le fait de légiférer « sous le coup de l'émotion » si cela peut sauver des vies.
Prenant l'exemple du rapport de Jean-Paul Garraud Réponses à la dangerosité qui a été remis depuis déjà deux ans, elle a estimé qu'il n'était vraiment plus possible de continuer à ne rien faire face aux faits divers les plus graves, simplement par crainte d'être taxé de légiférer sous le coup de l'émotion. De même que la création des pôles de l'instruction est liée, entre autres mesures, au drame d'Outreau et que l'enregistrement des gardes à vue pendant l'instruction remonte à une affaire qui a traumatisé des millions de Français, on ne saurait s'exonérer de telle ou telle mesure au simple motif d'être politiquement correct.
S'agissant des remises de peines, elle a distingué les réductions de peine pour bonne conduite, devenues à ce point automatiques que tout condamné sait qu'il ne fera pas la totalité de sa peine, des remises de peine dites supplémentaires qui sont décidées en contrepartie de gages de réinsertion. Ce que souhaite le Gouvernement, c'est que celui qui est condamné à vingt-sept ans de réclusion ne se dise pas qu'il n'en fera que dix-huit, mais qu'il en fera bien vingt-sept s'il ne donne pas de gages de réinsertion ou de bonne conduite. Ce n'est pas le principe de la remise de peine qui est remis en cause, mais ses modalités d'application.
Revenant ensuite sur le dispositif de « relégation » dénoncé par Christophe Caresche, elle a souligné que la mesure proposée existe depuis longtemps aux Pays-Bas, en Allemagne en Belgique, au Royaume-Uni ou encore au Canada, pays loin d'être liberticide où pourtant il n'existe pas de quantum de peine pour les infractions sexuelles, la libération n'intervenant que si la réinsertion est possible, justement pour prévenir la récidive. On ne peut d'ailleurs tout miser sur la réinsertion : dans le cas de refus de soins, il est en effet de la responsabilité des autorités de ne pas laisser en liberté des personnes qui refusent de se soigner.
Quant au prétendu caractère de peine que pourrait prendre dans les faits une mesure de sûreté, elle a estimé que ce n'est pas à la commission des lois, où l'on fait du droit, qu'elle apprendra que la surveillance judiciaire depuis la loi de 2005, ne constitue pas une peine, mais une mesure de sûreté, tout en relevant que l'obligation de justifier régulièrement de sa résidence, pour les personnes inscrites au FIJAIS, n'est peut-être pas suffisante, comme l'a démontré l'affaire Evrard.
Pour ce qui est de l'obstacle constitutionnel que constituerait le fait de dépasser le quantum de la peine, elle a fait observer, d'une part, que la décision de rétention d'un an renouvelable est une mesure de sûreté dont le caractère proportionné a été approuvé par le Conseil d'État ; d'autre part, que l'intervention d'un juge, garant des libertés individuelles, est préférable à une hospitalisation d'office, mesure administrative et non limitée dans le temps. En outre, ce n'est pas parce que la commission régionale est composée de magistrats que la mesure de rétention est pour autant une peine : les magistrats ne prononcent pas que des peines, à l'exemple des juges des libertés et de la détention et des juges d'application des peines.
Répondant ensuite à M. Dominique Raimbourg, elle a expliqué – sachant que 50 % des personnes placées sous surveillance judiciaire l'ont été en raison d'atteintes sur des mineurs de moins de quinze ans – que si la mesure proposée est circonscrite aux victimes mineures, c'est parce que les pédophiles, notamment, obéissent à des pulsions et nécessitent des soins, ce qui n'est pas forcément le cas d'un braqueur de transports de fonds.
À cet égard, elle a indiqué que tant le montant des expertises que le statut des experts seront revalorisés, étant précisé qu'aux Pays-Bas la notion d'expertise est très différente de la nôtre puisqu'on y recourt même en cas de délit.
Quant à la question de la comparution des irresponsables devant le collège de l'instruction, elle ne pourrait s'appliquer qu'à compter de 2010, étant rappelé que la chambre de l'instruction n'intervenait aujourd'hui qu'en appel.
Après avoir indiqué qu'elle adhérait totalement aux remarques de M. Garraud, elle a confirmé à M. Geoffroy que les centres socio-médico-judiciaires relevaient bien du champ de compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Répondant ensuite à M. Vaxès, elle a d'abord précisé que, s'agissant de l'appréciation de la dangerosité, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté se prononcera, comme c'est le cas aujourd'hui, au vu d'expertises. Dans le cas d'Evrard, trois expertises avaient souligné, avant sa sortie, qu'il présentait à la fois une dangerosité et un risque de récidive. Le texte ne constitue donc pas, là non plus, une nouveauté.
Quant aux soins qui pourraient d'ores et déjà être administrés pendant la détention, elle a fait observer que l'on ne pouvait pas obliger quelqu'un, comme ce fut le cas d'Evrard, à se soigner. Si l'on se heurte pendant quinze ans à un refus de soins, il faut bien que la personne en question fasse l'objet d'une mesure appropriée à sa sortie de détention.

ayant alors indiqué que cela pouvait signifier une peine à perpétuité, la garde des sceaux a souligné à nouveau que la mesure constituait, juridiquement, non pas une peine, mais une mesure de sûreté.
Quant à savoir si la comparution de présumés irresponsables en audience publique aiderait les victimes, elle a précisé qu'une telle comparution ne sera possible que si l'état de la personne le permet : on peut très bien être en état de démence au moment des faits et ne plus l'être après, comme ce fut le cas de Romain Dupuy qui a été en état de comparaître au point qu'un échange avec les familles des victimes a même été possible.

ayant alors souhaité savoir qui appréciera la possibilité de la comparution, la garde des sceaux a précisé que ce serait la chambre de l'instruction, après expertise.
Abordant enfin les questions posées par M. Jean-Jacques Urvoas, elle a d'abord fait remarquer qu'aujourd'hui déjà une mesure de surveillance judiciaire peut être prononcée sur la base non pas d'un acte, mais des conclusions d'une commission. S'il est vrai qu'avec l'instance nouvelle c'est une décision de placement en rétention qui peut être prononcée, il n'en reste pas moins que le recours à expertise est à droit constant.
Pour ce qui est du nombre de personnes concernées par le texte, elle a indiqué que les individus extrêmement dangereux représentent, au sein de la population carcérale actuelle, une centaine de personnes, dont une quinzaine présente un risque de récidive sur mineurs de moins de quinze ans. Tel est le cas d'Evrard qui refuse de se faire soigner afin de conserver sa potentialité sexuelle à l'encontre des mineurs.
Elle a par ailleurs rappelé que les centres socio-médico-judiciaires sont placés sous la double tutelle des ministères de la justice et de la santé et non sous l'autorité de l'administration pénitentiaire.
Enfin, pour répondre à l'inquiétude soulevée par la durée d'un an reconductible de la décision de rétention, elle a précisé que cette mesure sera prise selon des règles qui existent déjà dans le cadre des procès d'assises, et qui prévoient qu'il appartient toujours au juge de décider après que des psychiatres se sont prononcés.