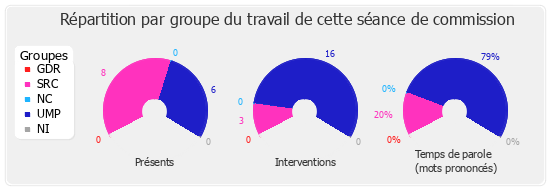Commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux
Séance du 6 juillet 2011 à 17h00
La séance
La réunion débute à dix-sept heures cinq.

Notre rapporteur, Jean-Pierre Gorges, n'ayant pu être présent lors de notre réunion constitutive du 22 juin dernier, je lui donne immédiatement la parole afin qu'il nous dise dans quel esprit il conçoit le travail de cette Commission d'enquête.

Je suis sensible à la confiance que m'a témoignée le groupe UMP en me proposant aux fonctions de rapporteur, dont je compte m'acquitter avec neutralité et discernement. J'assurerai à ce titre, en tandem avec Claude Bartolone, la conduite des auditions et il me reviendra, le moment venu, de vous proposer d'approuver le rapport qui conclura nos travaux
Comme notre Président, je dirige une collectivité territoriale et je suis très attaché à la fonction et à l'action publique locales. Je partage donc son souci de garantir aux collectivités les moyens financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Le recours à la dette fait normalement partie de ceux-ci. Il nous faudra étudier les produits structurés, aujourd'hui sur la sellette, avec toute l'objectivité requise et avec le souci d'aboutir à un diagnostic partagé : ont-ils permis à certaines collectivités de réduire durablement leur charge d'intérêts ? Sont-ils tous toxiques ou faut-il distinguer plusieurs catégories parmi eux ?
D'autre part, le principe de libre administration, inscrit dans notre Constitution, garantit à nos concitoyens une gestion de proximité – plus efficace – des services publics locaux. Dans l'analyse de la chaîne des responsabilités, nous ne devons en éluder aucune. Décisions des élus locaux, politique commerciale des banques, silence de certains préfets et de certains trésoriers-payeurs généraux : notre travail est de nous intéresser à tous ces éléments, qui ont pu peser lourd dans l'aggravation des difficultés de certaines collectivités.
Afin qu'ils soient efficaces, je souhaite que nos travaux débouchent sur des préconisations opérationnelles. Il nous faudra en particulier identifier les moyens juridiques permettant aux collectivités les plus fragilisées de transiger avec leurs prêteurs. Les leçons de ces difficultés devront également être tirées pour l'avenir, afin de renforcer la sincérité des comptes des collectivités territoriales.

Nous allons maintenant débuter nos travaux en recevant les représentants de trois collectivités qui ont été confrontées aux difficultés engendrées par des emprunts toxiques : M. Daniel Guiraud, vice-président chargé des finances au conseil général de la Seine-Saint-Denis, accompagné de M. Philippe Yvin, directeur général des services, de M. Axel Guglielmino, directeur adjoint de la direction du budget, et de M. Tony Di Martino, chargé de mission ; M. Simon Fortel, directeur des finances à la ville de Rouen, et M. Franck Masselus, adjoint au maire de Chartres, chargé des finances.
(Ces personnes sont introduites.)
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de venir si rapidement témoigner devant notre commission d'enquête. Vous savez qu'elle a pour objet de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des emprunts et produits structurés ont été souscrits auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement par les collectivités territoriales, par leurs groupements et par les autres acteurs publics locaux.
À compter des années quatre-vingt-dix, le groupe bancaire Dexia, spécialisé dans le financement des collectivités territoriales, ainsi que de nombreux autres établissements de crédit – Calyon, filiale de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, le groupe Banques populaires-Caisses d'épargne (BPCE), la Société générale, Royal Bank of Scotland (RBS), la Deutsche Bank ou encore le groupe irlandais Depfa Bank plc – ont développé une offre de produits de financement dits « structurés ». Les collectivités territoriales, confrontées à la même époque à des taux fixes élevés, ont été séduites par la perspective de faire baisser la charge de leur dette. Certaines ont ainsi accepté de substituer à leurs prêts à taux fixe des prêts structurés à taux variable, offrant des mensualités de remboursement moindres mais beaucoup plus risqués : ces prêts ont en effet la particularité d'être indexés, ce qui peut avoir pour effet, en cas par exemple de forte chute d'une monnaie par rapport à une autre, d'augmenter les taux d'intérêt de manière exponentielle.
Les difficultés sont particulièrement spectaculaires dans quelques grandes collectivités – comme les vôtres – mais elles concernent aussi de nombreuses municipalités moyennes ou petites. D'ailleurs, depuis que nous avons créé cette commission d'enquête, beaucoup d'élus locaux, qui hésitaient encore à évoquer publiquement les difficultés auxquelles ils sont confrontés, se décident de plus en plus à faire savoir quelle est leur situation. Gageons que nos travaux permettront de délier les langues pour nous permettre de comprendre encore mieux ce qui a pu se passer dans de grandes comme dans de très petites collectivités !
Je vais céder la parole au rapporteur, M. Jean-Pierre Gorges, pour un échange de questions et de réponses. Puis j'inviterai nos collègues à poser leurs questions.
Pour ma part, je souhaite vous demander pourquoi, selon vous, ces emprunts à risque ont été souscrits sans précaution. Quelle information a pu à l'époque être donnée aux administrations et aux élus ? En vous fondant sur les documents en votre possession, estimez-vous qu'il y a eu « tromperie sur la marchandise » ? Que pensez-vous du contrôle de légalité auquel ont été soumis les actes pris par vos collectivités ?
Avant que vous ne répondiez, je dois vous rappeler que l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires exige des personnes auditionnées par une commission d'enquête qu'elles prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Franck Masselus, Tony Di Martino, Daniel Guiraud, Philippe Yvin et Simon Fortel prêtent successivement serment.

Mes questions, très pragmatiques, appelleront des réponses précises. Les premières portent sur la souscription de ces emprunts dont certains seraient devenus toxiques.
Quels sont les principaux types d'emprunts structurés souscrits par vos collectivités ? Quel est aujourd'hui, en volume comme en pourcentage de la dette globale, le montant de l'endettement correspondant à ces produits ? Quelle proportion de ces emprunts jugez-vous toxique ou, à tout le moins, porteuse d'un risque ? Quelle proportion est hors charte Gissler ?
Les directeurs généraux des services, les directeurs des finances et moi-même – en tant à la fois que vice-président de l'agglomération et adjoint au maire – travaillons de façon collégiale au sein de la commission élargie qui a été créée dès 2001, conformément à la volonté du député-maire, et qui regroupe la ville de Chartres et l'agglomération, mais aussi un certain nombre de structures comme une société d'économie mixte et Chartres habitat. Les décisions sont donc prises dans ce cadre, ainsi que sous la couverture et la signature du maire.
L'analyse consolidée des emprunts montre que l'un des produits souscrits par la ville de Chartres auprès de la Caisse d'épargne, Helvetix, peut être considéré comme toxique. Reposant sur la parité euro-franc suisse, il a connu depuis deux ans une certaine dérive. Cet encours représente aujourd'hui 11,13 % de l'encours global de la ville, soit 8,4 millions d'euros sur un total de 75 millions.
Ce produit a été souscrit en 2006, alors que j'ai eu à emprunter, tant pour la ville que pour l'agglomération, plusieurs dizaines de millions d'euros. À cette époque, l'Euribor 12 mois variait de 150 points de base. J'ai alors morcelé ces emprunts par tranches d'environ 10 millions d'euros et j'ai diversifié les placements.
Au titre de l'agglomération, nous avons également souscrit un produit reposant sur la parité euro-franc suisse et euro-dollar, qui représente 13,5 millions d'euros sur un encours global de 100 millions, et qui évolue aujourd'hui aussi de façon défavorable.
J'insiste sur le fait que, lorsque nous effectuons de tels choix, nous disposons des marges de manoeuvre nécessaires. Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d'optimiser nos charges financières et le taux moyen d'intérêt est de 2,81 % pour les encours de la ville et de 2,89 % pour ceux de l'agglomération alors qu'il serait de 4,5 %, voire de 5 %, si j'avais, à la même époque, souscrit ces emprunts à taux fixe.
Dès qu'il a été élu président du conseil général de Seine-Saint-Denis, il y a trois ans, Claude Bartolone a mandaté le cabinet Michel Klopfler pour évaluer l'état des finances départementales. Le rapport remis en septembre 2008 a mis en lumière un fait extrêmement inquiétant, à savoir que l'encours de la dette était composé à 97 % de produits structurés. Le président du conseil général nous a alors donné pour consigne de consolider l'encours et, depuis trois ans, tous les nouveaux prêts ont été souscrits par le département à des taux fixes que nous sommes parvenus à négocier sur le marché à 3,6 ou 3,7 %. De la sorte, nous avons mécaniquement ramené la part des produits structurés à 71 % des 952,7 millions d'euros de l'encours global.
Composé de 46 lignes de prêts souscrits auprès de neuf institutions financières, cet encours comporte 18 produits d'opérations de couverture, dont on peut se demander en quoi ils sont sécurisants puisqu'ils aggravent parfois le sous-jacent du prêt initial. Les prêts à taux fixe souscrits depuis que Claude Bartolone est président du conseil général représentent désormais 27,7 % de l'encours, soit 263 millions, auxquels s'ajoutent, de manière résiduelle, 5,6 millions en taux capé – soit 0,5 %. Pour leur part, les produits à taux structurés représentent 71,7 % de l'encours, pour un montant de 683 millions.
Au regard de la charte Gissler, qui donne une sorte d'échelle de Richter de la toxicité de ces prêts – de 1 à 6 et de A à F –, 31 % de notre encours se situent hors charte, au niveau 6F, le plus dangereux. Il s'agit, comme dans le cas de la ville de Chartres, de produits reposant sur la parité euro-franc suisse, mais aussi de produits de pente, assis sur les courbes de taux. Au dernier fixing, un emprunt Depfa, qui était au cours de la période d'appel à un taux fixe anormalement bas de 1,47 %, est monté à 24,2 % et il serait même à 36 % si le fixing avait lieu cette semaine…
Nous sortons en effet, peu à peu, de la période d'appel. À cette occasion, un produit Crédit agricole devrait passer à 13,9 % et deux swaps de couverture Natixis à 18,4 et à 16,8 %. Les prévisions à échéance d'un an nous rendent extrêmement pessimistes car on pourrait assister à une véritable envolée des taux d'intérêt.
Le président Bartolone nous ayant demandé de sécuriser le plus possible l'encours, de très nombreux contacts ont été pris avec les banques, avec lesquelles nous avons tenu pas moins de soixante réunions. Nous avons également sollicité la médiation Gissler. Or, bien que le médiateur ait fait son travail, les résultats sont extrêmement décevants en raison de l'intransigeance des banques, notamment à propos des conditions de sortie de certains prêts hors charte Gissler – les prêts 6F –, qu'il s'agisse des taux, qui passent rapidement à deux chiffres, de la soulte de sortie, qui peut aller de 25 à 200 % du capital restant dû, ou de la durée du prêt.
Comme d'autres collectivités, la Ville de Rouen a été confrontée à ces produits dits nocifs ou toxiques, qui constituaient environ 80 % du stock de la dette en 2008, au moment du changement de majorité et de l'élection de Valérie Fourneyron. Il s'agissait essentiellement de produits structurés à effet cumulatif, dits snowball : une fois que l'on est sorti de la période de garantie ou d'encadrement du taux d'intérêt, ce dernier augmente par effets cliquets successifs, sans cap ni limite. Confrontée à un risque extrêmement important, la municipalité actuelle a fait beaucoup d'efforts auprès des banques concernées – RBS et Natixis – afin de sortir de ces produits à effet cumulatif.
Nous avons désormais renversé la tendance sans avoir eu besoin de recourir au contentieux, même si nous en avons menacé Natixis avant de parvenir finalement à un protocole d'accord. La solution trouvée est cependant onéreuse pour la ville puisque nous avons accepté de rembourser en dix ans les gains qui avaient été initialement dégagés. Qui plus est, la neutralisation de l'effet snowball a conduit à repartir sur la base de taux certes fixes mais avec des marges extrêmement importantes.
Aujourd'hui, notre dette n'est plus composée qu'à 15 % de produits « difficiles », dont plus de la moitié à échange de taux – euro-dollar et euro-franc suisse – pour lesquels la sortie de la période de garantie se fait à des taux tout à fait prohibitifs, de 20 ou 30 %, que le budget d'une collectivité comme la nôtre ne permet pas d'absorber.
En dépit de l'important travail réalisé, nous détenons encore, sur un stock de dette de 174 millions d'euros, 12 millions de produits RBS basés sur des taux de change et environ 7 millions de produits Dexia basés sur un taux Libor US$ avec coefficient multiplicateur.
Après nous être employés totalement en vain à poursuivre les négociations avec RBS et Dexia, qui semblent sourdes à nos difficultés, nous avons saisi le médiateur et nous attendons son intervention pour reprendre des discussions dont nous espérons qu'elles seront enfin positives.

Vous évoquez de façon assez diplomatique la sortie des produits snowball, mais à combien estimez-vous le taux d'intérêt dans le cadre du protocole de sortie ?
À environ 5 %, l'indexation étant sur l'Euribor 3 mois, plus une marge bancaire de 2,76. Cela ne semble pas excessif sachant que la renégociation a eu lieu en 2009, mais le taux ne serait pas le même aujourd'hui.
De nombreuses banques contestent qu'il s'agisse de produits spéculatifs, d'autant que les collectivités locales avaient interdiction d'en souscrire. Or des contrats de couverture présentent des résultats aujourd'hui totalement négatifs et leurs taux atteignent le triple de ceux des emprunts qu'ils sont censés couvrir. Alors qu'ils étaient conçus pour protéger contre les risques des emprunts sous-jacents, leur vie autonome de produits financiers spéculatifs en a fait des produits extrêmement dangereux. C'est notamment le cas des produits spéculatifs à double parité euro-dollar et euro-franc suisse, dont les taux dépassent 10 % du fait du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse et du raffermissement du dollar. Ainsi nous prévoyons pour 2012 une augmentation de 20 % – de 30 à 37 millions d'euros – des intérêts que le département de la Seine-Saint-Denis aura à verser, tandis que les annuités de remboursement du capital n'augmenteraient que de 1 %, autour de 54 à 55 millions. Cela tient notamment au fait que, pour la première fois depuis que le département a souscrit les contrats de couverture, ceux-ci deviendraient globalement négatifs à hauteur de 4 millions, contribuant à eux seuls pour plus de 10 % au renchérissement de 20 % des frais financiers.

Après que vous nous avez décrit la situation, nous allons nous attacher à en comprendre la dynamique.

Pourriez-vous nous indiquer à quelle période ces emprunts structurés ont été contractés ? Certes, on s'aperçoit maintenant que ces produits sont onéreux pour la collectivité, mais lui ont-ils été utiles, au moins pendant un certain temps, avant qu'ils ne deviennent toxiques quand leurs taux ont cessé de correspondre aux attentes ?
Nous avons souscrit le produit Helvetix en 2006, à un moment où notre besoin de ressources était important et où nous cherchions à optimiser nos charges financières et à accroître notre sécurité. Contrairement à mes collègues, je suis encore dans la phase des cinq ans de garantie et je bénéficie d'un taux bonifié à 2,75 % – d'où le taux moyen d'intérêt à 2,89 % pour la ville de Chartres. En prenant en compte l'échéance du 1er décembre, sur un emprunt de 10 millions, j'ai gagné 650 000 euros par rapport à un taux fixe qui nous était alors proposé à plus de 4 %.
Sur Dualis, produit de Dexia indexé sur la parité euro-franc suisse, auquel nous avons souscrit en 2007, j'ai réalisé à ce jour une économie de 743 000 euros.
Je ne me heurte pas aux mêmes problèmes que mes collègues dans mes rapports avec mes partenaires financiers, en particulier les groupes Caisse d'épargne, Crédit agricole et Dexia. Nous nous rencontrons au moins deux fois par an et le rythme de nos entretiens s'est même élevé puisque je leur demande maintenant presque chaque mois des cotations en vue d'une éventuelle sortie des produits classés 6F et j'ai de leur part des propositions concrètes à cette fin. Je les sollicite en outre en vue des investissements massifs auxquels nous continuons à procéder, par exemple pour la réalisation d'une station d'épuration ou d'un équipement culturel et sportif. Ils se montrent d'autant plus ouverts que nos besoins financiers demeurent importants.
En 2001, lorsque Jean-Pierre Gorges a été élu, nous avons trouvé un encours de 50 millions d'euros alors même que nos prédécesseurs avaient réalisé peu d'investissements. En tenant compte de la structure de cette dette, j'ai pu, pendant une partie du premier mandat, réduire cet encours de plus de moitié, ce qui m'a permis par la suite de relancer l'investissement pour un montant de 185 millions d'euros au cours des six dernières années, pour la seule ville de Chartres. J'ajoute que cela a été fait tout en diminuant chaque année la pression fiscale, sans garder l'oeil rivé sur les charges financières, qui ne représentent que 2 % de mon budget. Je dispose donc bien de marges financières, y compris si ces charges étaient appelées à doubler ou à tripler.

Dans la mesure où l'on est toujours dans la période de garantie, les menaces demeurent latentes.
La souscription de ces produits a débuté en 2002 et s'est achevée en 2008, avec l'élection de Claude Bartolone.
L'intérêt qu'ils présenteraient pour la collectivité est un des arguments des prêteurs. Ce n'est vrai que si l'on raisonne à très court terme : lorsque le taux effectif global du marché approche de 5 % et qu'un prêteur vous consent un taux à 1,5 % sur un prêt de plusieurs dizaines de millions d'euros, cela a bien évidemment des incidences importantes sur les dépenses de fonctionnement. Mais il peut suffire d'une seule année en structure activée pour annihiler tous les gains dégagés lorsque le taux était bas, pendant la période d'appel comme pendant la période de sortie. On imagine ce que peut être la perte pour la collectivité lorsque l'on demeure treize ou quatorze ans en structure activée…
Ces produits existent depuis longtemps et ils ont été renégociés à plusieurs reprises, avec à chaque fois des marges considérables pour les banques. Les calculs de valeur actualisée nette qui ont été faits sur les coûts d'intérêt comparés montrent que, dès l'époque à laquelle ils ont été souscrits, et où les taux apparents bonifiés étaient très favorables, des emprunts à taux variable, basés sur l'Euribor par exemple, étaient préférables à ces produits extrêmement compliqués.
La ville de Rouen, pour qui un point de fiscalité représente 650 000 euros, a été touchée à partir de 2005. Dans notre protocole d'accord avec Natixis, nous nous sommes engagés à rembourser les gains dégagés par les produits en question, soit 3,6 millions d'euros en trois ans. C'est donc cette somme qu'il n'a pas été nécessaire de demander aux contribuables locaux de 2005 à 2008 alors que, les élections approchant, il devenait difficile au maire d'augmenter les impôts… C'est pourquoi, au fur et à mesure que les marges de la collectivité se sont amenuisées, une des solutions envisagées pour continuer à offrir aux habitants des services inchangés a été de réduire les charges financières.
La période de garantie étant relativement brève – deux ou trois ans –, nous en sommes sortis au moment où survenait la crise de 2008, que les banquiers n'avaient pas intégrée dans leurs anticipations – ce qu'ils appellent les « forwards » et qui se résume à des formules mathématiques fondées sur les historiques.

J'en viens aux responsabilités. Qui a signé ces contrats ? Quelle était la délégation du conseil municipal au maire ? Quelles informations ce dernier lui a-t-il données ? A-t-on fait appel à des conseils extérieurs au moment où les choix ont été faits ?
J'ai bien évidemment délégation du maire pour passer de tels contrats. Mais c'est un domaine dans lequel il faut être extrêmement réactif : bien souvent, on tope en direct avec la salle des marchés et il est donc exclu de passer par des commissions d'appel d'offres.
Le maire fait bien évidemment état des décisions à chaque conseil municipal. En ma qualité d'adjoint aux finances, je réunis à l'occasion de la présentation de chaque document budgétaire important une commission générale ouverte à l'ensemble des élus. Ainsi, je viens de faire approuver le compte administratif : toute une partie du rapport d'analyse était consacrée à la structure de la dette et à la charge financière. Depuis dix ans, on ne m'a pratiquement jamais interrogé sur la souscription de ces emprunts et sur la restructuration de la dette. L'opposition n'a réagi que lors du dernier conseil municipal – peut-être n'est-ce pas sans lien avec la création de cette commission d'enquête… – et semble désormais vouloir faire peur aux Chartrains, en oubliant que les décisions ont été précédées d'une analyse et qu'elles ont permis d'investir.
Le conseil général de Seine-Saint-Denis a pris chaque année une délibération-cadre très générale donnant délégation au président pour les emprunts et couvrant à peu près tous les produits possibles. Le vice-président chargé des finances, qui signe lui-même les contrats, faisait ensuite en commission permanente un compte rendu des opérations effectuées.
La ville de Rouen fonctionne sensiblement selon le même schéma, avec une délégation donnée au maire et une signature des contrats par un adjoint.
Cela a été dit, ces opérations échappent au code des marchés publics. Il faut souvent agir dans une « fenêtre de tir » extrêmement réduite ; tout se passe au téléphone avec la salle des marchés ; on tope à l'instant t ; puis l'opération est bouclée, éventuellement débouclée, sur les marchés. De la sorte, la décision intervient a posteriori et est récapitulée dans un compte rendu au conseil municipal. L'ingénierie et le vocabulaire complexes rebutent nombre d'adjoints et même de techniciens et tout cela apparaît comme une affaire de spécialistes traitée entre spécialistes. Qui plus est, nous faisions une confiance un peu aveugle aux établissements bancaires dont les commerciaux nous vantaient « le produit de l'année » qu'il fallait saisir pour bénéficier des « opportunités » du marché…

Selon la taille des collectivités et selon les volumes d'engagements, ces opérations ont eu des conséquences différentes, parfois dramatiques. Dès lors, nous nous demandons si les contractants étaient à égalité dans la maîtrise des produits proposés, notamment dans la capacité d'apprécier des risques qui n'apparaissaient pas alors aussi évidents qu'aujourd'hui. Je vous trouve d'ailleurs extraordinairement fair-play vis-à-vis des organismes prêteurs – dont nous auditionnerons bien évidemment les représentants. Il me semble pourtant que vous demeurez vis-à-vis d'eux dans une certaine dépendance puisque la crise et la nécessité de sortir de ces produits structurés vous poussent à négocier de nouveaux emprunts. Parviendrez-vous cette fois à traiter d'égal à égal ?
Avec le recul, que pouvez-vous nous dire du rapport de confiance qu'entretenaient, avant ces opérations, les collectivités avec les établissements bancaires ? Lorsque ces derniers vous proposaient de souscrire dans l'urgence, aviez-vous connaissance de leurs travaux d'ingénierie financière et de leurs modèles mathématiques ? Êtes-vous désormais plus méfiants ?
Nous n'aurons vraisemblablement pas la possibilité de chiffrer les dommages que vous avez subis. Dès lors, il me paraît essentiel de mettre l'accent sur les rapports de confiance que vous avez eus, que vous pourriez encore avoir – ou que, peut-être, vous n'aurez jamais plus –, et de chercher les moyens de rétablir une égalité entre les cocontractants. Cela suppose sans doute que les collectivités locales, y compris les plus petites, disposent elles-mêmes d'une ingénierie et que les élus et leurs collaborateurs soient suffisamment formés.

Mes questions portent sur le déroulement des opérations. Vous avez souligné qu'il fallait réagir vite au moment de la souscription et parfois donner son accord en direct de la salle des marchés. La notion de preuve et le moment où l'accord a été donné apparaissant très importants, avez-vous souvenir que les conversations que vous avez eues ont été enregistrées ? Certains établissements vous en ont-ils fait la demande ? Lesquels ? Et si les collectivités ne disposent pas de ces enregistrements, n'est-ce pas un élément du rapport inégal qu'évoquait Serge Janquin ?
On vous a donc demandé, en direct de la salle des marchés, de donner votre accord à la souscription – et, curieusement, il s'est trouvé que le taux était très exactement celui qui vous avait été annoncé quelques jours plus tôt ! Vous a-t-on demandé à ce moment d'indiquer si vous aviez tout pouvoir et toute délégation pour engager effectivement votre collectivité ?

Considérez-vous que les collaborateurs des collectivités sont à égalité avec les prêteurs ?
Nous avons constitué récemment une agglomération regroupant trente-deux communes et plusieurs ont souhaité bénéficier de l'expertise de la commission élargie créée à Chartres depuis une dizaine d'années. Les maires de petites communes se trouvent en effet dépourvus lorsqu'il leur faut mener à bien seuls une opération de refinancement.
Oui, avant que je ne « tope », l'établissement financier a chaque fois demandé qu'on lui faxe ma délégation et toutes les opérations ont fait l'objet d'un enregistrement, dont nous avions la communication. Oui également, le taux en salle des marchés était celui qu'on nous avait annoncé la veille, à quelques points de base près.
Je persiste à garder confiance dans mes partenaires financiers. L'argent est une ressource dont nous avons besoin et notre relation avec eux est une relation normale de client à fournisseur. Nous leur demandons régulièrement de re-coter les produits et nous continuons de négocier, bien que nous soyons encore en phase de taux garanti ; c'est ainsi qu'ils nous font des propositions pour sécuriser l'emprunt à un taux de 5 % au cours des deux prochaines années, le tout assorti de contreparties habilement présentées. Mais je fais re-coter par un autre établissement et je suis à même de vérifier si mon interlocuteur fait ou non un effort !
Le fait de se retrouver en liaison avec une salle des marchés peut impressionner, et les banques en ont joué pour donner à des fonctionnaires territoriaux l'illusion qu'ils étaient devenus de véritables financiers, discutant presque à égalité de compétence avec leur prêteur. J'en ai moi-même fait l'expérience en arrivant en Seine-Saint-Denis – j'ai néanmoins refusé de toper ! On peut d'ailleurs s'interroger sur la légalité de cette pratique, consistant à faire toper des personnes dont on n'est pas assuré qu'elles aient qualité pour agir au nom de la collectivité. Nous avons été confrontés à un problème de ce genre à notre arrivée : en février 2008, des fonds avaient été versés au département après qu'on eut topé, et le contrat n'a jamais été signé.
Quand on lit les comptes rendus de ce qui s'est dit en commission permanente du conseil général tout au long de ces années, on s'aperçoit que les arguments avancés reproduisaient ceux des commerciaux, de Dexia notamment. On y retrouve les mêmes affirmations catégoriques, par exemple sur l'impossibilité historiquement démontrée de voir un jour franchie la barrière des 87 yens pour un dollar ou du franc suisse à 1,42 euro ! Élus et fonctionnaires n'étaient évidemment pas en mesure de contrer ces discours et c'est d'ailleurs en partie en se fondant sur cette inégalité de l'information entre le prêteur et l'emprunteur que la cour fédérale de Karlsruhe a récemment condamné la Deutsche Bank : la banque se devait de mettre à la disposition de ses clients les formules à l'aide desquelles elle évalue les risques attachés à ces produits extrêmement complexes.
Dans notre cas également, les banques ont toujours demandé que nous leur transmettions les documents certifiant que l'adjoint qui donnait l'accord – car il s'agissait toujours d'un élu, et non d'un fonctionnaire – disposait bien de la délégation lui permettant de s'engager.
L'accord était également enregistré, et nous en étions avisés. Ce cérémonial pouvait, c'est vrai, donner aux élus, voire aux fonctionnaires territoriaux, le sentiment d'être des experts financiers. Or, non seulement nous ne sommes pas des professionnels de la finance, mais nous avons peu de moyens pour évaluer les marges dégagées par les banques sur les produits qu'elles proposent. Nous pouvons certes demander à d'autres établissements de re-coter. Depuis trois ou quatre ans, nous pouvons également utiliser un site Internet spécialisé, celui de Finance Active. Faire une recherche sur la marge dégagée par la banque pour tel ou tel produit coté requiert néanmoins une certaine expertise, dont seuls disposent les grandes collectivités.

Le payeur départemental ou municipal a-t-il formulé des remarques dans le cadre habituel de vos relations ? Le contrôle de légalité a-t-il de même fait des observations sur les délibérations qui lui étaient transmises ?
Pour la négociation en cours sur la sortie des emprunts, parvenez-vous à trouver des banquiers prêts à discuter avec vous, hormis bien entendu vos prêteurs ? Bref, arrivez-vous à trouver d'autres partenaires ?

Je comprends que, dans une affaire de cette nature, le payeur ait été essentiellement un observateur, et qu'il n'ait pas nécessairement la compétence pour tirer la sonnette d'alarme. Mais il a par ailleurs une fonction générale de conseil. À ce titre, il aurait pu s'interroger, et se tourner – en l'absence de réponse – vers le trésorier-payeur général, qui vous aurait alors fourni des éléments d'appréciation. Ce système d'alerte a-t-il fonctionné ? Vous-mêmes, avez-vous estimé, à un moment donné, que le payeur municipal n'était pas en mesure de vous apporter les conseils attendus, et avez-vous envisagé de vous tourner vers le trésorier-payeur général ?
Quant au contrôle de légalité, je ne suis pas surpris qu'il ne soit pas intervenu. Rien n'était en effet contraire à la légalité au moment de la souscription, et la qualification technique des préfectures dans ce domaine très pointu ne va pas de soi. En revanche, on aurait pu attendre un véritable conseil de la part des services financiers.
Je ne suis pas certain en effet que le payeur dispose des compétences nécessaires dans ses services. Sa démarche est plus tournée vers l'analyse, dans le cadre du rapport de gestion. Nous lui transmettons en tout cas régulièrement les informations sur ce type d'opérations.
J'en viens au contrôle de légalité. La ville de Chartres était à l'époque en conflit avec un service de la préfecture. Notre budget avait en effet été déféré à la chambre régionale des comptes pour non-constitution d'une provision sur une délégation de service public. Nous n'avons reçu aucun signe de la préfecture durant cette période. Depuis l'arrivée du nouveau préfet, j'ai pu expliquer la position de la ville, mais les analyses se sont concentrées sur la situation des petites communes, qui ne disposent pas d'une véritable expertise dans leurs services.
Voilà trente ans que les collectivités ont le pouvoir d'« aller chercher » cette ressource que constitue l'argent. En 1985, l'encours des collectivités territoriales n'était constitué que d'emprunts à taux fixe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut mesurer les gains que ces années ont permis sur l'ensemble du territoire. L'encours des collectivités territoriales atteint désormais 140 milliards d'euros ; leurs investissements représentent 70 % des investissements publics. J'espère donc que cette commission d'enquête ne débouchera pas sur un durcissement de leurs relations avec leurs partenaires financiers. Il ne faudrait pas que ceux-ci soient contraints de ne plus nous proposer que des taux fixes. Quant aux provisions, elles relèvent de notre libre appréciation. Je ne vois donc pas l'intérêt d'un dispositif à cet effet.
S'agissant de notre département, le préfet et le trésorier-payeur général n'ont formulé aucune observation particulière. Mais la direction générale des collectivités locales (DGCL) elle-même ne l'a pas fait, alors même qu'une circulaire de 1992 – récemment remaniée – encadre le crédit aux collectivités locales.
On peut en effet s'interroger sur la possibilité même d'une telle intervention, mais on ne peut éluder la question du rôle du contrôle de légalité. En réalité, le contrôle n'incombait guère au trésorier-payeur général ou au payeur départemental, dès lors que la légalité externe des actes qui leur étaient communiqués pour procéder au paiement était établie. Il en va autrement pour le préfet. Les comptes rendus des assemblées délibérantes faisaient en effet précisément état des contrats, dont il est difficile de dire que certains n'étaient pas spéculatifs – même si les banques affirmeront sans doute le contraire pour leur défense. Or la circulaire de 1992 excluait explicitement les contrats spéculatifs du champ des prêts pouvant être souscrits par les collectivités locales. Les préfets n'auraient-ils pas dû exercer une surveillance et veiller à ce qu'elles n'en souscrivent pas ?
La préfecture et le trésorier municipal n'ont pas formulé de remarques particulières. Le contrôle du second est davantage orienté vers l'exécution des dépenses publiques et le recouvrement des produits locaux. Quant à la chambre régionale des comptes, qui a procédé à une vérification approfondie des comptes de la ville de Rouen en 2006-2007, son rapport n'a pas abordé ce sujet.

Dans la phase amont, on peut comprendre que le trésorier-payeur municipal n'ait rien décelé. Il en va de même de la chambre régionale des comptes. La ville de Chartres a été contrôlée. La chambre régionale a rendu un rapport qui nous était très favorable ; elle n'a pas vu que nous avions souscrit un produit qui était susceptible de dériver.
Maintenant que le problème est connu de tous, êtes-vous capable d'estimer les risques que vous encourez ? Avez-vous prévu des mécanismes de provisions ? Car cette fois-ci, le trésorier-payeur municipal ne manquera pas d'alerter le trésorier-payeur général. De même, le contrôle de légalité pourra considérer qu'en l'absence de provisions, les comptes ne sont pas sincères puisque la presse fait état de risques. Il est un fait que personne n'est intervenu dans la phase amont. Comment comptez-vous vous y prendre dans la phase aval ?

Vous aviez plusieurs banques pour interlocuteurs. Vous est-il arrivé d'avoir des « non-réponses » à vos questions sur les propositions qu'on vous faisait, ou avez-vous au contraire le sentiment que des interlocuteurs haut placés sont venus tout exprès vous trouver pour lancer un produit « miraculeux » permettant de faire un peu de spéculation ? Il semble en effet que le phénomène ait concerné tous les réseaux bancaires, qui ont tous vendu pratiquement le même produit au même moment.
Je me souviens qu'un partenaire financier est venu me trouver pour me vendre ce qu'il présentait à l'époque comme le produit de l'année : un emprunt assis sur le baril de pétrole. Mais un élu se doit d'être responsable : j'ai refusé de prendre ce risque, d'autant que les cours du baril étaient déjà soumis à un phénomène de yoyo. La crise n'était pas encore là mais, dans une optique de sécurisation, nous avons choisi de privilégier des placements en euros dans la zone européenne. Il faut cependant reconnaître qu'à l'époque, toutes les banques nous faisaient le même type de propositions – lorsque je lançais une consultation, je demandais un taux fixe, un taux variable et un produit structuré.
Il reste que, comme en 2008, nous risquons d'être confrontés à un problème de liquidités d'ici à la fin de l'année. J'en discutais tout à l'heure avec M. Fortel : nous avons dû devancer un certain nombre de consultations pour boucler les budgets de 2011. En effet, les banques nous ont déjà fait savoir qu'il leur serait difficile de répondre sur l'intégralité de nos demandes. De plus, nous savons que l'Euribor va se dégrader. Autant donc anticiper. La même évolution semble à l'oeuvre pour les lignes de trésorerie : là où tous nos partenaires répondaient pour l'intégralité de la ligne, il faut désormais « jongler » en associant deux, voire trois partenaires financiers. C'est évidemment plus complexe à gérer.
L'argent devient de plus en plus rare et de plus en plus cher. Depuis environ deux ans, les conditions d'emprunt se dégradent. J'ai lancé aujourd'hui même un emprunt de 10 millions d'euros. La Caisse d'épargne – qui compte pourtant parmi les banques de dépôt et devrait à ce titre avoir de la ressource – ne répond qu'à 20 % de notre besoin de financement. Pour boucler l'emprunt, nous devrons donc nous adresser à cinq banques !
Nous n'avons pas vécu la période de souscription de ces prêts. Le département de la Seine-Saint-Denis entretenait une relation de confiance avec ses partenaires historiques : contrairement à d'autres collectivités, il n'a pas souscrit auprès de banques étrangères, mais seulement auprès des grandes banques que sont Dexia, le Crédit agricole et la Caisse d'épargne. Ce sont ces partenaires historiques qui ont proposé ces produits « exotiques » – le dernier produit souscrit avant 2008, proposé par Dexia, était un contrat de 90 millions d'euros assis sur le dollar et le yen. C'est cette évolution-là qui est étonnante.
Pour sécuriser les financements nécessaires aux investissements à venir, nous avons adopté une stratégie pluriannuelle, en constituant des pools bancaires avec lesquels nous passons des conventions pour trois ans.

Personne ne m'ayant répondu, je réitère ma question : avez-vous estimé les risques pour votre encours et prévu de constituer des provisions ?
Nous n'avons pas constitué de provisions, car nous sommes encore dans la période de garantie. Nous pourrions néanmoins être conduits à le faire. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du change entre l'euro et le franc suisse, qui a bougé de 4 centimes en quelques jours suite aux annonces positives concernant la Grèce. Comment calculer la provision sur cette base ? Faut-il l'arrêter au 31 décembre, ou la conserver sur une période plus longue ? Hormis lorsqu'elles sont imposées, ce qui a été le cas à Chartres après le contrôle de la chambre régionale des comptes, ces provisions sont de toute façon toujours l'objet de litiges – encore davantage, d'ailleurs, dans le secteur privé, pour des raisons d'optimisation fiscale.
En l'absence d'obligation en la matière, nous n'avons donc pas constitué de provisions spécifiques à ce jour. Mais certains de mes collègues ont fait d'autres choix, et je suis intéressé par leur expérience.
En 2009, nous avons fait estimer par le cabinet GFS – Global Financial Services – le risque de delta lié aux produits structurés. Cette estimation a mis en évidence un risque de surcoût de 225 millions d'euros, soit 27 % de l'encours. Pour l'an prochain, c'est un surcoût de 20 % que nous devrons acquitter. En ce qui concerne la suite, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses – quelle sera, par exemple, notre structure d'emprunt si demain, le Portugal « dévisse » comme l'a fait la Grèce ?
Le chiffre de 225 millions d'euros – qui avait été très contesté en 2009 – a pourtant été confirmé par les propositions de renégociation des banques. Il a même été dépassé : à mesure que le marché se dégradait, les propositions de soulte – c'est-à-dire d'indemnités à payer correspondant au prix du risque – sont passées de 25 % à 30 %, puis 40 %. Les 225 millions constituaient donc un plancher !
En ce qui concerne les provisions, il n'existe en effet pas d'obligation en la matière. Nous avons pris le parti de provisionner les intérêts des prêts dont nous avons demandé l'annulation. Nous sommes en effet entrés dans une phase contentieuse, puisque le département de la Seine-Saint-Denis a demandé l'annulation de cinq produits.

La constitution de provisions est en effet obligatoire dès lors qu'une procédure est en cours.
En nomenclature M14, il existe des provisions budgétaires et des provisions semi-budgétaires. Les provisions budgétaires sont des opérations d'ordre, purement comptables, mais qui n'apportent pas, même en cas de reprise de provision, de réelle ressource supplémentaire. Les provisions semi-budgétaires impliquent en revanche un décaissement, puisque l'argent est mis à la Trésorerie – ce qui suppose de disposer de moyens budgétaires. Compte tenu de la dégradation de ces produits, il faudrait aujourd'hui provisionner pour la ville de Rouen l'équivalent de deux, voire de trois points de fiscalité. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de provisionner en semi-budgétaire ces 2,2 millions d'euros. Provisionner un pourcentage du risque sur des opérations d'ordre pourrait néanmoins être une manifestation de bonne volonté vis-à-vis de la chambre régionale des comptes, de la préfecture ou de la Trésorerie, sachant que nous ne pourrons faire davantage.

Un point m'inquiète particulièrement. Dès 2008, avant même d'être au coeur de la tourmente, l'estimation que nous avions demandée pour le département de la Seine-Saint-Denis atteignait quasiment ce 30 % de dégradation. Quelques questions de principe me semblent donc posées. La vraie nouveauté a consisté à proposer ce type de produits à des collectivités locales. Il suffit en effet de se pencher sur les publicités des établissements bancaires pour constater qu'ils étaient depuis longtemps proposés pour de la gestion d'actifs. Il n'y a aucun problème à ce qu'un particulier risque ses économies en prenant ce pari. À un moment donné – il faudra sans doute y revenir –, un premier établissement a décidé de proposer ce type de produits non plus sur de la gestion d'actif, mais sur de la gestion de passif. J'entends votre inquiétude, monsieur Masselus : vous craignez qu'on ne vous interdise un certain nombre de produits. Mais peut-on permettre à des collectivités, quelle que soit leur taille, de recourir à des produits sur lesquels la visibilité est des plus aléatoires ?
Vous nous dites aussi que vous avez plus de « souplesse » parce que vous êtes encore dans la période de garantie et que les produits à risque ne représentent qu'une faible part de votre encours. Pensez-vous qu'il faille instaurer un cliquet ?
Par ailleurs, et je m'adresse ici aux représentants du conseil général de Seine-Saint-Denis et de la ville de Rouen, quelles sont vos propositions de sortie ? Si nous avons créé cette commission d'enquête, c'est en effet parce que nous savons qu'un certain nombre de collectivités ont peu de chances de s'en sortir sans dommages.
J'aimerais enfin que nous parlions de l'avenir. Quels sont d'après vous les produits que les collectivités locales seraient en mesure de gérer en disposant des capacités humaines nécessaires ?

Des procédures en justice ou des négociations ont-elles été engagées ? La commission d'enquête a pour tâche de se préoccuper des conditions de sortie et de faire des propositions pour l'avenir, en respectant bien entendu le principe d'autonomie des collectivités – c'est un point important auquel nous devons veiller tout particulièrement.

Il me semble que la contradiction peut être dépassée. De même qu'avoir son permis de conduire ne dispense pas de respecter le code de la route, peut-il y avoir permis d'emprunter sans code de l'emprunt ?
Lorsque nous prenons la responsabilité de « jouer », même si je ne prise guère ce terme, c'est toujours dans l'intérêt de la collectivité – il s'agit de lui permettre d'investir plus et de réduire ses charges financières. Si la ville de Chartres n'avait emprunté qu'à taux fixe, mes concitoyens pourraient me reprocher d'être passé à côté de possibilités plus intéressantes. Les taux fixes pouvaient en effet atteindre 5 %, voire 6 %, alors que le taux d'intérêt moyen pour les collectivités chartraines se situe aujourd'hui aux alentours de 2,80 %.
Je suis favorable à l'instauration d'un cliquet par rapport à l'encours global. Cela aurait l'avantage de ne pas nous priver des possibilités intéressantes qui peuvent se présenter sur le marché. En 2007, nous avions souscrit pour 15 millions d'euros un produit structuré, que j'ai réussi à retourner et pour lequel nous avons désormais un taux fixe de 3,29 %. Selon nos partenaires financiers, c'est une superbe opération ! Certes, Dexia m'annonce que sur le Dualis, nous pourrions payer un taux d'intérêt à 8,91 % ; mais notre situation globale est de loin plus favorable que si nous n'avions souscrit qu'à taux fixe.
Je disais tout à l'heure que nous étions confrontés à une crise de liquidités. De nouveaux partenaires financiers entrent heureusement sur le marché – par exemple la BCME (Banque commerciale pour le marché de l'entreprise), filiale du Crédit mutuel. Nous leur demandons de re-coter pour nous assurer que nous pouvons toujours avoir confiance en nos partenaires financiers. Certains d'entre eux sont acculés. Il est par exemple devenu plus difficile de négocier avec Dexia, qui n'a pas la liquidité suffisante sur le marché pour répondre à nos prochaines consultations.
Limiter la part des produits à risque dans l'encours global éviterait certaines situations que nous connaissons tous, où la souscription d'un produit débouche sur une augmentation de la fiscalité. C'est alors le contribuable qui en fait les frais.
Je suis moi aussi en contentieux avec certains partenaires financiers. J'ai fait le tour de tous pour préparer cette réunion : compte tenu des conflits en cours, ils estiment qu'à l'avenir, il leur sera difficile de répondre à certaines collectivités. Soyons donc vigilants : il n'est pas dit que nous ne fassions pas les frais des procédures dans lesquelles nous nous engagerions.
La vraie question est de savoir si une collectivité territoriale a vocation à entrer sur le terrain spéculatif et à se doter d'une salle de marché – ou presque – pour être à égalité dans la discussion avec le prêteur. Je ne le crois pas.
En ce qui concerne l'avenir, le choix n'est pas nécessairement entre le taux fixe et rien. Avant que n'arrivent les produits structurés, les collectivités avaient une marge d'appréciation entre taux fixe et taux variable. Simplement, celui-ci était encadré : il y avait un cap et un floor, de sorte qu'on ne pouvait ni descendre à des taux anormalement bas, ni monter à des taux supérieurs au taux de l'usure. Bref, nous avions un tunnel de taux assez raisonnable, calé sur des indices accessibles aux petites collectivités : variation du taux du livret A, variation de l'Euribor… Ce n'est plus du tout le cas avec les produits « exotiques », qui tiennent davantage de la loterie – et d'une loterie biaisée.
S'agissant de la Seine-Saint-Denis, seules deux formes de sortie me paraissent envisageables. Soit le juge nous donne satisfaction et condamne le prêteur, soit l'on établit à l'échelle nationale une structure de défaisance, qui permettrait d'isoler les produits les plus toxiques – ceux qui sont hors charte Gissler – selon des modalités qui restent à arrêter. Chacun – État, banques, collectivités locales – prendrait bien sûr sa part dans le montage financier de cette structure de défaisance. On permettrait ainsi aux collectivités les plus exposées de sortir de la crise, et on reviendrait à un système assaini.
Pour reprendre votre image, monsieur le président, ce n'est pas parce qu'on a son permis de conduire qu'on peut piloter une Formule 1… Certaines collectivités ont des spécialistes qui savent gérer ce type de produits et les retourner pour en tirer des gains, mais la plupart – notamment les plus petites – ne disposent pas des compétences qui permettent de parler d'égal à égal avec les banquiers. Les fonctionnaires territoriaux doivent-ils pour autant devenir des spécialistes des salles de marché ? Je ne le pense pas. Nous avons d'autres métiers – davantage tournés vers la population – à développer.
Nous ne pourrons donc pas nous en sortir seuls. Le montant des charges financières que nous devrons acquitter dans les deux prochaines années si la tendance se confirme ne peut que conduire à des hausses d'impôts insupportables ou à la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet. Il faut donc mettre en place une structure de défaisance tripartite pour neutraliser la partie la plus spéculative de ces produits structurés, les collectivités ne conservant que ce qu'elles peuvent supporter sans mettre en péril leur budget.

Par rapport au particulier qui engage ses économies, les collectivités ont une particularité : leur variable d'ajustement est la fiscalité. Les emprunts à taux fixe leur permettent de faire des prévisions dans ce domaine. C'est aussi possible avec les produits à taux variable, puisqu'on connaît le taux minimum et le taux maximum. On pourrait donc considérer qu'il faut interdire tous les produits qui ne permettent pas une gestion maîtrisée de la fiscalité. C'est facile à mettre en oeuvre, et ce peut être l'angle d'attaque pour les situations extrêmes. De même qu'un concessionnaire automobile ne saurait vendre un véhicule sans fournir un certain nombre de spécifications techniques, un banquier peut-il vendre un produit dont lui-même ne maîtrise pas les conséquences financières ? Quel type de responsabilité porte-t-il le cas échéant ? Serait-il si absurde de considérer qu'il encourt une condamnation à ce titre ? Après tout, tout produit vendu n'est-il pas accompagné d'une fiche technique ? Nous nous demandions tout à l'heure si le trésorier-payeur municipal pouvait avoir la maîtrise de ces produits… mais les banquiers eux-mêmes ne l'avaient pas !
L'interdiction de tels produits pourrait figurer parmi nos propositions. Je le répète, la variable d'ajustement de la collectivité est la fiscalité. Lorsqu'on achète de l'argent, on achète une ressource pour réaliser un projet. C'est un produit comme un autre, qui a un coût. Mais si celui-ci ne peut pas être déterminé précisément, il y a doute sur l'évolution de la fiscalité. Dès lors qu'on ne peut fournir le cône des possibles du produit, celui-ci devrait être interdit aux collectivités locales. Partons donc de l'idée que l'argent est une ressource comme une autre.
Reste à sortir de la situation actuelle. Nous sommes hélas confrontés à un phénomène cumulatif : les collectivités qui sont dans une situation difficile n'ont peut-être pas le volant d'affaires qui leur permettrait de renégocier. M. Masselus m'a averti il y a quelque temps qu'un produit dérivait. Mais à Chartres, les investissements atteignent 170 millions d'euros sur la durée du mandat et s'y ajoutent pour un montant équivalent ceux de l'agglomération, tandis que l'encours de la société publique locale (SPL) s'élève à 800 millions : quel banquier refuserait de traiter avec nous ? Nous avons donc les leviers qui nous permettent d'obtenir une sortie raisonnable.

Vous ne souhaitez pas qu'on vous prive de la possibilité de saisir des opportunités de marché, monsieur Masselus. On aurait pu, dites-vous, vous reprocher de n'avoir emprunté qu'à taux fixe si les conditions de marché étaient favorables. Permettez-moi d'évoquer à ce propos un souvenir précis. Un établissement bancaire m'a présenté un jour un produit fantastique à ses dires, qui devait nous permettre de faire de réelles économies sur le fonctionnement. Ne comprenant goutte au contrat qui m'était présenté, j'ai refusé de signer. On m'a alors envoyé un représentant de la direction pour m'expliquer que je n'entendais rien aux finances modernes. J'avais l'assise nécessaire pour pouvoir dire non, mais je me suis quand même demandé si je ne passais pas à côté d'une chance…
On en revient donc à la question du rapporteur : peut-on permettre que tout produit soit proposé ? Ce n'est pas tant le caractère variable des taux qui pose problème que les indices « exotiques » – car les collectivités locales disposent rarement de spécialistes des projections sur le cours du yen, du dollar ou du franc suisse…

La limite me paraît vraiment être la fiscalité. Si on ne peut s'engager sur son évolution à l'égard de nos concitoyens, il ne faut pas souscrire le produit.
M. Guiraud parlait tout à l'heure de responsabilité partagée. N'oublions pas les cabinets de conseil comme Finance Active ou Orféor : ils n'ont jamais gagné autant d'argent que pendant cette période, alors qu'ils sont censés fournir un appui aux collectivités territoriales. Sans doute n'ont-ils pas complètement joué le jeu…
Ce serait, je pense, utile.

Je me suis occupé dans une vie antérieure des finances du département de la Haute-Loire et de la région Auvergne, sous l'autorité du président Giscard d'Estaing, qui était d'une prudence de Sioux dans ce domaine…
Il y a une trentaine d'années, Indosuez a proposé des swaps à notre petit département. Nous nous sommes interrogés, d'autant que la banque proposait de nous racheter une partie de notre dette. Après bien des hésitations, nous avons refusé. Les produits dérivés sont-ils des dérivés de la technique du swap étendue à des calculs mathématiciens ?
Indépendamment de la nature des produits, il y a eu une rupture dans la relation entre prêteurs et collectivités. Avant qu'on ne commence à nous vendre ce type de prêts, nous avions des taux fixes, des taux variables, et même des swaps sur des taux de livret de Caisse d'épargne. Tout cela restait cependant acceptable dans la mesure où ces produits restaient dans les banques. Le changement fondamental tient au fait que les banques se sont mises à revendre le risque de nos produits à d'autres institutions, y compris aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui explique le blocage des négociations : cela leur coûterait extrêmement cher de revenir sur leurs positions. C'est cette financiarisation des relations, y compris dans ce domaine des prêts aux collectivités locales, qui est en jeu aujourd'hui. Il pourrait être intéressant de démontrer que c'est aussi parce que ces produits sont devenus des objets de spéculation qu'on se heurte à un tel blocage.

Ces produits deviennent en effet des produits non contrôlés – qu'une collectivité ne peut se permettre d'avoir dans son compte d'exploitation. C'est toute la relation avec le marché financier qui est transformée.
Les collectivités ont tout de même la possibilité d'optimiser la gestion financière par une gestion active. Il ne faut pas les en priver !
Le problème porte moins sur l'indexation que sur le cap. Si une collectivité est tentée par un produit dit exotique, ce qui peut être une stratégie financière, celui-ci doit être sécurisé par un cap, ne serait-ce que pour permettre d'anticiper une hausse de la fiscalité s'il venait à dériver.
En 2008 ou en 2009, l'État a réinjecté 5 milliards d'euros dans le circuit bancaire pour financer les collectivités territoriales. Ne faudrait-il pas réitérer l'opération en 2011, pour un montant à déterminer, afin de faire face aux graves problèmes budgétaires qui se posent ? Si les partenaires financiers ne répondent plus à nos consultations, quid de nos budgets et de nos comptes administratifs ?

Le débat porte d'abord sur les produits qui peuvent être proposés. Vos interventions montrent qu'il faut trouver un système qui permette une gestion active de la dette et offrir aux collectivités locales le choix entre des produits à index variable contrôlé. Vous n'avez cependant pas répondu à toutes nos interrogations. Ainsi, quid des tutelles ? À quel niveau pensez-vous qu'elles auraient dû jouer un rôle de contrôle et – surtout – de prévention ?
L'État ne pouvait pas ignorer les pratiques du secteur bancaire, ni les termes de la circulaire de 1992 qui interdisait la spéculation. Il y a donc eu un manquement assez grave de sa part.

La circulaire de 1992 n'aurait donc pas été suffisamment précisée par la DGCL lors de l'apparition de ces produits sur le marché ?
En effet.
Le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de provisions a aussi joué, puisque les produits pouvaient être souscrits sans anticipation d'une éventuelle dérive financière. Si l'on exige que les produits soient capés dès lors qu'ils sont basés sur des indices « exotiques », il faudra également réfléchir à la nécessité de provisionner – et pas seulement pour ordre.

Un certain nombre des produits que nous évoquons seraient alors apparus bien moins intéressants dès la période de garantie. Je l'ai moi-même constaté pour des contrats signés par une collectivité que je connais bien : le lendemain de la signature, le rendement était déjà beaucoup moins bon… Si le département de la Seine-Saint-Denis devait tenir une comptabilité d'entreprise privée, il aurait dû provisionner près de 30 millions d'euros par an !
On ne peut provisionner que si l'on connaît le montant – par exemple si l'on est sur un produit variable capé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple du produit Depfa Bank euro-franc suisse. Le franc suisse est aujourd'hui à 1,18 euro et certains spécialistes pensent que l'on pourrait arriver à la parité. Dans ces conditions, que pouvons-nous provisionner, sachant que les évolutions peuvent être très rapides? Pour parvenir à sécuriser ce genre de produits, il faut tout simplement interdire les produits sans limite.

Le seul recours est le caping avec provisions, qui n'empêche pas une gestion active de la dette. On peut aller très loin dans une fourchette déterminée, mais il faut provisionner. Cela constituerait à mon sens un encadrement efficace.
Si on combine cap et provision, on peut facilement définir des modalités de calcul qui éviteraient les contestations sur le montant de la provision à constituer.

Cela paraît séduisant. Mais le débat entre majorité et opposition dans chaque conseil portera alors sur la fixation du cap – autrement dit, faut-il choisir la variable la plus « négative » ou la plus « positive » ?
Je conçois qu'il faille fixer des limites pour l'avenir, mais soyons attentifs à la réaction des banquiers : si on durcit trop les conditions d'emprunt, nous risquons de le payer. L'accord de Bâle III va déjà contraindre les établissements à accroître leurs marges. Si on leur impose des conditions supplémentaires sur les produits, les collectivités paieront l'argent encore plus cher. Nous avons tous lancé des consultations : le résultat va d'un Euribor plus 110 points de base jusqu'à un Euribor plus 150, voire 170 points, alors que nous avons connu un Euribor sans marge…
Quant à l'encours, on peut toujours chercher des responsables mais encore faut-il savoir qui paye. Pour ma part, je pense que les collectivités qui sont dans une dynamique d'investissement peuvent encore parvenir à négocier avec leurs partenaires.

Je crois savoir qu'à un moment donné, le conseil de surveillance de la Banque de France s'est interrogé sur les produits structurés, et qu'il a envisagé de fixer un plafond à 50 % de l'encours de la dette.
Nous avons été contrôlés à plusieurs reprises par la chambre régionale des comptes. Celle-ci me demande de constituer une provision de 5 millions d'euros pour un litige relatif à une délégation de service public. Or cette provision – sur un budget de 100 millions – va freiner notre investissement pour six mois, car tant que la cour administrative d'appel ne se sera pas prononcée, cette somme restera bloquée.

Il faut distinguer la provision réelle et la provision « virtuelle ». On peut anticiper, sur le seuil bas et sur le seuil haut, ses conséquences sur la fiscalité. C'est en effet celle-ci qui est la variable d'ajustement : si les choses se passent mal, cela peut déboucher – comme c'est arrivé dans certaines communes – sur un alourdissement de la fiscalité de deux ou trois points. Je pense qu'il faut maintenir la possibilité de souscrire ces produits, mais à condition qu'ils soient capés. Ensuite, on a soit la solution de l'amortissement, soit celle de prendre le risque de l'ajustement via l'imposition. À Chartres, nous baissons les impôts tous les ans depuis 2001 tout en continuant à investir. Ce sont aussi les gains mentionnés par M. Masselus qui nous l'ont permis. Nous sommes dans une phase où le produit en question est encore maîtrisable et nous avons le volant d'affaires qui nous permettra, le cas échéant, de l'intégrer dans les prochaines négociations.

Il y a des différences d'une collectivité à l'autre. Tout dépend évidemment de la part qu'occupe le remboursement de la dette dans le budget.
Pour le département de la Seine-Saint-Denis, 2 %.

Les départements sont dans une situation particulière, l'essentiel de leurs dépenses budgétaires étant des dépenses obligatoires.

Si les frais financiers mordent sur l'action sociale, cela pose évidemment problème. Quoi qu'il en soit, le pourcentage de 2 % est plus faible que ce que j'imaginais.

Je remercie les représentants du département de la Seine-Saint-Denis et des villes de Chartres et de Rouen pour les informations qu'ils nous ont fournies. Je ne doute pas que le rapporteur et la commission sauront en faire bon usage…
La séance est levée à dix-neuf heures cinq.