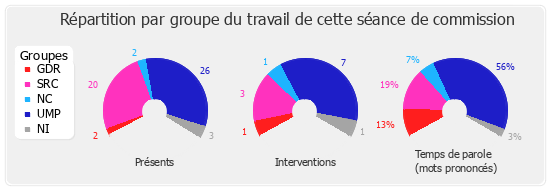Commission des affaires étrangères
Séance du 15 mars 2011 à 16h45
La séance
Audition de M. Alain Juppé, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq.

Merci, monsieur le ministre d'État, d'avoir accepté l'invitation de notre commission, deux semaines après votre prise de fonction. Comme l'a dit le Président de la République lors de son allocution du 27 février, les révolutions arabes en cours ouvrent une ère nouvelle des relations entre la France et les pays concernés. Vous avez été choisi pour conduire notre diplomatie sur cette voie : la tâche est aussi capitale que délicate.
Ayant effectué un passage remarqué dans ce ministère entre 1993 et 1995, vous êtes déjà au fait des enjeux. Soyez assuré que notre commission suivra avec attention cette nouvelle ère de la diplomatie française.
Bien qu'elle ne se limite pas, loin s'en faut, à ces événements, l'actualité internationale est dominée par le formidable réveil démocratique que connaît le monde arabe depuis le mois de décembre dernier, ainsi que par l'évolution dramatique de la guerre en Libye. Sur ces deux points, nous sommes intéressés par votre analyse. Quelles sont les initiatives de la France ? Où en sont les discussions avec nos partenaires européens ? S'agissant de la Libye, comment interprétez-vous la déclaration de la Ligue arabe, samedi dernier, en faveur d'une zone d'exclusion aérienne ?
Peut-être nous direz-vous aussi un mot de l'aide que notre pays peut apporter au Japon, qui est cruellement frappé par une catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle.
Merci de me donner cette première occasion de m'exprimer devant votre commission en qualité de ministre des affaires étrangères et européennes. Je ne pourrai pas vous consacrer beaucoup plus d'une heure, car le Président de la République organise, en fin d'après-midi, une réunion consacrée à la situation internationale. Nous nous reverrons cependant aussi souvent que vous le souhaiterez.
Je suis très heureux de retrouver ce ministère, et me réjouis qu'il ait conservé son dynamisme et son sens de l'intérêt général : notre pays dispose d'une belle machine pour mettre en oeuvre sa politique étrangère. Je reviens néanmoins avec d'autant plus d'humilité que le monde est plus imprévisible que jamais. Je limiterai mon propos à trois zones géographiques : le Japon, la rive Sud de la Méditerranée – notamment la Libye – et la Côte d'Ivoire.
Le Japon vient d'être frappé par un séisme, un tsunami et une série d'accidents nucléaires sans précédent. Malgré ces événements, mon homologue japonais, M. Matsumoto, était hier et aujourd'hui à Paris pour la réunion du G8 ; il nous a donné beaucoup d'informations, dans un souci de transparence qu'il faut saluer. Nous lui avons exprimé notre admiration pour le sang-froid, le calme et le courage exemplaires du peuple japonais dans cette tragédie.
Le Président de la République l'a dit ce matin : la situation est dramatique. Plus d'une cinquantaine de répliques ont déjà eu lieu, dont une très forte il y a quelques minutes. Le Nord-Est du pays est totalement dévasté ; un bilan provisoire fait état de 2 415 morts, de plus de 10 000 disparus et 1 600 blessés ; mais il continue, hélas, de s'alourdir à mesure que les équipes de sauveteurs progressent. Par ailleurs, on craint à tout moment de nouvelles secousses de forte magnitude.
Le Gouvernement et le peuple japonais font face à cette catastrophe avec courage et dignité. Les équipes de secours à l'oeuvre dans les zones sinistrées sont assistées par des équipes internationales, dont deux équipes françaises qui interviennent en ce moment dans l'une des zones les plus critiques, la région de Sendai. Le métro et les trains recommencent à fonctionner, et les routes sont remises en état, mais les difficultés pour se déplacer restent considérables ; c'est la raison pour laquelle les Japonais nous ont demandé, ce matin, d'étudier une assistance en matériel humanitaire, ce que nous avons bien entendu accepté.
En ce qui concerne le risque nucléaire, la plus grande vigilance est de rigueur car la situation, d'une exceptionnelle gravité, peut dégénérer à tout moment. Les 55 réacteurs nucléaires que compte le Japon ont dans l'ensemble résisté aux secousses ; mais la situation de la centrale de Fukushima Daiichi est critique, puisque l'accident a atteint le niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7. Nous avons proposé aux autorités japonaises une offre de coopération en matière de radioprotection, fondée sur les compétences des experts et des médecins de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Sur les 9 000 Français présents au Japon, aucune victime n'a été signalée à ce jour. Cependant, quatre Français sont recherchés dans la zone critique de Miyagi-Ken ; nous poursuivons nos vérifications à leur sujet.
Même si quelques témoignages critiques se sont fait entendre sur les ondes, notre dispositif est pleinement mobilisé au service de nos compatriotes. À Paris, le centre de crise fait preuve d'une vigilance de tous les instants, et il répond, depuis le début de la tragédie, à des milliers d'appels téléphoniques ; à Tokyo, notre ambassade – dont les bâtiments, préparés au risque sismique, ont résisté – a pu mettre immédiatement en place un dispositif de crise opérationnel. S'agissant des bâtiments, M. Matsumoto me disait tout à l'heure que les dommages les plus graves n'ont pas été causés par le séisme – le Japon ayant pris depuis des années des précautions en la matière –, mais par le tsunami. Nous continuons à renforcer notre dispositif de crise : deux nouvelles équipes de six personnes du centre de crise doivent partir dans les meilleurs délais pour renforcer le consulat à Kyoto, où sont regroupés de nombreux Français.
Dans ce contexte, nous suivons les recommandations des autorités japonaises. Les personnes habitant à proximité des centrales ont été évacuées ; il est demandé aux autres de calfeutrer leur domicile et de faire, si possible, des provisions d'eau potable et de nourriture pour plusieurs jours. Il convient de porter un masque respiratoire en cas de sortie indispensable, et de prendre des pastilles d'iode – nous en avons livré 10 000 à nos services diplomatiques – si les autorités japonaises le recommandent.
À titre de précaution, nous continuons à demander aux Français de se déplacer vers le Sud du Japon pour éviter d'éventuelles émissions radioactives. Pour l'instant la situation est stable, mais, en cas de crise avérée, nous nous associerons aux autorités japonaises pour demander à nos compatriotes de rester confinés chez eux.
Enfin, nous prenons des mesures pour faciliter le départ des Français qui le souhaitent : Air France a renforcé ses dessertes à Tokyo et Osaka, et nous allons affréter des avions spéciaux. Dès aujourd'hui, 280 Français appartenant aux catégories les plus fragiles – femmes avec de jeunes enfants, ou personnes âgées – sont rapatriés par un vol spécial. Ces dispositions, nous les prenons aussi pour alléger le fardeau des autorités japonaises, qui les comprennent d'ailleurs fort bien.
Je veux à présent évoquer la rive Sud de la Méditerranée. La révolution du jasmin en Tunisie et la journée du 25 janvier en Égypte ont ouvert la voie à une série de bouleversements sans précédent, que l'un de mes collègues du G8 n'hésitait pas à comparer à la chute du mur de Berlin. On nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir anticipés ; mais, s'il est des sciences prospectives, il en est d'autres qui sont rétrospectives : peut-être la diplomatie appartient-elle à cette seconde catégorie.
Les causes de ces événements sont multiples. La première est la remise en cause de la légitimité des régimes politiques autoritaires arabes, républiques ou monarchies, notamment par des classes moyennes naissantes, instruites et modernes, qui aspirent à participer davantage à la vie politique et expriment leur désir de liberté. Ainsi, en Tunisie, les efforts consentis depuis des années pour élever le niveau de formation ont fait naître chez les jeunes une conscience politique aiguë, alors que, dans le même temps, ils ne trouvaient pas d'emplois.
La deuxième raison tient à l'usure du pouvoir – certains règnes ayant duré plusieurs décennies – et le sentiment de frustration des populations face à l'accaparement des richesses, à la corruption et aux brimades quotidiennes imposées par les forces de l'ordre.
Il y a encore les problèmes économiques et sociaux, comme le chômage ou la hausse des prix des produits de première nécessité, en particulier alimentaires, tous phénomènes liés à la crise économique mondiale de ces deux dernières années.
On peut enfin évoquer le rôle amplificateur des médias : la chaîne Al-Jazira et, sur internet, des réseaux sociaux tels que Facebook, dont l'un des membres du groupe de la coordination du 25 janvier que j'ai rencontré place Tahrir était d'ailleurs spécialiste.
Ces éléments sont communs à tous les pays de la zone qui s'étend du Maroc à l'Iran ; à travers les mouvements de contestation qu'ils ont déclenchés, ils portent en eux un immense espoir de changement pour l'ensemble de la région. Ce nouveau « printemps arabe » ne doit pas nous faire peur. Trop longtemps, nous avons cru que les régimes autoritaires étaient les seuls remparts contre l'extrémisme dans les sociétés arabes. En Tunisie et en Égypte, les peuples ont balayé ce cliché en exprimant avec une grande maturité leur aspiration à la démocratie. En Égypte, les autorités ont répondu de manière responsable, sans céder à la tentation de la violence : l'armée pilote désormais la transition en concertation avec les représentants de la place de la Libération –place Tahrir –, que j'ai rencontrés lors de ma visite au Caire le 6 mars dernier. Plusieurs problèmes restent néanmoins posés : le calendrier électoral, mais aussi les espoirs suscités au sein de la population, qui attend les bénéfices de la révolution, autrement dit des augmentations de salaire et des avantages sociaux. Or, en Égypte, la machine économique se grippe : le taux de fréquentation des hôtels est tombé à 10 ou 15 %, et plusieurs centaines de milliers de réfugiés de Libye, qui envoyaient de l'argent, sont rentrés ou vont le faire. Cette situation ne fait que renforcer notre devoir d'aide.
Au Maroc, le Roi a prononcé un discours visionnaire et courageux que je veux saluer : il est le premier, à ma connaissance, à lancer l'idée, qui pourrait servir d'exemple, d'une monarchie constitutionnelle. Cette réforme devrait être élaborée en concertation avec les partis politiques et la société civile.
Nous devons prendre acte de cette nouvelle donne dans notre approche de la région du Sud méditerranéen, non pour donner des leçons ou exporter nos standards, mais pour accompagner nos partenaires dans leur transition démocratique, dans un esprit de confiance, d'amitié et d'écoute. Il s'agit également de favoriser l'émergence d'une zone stable et prospère, en aidant les pays concernés à résoudre leurs difficultés économiques et sociales : c'est non seulement notre responsabilité mais aussi notre intérêt. Il est totalement illusoire de vouloir maîtriser les flux migratoires en érigeant des murs : d'autres ont essayé de le faire, avec le résultat que l'on sait, à la frontière du Mexique. Même si, dans l'immédiat, nous devons faire preuve d'une grande vigilance sur l'immigration illégale, la seule solution, à plus long terme, est la diminution des inégalités de développement entre le Nord et le Sud.
C'est dans cet esprit que nous devons aussi refonder l'Union pour la Méditerranée (UPM). Même si cette initiative s'est heurtée à plusieurs obstacles, à commencer par le blocage du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, les événements actuels montrent qu'elle était prémonitoire. Nous allons donc la relancer en rappelant, d'une part, qu'elle repose sur un partenariat équilibré entre le Nord et le Sud, et, de l'autre, qu'elle consiste à développer des projets concrets, qu'il s'agisse de l'énergie solaire, de la dépollution de la Méditerranée ou de l'Office méditerranéen de la jeunesse, qui permettra d'organiser le flux des étudiants.
Dans l'immédiat, et pour répondre à l'urgence, nous pouvons nous appuyer sur les outils existants, comme la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) ou la Banque européenne d'investissement (BEI), dont le Conseil européen a décidé, la semaine dernière, de relever le plafond des mandats d'intervention en Méditerranée. Pour aller plus loin, la France propose de créer une véritable facilité méditerranéenne d'investissement, en s'appuyant notamment sur la FEMIP.
Nous devons également poursuivre nos efforts en faveur du processus de paix. Les aspirations du peuple palestinien ne sont pas moins légitimes que celles des autres peuples de la région : il nous faut y répondre en oeuvrant à l'établissement d'un État palestinien démocratique, viable, continu, vivant en paix et en sécurité au côté de l'État d'Israël. Cet objectif est aujourd'hui agréé par tous. Le statu quo n'est pas tenable. Une nouvelle donne s'est créée autour d'Israël : nous devons en convaincre nos partenaires du Quartet afin de progresser dans la définition des paramètres d'un accord sur le statut final. L'année 2011 doit être celle de la reconnaissance d'un État palestinien, conformément à la feuille de route que nous nous sommes fixée : tous les partenaires du G8 partagent ce sentiment, même si nos amis américains le font avec quelques nuances.
Enfin, nous devons veiller à adapter les grandes lignes de notre action aux spécificités de chaque pays. L'urgence est évidemment la Libye, notre premier souci étant de protéger les populations civiles. Le dossier est évidemment très sensible, dans la mesure où le rapport de forces entre le régime de Tripoli et l'opposition établie à Benghazi, est en train d'évoluer. Sans vouloir m'attarder sur le passé récent, je ne résiste pas à l'envie de rappeler que la France a été le premier pays, avec la Grande-Bretagne, à dire qu'il fallait empêcher le colonel Kadhafi d'utiliser la violence pour tenter de rétablir son autorité. C'est possible, car peu d'aéroports permettent le décollage d'avions de guerre ; de surcroît, si la Libye a peut-être acheté quelque 400 avions de chasse depuis quarante ans, il n'est pas vrai, comme l'ont soutenu certains de nos partenaires, qu'ils soient tous opérationnels : moins d'une vingtaine le sont, et guère plus d'hélicoptères. La France ne défendait pas l'idée d'une zone d'exclusion aérienne, difficile sur un territoire aussi vaste, mais, sur la base d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, des frappes ciblées sur des objectifs militaires ; car ce sont bien les bombardements aériens qui ont permis au colonel Kadhafi de renverser le rapport de forces avec la rébellion. Certains de nos partenaires, au premier rang desquels mon collègue allemand, se sont opposés à tout recours à la force. La Russie, quant à elle, n'était guère enthousiaste, et les États-Unis ont mis beaucoup de temps à définir leur position.
Que faire face à la progression des troupes du colonel Kadhafi ? J'ai eu beaucoup de mal à mettre d'accord les participants au G8, qui, sans être un organe de décision, regroupe tout de même quatre membres du Conseil de sécurité. Un consensus a été trouvé pour que celui-ci adopte, dans les plus brefs délais, des mesures destinées à exercer une pression suffisante sur le colonel Kadhafi : l'idée d'une zone d'exclusion aérienne est l'une d'entre elles, même si certains membres y sont hostiles ; pour notre part, nous la jugeons dépassée. Second point d'accord : la nécessaire implication des pays arabes. Entrer en Libye sous la bannière de l'OTAN serait la meilleure façon de braquer les opinions arabes. La Ligue arabe a demandé une zone d'exclusion aérienne, mais nos amis russes ont fait observer que cette déclaration était un peu ambiguë et assortie de réserves ; quant à l'Union africaine, elle n'est pas tout à fait sur la même ligne. Le Président de la République travaille à l'organisation d'un sommet entre l'Union européenne, l'Union africaine et la Ligue arabe.
J'en viens à la Côte d'Ivoire, où la situation a pris un tour dramatique. Les élections présidentielles, différées pendant des années par Laurent Gbagbo, ont été remportées, le 28 novembre dernier, par Alassane Ouattara. Cette victoire a été reconnue non seulement par l'Union africaine, mais aussi par l'ONU à l'unanimité de ses membres, c'est-à-dire par la communauté internationale tout entière. Alassane Ouattara est donc, pour nous, le seul président de la Côte d'Ivoire.
Depuis le 28 novembre, Laurent Gbagbo refuse de reconnaître la volonté du peuple ivoirien, s'accrochant à un pouvoir qu'il considère comme le sien. Il a également perpétré un véritable hold-up contre la direction nationale de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire à Abidjan, puis contre les succursales des banques. Enfin, il n'hésite pas à risquer une guerre civile : à Abidjan, il a lancé ses milices contre la population et fait tirer sur des femmes désarmées ; dans le reste du pays, de violents affrontements ont lieu entre les deux camps. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est donc à la veille d'une crise comparable à celle de 2002.
Face à cette situation inacceptable, la communauté internationale tout entière s'est mobilisée, d'abord pour faire comprendre à M. Gbagbo qu'il devait quitter le pouvoir pacifiquement, puis pour le sanctionner économiquement et financièrement et l'empêcher de nuire. Avec ses partenaires européens, la France a joué un rôle majeur en ce sens, notamment au Conseil de sécurité qui a condamné fermement les agissements de M. Gbagbo, et à l'Union européenne, pour l'adoption des sanctions. Je pense que cette stratégie donnera des résultats : M. Gbagbo est fragilisé ; il n'a plus les moyens de payer convenablement ni ses fonctionnaires, ni ses militaires, ni même ses mercenaires. La semaine dernière, l'Union africaine, réunie à Addis-Abeba, lui a clairement demandé de quitter le pouvoir, rappelant que le seul président légal et légitime était Alassane Ouattara. L'étau se resserre : la situation pourrait donc évoluer favorablement.
Pour empêcher les violences, nous avons appelé l'ONUCI, l'Opération des Nations-Unies en Côte d'Ivoire, à jouer son rôle : les effectifs, bientôt portés à 11 500 casques bleus – majoritairement à Abidjan –, sont placés sous le mandat du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, qui leur permet de recourir à la force. La force Licorne, je le rappelle, n'est qu'un appui de l'ONUCI : elle n'interviendra que si le secrétaire général des Nations-Unies et le Conseil de sécurité nous le demandent explicitement. J'ajoute qu'une intervention militaire française visant à ramener M. Ouattara au pouvoir serait aussi désastreuse pour nous que pour lui. Nous restons néanmoins très vigilants sur la situation, pour évacuer nos ressortissants si nécessaire : notre dispositif reste pleinement opérationnel.

Une mission que je dirige se rendra à Tunis lundi et mardi prochains : beaucoup de rencontres sont prévues.
Nous en venons aux questions.

Hier, à Tunis, j'ai été reçu par le Président Mebazaa en ma qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Si le processus de démocratisation recueille un large assentiment de la population, la situation économique et sociale s'est aggravée depuis la révolution. Les activités touristiques ont cessé, et les autorités s'inquiètent des positions de l'Europe, qui à leurs yeux abandonnent le Sud au profit des pays de l'Est. Les Tunisiens se tournent vers la France pour que la Tunisie ne soit pas oubliée. Qu'en pensez-vous ?

Sous quel mandat de l'ONU l'Arabie Saoudite intervient-elle au Bahreïn ? Quelle est la position de la France à ce sujet ? Cela paraît malheureusement clair.
La position du Gouvernement français sur le dossier libyen me paraît la bonne : je regrette qu'elle n'ait pas été suivie. Il est tout aussi impossible de laisser les massacres se poursuivre que d'intervenir sous la bannière de l'OTAN, ne serait-ce qu'en raison du veto de la Turquie. Cependant, on ne peut rester sans rien faire. Les pays européens ont-ils vraiment besoin de diverses autorisations pour agir ? Ne pourrait-on, à tout le moins, armer la résistance libyenne à Benghazi ? Cela me semblerait conforme à la morale.

Hier, à Beyrouth, une grande manifestation a été organisée contre le Hezbollah, que l'on accuse d'avoir renversé le Gouvernement Hariri par un coup d'État et d'enrayer les travaux du tribunal spécial. Comment interprétez-vous ces événements ? Quelle est votre analyse de la situation au Liban ?

Il y a quinze jours, lors d'un débat dans l'hémicycle, nous exprimions nos espoirs d'une démocratisation de l'Afrique du Nord ; la semaine dernière, lors de l'audition de l'ambassadeur de Libye, nous évoquions une possible partition entre l'Est et l'Ouest, et même l'installation de représentations diplomatiques à Benghazi. Au rythme où vont les choses, ces échanges me semblent déjà lointains.
J'approuve la position du Président de la République, qui a reconnu le Conseil national de transition et proposé des frappes ciblées. Des femmes libyennes avaient alors brandi le drapeau français, mais, depuis, les mercenaires de Kadhafi ont progressé vers Benghazi. Le prix de l'inaction et la victoire odieuse du dictateur seraient dramatiques pour les combattants de la liberté, sans parler de la perte de crédit de l'Occident et de l'inadaptation des organisations internationales, notamment de l'Union européenne, qui se montre incapable de définir une politique commune. La France peut-elle prendre des initiatives pour éviter une tuerie sanglante et faire en sorte que la démocratie soit une force agissante ?

Nous avons toujours manifesté notre hostilité au colonel Kadhafi, notamment lors de sa réception par l'Assemblée nationale et les plus hautes autorités de l'État. Cependant, l'attitude du gouvernement sur l'utilisation de la force en Libye ne nous apparaît pas comme une bonne réponse et de manière générale l'utilisation de la force armée ne nous semble pas la bonne réponse. Les problèmes auraient pu se régler politiquement ; le peuple libyen paie aujourd'hui le prix de notre passivité d'alors.
Vous avez évoqué le contexte social de la révolution tunisienne ; il semble que la situation soit un peu différente en Libye. Avez-vous des précisions, notamment sur la répartition des richesses dans ce pays ?
Enfin, la répression marocaine au Sahara occidental, où sont nés les premiers mouvements de résistance, reste très dure. J'ai bien noté les dernières déclarations du roi du Maroc, mais je souhaiterais que notre pays ne reste pas silencieux sur ce point.
Il n'y a pas lieu de craindre, monsieur Salles, que l'Europe abandonne le Sud méditerranéen, auquel, selon le voeu de la France, un Conseil européen a été intégralement consacré. La déclaration finale, sans ambiguïté, indique que le colonel Kadhafi doit quitter le pouvoir, que les sanctions et l'aide humanitaire doivent être renforcées, que l'Europe doit s'investir fortement dans l'aide aux pays du Sud et que le Conseil de sécurité de l'ONU doit étudier tous les moyens – en d'autres termes, y compris une zone d'exclusion aérienne. Sur les 12 milliards d'euros alloués au titre de la politique de voisinage entre 2007 et 2013, les deux tiers vont aux pays méditerranéens, contre un tiers aux pays d'Europe orientale. À Budapest, la présidence hongroise m'avait d'ailleurs fait part d'une inquiétude inverse de celle que vous avez évoquée.
Rien n'interdit à un pays de venir en aide à un autre qui le lui demande, monsieur Boucheron : l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis n'ont donc pas besoin d'un mandat international pour intervenir au Bahreïn. Nous avons néanmoins rappelé qu'une telle intervention n'exonérait pas les gouvernements de tenir compte des aspirations démocratiques des peuples. Notre discours est le même que pour le Yémen : la force ne peut se substituer au dialogue avec les populations.
Quant à la Libye, tout dépend de ce que nous obtiendrons du Conseil de sécurité de l'ONU. Un embargo maritime, par exemple, priverait le colonel Kadhafi de frégates. Je n'ai pas de réponse explicite à vous faire sur la livraison d'armes.
J'ai bien noté, monsieur Souchet, les manifestations au Liban où un gouvernement est en cours de constitution. Nous lui avons clairement indiqué que le tribunal spécial devait avoir les moyens de travailler ; dans le cas contraire, nous reverrions notre position. Nous mettons en garde contre toute ingérence étrangère.
Il est d'usage, monsieur Lecou, de dénoncer l'incapacité de l'Union européenne. Mais celle-ci n'a ni la légitimité ni les moyens de rétablir l'ordre au Bahreïn ou ailleurs ; au demeurant, si elle le faisait, elle provoquerait des réactions très hostiles. Nous devons soutenir les pays concernés, non leur imposer notre modèle de démocratie en y envoyant nos troupes.
Quant aux initiatives de la France, elles n'ont pas cessé : Conseil européen sur la Libye ; prochaine tenue, sans doute à Paris dans le cadre du G8 – ce qui nous permettra d'inviter les pays européens qui y siègent – d'une réunion entre l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Union européenne ; proposition du Président de la République de réunir les ministres du G20 sur l'énergie et la sécurité nucléaire ; sans oublier nos préconisations sur une intervention aérienne en Libye. Mais, sur ce dernier point, la France ne peut s'engager seule : elle doit le faire dans le cadre d'une coalition internationale associant les pays arabes.
Monsieur Lecoq, c'est lorsque le Président Chirac a menacé de riposter par la force que le processus de paix s'est déclenché dans les Balkans ; la même menace, formulée par la France et les États-Unis, avait d'ailleurs permis de mettre fin au bombardement de Sarajevo. Comme dit l'adage, si vis pacem, para bellum. Je ne partage donc pas votre refus a priori du recours à la force.

Faut-il conclure, à l'issue de la réunion des ministres des affaires étrangères du G8 hier, qu'il n'y aura pas de résolution pour une zone d'exclusion aérienne en Libye, au risque de voir les insurgés se faire massacrer par l'armée ?

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est particulièrement alarmiste sur la situation en Côte d'Ivoire, qu'il estime proche de la guerre civile. Quels sont les rapports de force entre les deux camps ? La diplomatie française peut-elle encore oeuvrer à un projet de paix ?

L'UPM était peut-être prémonitoire, mais elle est devenue une usine à gaz amalgamant tous les problèmes, notamment celui des relations entre Gaza et Israël. Il faut revenir à ce que j'appellerais un « multi-bilatéralisme ».
Deuxième point : pourquoi ne pas prendre l'initiative de reconnaître un État palestinien ? Cela permettrait de débloquer les choses : ayons le courage d'un nouveau discours de Phnom Penh.
En Égypte, les Frères musulmans tiennent des discours variés. Qu'en pensez-vous ?
À propos de la Libye, on constate l'impuissance de l'Union européenne. Toutefois, il y a peut-être une solution si les rebelles se constituent en gouvernement autonome et démocratique, puis font appel à la Ligue arabe.
Enfin, n'oubliez pas de vous préoccuper du budget de votre ministère.

La Tunisie est le pays le plus avancé dans la transition démocratique ; et c'est celui qui, par son histoire, sa culture et sa langue, est le plus proche du nôtre. Il est donc essentiel qu'il réussisse aussi sa transition sur le plan économique et social.
La France a une responsabilité particulière à cet égard. Ne peut-on faire appel à certaines de nos entreprises, développer une coopération décentralisée vers les collectivités territoriales tunisiennes, ou même suggérer à nos concitoyens de prendre leurs prochains congés à Djerba plutôt qu'à Arcachon ?

Vous avez comparé à juste titre les révolutions du monde arabe avec la chute du mur de Berlin. Source de beaucoup d'espoirs, ce printemps des peuples peut aussi entraîner des désordres. Vous vous étiez rendu au Niger et au Sahel en tant que ministre de la défense : ne craignez-vous pas, au vu notamment des événements en Libye et des possibles soubresauts en Algérie, une recrudescence de l'islamisme radical dans cette région ? AQMI ne risque-t-il pas de faire son miel de la situation ? Quelles initiatives la France et l'Europe peuvent-elles prendre pour empêcher des conséquences désastreuses à cet égard ?
Ce n'est pas sans mal que nous avons arraché au G8 une déclaration d'intention commune, monsieur Dupré. Sur cette base, nos représentants à l'ONU travaillent à un projet de résolution avec nos partenaires, incluant l'hypothèse d'une zone d'exclusion aérienne.
Il est vrai sans doute que la prise de Benghazi par le colonel Kadhafi serait non seulement un désastre en termes de vies humaines, mais aussi un échec politique pour tous ceux qui réclament son départ depuis des semaines – les Européens, mais également les Américains –, sans parler du risque de « somalisation », car je n'imagine pas que M. Kadhafi puisse rétablir un pouvoir autoritaire sans provoquer des réactions très hostiles ; cela pourrait en effet, monsieur Plagnol, augmenter les risques liés à Al Qaeda.
Il est très difficile, monsieur Christ, de dire où en est le rapport de forces entre les clans Ouattara et Gbagbo : depuis le début de la crise, le second s'est réarmé, notamment en armes lourdes et en hélicoptères, et des mercenaires sont venus du Libéria ; mais les forces du Nord se sont elles aussi étoffées. Les conditions d'un affrontement militaire sont donc hélas réunies ; d'où les pressions que nous exerçons au côté de l'Union africaine. Je m'apprêtais tout à l'heure à en parler avec Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, mais notre communication a été interrompue.
Il faut peut-être simplifier le fonctionnement de l'UPM, monsieur Myard, mais elle a au moins le mérite de proposer des projets concrets, tels qu'un Office méditerranéen de la jeunesse ou une banque d'investissement pour l'Afrique du Nord. Quant à reconnaître un État palestinien, cela ne sert à rien de le faire seul – pardon de vous rappeler, sur ce point, les vertus de la coopération européenne. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous devons, je pense, garder cette hypothèse à l'esprit.
S'agissant des Frères musulmans en Égypte, tout est possible, le pire comme le meilleur. Parmi les jeunes que j'ai rencontrés, qui m'ont beaucoup impressionné par leurs qualités intellectuelles, quatre disaient appartenir aux Frères musulmans – l'un se qualifiait de « musulman libéral » –, et leur référence commune était l'AKP en Turquie, parti islamique mais démocratique. Nous devons, je pense, faire le pari de la confiance, tout en aidant ces pays, y compris économiquement.
Je veux bien que l'on parle d'impuissance européenne en Libye, mais où est la puissance américaine, russe, chinoise ? Le blocage actuel ne tient pas à une impuissance de l'Europe, mais au refus de la Chine de toute ingérence internationale. La Russie est en train d'évoluer et les Américains, dont on a tant vanté la lucidité sur la Tunisie et l'Égypte, n'ont pas défini de position ; pour le coup, si nous n'avons pas anticipé tous les événements en Libye, du moins avons-nous agi avant les autres.
Je ne suis pas venu pour défendre le budget de mon ministère, mais le fait est que la situation n'est pas satisfaisante. Le Quai d'Orsay effectuant ses recrutements en décalage par rapport à l'année civile, il a anticipé, dans le budget de 2009, les suppressions de postes de 2010, allant même au-delà de ce que prévoyait la RGPP. Or, on nous demande aujourd'hui de respecter le quota initialement prévu pour 2010 sans tenir compte des anticipations de l'année précédente. On ne peut réclamer des personnels diplomatiques disponibles dans les situations de crise tout en continuant de supprimer des emplois comme on le fait depuis dix ans : nous sommes désormais à l'os ; il s'agit de savoir si notre pays entend conserver ses moyens diplomatiques.
Il faut effectivement mobiliser davantage de moyens pour la Tunisie, monsieur Destot. Nous avons demandé à l'Agence française de développement d'augmenter les crédits consacrés aux missions d'entreprises. Et nous prévoyons d'organiser dans les prochains mois en Tunisie, où je me rendrai dès que possible, des assises de la coopération décentralisée. Un plan d'urgence est indispensable, de même que pour l'Égypte.
S'agissant du tourisme, notre pays est l'un des seuls à ne pas déconseiller de se rendre en Égypte ou en Tunisie.

Je salue votre voyage en Égypte, qui a donné une image sympathique et moderne de la diplomatie française.
Sur la Libye, vous avez formulé une proposition : reste à la faire appliquer. A Sarajevo, le Président de la République s'était souvenu qu'il était chef des armées, et il n'avait sollicité l'avis ni de la Chine, ni de la Russie. Si l'on veut éviter un génocide en Libye, la seule solution, dont vous avez dit qu'elle n'était pas difficile à mettre en oeuvre, est de neutraliser l'aviation du colonel Kadhafi, puis les deux bâtiments militaires qui tirent sur les populations civiles.
Nous avons observé, dans l'hémicycle, une minute de silence pour les victimes japonaises ; il nous serait insupportable de le faire un jour pour celles de Benghazi. La crédibilité de notre pays et de son chef d'État en serait gravement affectée.
Il est possible, mais non facile, de détruire la force aérienne du colonel Kadhafi : n'oublions pas que la Libye dispose de défenses anti-aériennes.
La comparaison avec les Balkans a ses limites : le conflit était européen et des forces étaient déjà sur place. Vous nous confiez la lourde responsabilité d'arrêter le massacre : nous ferons tout pour cela.

La voix des États-Unis, flamboyante au début des révolutions arabes, semble s'éteindre comme une bougie. Avez-vous des explications ?
J'aimerais également que vous nous disiez un mot sur la mise au pas de Bahreïn par l'Arabie saoudite, dans l'indifférence médiatique générale et le mutisme des États-Unis. Y aurait-il une odeur de pétrole ?
Le président Obama a clairement indiqué que le colonel Kadhafi devait partir et Mme Clinton, que nous avons rencontrée hier soir dans le cadre du G8, soutient notre démarche en posant une condition que nous partageons, à savoir l'implication des pays arabes. Les Américains sont tout à fait conscients qu'une intervention sous la bannière de l'OTAN serait contre-productive. Si nous décidons une intervention aérienne, les pays arabes doivent s'y associer.
Si : les Émirats arabes unis ont une flotte, de même que l'Arabie Saoudite – nous avons même formé leurs pilotes.
Quant au Bahreïn, je vous renvoie à mon propos liminaire. La clé est moins le pétrole que la rivalité entre Chiites et Sunnites.

Que penser des conséquences, certes très indirectes, des catastrophes naturelles au Japon pour l'Europe ? La décision allemande de suspendre la production de sept centrales nucléaires vieillissantes pose un problème au regard de l'équilibre du marché européen de l'énergie. Cette décision a-t-elle fait l'objet d'une concertation avec la France ?

Il reste une dizaine d'orateurs inscrits, mais nous arrivons au terme de cette audition. J'espère donc, monsieur le ministre d'État, que nous pourrons vous entendre de nouveau très bientôt.
Je suis désolé de ne pouvoir vous consacrer tout le temps qui aurait été nécessaire pour cette première audition : je reviendrai devant votre commission le plus vite possible.
Je n'ai pas de jugement à porter sur la décision allemande, et j'ignore quel a été le degré de concertation entre les ministères concernés. Il faut sans doute prendre en compte la situation politique, le Gouvernement allemand étant formé par une coalition.
Quoi qu'il en soit, laisser entendre à nos compatriotes que l'on pourrait sortir du nucléaire en dix ou quinze ans est un mensonge : 78 % de notre électricité sont d'origine nucléaire, contre 12 % d'origine hydroélectrique. Le Gouvernement vient de lancer un plan ambitieux en faveur de l'éolien offshore, et j'ai regretté que le photovoltaïque soit resté un peu en retrait. Il faut à l'évidence développer les énergies renouvelables, tout en faisant des économies. On me reproche souvent, notamment dans l'hémicycle, d'être resté maire, mais cela me permet de constater que tous les projets nouveaux prennent désormais en compte des paramètres écologiques. Malgré ces efforts, les énergies renouvelables ne dépasseront pas 20 % dans les dix ou quinze prochaines années. La seule voie possible est donc le contrôle rigoureux de la sécurité de nos centrales nucléaires.
La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.