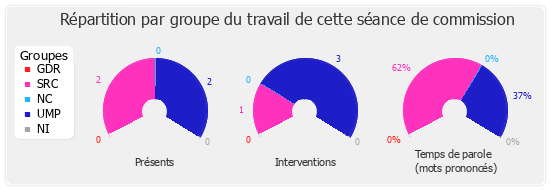Commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies
Séance du 10 novembre 2010 à 16h00
La séance

Nous accueillons aujourd'hui M. Philippe Marchessaux, administrateur-directeur général de BNP Paribas Investment Partners. Il est accompagné de M. Christian Dargnat, responsable de la gestion, et de M. François Delooz, responsable de la conformité. Monsieur Marchessaux, avez-vous des recommandations à faire pour éviter la spéculation « négative », celle qui n'apporte rien à l'économie, voire lui est nuisible ?
(M. Philippe Marchessaux prête serment.)
En introduction, je rappellerai brièvement que le rôle d'un gestionnaire d'actifs est, non pas de faire de la spéculation pour compte propre, mais de gérer de l'argent qui lui est confié en le plaçant, ou de conseiller des clients. BNP Paribas Investment Partners gère ainsi 530 milliards d'euros d'actifs. Notre clientèle se recrute parmi les institutions financières – caisses de retraite en France ou fonds de pension –, parmi les grandes entreprises ou parmi les particuliers. Nous ne nous occupons pas des fonds propres de la banque, et n'avons pas d'autre intérêt lorsque nous investissons que celui de nos clients. Notre activité de société de gestion pour compte de tiers consiste à faire des choix d'investissement en fonction de nos analyses et de notre expertise, mais aussi dans le cadre que nous imposent la réglementation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), les instructions du client et les statuts qui sont déposés auprès de la même AMF.
Ainsi, si un client nous donne mandat de n'investir que dans des obligations d'État qui sont notées investment grade, nous n'achèterons pas d'obligations grecques par exemple, quelle que soit par ailleurs notre opinion sur la qualité de ces titres.
Je précise que nous investissons à un horizon relativement long et que la rotation de nos portefeuilles est relativement lente, de sorte que nous sommes fort peu concernés par les problématiques du trading intraday, technique consistant à faire des allers-retours dans la journée, et du high frequency trading (HFT).
Non. En termes d'horizon de placement, beaucoup dépend des mandats qui nous sont confiés, et nous proposons aussi de la gestion monétaire, qui peut être au jour le jour mais n'a rien à voir avec du HFT. Les produits choisis doivent être adaptés à l'horizon de gestion qui nous a été fixé.
Notre préoccupation est de nous conformer aux orientations des produits et aux règles de protection du consommateur, qui sont destinées à assurer la transparence – il nous faut exposer de manière compréhensible par le client les caractéristiques des produits dans les plaquettes qui lui sont destinées, notamment la performance attendue, le niveau de risque et le prix –, à veiller à ce que ces produits soient conformes aussi bien à ce que nous annonçons qu'aux attentes des clients, et à prévenir les conflits d'intérêts.
La régulation porte aussi bien sur les produits, qui sont agréés et classifiés, que sur notre organisation interne – le programme d'activité détaillé est soumis au régulateur. Nous sommes soumis à des exigences en termes de contrôle de risque et de contrôle interne. En outre, des contrôleurs externes multiples veillent au respect du corpus réglementaire : le dépositaire, les commissaires aux comptes des fonds et des sociétés de gestion, les régulateurs.
Dans l'industrie de la gestion d'actifs, la France est leader européen et se place au deuxième rang mondial. Le secteur emploie directement et indirectement 70 000 personnes.
S'agissant de la spéculation, je partage le point de vue développé devant vous par Jean-Pierre Jouyet : il y a la bonne et la mauvaise spéculation. Pour nous, gestionnaires d'actifs, et dans l'intérêt de nos clients, il est fondamental que soient garanties la transparence, d'une part, et la liquidité, d'autre part. Pour différencier ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, il faut distinguer l'usage et l'abus.
De deux façons. D'une part, nous fabriquons des fonds dits collectifs que nous commercialisons – une SICAV par exemple –, y compris par l'intermédiaire de notre réseau bancaire, et dont nous assurons la liquidité sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon le type de produit. D'autre part, dans le cadre d'un mandat qui nous est confié par un institutionnel, les actifs nous sont apportés en une fois, ou en plusieurs, mais ils restent stables dans le temps. Si nous remportons un appel d'offre, la durée du contrat est fixée au départ. En revanche, dans le cas des produits collectifs, les clients achètent et vendent à leur guise.
Concernant la crise grecque, je voudrais témoigner de la façon dont nous l'avons vécue. Les obligations de la zone euro représentent une part importante, environ 20 %, de nos actifs sous gestion. Les gestionnaires prennent position en fonction d'indices de référence qui définissent leur cadre d'action. Si la Grèce est incluse dans l'indice, nous l'inclurons dans nos analyses fondamentales portant sur l'économie, sur les perspectives conjoncturelles, avant de décider d'investir ou non, et, si oui, de surpondérer ou de sous-pondérer par rapport à l'indice, en fonction des rendements attendus d'autres placements de même nature. Si l'on juge qu'une obligation rapportera plus qu'une autre, on en achètera proportionnellement plus que l'indice. Lorsque, fin 2009, les premières mauvaises nouvelles sont venues de Grèce, notamment les doutes à propos de la qualité des comptes, nous avons décidé de sous-pondérer ses titres. En nous détournant d'actifs devenus plus risqués, nous ne spéculons pas, nous protégeons les portefeuilles de nos clients. Inversement, nous avons choisi de revenir à une surpondération de la Grèce, après la forte baisse des titres, car nous avons considéré que le risque était intégré dans les cours. Notre politique constante consiste à ajuster nos positions en fonction de notre analyse macroéconomique et des prix de marché.
Il y a toutefois pour nous un critère qui peut être important en fonction des orientations du mandataire : la notation. Lorsque la dette grecque a été rétrogradée en dessous d'AAA, nous avons dû solder nos positions en vertu de plusieurs mandats, qui exigeaient de ne pas détenir de titres avec une notation inférieure.
Non, et des CDO – collateralized debt obligations – non plus, sinon de façon marginale. Nous détenons des obligations, des actions et des produits diversifiés combinant les deux en proportion variable. Les portefeuilles obligataires représentent 25 % à 30 % de nos actifs, les portefeuilles monétaires 20 %, les portefeuilles actions 15 %, et nous arbitrons en fonction de nos anticipations de l'évolution des sous-jacents.
Ce qui, selon nous, a provoqué la crise grecque est, non pas la spéculation, mais la perte de confiance dans ce pays quand il est apparu que ses comptes publics n'étaient pas tout à fait exacts. Certains mécanismes ont pu accélérer ou amplifier la crise, comme les ventes automatiques consécutives à la dégradation des notes. À cet égard, une approche coordonnée au plan européen et même mondial serait utile.
Il est important pour nous, en tant qu'investisseur, d'avoir des marchés transparents, liquides, je l'ai dit, mais aussi cohérents, c'est-à-dire régulés de manière coordonnée. Les mesures prises au niveau européen sont une bonne chose, en particulier la création de l'European Securities Markets Authority, l'ESMA, qui supervisera les marchés. De notre point de vue, le dialogue transatlantique ne doit pas être négligé non plus car le bon fonctionnement des marchés financiers et les règles prudentielles à mettre en oeuvre ne concernent pas que les pays européens. C'est un point capital. En Europe, la fragmentation réglementaire est source de dysfonctionnements car elle permet des arbitrages réglementaires. Tout ce qui va dans le sens d'une meilleure coordination est souhaitable, y compris la création d'un régulateur unique.

Avant la crise grecque, il y a eu la crise financière. Comment expliquer pareille déflagration ?
Cette crise, de notre point de vue, trouve son fait générateur dans la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 car les investisseurs ont été extrêmement surpris que l'État américain n'intervienne pas. Je ne mets pas sur un même plan l'assèchement du marché interbancaire. Pour moi, la crise de confiance a alimenté la baisse des marchés financiers.

Soit. Mais, auparavant, les produits dérivés avaient proliféré. Certains d'entre eux ne sont-ils pas dangereux ? Par ailleurs, en tant que filiale d'une grande banque, gérez-vous des fonds pour le compte propre de votre maison mère ? Enfin, en quoi un bureau au Luxembourg vous est-il utile ? Le Président de la République et le ministre des finances ont demandé aux banques françaises de quitter certaines places.

Dans la mesure où la réglementation à laquelle vous êtes soumis est très stricte et où vous ne recourez pas aux techniques qu'emprunte la spéculation effrénée, on peut considérer que vous pourriez être victime de cette dernière. Quelles sont, dès lors, les principales réformes qui doivent selon vous être menées aujourd'hui pour apporter aux marchés toute la liquidité nécessaire tout en évitant les débordements spéculatifs qui affectent l'économie réelle ?
Concernant le Luxembourg, il n'y a pas eu de directive particulière puisqu'il s'agit d'un pays européen qui est soumis aux mêmes directives que les autres. Au Luxembourg, l'industrie de fonds est régulée sur les mêmes bases qu'en France. Mais ce pays s'est imposé par sa célérité à délivrer les passeports nécessaires à la commercialisation des produits dans l'ensemble européen. En transposant rapidement les directives, le Luxembourg a acquis un avantage qui le place en tête en termes d'actifs gérés sous forme de fonds. C'est la raison principale pour laquelle la plupart des grands acteurs de la gestion européens, voire américains quand ils sont implantés en Europe, sont installés au Luxembourg. Cette décision n'a rien à voir avec la spéculation.
Pas spécialement.

Lors de la crise grecque, causée, selon vous, par une perte de confiance, vous avez dû procéder à des arbitrages dans l'intérêt de vos clients. Dans la mesure où les opérateurs s'observent les uns les autres, vos décisions n'ont-elles pas rétroagi sur les marchés et accentué cette perte de confiance ?
Notre métier consiste à acheter et vendre sur les marchés, en l'occurrence des titres d'État, après avoir évalué en propre les perspectives dans chacun des pays, pour faire fructifier au mieux l'argent de nos clients. Nous sommes des investisseurs de long terme, la durée de détention variant selon les types de produits.
Elle est plus courte pour les actions – un an en moyenne – que pour les obligations. Mais il existe d'autres intervenants, comme les hedge funds, qui font du trading intraday.
Je complète la réponse à propos du Luxembourg. Nous n'avons pas d'équipe de gestion là-bas. Nos produits étant, pour les raisons qui ont été données, de droit luxembourgeois, il nous faut cependant avoir du personnel sur place pour vérifier que les valorisations sont faites et les activités de dépositaire sont exercées conformément à la loi luxembourgeoise.
Tout à l'origine de la crise se trouve le surendettement des ménages américains. Il a miné la confiance et provoqué un reflux de la liquidité de certains marchés dont les acteurs ont, quand ils le pouvaient, joué à fond sur l'effet de levier. Les gérants comme nous ne peuvent agir de même, la réglementation les en empêche : nous ne pouvons pas investir plus que l'argent que l'on nous confie.

Au lieu de s'interroger sur la perte de confiance, ne faudrait-il pas plutôt se demander pourquoi la confiance s'est maintenue aussi longtemps alors que nous avions la certitude – je vous renvoie aux analyses académiques parues dès les années quatre-vingts – que, fatalement, la bulle exploserait ? Je rappelle que les prêts cumulés de Freddie Mac et Fannie Mae, placés sous le contrôle du Congrès des États-Unis en contrepartie de la garantie dont bénéficiaient ces organismes de la part du Trésor américain, représentaient près de la moitié du PIB américain, soit 6 000 milliards de dollars. Les « prêteurs » avaient progressivement perdu de vue la capacité de remboursement des emprunteurs et s'étaient convaincus que la valeur des biens immobiliers financés augmenterait quoi qu'il arrive ; d'où les crédits dits NINJA – pour no income, no job, no asset – attribués à des gens qui n'avaient rien. De même, comment avoir fait confiance aux produits OTC, over the counter, ou de gré à gré de certaines banques, ou plus exactement de certaines institutions financières américaines, en particulier AIG ? Plus tardive a été la prise de conscience, plus dure a été la chute, mais elle devait arriver. L'euphorie n'aurait pas duré aussi longtemps si les banquiers centraux, essentiellement la Fed, n'avaient pas, en vertu d'une théorie qui pourrait porter le nom de ses chantres, Bernanke ou Greenspan, considéré que la meilleure façon de guérir l'alcoolisme était de continuer à servir à boire !
Pour en revenir aux obligations grecques, les institutions européennes ont pourtant mis assez rapidement à disposition de l'État grec des mécanismes de garantie. Si vous avez sous-pondéré, est-ce parce que ceux-ci vous ont paru insuffisants ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Le Wall Street Journal fait état d'un avertissement lancé par M. Chopra, directeur adjoint du Fonds monétaire international, qui souligne que les prêts des banques britanniques à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal et à l'Espagne sont pour elles un facteur de risque. Ces informations, jointes à la remontée des taux, vous ont-elles conduits à revoir vos décisions de gestion ?
Abandonnons le terme de confiance et préoccupons-nous de rendement et de risque qui sont, pour un asset manager, l'avers et le revers d'une même médaille. Nous devons placer les fonds de telle sorte qu'ils produisent le meilleur rendement possible, mais à quel risque ? Nous sommes sans doute sortis trop tôt du marché des titres grecs, ou plutôt nous avons sous-pondéré trop vite, parce qu'il a continué dans un premier temps à enregistrer de bonnes performances. La crise a fini par nous donner raison, mais, ensuite, nous sommes revenus trop tôt sur ce marché car le ratio rendementrisque, dont nous pensions qu'il redevenait intéressant, a continué à se dégrader. Quant à la qualité des garanties apportées par les États, nous sommes aujourd'hui « surpondérés » sur les obligations grecques à un horizon de deux ans, voire de trois, mais pas au-delà, compte tenu des fondamentaux de l'économie grecque.

Et quid des réformes en cours et à venir, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou à celui du G20 ? Quant aux produits dérivés, ils sont indispensables, ne serait-ce que pour renforcer la sécurité d'autres produits, mais comment séparer le bon grain de l'ivraie ? La réglementation peut-elle éviter les dérapages ?
Les propositions de réforme sont nombreuses, tant au plan national, avec la loi de régulation financière, qu'au niveau européen. Toutes celles, telles la création de l'ESMA ou la transformation de différents comités en autorités dotées de pouvoirs, qui visent à améliorer l'information sur les transactions au bénéfice des opérateurs, des clients et des régulateurs, vont dans le bon sens.
Le reporting en particulier est souhaitable. C'est pourquoi il y a des aménagements à apporter à la directive MIF, sur les marchés d'instruments financiers. Si elle a marqué des avancées en matière d'information et d'adéquation des produits aux besoins du client, les dispositions concernant les plateformes de passation d'ordres sont plus discutables. La concentration qui prévalait en France notamment était plus propice à une bonne connaissance des transactions.
Par ailleurs, les produits dérivés sont utilisés par nous, pour l'essentiel, dans un souci de couverture.
Non. L'AMF a publié aujourd'hui un projet d'instruction qui oblige, en cas de vente à nu, tout personne qui franchit un seuil en capital à le déclarer. Ainsi, si vous vendez pour plus de 0,5 % du capital d'une entreprise, vous devez le signaler. Toutes les mesures de ce type vont dans le bon sens. À l'inverse, toute interdiction risquerait d'être contre-productive. En voulant supprimer l'abus, on bloquerait l'usage et, partant, la possibilité d'accéder à des marchés liquides et transparents. Mais il faut pouvoir détecter l'abus, et telle est la raison d'être du reporting, et surtout des mesures de mise en cohérence des marchés.
La force des outils de régulation aux États-Unis réside dans l'infrastructure que représentent cinquante États coiffés par un État fédéral, à ceci près qu'elle n'a pas empêché la crise parce que des pans entiers de l'économie étaient hors régulation. En Europe, les choses sont plus compliquées, mais nous sommes sur la bonne voie.

L'Autorité des marchés financiers conclut dans le même sens que vous, s'agissant du reporting, de la traçabilité et de la directive MIF. Elle nous a signalé par exemple que presque 40 % du high frequency trading (HFT) ne passait pas par les plateformes régulées. Êtes-vous au courant de pratiques qui vous paraîtraient choquantes ?
Ce qui me choque, c'est l'excès en général. Nous nous efforçons quant à nous de ne pas peser sur le marché, pour limiter l'impact sur le prix.
Ce type d'excès ne peut concerner un intervenant final sur le marché. Quand nous achetons une valeur, nous nous sommes fixé pour règle de ne pas dépasser un certain pourcentage des transactions quotidiennes si nous voulons pouvoir liquider la ligne en une journée. Les acteurs comme nous ne passent pas par les dark pools, ils préfèrent les plateformes régulées, pour une question de traçabilité. Je dois pouvoir prouver que je fais ce que je dis et que je dis ce que je fais.
Oui, selon que l'on considère ou non comme européen Black Rock, qui a racheté Barclays Global Investors.
Elles sont utiles mais elles doivent être encadrées. Il faut distinguer la notation des émetteurs et celle des produits, et veiller ensuite au tempo. Les agences n'ont pas créé la crise, mais elles ont un effet nettement procyclique. Dès lors, la question de l'opportunité de leurs annonces se pose. La Commission européenne a prévu de demander aux agences de prévenir trois jours avant, au lieu de douze heures, les États dont elles envisagent de réviser la note.
L'agence de notation est un acteur du marché et elle permet aux investisseurs de mieux évaluer la solvabilité d'un émetteur. Si conflits d'intérêts il y a, il faut mettre en place le cadre et les règles nécessaires pour les prévenir.

À un moment, il est apparu que l'existence de ces agences était la conséquence d'une externalisation de l'expertise. En ce qui vous concerne, vous avez sans doute maintenu celle-ci au sein de votre institution ?
Oui. Nous employons cinquante analystes crédit, ce qui ne veut pas dire que nous nous désintéressons des évaluations des agences. Mais nos spécialistes se forgent leur propre opinion. En revanche, les statuts des fonds et les orientations données par les clients peuvent nous interdire d'investir dans des titres qui n'ont pas telle ou telle note, ou nous obliger à solder nos positions en cas de déclassement d'un émetteur.
Le plus curieux, c'est que les notes peuvent être réduites de plusieurs crans en une seule fois. Dans ce cas, les agences suivent certainement le marché.