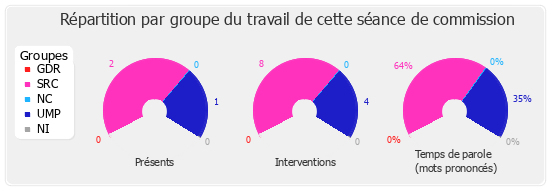Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances
Séance du 11 juin 2008 à 9h30
La séance

Je souhaite la bienvenue à MM. Jean Fabbri, Stéphane Tassel et Michel Piecuch, représentants de syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'à M. Yann Pétel, conseiller maître à la Cour des comptes.
Cette mission d'évaluation et de contrôle – MEC – est destinée à proposer, dans un esprit non partisan, un système équitable et efficace d'allocation des moyens des universités. Il s'agit notamment de rénover le système analytique de répartition des moyens – San Remo.
Après avoir entendu les représentants de la conférence des présidents d'université et de plusieurs syndicats étudiants, les membres des corps d'inspection auteurs de rapports sur la mise en oeuvre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités – LRU –, le président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur – AERES – ainsi que les directeurs d'administration centrale concernés, nous recevrons la semaine prochaine Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Que pensez-vous, messieurs, de l'actuel système de financement des universités ? Est-il transparent et équitable ? Faut-il en modifier les critères ?
Nous vous avons remis un document qui devrait vous permettre de mieux prendre en compte nos analyses et nos propositions. Cela dit, nous estimons que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche est notoirement insuffisant et que les mesures dites « de rattrapage » compensent à peine les désengagements avérés de ces dernières années. Par ailleurs, les critères appliqués aujourd'hui ne sont plus seulement ceux du dispositif San Remo, du fait d'une multiplication de plans ayant complètement perturbé la dotation des universités comme des établissements et des organismes de recherche. On doit donc déplorer l'opacité de l'attribution des moyens, de la vérification de l'attribution de ces moyens qui ne sont ni justes, ni équitables et globalement insuffisants.
Des instances comme le Parlement, et en tout cas comme le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche – CNESER –, se trouvent actuellement dans l'incapacité de mesurer la réalité et l'équité des dotations de l'État aux établissements d'enseignement supérieur.
En tant que mathématicien, il me semble paradoxal qu'à un moment où l'on multiplie les modèles aux milliards de paramètres possibles, on nous demande de réduire à un tout petit nombre d'indicateurs les outils à partir desquels les moyens seront répartis. Cela revient à ignorer la richesse de l'administration et des organisations syndicales qui sont à même de fournir des indicateurs fiables et de les intégrer dans des modèles différents et pertinents permettant une affectation juste des moyens en fonction des objectifs assignés à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Avez-vous des critiques à formuler à l'encontre de la dotation globale de fonctionnement – DGF – et du contrat, éléments de répartition des moyens ?
L'ensemble est illisible. La DGF est affectée sur des critères qui ne sont pas transparents.
La norme San Remo, établie voilà une vingtaine d'années et modifiée à deux ou trois reprises, ne prend pas suffisamment en compte les différences entre les formations. Des moyens sont alloués de manière indifférenciée, alors que les formations peuvent avoir des besoins différents. C'est ainsi qu'en histoire, certaines formations académiques ne demandent pas les mêmes moyens que d'autres, comme celles qui relèvent de l'archéologie.
Je rejoins M. Fabbri à propos de l'insuffisance des moyens. En 2005, l'université d'Harvard disposait d'un budget de 2,8 milliards d'euros pour 20 000 étudiants. La même année, l'université française avait un budget de 9,3 milliards d'euros pour 1 450 000 étudiants. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que l'université française puisse prendre sa place dans la compétition internationale ?
Il existe de nombreuses inégalités entre classes préparatoires et premier cycle des universités ou encore entre grandes écoles et universités, qui sont inhérentes à notre système d'enseignement supérieur. Le SGEN se prononce pour un système totalement différent. Nous sommes pour l'autonomie des universités et pour des contrats d'objectifs passés entre l'université et l'État : tandis que la première s'engage, par exemple, à obtenir un certain taux de réussite en premier cycle ou encore à obtenir tel ou tel résultat en matière de recherche, le second s'oblige à lui fournir les moyens nécessaires, ce qui nécessite une évaluation a posteriori.

Le système actuel repose sur deux principales ressources : la DGF et le contrat. Quelles critiques apportez-vous à un tel mécanisme de financement ? Engendre-t-il des inégalités entre les universités ?
Des inégalités et des effets pervers, telle l'inflation des diplômes proposés, qui ne nous semble pas constituer un progrès pour l'université française.
Pas vraiment, malgré le système de l'AERES, qui ne repose sur aucun des principes auquel doit répondre tout système d'évaluation : être contradictoire, transparent et susceptible d'appel. Or il n'y a ni contradiction ni instance de recours, et outre que l'on ne sait pas vraiment comment sont nommés les experts, on cherche encore ses premiers rapports qui devraient figurer sur son site.

Sur quels éléments fondez-vous vos critiques à l'encontre du système San Remo ? Sa complexité ou ses critères ?
Essentiellement sur sa complexité. Nous préférerions un système beaucoup plus simple, fondé sur des contrats d'objectifs entre l'université et l'État.
Sur le fond, l'utilisation de critères du type San Remo pour apprécier les formations et les situations des établissements peut être une bonne chose. Nous disposons aujourd'hui d'outils mathématiques et de logiciels permettant de tester les modèles. Il est regrettable que le ministère qui dispose de tels outils ne fasse pas travailler le CNESER, les organisations syndicales et les parlementaires pour comparer l'efficacité de tel ou tel modèle, alors que nous pourrions ensemble construire quelque chose de tout à fait adapté.
Cela ne réglerait pas tous les problèmes, notamment le reproche fait au système San Remo de ne pas donner assez de moyens aux établissements. Situation ensuite invoquée afin d'être corrigée par le contrat quadriennal et par divers plans tels que le plan « Réussir en licence » qui prévoit de développer l'orientation, l'opération Campus ou encore le plan IUT. Mais tous ces dispositifs aboutissent à un saupoudrage de moyens sans aucune lisibilité, selon des critères tout à fait discrétionnaires. C'est ce mécanisme-là qu'il faut casser.
Il faut d'abord des financements beaucoup plus conséquents, mieux répartis grâce à une base de données et à un modèle intégrant le plus grand nombre de paramètres, et susceptibles, pour corriger les inégalités, de donner lieu à des débats instruits par le Parlement, puis arbitrés par des instances comme le CNESER, qui ne joue pas du tout son rôle en la matière.
Nous avons un désaccord de fond. Le SGEN s'est résolument prononcé pour l'autonomie des universités. Or, d'une certaine façon, la démarche normative par budget est contradictoire avec l'autonomie des universités. La difficulté est réelle et nous n'avons pas encore de proposition à faire, si ce n'est de dire que les universités doivent prendre en charge des contrats d'objectifs et les traduire elles-mêmes en demandes budgétaires, négociées ensuite avec une autorité responsable.

Supposons que la masse financière globale consacrée aux universités soit au niveau souhaité par les uns et les autres. S'agissant de la formation, quels critères faudrait-il retenir pour calculer la dotation par université ? Faut-il traiter différemment les diverses formations ainsi que les licences et les masters ? Doit-on inclure dans cette masse les IUT et les grandes écoles ?
Il faut d'abord évacuer l'idée, à mon avis anti-scientifique, de réduire le critère d'affectation des moyens aux établissements à une dizaine ou à une vingtaine de paramètres.
Nous sommes pour une multiplication de critères pondérés. Le ministère, les mathématiciens, les informaticiens sont tout à fait capables de construire des modèles, en intégrant quelques centaines de données relatives aux établissements. Les besoins ne sont pas les mêmes selon que les formations requièrent ou non de nombreux déplacements, comme l'archéologie, ou des locaux supplémentaires pour les travaux pratiques. De même, il convient d'intégrer des paramètres liés à certains objectifs, comme celui d'atteindre les 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur.
De tels paramètres permettent de vérifier si les établissements sont à même d'atteindre un tel objectif et de corriger les inégalités sociales, ou encore d'apprécier si, dans un établissement, l'éventail des catégories socioprofessionnelles – CSP – se maintient ou s'accroît entre l'entrée en première année de licence et la sortie de troisième année, c'est-à-dire si l'on assiste ou non à une évaporation des CSP les plus fragiles entre l'entrée en université et la fin d'un DUT ou d'une licence. Tous ces paramètres sont en rapport avec les missions qui doivent être assignées à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Les critères ne résolvent pas tout. Le ministère, pour le plan « Réussir en licence », a récemment mis en avant le critère des bacheliers en retard. Un tel critère social a une certaine valeur, notamment expérimentale, mais il est insuffisant pour traiter ce délicat problème.

Mme la ministre a évoqué à plusieurs reprises le nombre d'étudiants inscrits aux examens. Cela vous paraît-il judicieux ou inacceptable ?
Inacceptable. L'objectif est de faire en sorte que les étudiants qui s'inscrivent à l'université y restent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'évaporation et qu'ils soient soutenus pédagogiquement et financièrement.
Nous ne rejetons pas forcément un tel critère. Il nous paraît raisonnable. Si l'université veut garder ses étudiants, elle doit faire des efforts, notamment en interne, pour qu'ils se présentent aux examens.
À partir de ce seul critère, comparons Paris VIII ou Paris XIII, en Seine-Saint-Denis, dont les publics sont pour partie socialement et sociologiquement défavorisés – certains devant vivre de petits boulots pour poursuivre leurs études – avec une université scientifique sélective, comme celle de Paris VI, en plein coeur de la capitale. Si le pourcentage d'étudiants inscrits n'est pas le même que celui des présents aux examens, va-t-on encourager le mécanisme élitiste de Paris VI ou va-t-on faire en sorte d'accroître partout le nombre des étudiants diplômés, en aidant ceux qui en ont le plus besoin ?
C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions des contrats d'objectifs entre l'université et l'État. Il serait même possible d'imaginer, même si le SGEN n'est pas forcément favorable à ce type de cursus, que des universités proposent des cursus très élitistes en économie ou en MBA. En tout état de cause la réalisation du contrat d'objectif passé avec l'État doit être évaluée a posteriori.
Encore une fois, notre position en faveur de l'autonomie des universités fait que nous ne sommes pas favorables à la création d'un système national unique d'attribution des moyens.
Les outils logiciels sont beaucoup plus performants qu'il y a vingt ans. On peut travailler de façon très différenciée.

Lors des précédentes auditions, l'évaluation de la variation du nombre des étudiants dans les différents cursus a plutôt été évoquée. Un tel critère conduirait ainsi à allouer les moyens en prenant en compte le nombre des étudiants passant les examens plutôt que celui des étudiants inscrits. Trouvez-vous cette solution intéressante ?
Le système contractuel actuel représente à peine 5 % des moyens alloués par l'État aux universités. Que mettriez-vous, monsieur Piecuch, dans les contrats que vous évoquez ? Et selon quelles modalités ?
Dans notre conception fondée sur l'autonomie des universités, nous serions favorables à tout mettre dans le contrat. L'université se débrouillerait avec son budget global et elle rendrait compte ensuite, à partir d'une évaluation effectuée a posteriori.

Encore faut-il que pour l'évaluation, dans laquelle interviendra sûrement l'AERES, existe un outil transparent, partagé et contradictoire.
Notre organisation défend cette position depuis longtemps.
Nous ne pensons pas que des indicateurs instantanés soient pertinents. Il faut disposer d'une évolution moyenne pour pouvoir corriger les inégalités et aller vers davantage de pluridisciplinarité et d'efficacité sociale.
Les indicateurs utilisés à l'heure actuelle par le ministère au cours de la phase de contractualisation – ce qui est le cas des universités évaluées au titre de la vague B – sont pour la plupart des indicateurs instantanés, qui n'ont aucun sens. Nous avons besoin de moyennes et de mesures des tendances, ce que l'on sait faire.
On ne pourra jamais se limiter à un très petit nombre d'indicateurs si l'on veut atteindre l'objectif d'élévation du niveau des formations et de 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur.
Notre position est très simple. Nous sommes pour l'autonomie et le budget global. Il est bien évident que la question des IUT relève de la responsabilité des universités de financer en interne ces filières dont l'autonomie d'action est garantie par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

S'agissant de la formation, quelle doit être la part à l'activité et quelle doit être la part à la performance ?
Nous ne sommes que moyennement favorables au financement à la performance, dans la mesure où celui-ci intervient forcément a posteriori, après évaluation. Ce ne peut qu'être une prime pour le contrat suivant.

Le contrat d'objectifs que vous envisagez est presque exclusivement financé par l'activité ?
Je voudrais revenir sur les dotations spécifiques des IUT, des écoles et des écoles internes comme les IUFM.
Au moment de l'intégration de ces derniers, la question des frais de transport de leurs élèves s'est posée car une telle prise en charge constituait une part très importante de leur budget. La mutualisation au sein des universités risque de faire complètement disparaître ce financement, dans un contexte de moyens globalement insuffisants. Il en est de même de l'accompagnement de certaines formations, qui restent spécifiques : DUT, licences pro, formations dans les écoles. Là aussi, des évaluations transparentes sont nécessaires.
Nous sommes hostiles à la composition de la commission des titres d'ingénieurs – la CTI – étant donné la façon dont elle fonctionne en matière d'évaluation et d'habilitation des formations d'ingénieurs. Le président de l'AERES a émis l'hypothèse d'intégrer la CTI dans l'Agence, mais celle-ci travaille également dans l'obscurité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous estimons qu'une plus grande transparence est nécessaire dans les deux instances.
Nous sommes également hostiles à un financement à la performance, surtout lorsque l'on n'indique pas quels sont les critères retenus.

Nous sommes là pour les définir. Vous semblerait-il intéressant de prendre en compte le fait qu'une université est passée d'un taux de diplômés de 40 à 50 % d'une classe d'âge ?
C'est un indicateur de performance possible. Un tel indicateur permet la réalisation d'un objectif fixé par l'État aux universités et encourage la correction d'une situation insatisfaisante.

Le fait de prendre en compte la capacité d'une université à amener ses élèves de l'année n à l'année n+4 vous paraît-il pertinent ?
Oui, dans la mesure où il s'agit d'un élément qui corrige des insuffisances ou des inégalités.
Il faut apprécier les indicateurs à la fois dans leur relativité et dans leur caractère absolu. Orsay et Paris VI ont de très nombreux étudiants inscrits dans les filières master, avec des taux de réussite excellents ; pour elles, passer de 80 à 83 % n'est pas significatif. Cela ne représente pas la même performance que passer, pour l'université de Limoges, de 33 à 38 %. Les moyens attribués ne doivent pas être les mêmes. Voilà pourquoi, dans tous les cas, il faut mener un véritable débat. On ne peut pas se cacher derrière les chiffres pour trancher les politiques budgétaires.
Pour l'instant, son fonctionnement est peu transparent. On ne sait pas comment sont nommés les experts. En principe, nous devrions pouvoir lire, début juillet, ses premiers rapports sur son site s'agissant de la vague B. On attend un peu pour pouvoir porter un jugement définitif.
L'autre problème tient au caractère non contradictoire de ses évaluations et à l'absence de possibilité de recours.
Le ministère nous ignore complètement. Il pourrait pourtant discuter avec les organisations syndicales ou le CNESER de ses propositions de correction du dispositif San Remo ou d'autres systèmes.
S'agissant de l'AERES, il est très inquiétant que l'on ait cassé des outils appréciés par les universitaires, pour les remplacer par des instances dans lesquelles il y a peu de pluralisme et de transparence, où tous les experts sont nommés et où l'aspect contradictoire n'existe pas. D'ailleurs, la communauté universitaire a de plus en plus de mal à saisir les enjeux et les critères d'arbitrage du Gouvernement. Les derniers plans en ont apporté une preuve supplémentaire. C'est le règne de l'arbitraire.
Le critère actuel d'enseignant chercheur publiant me semble extrêmement réducteur. J'ai été jusqu'à une période récente dirigeant d'un grand laboratoire de physique, où certains chercheurs publiaient peu. Mais ils avaient un rôle important, que ce soit en termes de travail administratif, ou d'organisation de séminaires et de conférences.
Là encore, le problème de l'évaluation de la recherche doit se faire a posteriori et sur des critères qui ne sont pas forcément numériques. Je ne suis pas un ennemi de la bibliométrie, mais encore faut-il ne pas uniquement utiliser cet élément de quantification. Le critère actuel est d'ailleurs d'un niveau encore plus bas que le critère bibliométrique, puisque l'on utilise seulement le nombre de publications par chercheur comme critère d'évaluation de la recherche. Un tel critère me semble relativement mauvais.
Totalement mauvais ! J'ai participé pendant huit ans à la section mathématiques du Conseil des universités, qui mène un vrai travail d'appréciation du travail individuel des enseignants-chercheurs prenant en compte la nature des travaux, le nombre des publications et les brevets. On y procède à une évaluation, par les pairs, de la profondeur des articles publiés, de leur rayonnement, de la possibilité de nouer des coopérations disciplinaires ou interdisciplinaires.
Il est paradoxal de vouloir, d'une part, réduire les indicateurs en matière d'appréciation de la recherche aux seuls critères bibliométriques, et d'autre part, apprécier globalement le fonctionnement des établissements et leur performance. Une appréciation qualitative est partout nécessaire, arbitrée par des débats. Rendre leur rôle à des instances de débat qui sont instruites par des indicateurs chiffrés serait une mission pour les parlementaires.

Après le vote de la loi LRU, le ministère a-t-il animé des groupes de travail sur le financement des universités ?
Le ministère ignore superbement les organisations syndicales, et en tout cas la nôtre, qui est largement la plus importante.

Avez-vous été conviés à des groupes de travail mis en place sur le financement des universités ?
Non. Ni les organisations syndicales comme la nôtre, ni d'autres instances comme le CNESER. Nous sommes tous les trois, ici présents, membres du CNESER et nous n'avons jamais été associés, même à des projets de modification de San Remo ou d'équilibrage entre la DGF et les contrats. Tout se passe de manière totalement opaque.
Il existe des critères collectifs simples pour juger de la recherche, et qui ne sont pas utilisés : par exemple, le nombre de congrès internationaux organisés par le laboratoire, qui participe ainsi au rayonnement de la ville et de l'université.
Financer de manière conséquente les objectifs fixés en matière de recherche et de formation, faire en sorte que la communauté universitaire, qui est très active et très attentive, soit vraiment associée à la définition des objectifs et à leur contrôle, et organiser un vrai débat sur les enjeux de recherche et de formation devant les citoyens. Les universités ne doivent pas être des tours d'ivoire.
Un autre objectif, qui me semble important, a été à peine évoqué : l'unification nécessaire, même dans le cadre d'un paysage diversifié, des formations post-baccalauréat, qui concernent 2,3 millions d'étudiants. Il faut des passerelles et de la transparence. Le système est opaque pour les jeunes bacheliers. Or il faut favoriser les reprises d'études, la formation continue, les validations des acquis et d'expériences, ce que ne font pas suffisamment les établissements d'enseignement supérieur publics.
Dans le cadre d'objectifs votés par le Parlement pour les universités françaises, le rôle de l'État et du ministère est de mettre en place des contrats avec les universités autonomes, pour atteindre ces objectifs. Dans un tel système, c'est le contrat avec l'État qui doit et qui peut servir à réaliser les objectifs de l'État. L'État est arbitre, il évalue a posteriori le fonctionnement des universités par rapport aux objectifs qu'il leur a fixés.

Vous dites que le contrat doit avoir pour finalité d'atteindre les objectifs de l'université autonome. Entendez-vous par là, notamment, les missions que le législateur a précisées à l'occasion de la loi d'août 2007 ?

À côté de la mission d'enseignement et de la mission de recherche, d'autres missions existent telles que l'insertion professionnelle.
L'appréciation de cette mission n'est pas simple et la loi SRU bride plus qu'elle ne libère. Certes, même si nous n'avons pas été beaucoup entendus. Nous avons d'ailleurs appelé nos collègues, qui nous ont suivis dans les scrutins, à exprimer leurs réserves et leurs critiques sur maints aspects de la loi, laquelle peut être améliorée. Le processus législatif est en effet un processus continu.
L'objectif d'insertion nous semble intéressant. Mais là encore, il est source de nombreuses inégalités. Prenez les formations d'audit en finances, qui n'offrent que peu de débouchés, qui ne sont préparées que dans quelques filières, et qui assurent des salaires d'embauche élevés. Faut-il survaloriser ces formations de spécialistes en finances ou en management par rapport à d'autres formations pour lesquels les processus d'insertion sont d'une autre nature ? Des critères trop simplistes risquent de privilégier toujours les mêmes et l'on peut craindre des effets pervers. En effet, les étudiants qui suivent ce type d'études pourront, parce qu'ils peuvent espérer avoir des salaires élevés, financer leurs études par des prêts et être plus assidus. Les étudiants qui suivent d'autres formations – professeurs des écoles, archéologues ou kinésithérapeutes – qui sont tout aussi utiles, mais qui ne débouchent pas sur les mêmes salaires, ne pourront pas bénéficier de prêts aussi facilement.
On peut donc être attentif à ce souci d'insertion, mais il faut prévoir des correctifs. Les indicateurs chiffrés risquent d'être très réducteurs.
Le SNESUP souhaite défendre, à la fois devant les parlementaires et devant les services de l'État, notamment ceux du ministère de l'enseignement supérieur, ses propositions. Jusqu'à présent en effet il n'a pu discuter des hypothèses de travail formulées par les services du ministère. Telle n'est pas notre conception d'un dialogue social moderne. Les parlementaires peuvent, pour leur part, être plus actifs.

Nous le serons mercredi en interrogeant Mme Pécresse et en lui faisant part de vos remarques.