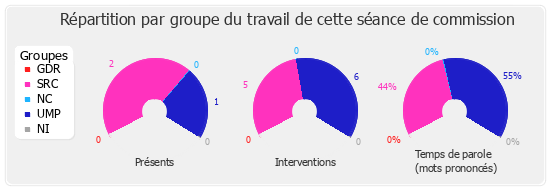Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances
Séance du 15 avril 2009 à 15h00
La séance

Nous avons le plaisir d'accueillir M. Marc Ledoux, directeur de la politique industrielle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), accompagné de M. Laurent Courde, coordinateur des pôles de compétitivité.

Ma première question concerne la participation du CNRS au dispositif des pôles de compétitivité. Dans combien de pôles le CNRS intervient-il, et pour quel montant financier ? Y a-t-il des disciplines dans lesquelles il est plus particulièrement présent ?
Le CNRS étant un organisme pluridisciplinaire, il n'y a pas de disciplines prioritaires pour nous.
Je ne dispose pas encore des chiffres de l'année 2008, mais je peux vous communiquer ceux des années précédentes. En 2006, 153 laboratoires du CNRS participaient à 302 contrats de recherche dans 46 pôles, pour un peu plus de 45 millions d'euros. En 2007, on comptait 456 contrats signés par 185 laboratoires dans 53 pôles, pour environ 63 millions d'euros. Ce montant très important représente environ 10 % du total des contrats du CNRS.
Toutefois, il faut souligner que la création des pôles de compétitivité a provoqué un effet d'aubaine : en 2005, alors que les pôles n'existaient pas, le montant des contrats de recherche industrielle s'élevait à 113 millions d'euros ; en 2006, le montant des contrats que nous avons signés avec les industriels s'est élevé à 70 millions d'euros, et s'y sont ajoutés 45 millions d'euros au titre des pôles de compétitivité. Il n'y a donc pas eu, contrairement à ce que nous espérions, d'augmentation du volume global des contrats ; les industriels se sont en quelque sorte fait payer les contrats par les pôles. En 2007, le montant des contrats de pôle a certes augmenté, puisqu'il a atteint 63 millions d'euros, mais celui des contrats signés avec les industriels a stagné à 70 millions.
S'agissant du financement, l'ANR a fourni 21,6 millions d'euros en 2007, les régions 9,2 millions, les industriels 3,2 millions, le reste provenant du Fonds unique interministériel, le FUI.

Dans combien de pôles le CNRS intervient-il aujourd'hui ? Et dans combien de conseils d'administration est-il présent ?
En termes de contrats de recherche, nous sommes présents dans 61 pôles et, de mémoire, nous participons au conseil d'administration de 34 ou 35 d'entre eux.
Non, au contraire, nous finançons sur notre propre budget notre cotisation.

Au vu de votre expérience, les pôles vous apparaissent-ils plutôt comme un accélérateur ou comme une contrainte supplémentaire pour la recherche ?
Ni l'un, ni l'autre : leur effet est assez neutre, puisqu'il y a substitution. Pour notre part, nous avions déjà tissé des liens avec les industriels bien avant la création des pôles de compétitivité.
Leur première utilité a été de faire prendre conscience aux industriels situés dans une même zone géographique, en particulier les PME, qu'ils pouvaient travailler avec les grands groupes et avec la recherche publique.
En outre, certains de nos laboratoires se sont aperçus qu'ils pouvaient coopérer avec des interlocuteurs très divers, aussi bien locaux qu'internationaux. C'est un second point positif. Je pense notamment au développement de pôles informatiques dans des zones peu actives dans ce secteur : on peut très bien aller chercher les ressources nécessaires ailleurs.
Cela étant, le concept même de pôle de compétitivité n'est pas exempt de dangers. En effet, des entreprises en situation de concurrence ne s'accordent que sur des éléments non stratégiques pour elles, en particulier en matière de recherche. J'ai eu l'occasion de le constater à de nombreuses reprises lorsque j'étais chargé d'évaluer les programmes européens. Comme on l'avait compris à Bruxelles, et comme on commence à le comprendre en France au sujet des pôles, il faut éviter de faire participer à la même structure des industriels qui sont en compétition. En revanche, on peut associer un industriel fournisseur et un industriel donneur d'ordres.
Le deuxième problème, c'est la méfiance qu'éprouvent les PME à l'égard des pôles de compétitivité. Elles ont peur de se faire voler le fruit de leur travail. Cela arrive effectivement, j'ai pu le constater au niveau européen.

Si l'on veut éviter ce risque, les représentants des PME nous disent que le crédit d'impôt recherche est un meilleur outil.
C'est vrai aussi pour les entreprises de plus grande taille. Autant les questions de confidentialité et de propriété industrielle étaient faciles à gérer dans le cadre les contrats bilatéraux qui liaient les entreprises au CNRS, autant elles deviennent très complexes quand dix ou quinze partenaires participent au pôle, surtout quand leurs intérêts divergent.
Il faut prendre garde à ces obstacles, mais je suis néanmoins favorable à l'existence de pôles car certains sont de grandes réussites. Ce fut le cas du pôle textile à Florence, et certains pôles français marchent très bien également.
S'agissant du crédit d'impôt recherche, nous attendons les chiffres de l'année 2008. Je crois beaucoup à l'efficacité de ce dispositif, qui me paraît l'outil essentiel pour favoriser l'innovation.
En effet, quel est le problème de la France en matière d'innovation ? Elle est classée par l'Union européenne autour du dixième rang, soit au-dessus de la moyenne, mais néanmoins dans le groupe des « suiveurs » - quoique les marges d'erreur puissent nous rapprocher du groupe des « leaders ». Ce qui nuit le plus à sa position, c'est la faiblesse de la recherche industrielle - qui, en volume, est deux fois moins développée qu'en Allemagne. Il suffirait qu'elle augmente de 25 à 30 % pour que nous nous classions parmi les tout premiers en Europe en matière d'innovation.
Pour y parvenir, le crédit d'impôt recherche est le seul outil vraiment incitatif. Si les entreprises françaises ne consacrent pas autant d'efforts à la recherche que leurs homologues européennes, c'est pour des raisons culturelles : leurs dirigeants, qui sortent presque tous du même « moule », ont une grande aversion pour le risque. Or, la recherche et l'innovation constituent, par définition, un risque pour l'entreprise.

Il faut donc changer le management, cesser de le confier à des personnes issues des grandes écoles ?
Je vous laisse la responsabilité de cette conclusion.
Je n'ai pas d'éléments pour vous répondre, j'espère qu'il l'est. Je sais que les PME se plaignent qu'il bénéficie surtout aux grands groupes ; pour ma part cela ne me semblerait pas anormal car ce sont eux qui réalisent l'essentiel des innovations. Et quand une PME réussit à innover, elle est généralement rachetée car il est nécessaire de sortir l'artillerie lourde pour explorer un nouveau marché.

Concernant les pôles, vous évoquiez tout à l'heure les risques d'effets pervers, les entreprises participantes concluant des pactes de non-agression et se mettant d'accord sur quelques études, mais continuant à faire l'essentiel de leur recherche en dehors des pôles, en dépit des crédits dont ceux-ci bénéficient. Quelle appréciation portez-vous sur l'évaluation scientifique et technique des projets labellisés au sein des pôles ?
Même si les entreprises ne s'entendent que sur le plus petit dénominateur commun, l'existence d'un pôle de compétitivité favorise la constitution d'une masse critique en matière de recherche. En dépit du fait que les crédits ne sont pas affectés tout de suite aux travaux les plus essentiels, ils permettent à l'entreprise de fidéliser un potentiel humain qui sera utile à d'autres recherches.

C'est d'autant plus important qu'on ne trouve généralement pas ce qu'on cherche, mais autre chose.
En effet. Si l'on pouvait programmer les résultats, ce ne serait plus de la recherche.
Là encore, nous manquons d'éléments concrets. En ce qui nous concerne, la plupart de nos contrats sont labellisés par l'Agence nationale de la recherche, celle-ci ayant ses propres critères d'évaluation. Cela étant, je me suis laissé dire qu'il n'était guère difficile d'obtenir une labellisation au titre des pôles de compétitivité quand on bénéficiait déjà du label de l'ANR.

C'est également ce qui nous a été indiqué par d'autres. Certains pôles sont ainsi de simples réceptacles, sans réalité locale.
Il reste qu'il y a de grandes réussites dans les trois catégories de pôles. Le pôle Fibres Grand Est d'Epinal, par exemple, réunissant des scieurs de bois et des fabricants de plastique, était un pari improbable. Or c'est un grand succès : il a permis de faire travailler ensemble de nombreux acteurs et d'ouvrir de nouveaux marchés. Il faudrait d'ailleurs mesurer, lors de la prochaine évaluation des pôles, leur impact sur les exportations.
Ils sont en chute libre. Ils représentaient un peu plus de 20 % du montant total de nos contrats en 2005, environ 19 % en 2006, et leur part est tombée à 3 % en 2007. L'explication est simple : il est beaucoup facile d'obtenir un financement de l'ANR que de monter un projet européen – ce qui est, chacun le sait, d'une complexité effroyable.
Très peu. Il y a un projet commun avec la Finlande, un autre avec l'Allemagne, mais cela reste marginal.

Pour en revenir aux crédits européens, faut-il comprendre qu'ils vont ailleurs qu'en France ?
Tout à fait. Alors que la contribution de la France représente environ 13 % du PCRD, le programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne, les crédits européens ne représentent plus que 3 % du total de nos contrats.

Que faut-il faire ? Doit-on simplifier les procédures européennes ? N'y a-t-il pas un problème franco-français ?
Il faut « casser » le système administratif de Bruxelles. La situation étant ressentie de la même façon dans les autres pays européens, nous sommes en train de nous concerter pour boycotter le PCRD.

Pensez-vous que l'existence des pôles de compétitivité contribue à améliorer la culture de la recherche en France ? Puisque nous n'avons ni pétrole, ni minerai à exploiter, ce doit être notre priorité. Il me semble que nous avons bien progressé, même si certains fonds ne sont pas assez drainés. Est-ce également votre analyse ?
Dans l'industrie, je pense effectivement que les pôles font progresser la culture de la recherche. Par ailleurs, contrairement à ce que l'on entend souvent dire, la recherche ne manque pas d'argent en France ; et elle produit de bons résultats : les évaluations réalisées par les Britanniques nous classent dans les quatre premiers rangs mondiaux dans quasiment toutes les disciplines.
En revanche, il est vrai que nous manquons d'entreprises pour valoriser nos résultats. Le CNRS est très performant dans le domaine pharmaceutique, par exemple, mais les industriels français ne sont pas intéressés par de nouvelles molécules. Nous sommes donc obligés de nous adresser à des acteurs installés dans d'autres pays.
Malheureusement non, car ils produisent leurs effets plus en amont : ils favorisent la culture de la recherche, mais cela ne signifie pas que les entreprises vont ensuite concrétiser l'innovation.
Je le répète : nous sommes confrontés à un problème d'aversion au risque. Le moment où l'industrie française a innové, c'est lorsqu'elle était nationalisée : c'était alors l'État qui assumait le risque, et non les entreprises. C'est ce qui nous a permis de concevoir des Airbus et des trains. Il y a là aussi un problème culturel : dès qu'il y a un risque, les dirigeants de nos entreprises ont peur.
Il faut que l'ANR reste dans son rôle, qui est de fournir des crédits pour des contrats de court terme et de moyen terme. Le risque est que, ayant plus d'argent que le CNRS ou d'autres organismes, elle se substitue à eux, sans avoir leurs forces vives.
Cette année, il sera d'environ 6 millions d'euros.

J'en reviens à l'ANR. Si l'on finance essentiellement la recherche par l'intermédiaire des projets, n'assèche-t-on pas les structures qui les portent ?
Tout à fait. Et l'on risque ainsi d'assécher la recherche fondamentale. Le problème est qu'il faut être dans le mainstream pour bénéficier des crédits de l'ANR : il faut appartenir aux principaux réseaux et mener des recherches dans le coeur de sa discipline. Or, c'est dans les marges que se fait la recherche la plus fructueuse.

Les pôles de compétitivité ont-ils à vos yeux l'avantage de faire travailler ensemble les organismes de recherche, par exemple l'INSERM et le CNRS dans le domaine des sciences de la vie ?
Il y a très peu de pôles de compétitivité dans ce domaine. Une Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé vient d'être conclue, mais elle ne fait que consacrer des coopérations qui existent déjà.

Il est question de faire travailler davantage les pôles de compétitivité avec les PRES, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Pourquoi le CNRS est-il si frileux à ce sujet ?
Nous ne sommes pas du tout frileux. Nous avons décidé d'attendre la constitution effective des PRES avant de nous engager car nous ne souhaitons pas être accusés, une fois encore, de prendre des décisions à la place de nos partenaires.
Il faut par ailleurs reconnaître que les PRES ressemblent, pour le moment, à des auberges espagnoles. Il n'y en a pas deux dont les contenus soient identiques. À Bordeaux, seule la valorisation est concernée, alors qu'à Strasbourg toutes les structures ont fusionné.
Il reste que les laboratoires du CNRS pourraient servir de lien entre les PRES et les pôles de compétitivité, puisqu'ils participent déjà à ces deux types de structures.

En résumé, vous considérez que le crédit d'impôt recherche est un excellent outil, qu'il faudrait modifier la gouvernance des entreprises pour que les risques de la recherche et de l'innovation soient acceptés, et qu'il faut simplifier le montage des dossiers au niveau européen. Faut-il en conclure que les pôles de compétitivité ne présentent pas d'intérêt ?
En ce qui concerne l'Europe, le problème ne concerne pas tant le montage des projets que leur gestion extraordinairement tatillonne. Quant aux pôles de compétitivité, je ne les trouve pas du tout inutiles. J'en connais qui fonctionnent très bien.
Comme je l'ai indiqué, leur grand intérêt est de faire prendre conscience aux industriels de la nécessité de faire de la recherche.

Si je vous suis bien, il y a d'un côté des entreprises qui ne font pas assez de recherche et, de l'autre, des chercheurs qui ne trouvent pas d'entreprise pour valoriser leurs projets. Dans ces conditions, le but des pôles de compétitivité ne doit-il pas être de faire en sorte que les entreprises se saisissent d'idées qui dorment sur des étagères du CNRS ?
Il n'y en a pas car dès qu'une idée est valorisable, nous la valorisons. 44 % des 294 brevets publiés en 2008 par le CNRS sont déjà exploités par les industriels, ce qui est un record mondial.
De façon temporaire. Il faut en moyenne trois mois pour signer une licence d'exploitation dans le domaine des sciences et technologies de l'information et de la communication, un an en chimie, deux ans en sciences de la vie, et presque trois ans en physique. Il est normal que la valorisation ne se fasse pas au même rythme dans toutes les disciplines. En revanche, force est de constater qu'elle n'est pas toujours le fait d'acteurs français.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que le crédit d'impôt recherche présente un si grand intérêt. Il n'est pas très normal que le CNRS soit obligé de créer entre 40 ou 50 entreprises par an pour valoriser la recherche, faute de trouver des industriels pour le faire.
Non, pas nécessairement. Elles peuvent être créées dans le cadre d'incubateurs ou s'installer elles-mêmes.
Nous créons, donc, 40 à 50 entreprises par an depuis la « loi Allègre » sur l'innovation et la recherche de 1999 ; 88 % d'entre elles sont toujours vivantes. C'est peut-être un beau résultat, mais ce n'est pas une situation normale. La création d'entreprise est en effet la moins bonne solution pour innover : on perd énormément de temps à monter une structure et à chercher des crédits. Si l'on trouve un industriel disposant déjà d'une force de vente, de fabrication et d'investissement, on peut gagner entre trois et quatre ans. On fait souvent l'apologie de la création d'entreprise, mais ce n'est qu'un pis-aller.
Près de 50 % des projets du CNRS concernent, d'une façon ou d'une autre, les questions de développement durable. Par exemple, de nombreux laboratoires travaillent dans ce domaine à Poitiers, qui est à la pointe des recherches sur l'eau, la combustion ou encore la catalyse.
Les éco-technologies font déjà l'objet d'un grand nombre de projets menés par le CNRS, mais il n'y a pas encore beaucoup de pôles de compétitivité actifs dans ce secteur. Adrien Zeller souhaite en créer un en Alsace. Poitiers serait une localisation très logique pour en créer un autre.

Faut-il constituer des pôles de compétitivité spécifiques, ou l'éco-technologie doit-elle être présente partout ?
Certes le développement durable concerne tout le monde, mais lorsqu'il existe une masse critique de chercheurs publics, comme à Poitiers, ou une masse critique d'industriels tournés vers l'environnement, comme en Alsace, il serait dommage de ne pas l'utiliser.
Pour répondre à une question qui m'a été adressée par écrit sur le rôle international des pôles de compétitivité, il me semble que les laboratoires du CNRS qui font partie à la fois de pôles et de réseaux européens peuvent servir de tête de pont pour développer des liens - comme cela s'était fait dans le cluster de Florence, qui avait beaucoup utilisé les projets européens.

Il me reste à vous remercier d'avoir répondu à toutes nos questions avec une telle franchise.