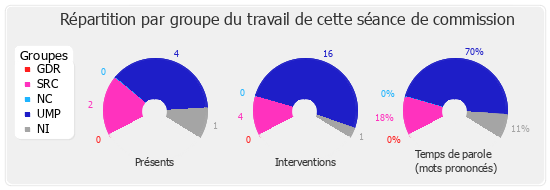Mission d’information sur les questions mémorielles
Séance du 27 mai 2008 à 17h00
La séance
La mission d'information sur les questions mémorielles a auditionné M. Gérard Noiriel, historien, directeur d'étude à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Je vous prie d'excuser le président Bernard Accoyer, qui préside actuellement les débats en séance publique sur le projet de loi constitutionnelle.
Notre mission, qui a été créée à son initiative, s'est donnée comme objectif de réfléchir aux moyens de promouvoir le devoir de mémoire. Si nous avons souhaité vous entendre, monsieur Gérard Noiriel, c'est non seulement en tant qu'historien mais également en tant que sociologue de l'histoire. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et codirecteur de la collection Socio-histoire. Vous avez notamment écrit, en 1996, La crise de l'histoire, ouvrage dans lequel vous insistez sur le rôle social de l'histoire.
Vous présidez également le Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, le CVUH. Ce comité, créé à la suite de l'adoption de la loi dite « Mekachera » du 23 février 2005 sur les rapatriés, rassemble des chercheurs et enseignants qui entendent défendre la vérité historique contre l'instrumentalisation du passé, notamment par les politiques – une pierre jetée dans notre jardin. Le comité a notamment souhaité réagir à un certain nombre de récupérations politiques récentes transformant l'histoire en « bien de consommation ».
Pourtant, comme le rappelle un article du CVUH, « l'histoire […] n'est jamais restée dans les monastères ». Nous savons tous que les pouvoirs en ont toujours fait un large usage, ne serait-ce que pour conforter le sentiment d'appartenance nationale des citoyens à travers la construction d'une mémoire collective. Il serait intéressant que vous nous nous expliquiez comment concilier histoire et mémoires. Ces dernières constituent un hommage nécessaire au passé, que nous devons éviter d'instrumentaliser.
Je vous remercie de m'avoir invité à participer à la réflexion de votre mission d'information. J'ai lu avec attention le questionnaire indicatif que vous m'avez adressé et je ferai de mon mieux pour y répondre. Au préalable, je préciserai le sens dans lequel j'utilise les termes « histoire », « mémoire » et « lois mémorielles ». L'une des difficultés de ce débat, y compris chez les historiens, tient en effet au fait que nous ne donnons pas tous la même signification aux mots que nous employons.
Depuis 2005, je préside en effet le CVUH. Ce comité regroupe des historiens, universitaires et enseignants du secondaire, qui ont jugé nécessaire de se mobiliser pour que la spécificité de leur fonction soit davantage respectée dans l'espace public. Le succès de ce comité, qui possède aujourd'hui des antennes dans pratiquement toutes les régions de France, prouve que cette revendication est largement partagée par la profession. Nous avons le sentiment que le métier d'historien n'est plus considéré comme légitime et que les valeurs qui le sous-tendent – l'esprit critique, la compréhension du passé, l'universalité de la raison – ne sont plus comprises et parfois ne sont même plus admises dans l'espace public. Les deux événements qui, à nos yeux, ont marqué le point de départ de cette dérive se sont produits au début de l'année 2005 : la fameuse loi du 23 février 2005, dont l'article 4 disposait que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer » ; la menace de procès pour négationnisme intenté à l'un de nos collègues, dont les écrits sur l'histoire de l'esclavage avaient déplu à une association mémorielle.
Notre comité n'a pas été la seule organisation à protester très vivement contre ces pressions ; l'immense majorité de la communauté des historiens a exprimé sa désapprobation. Des divergences sont néanmoins apparues entre nous sur les solutions à adopter. Ce clivage a été illustré par les deux pétitions lancées à ce moment. La première, celle que notre comité a soutenue, demandait le retrait de la loi du 23 février 2005, qui illustrait une intrusion directe du pouvoir politique dans l'enseignement de l'histoire. La seconde, intitulée « Liberté pour l'histoire », revendiquait la suppression de toutes les lois mémorielles. Ces divergences, que certains journaux ont appelées « la querelle des historiens », ont fait découvrir au grand public une réalité qui relève de l'évidence pour tous les universitaires. On peut estimer à 50 000 le nombre d'enseignants en histoire et à 1 200 le nombre d'universitaires spécialisés dans cette discipline, sans compter les chercheurs étrangers, notamment Américains, qui, dans certains domaines, sont plus nombreux que les Français à étudier l'histoire de France. Notre milieu n'est donc pas plus homogène que le monde politique ; il abrite des enseignants et des chercheurs porteurs de conceptions différentes de leur métier, de la manière de le pratiquer et de ses finalités. L'aspect positif de cette polémique sur les questions mémorielles aura été de faire reconnaître ce pluralisme.
Quelles raisons peuvent expliquer nos divergences internes au sujet de ces questions ? La première tient au fait que le mot « histoire » prend des sens très différents selon les contextes et selon les interlocuteurs. Depuis le début du XIXe siècle, les discours sur le passé se répartissent en deux ensembles : l'histoire « science », qui cherche à comprendre et à expliquer le passé ; l'histoire « mémoire », tournée vers le jugement sur le passé.
En tant que citoyens, nous nous situons tous dans l'histoire mémoire. Nous voulons entretenir le souvenir de nos proches et défendre la mémoire des groupes auxquels nous appartenons. Le fait de prendre ses distances à l'égard du passé pour tenter de l'expliquer n'est donc pas une démarche naturelle. C'est la raison pour laquelle les États nations, inspirés par l'esprit des Lumières, ont commencé à rémunérer des enseignants-chercheurs ayant pour fonction de produire et de transmettre des connaissances sur le passé qui ne soient plus au service de tel ou tel groupe mémoriel.
En France, c'est la Troisième République qui a mis en oeuvre les réformes démocratiques grâce auxquelles les historiens ont pu se constituer en communauté savante. Ces réformes ont renforcé les exigences scientifiques : les thèses sont devenues de plus en plus volumineuses, de plus en plus spécialisées, mobilisant une masse d'archives de plus en plus impressionnante. Mais dans le même temps, les réformes républicaines ont accordé une importance centrale à l'histoire mémoire sur le plan civique : les historiens ont été sollicités pour élaborer des programmes d'enseignement et participer à des commémorations officielles, dans le but de souder la communauté nationale autour d'une histoire commune. Une double mission a ainsi été assignée à l'enseignement de l'histoire : consolider la mémoire nationale et transmettre aux élèves des connaissances et un esprit critique afin qu'ils deviennent des citoyens autonomes.
En légitimant à la fois l'histoire science et l'histoire mémoire, la Troisième République a donc inauguré les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mémoire et histoire sont en effet deux façons complémentaires et contradictoires d'appréhender le passé. Il est donc normal, dans une démocratie, que ces deux discours entrent de temps à autre en conflit.
Le danger survient quand un déséquilibre se produit entre ces deux pôles. L'histoire mémoire est portée par des forces infiniment plus puissantes que l'histoire science. Jusqu'ici, en France, l'histoire scientifique n'a jamais été menacée de disparition, mais elle court toujours le risque d'être marginalisée par rapport à l'espace public. Ce risque est particulièrement fort, d'une part, lorsque les historiens se replient dans leur tour d'ivoire en désertant le débat public, d'autre part, quand les polémiques mémorielles font la une de l'actualité. Une situation de ce type a déjà eu lieu en France dans les années trente, à tel point que Marc Bloch écrivit, dans sa fameuse Apologie pour l'histoire, ouvrage écrit pendant la Résistance, que la « manie du jugement » avait tué jusqu'au goût d'expliquer.
Bien que le contexte soit aujourd'hui infiniment moins dramatique, nous vivons une situation comparable. La principale différence par rapport aux années trente tient au fait que les querelles mémorielles sont désormais constamment alimentées par les médias. La mémoire est devenue un moyen d'attirer l'attention du public. C'est une ressource que mobilisent certains responsables politiques, les militants, mais aussi les chanteurs, les footballeurs ou les animateurs télé, pour se faire connaître et reconnaître. Le pouvoir médiatique plébiscite naturellement l'histoire mémoire au détriment de l'histoire science. L'histoire intéresse les journalistes surtout dans la mesure où elle est spectaculaire, où elle crée la polémique, quand il y a des coupables à dénoncer et des victimes à déplorer. Dans un tel monde, il n'y a pas de place pour la compréhension ou l'explication du passé. C'est pourquoi les jeunes historiens ont de plus en plus de mal à trouver un éditeur pour leur thèse. Les historiens de ma génération, qui ont eu la chance de publier leurs premiers livres à un moment où l'audimat n'avait pas encore imposé sa loi, constatent avec tristesse que les recherches de leurs étudiants, souvent de très grande valeur, restent complètement ignorées du public. C'est pourquoi, dans le manifeste que le CVUH a diffusé lors de sa création, nous avons insisté sur la nécessité de défendre notre métier contre l'emprise du pouvoir médiatique. Malheureusement, sur ce point, nous n'avons guère été suivis.
L'action que nous avons lancée dès le printemps 2005 contre la loi du 23 février 2005 a eu davantage d'impact. Je tiens toutefois à préciser qu'à la différence des collègues qui ont lancé ensuite la pétition « Liberté pour l'histoire », nous n'avons jamais contesté l'idée que les parlementaires puissent légiférer sur le passé.
Le Président de la République alors en exercice, Jacques Chirac, a dit à juste titre, lorsqu'il a lancé la procédure qui a abouti au déclassement de l'article 4 de cette loi : « Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. ». Nous pensons pour notre part que, si ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire, ce n'est pas non plus aux historiens de faire la loi. La mémoire collective concerne l'ensemble des citoyens et leurs représentants. En tant que citoyens, nous pouvons nous-mêmes, bien sûr, intervenir sur les questions mémorielles. Mais le fait d'exercer le métier d'historien ne nous donne aucune compétence particulière pour dire ce que doit être la mémoire collective. Les problèmes scientifiques que nous nous posons n'ont en effet pratiquement rien à voir avec les polémiques d'actualité. Affirmer que notre liberté serait mise en danger par la multiplication des lois sur le passé, c'est oublier que l'histoire, surtout contemporaine, a toujours été indirectement sous la dépendance de la mémoire. Un grand nombre de nouveaux domaines de la recherche historique – l'histoire du mouvement ouvrier, des femmes, de la Shoah, de l'immigration – ont été au départ développés par des groupes mémoriels. Les historiens qui sont devenus spécialistes de ces questions étaient souvent eux-mêmes au départ engagés dans ces enjeux de mémoire, pour des raisons liées à leur propre histoire personnelle.
L'objectivité de l'historien est relative car l'histoire s'écrit toujours à partir d'un point de vue particulier. Il est préférable, selon nous, de le reconnaître, plutôt que de faire croire à une objectivité qui n'est le plus souvent qu'une subjectivité qui s'ignore. Mais cela n'empêche nullement qu'un véritable historien doit nécessairement respecter les trois grandes règles de son métier : la pertinence du questionnement scientifique, le refus des jugements de valeur et la confrontation des sources.
Étant nous-mêmes influencés, en tant qu'historiens, par ces mouvements mémoriels, il nous paraît normal que les élus y soient eux aussi sensibles. Que des lois aient été votées pour interdire la propagande des négationnistes, reconnaître publiquement les souffrances du peuple arménien ou accorder enfin à l'esclavage une véritable place dans la recherche et l'enseignement de l'histoire, nous semble donc légitime. Nous ne voyons pas en quoi notre liberté serait menacée par ces dispositions. Ceux qui voulaient intenter un procès pour négationnisme à notre collègue de Nantes se sont d'ailleurs rapidement rétractés devant le tollé de toute une profession.
La raison pour laquelle nous nous sommes opposés à la loi du 23 février 2005 tient au fait que la rédaction de son article 4 remettait en cause l'autonomie de notre profession : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer ». Le mot « positif » constitue un jugement de valeur qui tend à imposer l'histoire mémoire au détriment de l'histoire science, alors que le rôle des enseignants est de faire comprendre, d'expliquer le passé et non de le juger. L'État contribuait ainsi à introduire les querelles mémorielles dans les salles de classes.
Je précise que l'analyse critique mise en oeuvre dans nos recherches est une démarche à caractère rationnel, nécessaire si l'on veut expliquer les phénomènes historiques. Comme l'a montré notamment Marc Bloch, la réflexion critique est une dimension fondamentale du travail de l'historien, qui n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou de détester la France, ni même avec une quelconque repentance.
Je voudrais enfin dire un mot de mon expérience concernant l'histoire et la mémoire de l'immigration. Depuis les années quatre-vingts, je me suis beaucoup investi pour que la République française reconnaisse le rôle fondamental joué par l'immigration dans l'histoire contemporaine de la France. J'ai participé à plusieurs commissions sur l'enseignement de cette histoire et j'ai été parmi les fondateurs de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Néanmoins, j'ai toujours été très prudent avec la notion de « devoir de mémoire ». J'ai en effet rencontré dans mes recherches et dans mes activités civiques sur cette question beaucoup de personnes, issues de l'immigration, qui ne tenaient nullement à ce que cette partie de leur passé soit exhibée publiquement. En Lorraine, dans les milieux ouvriers, que j'ai beaucoup fréquentés, un grand nombre de personnes d'origine italienne, polonaise ou algérienne se définissaient avant tout comme sidérurgistes lorrains et célébraient la mémoire du mouvement ouvrier – le premier mai, la Commune de Paris, etc. – plutôt que celle de leur groupe d'origine. Chaque être humain est formé d'un grand nombre de facteurs identitaires et se situe au carrefour de plusieurs histoires. J'ai conçu mon engagement en faveur de la mémoire de l'immigration comme un moyen d'élargir l'éventail des choix possibles en matière de mémoire, comme une liberté supplémentaire accordée aux citoyens et non comme une sorte d'assignation mémorielle. Le devoir de mémoire ne doit pas occulter le droit à l'oubli.

Vous avez évoqué la nécessité, pour votre profession, de se défendre contre le pouvoir médiatique. Comment pourriez-vous y parvenir et qui pourrait vous y aider ?
Un travail de conviction doit être mené en direction des journalistes. Le contentieux avec les chercheurs est très lourd, surtout avec ceux qui travaillent sur des questions sensibles. Mais la démocratie, c'est la discussion. La question ne peut donc être réglée par la réglementation ou la législation mais par l'éducation. Il faut rappeler que, parmi les valeurs de la République, figure la croyance dans la science et la raison pour dépasser les logiques mémorielles et aller vers l'universalisme et la compréhension réciproque. À l'intérieur même de la communauté des historiens, nous n'avons pas la même analyse. Nos collègues signataires de la pétition « Liberté pour l'histoire » considèrent que leur liberté n'est menacée que par les dispositions législatives et n'abordent pas du tout cette problématique du rapport avec les journalistes, à laquelle nous sommes pour notre part très sensibles.

Vous avez bien voulu reconnaître que l'histoire n'est pas une science objective mais une science dite « molle ».

Paul Ricoeur a été extrêmement clair à ce propos : l'historien sélectionne les faits et les schémas de causalité. Mais il a aussi ses sympathies et ses antipathies. Enfin, la distance du temps complique les interprétations. L'histoire n'est même pas toujours une science, car la science historique doit être distinguée de la mémoire. Dans un livre d'histoire, lorsqu'un événement qui a duré un ou deux siècles, comme la colonisation, est traité en une page, s'agit-il de science ou de mémoire ? Or, en matière de mémoire, les parlementaires ont en effet leur mot à dire.
Je suis un peu étonné que des jugements différents soient portés sur la fameuse loi de 2005 et sur la loi dite « Taubira », par exemple. La loi de 2005 est un texte de reconnaissance envers les rapatriés. Et les historiens ont curieusement oublié trois choses : ce texte distinguait recherche universitaire et recherche scolaire ; l'expression « en particulier » signifiait que le « rôle positif » s'inscrivait dans un cadre général, pas forcément positif ; la phrase suivante soulignait « la place éminente » jouée dans la Libération du pays par les troupes issues de l'outre-mer.
Quand une science est molle, elle contient beaucoup d'idéologie. La loi de 2005 avait pour but évident de réagir contre l'idéologie dominante qui forme les futurs citoyens français. Un grand historien, François Furet, a montré à quel point les Français, pendant des années, ont été mal informés sur la Révolution française, à partir de l'interprétation marxiste favorisée par les professeurs d'histoire, qui ont agi en idéologues.
Ces propos n'appellent pas de réponse. Vous n'aimez pas les historiens, j'en prends acte.
Je me suis efforcé de décrire la différence entre histoire science et histoire mémoire. Vous entrez dans des considérations dépassées sur le statut de la science. Ceux qui refusent de considérer l'histoire comme une science, c'est qu'elle les dérange.
L'engagement politique n'a rien à voir. Nous avons rejoint le conseil scientifique de la Cité de l'immigration sans prêter attention à l'étiquette politique du Président de la République, parce que la cause nous semblait juste. Arrêtez les procès d'intention systématiques ! Comment discuter normalement avec des gens qui nous suspectent sans cesse d'endoctriner les élèves et d'être des marxistes attardés ?
Je peux parler du milieu enseignant car j'ai longtemps exercé dans le secondaire et j'ai même commencé à travailler en école primaire.
Les enseignants sont pris dans des situations extrêmement difficiles. Au lieu d'introduire des jugements de valeur dans les programmes, il faut donc les aider à prendre du recul pour que la discipline garde le cap d'une logique de connaissance. Nous aurions tout autant combattu une loi qui nous aurait contraints à présenter les aspects négatifs de l'immigration.

J'apprécie beaucoup Gérard Noiriel, historien qu'il m'a été donné de lire et d'utiliser en tant que professeur d'histoire.
J'en étais restée à l'idée que l'histoire bénéficie d'une grosse cote dans les médias, comme dans les années soixante-dix et quatre-vingts, avec les succès auprès du grand public d'auteurs comme Emmanuel Leroy-Ladurie.
Grand spécialiste de l'immigration, vous avez notamment écrit un ouvrage intitulé Population, immigration et identité nationale en France. Derrière les notions de mémoire et d'histoire, se posent celles de l'identité nationale et des identités des Français d'origine étrangère.
Je désapprouve les propos de mon collègue Vanneste, qui remet en cause le travail des historiens. Je ressens, de la part des politiques, une tentation d'écrire l'histoire. Il est arrivé, sous le Président Mitterrand, que les programmes d'histoire soient discutés en conseil des ministres. De même, lorsque M. Bayrou était ministre de l'éducation nationale, il dressait la liste des dates à enseigner. Qu'en pensez-vous ?
J'ai quitté l'enseignement secondaire depuis un moment mais j'ai toujours maintenu le contact, notamment en animant des ateliers pédagogiques. Je me suis souvent interrogé sur la manière de ménager une place à l'immigration dans l'enseignement de l'histoire contemporaine. Le modèle américain ne me convient pas, d'abord parce qu'il correspond à un pays où les programmes sont décentralisés, ensuite parce que la question y est traitée sous l'angle des « contributions » des communautés. J'ai toujours été hostile à cette démarche parce que la notion de communauté est plus compliquée qu'il n'y paraît mais aussi parce qu'il est beaucoup plus intéressant d'expliquer des processus. Je ne travaille pas sur les immigrés mais sur l'immigration, car la compréhension des processus universels permet de rattacher les enfants à leur histoire : les migrations sont l'une de composantes fondamentales de l'histoire des civilisations depuis le début de l'humanité, tout particulièrement pour la France ; elles suscitent des échanges entre les pays d'origine et d'accueil ; elles donnent lieu aussi à des difficultés. Focaliser la question sur les spécificités n'entre pas dans la tradition française et nous entraîne dans un engrenage ingérable. Nous avons été déçus du peu d'impact de nos propositions, malgré l'engagement de Jacques Toubon autour de la Cité de l'immigration. L'histoire de l'immigration, c'est aussi l'histoire des papiers d'identité.
L'histoire a eu naguère le vent en poupe, mais c'était une période exceptionnelle et seules quelques vedettes ont eu les faveurs de la télévision. On n'entend jamais parler de ceux qui produisent les connaissances, animent les associations et publient dans les revues savantes. La période actuelle n'est plus aux honneurs car le rapport à l'histoire a changé – j'entends l'histoire savante, car la vulgarisation historique permet toujours de toucher de vastes publics. Je serais favorable à ce que la télévision, notamment les chaînes publiques, trouve les moyens de ménager une petite place pour nos travaux. Issu d'un milieu modeste, j'ai moi-même pris goût à l'histoire grâce à la télévision.
La caméra explore le temps ! Cette émission atteignait le grand public. Un autre problème actuel est celui du recul de la démocratisation de l'accès à la profession d'historien. Le recrutement d'historiens apportant des expériences différentes améliore l'objectivité de la profession. Il est essentiel d'élargir la base sociale des professionnels de l'histoire, en dépit du degré de sévérité des concours. Un musée comme la Cité de l'immigration peut aussi avoir pour fonction d'aider au passage de la mémoire à l'histoire.

Je souhaite la bienvenue à MM. François Dosse et Thomas Férenczi, qui viennent de nous rejoindre.

L'histoire n'est pas une science mais la recherche permanente de la vérité à partir de faits en croisant les regards. Une science est figée et formule des définitions qui se transforment en dogme. Or tout est en mouvement. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire existe et que les historiens travaillent, à partir de matériaux variés. Des recherches nouvelles obligent à revoir certains événements, ce qui donne à l'histoire un caractère relatif. Par ailleurs, même si certains chercheurs ne voient que ses côtés positifs ou négatifs, tout fait historique comporte des aspects contradictoires, y compris la Révolution française. Je ne suis pas de ceux qui croient à l'existence d'une vérité historique indiscutable, même si les avancées de la recherche améliorent la connaissance des faits mise à la disposition du peuple. C'est important car « un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Mémoire individuelle et mémoire collective sont au demeurant inséparables.
L'histoire est votre métier, d'accord, mais vous n'êtes pas les seuls à pouvoir y toucher. Je réfute l'idée que le législateur soit dans son rôle en écrivant l'histoire ; toutefois, il l'est parfaitement quand il intervient sur une question précise, par exemple pour combattre le racisme, la violence ou la haine, ce qui fait partie des principes de la République.
Des progrès restent à accomplir dans l'enseignement de l'histoire, largement incomplet. Notre mission d'information devrait contribuer à repérer des lacunes et à orienter les historiens.
Je suis surpris que vous vous interrogiez autant sur le fait de savoir si l'histoire est une science ! Enseignant dans une institution baptisée l'École des hautes études en sciences sociales, je ne vais tout de même pas affirmer que l'histoire n'est pas une science ! Mais je comprends ce que vous voulez dire, d'autant que j'ai beaucoup bataillé autrefois contre la notion de « science de l'histoire » que les marxistes entendaient imposer – j'ai même été exclu du Parti communiste français pour des motifs de cet ordre…
J'en profite pour rappeler que Marc Bloch reconnaissait l'apport de Marx à ses recherches. Un historien peut très bien utiliser des instruments sans s'aligner derrière une idéologie.
Si nous ne défendions pas la spécificité de notre travail, les citoyens et les élus du peuple seraient en droit de demander pourquoi ils nous paient ! Mais je suis d'accord sur le fait qu'il convient de distinguer différentes formes de contributions sur le passé, car chacun a son propre rapport au savoir. Un espace existe pour discuter sereinement et avancer en dépassant les incompréhensions.
En tout cas, sur les questions mémorielles, nous devons garder le cap fixé par un texte fondateur de la République française : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Je suis relativement choquée par le contexte qui vous a conduits à créer le CVUH. Je considère en effet l'histoire comme une science humaine qui permet de se construire. À la limite, que le professeur soit marxiste ou autre, si son enseignement est bien dispensé, même avec conviction, il aide les élèves à se forger leur idée, à se positionner face aux événements et à se construire. Nous avons eu des professeurs, plus souvent de gauche mais aussi parfois de droite, qui ont produit d'excellents hommes et surtout femmes politiques.

Je suis désolée que le législateur contribue à figer l'histoire. Craignez-vous davantage le pouvoir médiatique ou le pouvoir politique ? Celui-ci, selon moi, peut faire obstacle à l'établissement de la vérité. Lorsque nous avons entendu Christiane Taubira, toutes ses fibres vibraient. Où était l'objectivité ? Le législateur doit s'appuyer sur le passé, organiser le présent et poser des jalons pour construire l'avenir.
Je crois également à la dialectique selon laquelle l'histoire aide à se construire. Cette dimension personnelle n'est pas négligeable : certains historiens engagés avec passion dans leur travail se sont construits par ce biais. La transmission historique aux élèves est importante, surtout dans les milieux n'ayant pas spontanément accès à la culture légitime.
Le pouvoir médiatique me semble aujourd'hui le plus dangereux, même s'il est traversé par de grandes contradictions. Des jeunes chercheurs qui ont rédigé des travaux extraordinaires, notamment sur l'histoire de l'immigration, ne trouvent même pas d'éditeur, alors qu'ils n'auraient eu aucun mal à publier s'ils avaient écrit un texte polémique cherchant à prouver, par exemple, que la Shoah est plus dramatique que l'esclavage. Une telle hiérarchisation des souffrances est insupportable pour un historien. Il faut trouver des moyens pour revaloriser un raisonnement ouvert, favorisant la compréhension, opposé à la recherche systématique de la dénonciation, de l'autojustification ou de la victimisation. Cette appropriation de l'histoire, notamment par des groupes de jeunes dans les quartiers difficiles, complique encore plus le travail des enseignants. Je ne veux pas donner l'impression qu'il existe des blocs : celui des historiens, celui des politiques, celui de journalistes. Chacun exerce son métier, avec ses compétences et sa légitimité. Il faut trouver les moyens de travailler ensemble, en respectant notre déontologie, pour défendre des valeurs communes.

Vous êtes manifestement passionné et c'est tout le problème. L'histoire est la plus humaine des sciences sociales. Des tentatives d'histoire quantitative ont été menées, mais cela n'intéresse personne. On n'explique pas les hommes comme des électrons. N'est-ce pas ?
Si l'histoire quantitative n'intéresse pas le grand public, elle n'est pas dépassée pour autant, loin s'en faut.

Monsieur Vanneste, on n'explique pas les hommes comme des électrons, même si les hommes sont souvent des « électrons libres » ! (Sourires.)

Je n'ai pas lu votre ouvrage Les origines républicaines de Vichy mais, député de celle ville, je m'intéresse particulièrement à ce qui s'y est passé entre 1940 et 1944. Qu'entendez-vous par « origines républicaines de Vichy » ? J'aurais préféré que vous utilisiez l'expression « l'État français » ou « le gouvernement de Pétain » car, pour moi, le régime de Vichy consiste en des carottes émincées et cuites dans l'eau thermale. (Rires.)
Pour les titres, nous sommes tributaires des éditeurs, vous le savez. Le propos de ce livre était de participer au débat historique sur la nature du régime de Vichy : s'inscrivait-il en continuité ou en rupture de la Troisième République ? J'ai notamment travaillé sur les technologies d'identification des personnes. Avant la guerre, certaines voix se sont exprimées pour dénoncer la construction d'instruments anodins en démocratie mais susceptibles de tomber entre d'autres mains.

Monsieur Noiriel, je vous remercie.
La mission d'information a ensuite procédé à l'audition commune de M. François Dosse, historien et de M. Thomas Ferenczi, journaliste, responsable du bureau de Bruxelles au journal Le Monde.

Je suis heureux d'accueillir MM. François Dosse et Thomas Ferenczi et je les prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Bernard Accoyer qui préside en ce moment même les débats de la séance publique consacrés à la révision constitutionnelle.
Nous avons souhaité vous entendre ensemble parce que vous vous êtes intéressés tous deux, respectivement en tant qu'historien et en tant que journaliste, aux questions liées à l'équilibre entre la mémoire et l'oubli, notamment, au rôle des pouvoirs publics dans l'évocation collective de notre passé.
Monsieur Ferenczi, vous êtes agrégé de lettre classiques, journaliste au Monde depuis 1971, journal dont vous êtes actuellement le correspondant à Bruxelles. En 2002, vous avez assuré la direction d'un ouvrage collectif édité à la suite d'un Forum organisé en octobre 2001 qui avait pour thème « Devoir de mémoire, droit à l'oubli » auquel Paul Ricoeur, décédé en mai 2005, avait apporté une importante contribution.
Monsieur Dosse, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des idées et, dans le cadre de votre réflexion sur l'écriture de l'histoire, vous avez eu notamment l'occasion de commenter et d'approfondir la pensée de Paul Ricoeur - en particulier sa fameuse notion de « juste mémoire ». Dans un contexte marqué par la « concurrence des mémoires », par le souci de gérer « les années sombres » de notre pays mais aussi par ce que certains appellent la « manie des commémorations », il était en effet intéressant de mieux comprendre les analyses de ce grand philosophe qui n'hésitait pas, lui, à en appeler au « droit à l'oubli ».
Sur toutes ces questions, vous avez sans aucun doute l'un et l'autre des considérations essentielles à formuler.
Je vous remercie d'autant plus de votre accueil que ces auditions me semblent particulièrement bienvenues, comme en témoignent les interventions de vos précédents invités et votre propre questionnement. Il me paraît en l'occurrence essentiel de mettre enfin en évidence l'extraordinaire travail de clarification conceptuelle de Paul Ricoeur dont l'un des grands livres consacrés aux questions qui nous préoccupent, La Mémoire, l'histoire, l'oubli, a été publié en 2000.
« Promouvoir le devoir de mémoire » : voilà une formulation un peu impérative qui suppose tout d'abord de s'interroger sur la nature de ce devoir-là. Si, en tant que représentants de la nation, vous avez pleine légitimité pour poser ainsi le problème, je tiens néanmoins à souligner que celui-ci n'est pas pour autant dénué de danger. Je crois en effet qu'il faut veiller à préserver la « juste distance » à la fois dans le cadre de la prescription des programmes et dans la transmission de l'histoire. Quand la loi, qui a vocation à être pérenne, a tendance à clore ou à circonscrire définitivement son objet, la discipline historique, elle, a vocation à l'ouverture et à l'inachèvement – ce mot est significativement le dernier de La Mémoire, l'histoire et l'oubli. Par définition, l'histoire est donc « révisionniste », même si ce terme a été accaparé par des individus dont la probité est pour le moins sujette à caution. Outre que le langage de l'historien est lui-même ouvert, il est également « équivoque », comme disait Paul Ricoeur en 1954 dans Histoire et vérité. Le langage de l'historien, assure-t-il, ne peut pas être celui du passé ni du présent : c'est un langage de l'entre-deux, comme celui du traducteur ou de l'interprète.
Vos précédents débats ont en outre été l'occasion de vous interroger sur la possible identification du juge et de l'historien. Or, Marc Bloch s'était aussi posé la question dans Apologie pour l'histoire et il tenait beaucoup à cette association, à condition de bien distinguer le juge d'instruction, auquel l'historien peut être comparé, et le juge du siège. La séparation entre les deux doit en effet être radicale : « Un moment vient où les chemins se séparent, écrit Marc Bloch, quand le savant a observé et expliqué, sa tâche est finie. Au juge, il reste encore à rendre sa sentence. » Et il n'y a pas de sentence historienne : l'historien n'a pas pour mission de juger mais il doit s'efforcer de comprendre.
Je déplore que, ces dernières années, la confusion entre mémoire et histoire ait été aussi massive - c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai signé le texte « Liberté pour l'histoire », et non « pour l'historien », notre initiative n'ayant rien de corporatiste. Dans La Mémoire, l'histoire, l'oubli, Paul Ricoeur débrouille cet écheveau complexe à des fins civiques en déclarant : « Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard l'un des mes thèmes civiques avoués. » Les dimensions mémorielle et historique doivent être en effet clairement distinguées afin de mieux penser leur possible articulation. C'est parce que cette perspective n'a guère été explorée que Pierre Nora, dans Le Débat, a diagnostiqué un « malaise dans l'identité historique. »
La crise que nous traversons est en outre profonde car, après l'effondrement des utopies et l'échec des retours à la tradition, elle touche notre être historique même en affectant ce que l'historien allemand Reinhart Kosseleck appelle notre « horizon d'attente ». Notre société, en effet, peine à s'investir dans un projet collectif – d'où les débordements mémoriels et leurs lots de pathologies. J'ai moi-même évoqué, il y a quelques années, une « commémorite aigue. » Faute de projet, nous semblons condamnés au ressassement et l'histoire elle-même, sous la pression mémorielle, demeure soumise à ce que Pierre Nora appelle la « tyrannie de la mémoire » : lois mémorielles, poursuites judiciaires – que l'on songe à Bernard Lewis ou Olivier Pétré-Grenouilleau…
Paul Ricoeur recommande de distinguer ces deux domaines en raison de leur différence de nature. La mémoire est fondée sur la fidélité ; l'histoire, sur la quête de vérité. Cela n'empêche évidemment pas, par exemple, un enrichissement de l'histoire par la mémoire, comme ce fut le cas dans les vingt dernières années. e surcroît, une séparation trop tranchée reviendrait soit à sacraliser la posture historienne, soit à la minorer au nom d'une appartenance qui suffirait à garantir la véracité du savoir. Cela reviendrait également à faire l'impasse sur la méthodologie et l'épistémologie mais aussi sur ce que Paul Ricoeur, après Michel de Certeau, appelle l' « expliquer-comprendre ». Il ne s'agit donc pas de considérer l'histoire comme une discipline relativiste : Paul Ricoeur, que certains ont taxé de positivisme, tient à la « quête véritative » qui est au coeur de l'art historiographique. Cette vérité surgit d'ailleurs dès ce premier niveau de la recherche historique qu'est « la phase documentaire » : l'archive est-elle vraie ou fausse ? Comment séparer le bon grain de l'ivraie ? Ici commence le soupçon historique, absolument nécessaire. Ricoeur fait même appel au critère poppérien de falsifiabilité pour signifier la scientificité de ce premier stade. D'ailleurs, selon lui, « la réfutation du négationnisme se joue à ce niveau ». L'interprétation, quant à elle, est toujours-déjà présente, ne serait-ce que par la délimitation du corpus – Michel de Certeau parlait d'« archivation » pour désigner ce travail de mise à l'écart.
La mémoire, elle, a une force extraordinaire et des faiblesses innombrables. Dans le cadre des conférences Marc-Bloch, Paul Ricoeur a expliqué que si elle procure ce « petit bonheur » de la reconnaissance et de la familiarité que l'histoire est impuissante à transmettre, elle peut être aussi empêchée, manipulée, commandée, refoulée.
Autre apport du philosophe : l'oubli ne se réduit pas à une pure négativité ; l'« oubli de réserve » peut, en effet, préserver. C'est d'ailleurs lui qui rend possible la saine mémoire – souvenons-nous de Funès, ce personnage d'un conte de Borgès qui meurt fou faute de ne pouvoir rien oublier ! Renan lui-même, comme l'a rappelé Thomas Ferenczi dans sa préface à Devoir de mémoire, droit d'oubli, considérait que l' « essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. »
Faut-il que, de la mémoire ou de l'histoire, l'un des deux finissent par prévaloir ? Non. Le problème se situe donc dans leur articulation. Paul Ricoeur, encore : « La compétition entre la mémoire et l'histoire, entre la fidélité de l'une et la vérité de l'autre, ne peut être tranchée au plan épistémologique ». Ce sont-là, en effet, deux rapports de liment et de déliement au passé de nature différente : plus distanciée et plus impersonnelle, l'histoire peut être équitable et aider à tempérer l'exclusivisme des mémoires singulières ; elle peut également contribuer à pacifier les guerres mémorielles. C'est ainsi qu'au soir de sa vie, Paul Ricoeur nous donne une leçon de jeunesse et d'espérance : la dialectique de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli interdit la compulsion de répétition et le ressassement mortifère ; elle permet aussi de raviver le nécessaire rapport entre passé, présent et avenir. Dans Temps et récit, Ricoeur disait qu'il fallait « rendre nos attentes plus déterminées et notre expérience plus indéterminée. » C'est là une extraordinaire leçon de « défatalisation » du passé. Comme le disait joliment mon maître Jean Bouvier, si l'historien est très fort pour prédire le passé, il s'agit surtout de retrouver l'indétermination qui fut le présent des sociétés passées.
Tout ceci explique que Paul Ricoeur ait pris ses distances à l'endroit de cette notion de devoir de mémoire. Il a d'ailleurs été victime d'un procès d'intention : lui, ce grand chrétien, aurait fait fi du « Souviens-toi » deutéronomique ? C'est absurde. A ce devoir de mémoire, Paul Ricoeur a préféré le « travail de mémoire » - où l'on entendra les échos freudiens de la cure, des souvenirs-écrans, de la résistance, du refoulement, du travail de deuil aussi. L'histoire comme « tombeau » pour le mort, pour reprendre cette fois la formule de Michel de Certeau - elle-même reprise par Paul Ricoeur - permet de faire place au présent en honorant et en fixant le passé : le tombeau sauve l'« avoir été des ruines du n'être plus. »
Si le devoir de mémoire est légitime, il peut en outre faire l'objet d'abus. Paul Ricoeur, à nouveau : « L'injonction à se souvenir risque d'être entendue comme une invitation adressée à la mémoire de court-circuiter le travail de l'histoire. » Les historiens doivent se fixer pour mission l'écriture de l'histoire sociale de la mémoire afin d'articuler ces deux pôles. Il faut qu'ils soient à l'écoute de leur temps en prenant en compte la « demande sociale ». Paul Ricoeur disait que c'est en délivrant, par le moyen de l'histoire, les promesses non tenues, voire, empêchées ou refoulées par le cours ultérieur de l'histoire qu'un peuple, une nation, une entité culturelle peuvent accéder à une conception ouverte et vivante de leurs traditions.
N'en déplaise aux grammairiens : l'effondrement du télos et de la naturalisation de l'histoire font qu'il n'y aura plus jamais de « passé simple ». L'histoire ne peut qu'être « au second degré », selon la juste formule de Pierre Nora : elle ne peut qu'être réflexive, critique, plurielle, ouvertes aux mémoires. La diversité des herméneutiques est une chance.
Si la reconnaissance par les pouvoirs publics des injustices passées, des mémoires refoulées ou dominées est positive tant qu'elle s'effectue à travers des déclarations, des commémorations, des fêtes ou des hommages, elle ne doit pas néanmoins déboucher sur une sanctuarisation génératrice d'interdits législatifs.
Je suis très honoré de votre invitation même si, n'étant pas historien, je ne suis peut-être pas tout à fait à ma place parmi vous. J'ai certes invité Paul Ricoeur au Forum organisé par Le Monde, l'université du Maine et la ville du Mans, mais je suis avant tout un journaliste. En tant que tel, je suis attentif à l'air du temps, lequel me semble rempli de ce fameux « devoir de mémoire » qui consiste selon moi à percevoir comme un impératif moral et politique l'attention soutenue et systématique aux événements passés. Cette volonté mémorielle s'explique peut-être par cette crise de l'horizon d'attente dont parlait François Dosse. Dans Instantanés, Roger Grenier écrit quant à lui : « Les morts tombent de plus en plus vite dans l'oubli, une perte de mémoire qui me semble une des plus graves maladie de notre époque. » Revenir sur le passé doit permettre d'en guérir. Cette démarche me semble positive, à condition qu'elle soit conduite selon certaines règles et qu'elle ne devienne pas obsessionnelle. Si, en effet, le souvenir peut être entaché de nostalgie ou de ressentiment, il peut également favoriser la reconstruction de soi et l'apaisement. C'est cela, à mon avis, la « juste mémoire ».
Lors de ce Forum, Paul Ricoeur ne s'est pas livré à une apologie de l'oubli, même si son discours était sans doute un peu provoquant. Des malentendus se sont d'ailleurs fait jour, et jusque dans la publication des Actes puisque le philosophe m'avait demandé d'ajouter un post-scriptum à sa communication indiquant qu'il avait été indigné par le compte rendu qu'en avait fait Le Monde, lequel l'avait accusé de prôner l'oubli. Ricoeur disait vouloir refuser « cette méchante querelle » et avait alors dénoncé les « stratégies d'omission et d'évitement » : « une forme d'oubli peut être légitimement évoquée », disait-il, mais elle ne doit pas se confondre avec « un devoir de taire le mal » ; il s'agira bien plutôt de le « dire sur un ton apaisé, sans colère ». Ricoeur, enfin, avait opposé l' « oublieuse mémoire de la vie ordinaire » à l' « inoublieuse mémoire du ressentiment, de la haine et de la vengeance ».
Le devoir de mémoire doit permettre de réconcilier la société avec elle-même à partir de la reconnaissance de ses fautes, de ses torts ou de ses crimes à l'endroit de telle ou telle de ses communautés mais également sur la base de la reconnaissance des souffrances ou des injustices subies par tel ou tel groupe. Il doit aussi contribuer au renforcement de la vigilance face à d'éventuels renouvellements de ces actes et insister sur les valeurs auxquelles la société est attachée. Du passé, il faut aussi bien connaître ses aspects glorieux que ceux qui sont condamnables car on ne bâtit rien de bon sur le mensonge, fût-ce par omission. Comme l'a dit le Président de la République dans le discours qu'il a prononcé lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage : « Regardons cette histoire telle qu'elle a été, regardons-là lucidement car c'est l'histoire de France ». Une fois n'est pas coutume : c'était une excellente formule (Sourires).
Devoir de mémoire, droit à l'oubli mentionne par ailleurs à plusieurs reprises ces deux mémoires dont il a été souvent question : la mémoire mélancolique et lancinante d'une part, la mémoire vive ou infinie servant aux combats présents d'autre part.
Les travaux des historiens sont bien entendu indispensables, ne serait-ce que pour ne pas laisser les mémoires partisanes ou communautaires occuper tout le terrain, mais les appels de telle ou telle communauté à la reconnaissance de leur expérience doivent également pouvoir s'exprimer de manière à ce que mémoire et histoire ne s'opposent pas mais se complètent. Les commémorations, qu'elles soient orchestrées par les médias – comme celles concernant Mai-68 en ce moment - ou les pouvoirs publics – déclarations, manifestations, lois, programmes scolaires – doivent servir le même objectif. La lutte contre l'oubli, en outre, peut prendre la forme d'une action judiciaire – que l'on songe au procès de Maurice Papon ou aux commissions de vérité et de réconciliation dans certains pays.
L'expression des politiques me semble on ne peut plus légitime en la matière. Dans Vivre avec de Gaulle, un témoin raconte ainsi une visite du Général au Struthof. Il déclara alors : « Saint-Exupéry avait raison : il est plus difficile d'être un otage que de combattre sous l'uniforme. La déportation est la voie la plus douloureuse de la Libération. Il faudra que les Français s'en souviennent. » Ces questions mémorielles étant toutefois difficiles à manier tant elles provoquent de passions, les pouvoirs publics doivent également faire preuve de prudence et de discernement. Il importe donc de trouver le juste équilibre entre le travail des historiens, les demandes des communautés et les interventions des politiques. Le travail historique doit permettre en particulier d'éviter les amalgames et les surenchères.
Il importe en outre de rechercher le consensus le plus large possible. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter les mémoires minoritaires au motif qu'elles susciteraient des discordes et des polémiques mais qu'il faut tenter de les intégrer, par le débat et la reconnaissance mutuelle, dans une mémoire nationale.
Il faut, enfin, prendre son temps pour que le plus grand nombre possible de citoyens se reconnaissent dans l'ensemble de ces discussions. Lorsque Lionel Jospin a appelé à la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre, il a choqué, certes, mais il a eu le mérite de lancer le débat. M. le secrétaire d'État aux anciens combattants, aujourd'hui, envisage me semble-t-il une réhabilitation au cas par cas de ces soldats. De la même manière, souligner le rôle positif de la présence française outre-mer constitue sans doute un message légitime adressé aux Pieds-noirs et aux Harkis, même s'il est exprimé d'une manière contestable, la colonisation étant fondée sur la domination et le déni de l'autre, quels qu'aient été par ailleurs les comportements personnels des colons.
Il est donc difficile de construire une mémoire collective non conflictuelle et je ne suis pas sûr que l'on y parvienne en usant de contraintes légales. Les sanctions pénales contre le négationnisme me laissent ainsi perplexe tant le risque de porter abusivement atteinte à la liberté d'expression est patent. Cette question a d'ailleurs profondément divisé l'Union européenne lors de la discussion d'une décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. L'Union a choisi de sanctionner l'apologie ou la négation des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, en particulier la Shoah, mais les pays scandinaves et la Grande-Bretagne restant très attachés au strict respect de la liberté d'expression, le texte finalement adopté précise que les États ont le choix de ne punir l'apologie ou la négation du génocide que si ce comportement apparaît comme une incitation à la haine et à la xénophobie. Cette législation a le mérite d'introduire un critère laissé à l'appréciation du juge.
Par ailleurs, tout ce qui peut favoriser la construction d'une mémoire européenne sera bienvenu, même si cela ne sera pas facile. Nous savons que les anciens pays communistes sont particulièrement sensibles aux crimes qui ont été commis au nom de cette idéologie mais ils n'ont pas obtenu que ces derniers soient assimilés à ceux du nazisme, le conseil des ministres s'étant contenté d'inviter la Commission à réfléchir à la question de savoir si l'apologie ou la négation de ces crimes pouvaient faire également l'objet d'une législation.
Enfin, il existe à ce jour deux manuels d'histoire communs franco-allemands ; un manuel germano-polonais est également en cours de rédaction. Il s'agit-là, me semble-t-il, d'une bonne façon de construire une mémoire commune.

La question de la vérité historique concerne au premier chef les historiens mais celle de la bonne santé d'un peuple nous concerne nous, les politiques. Ne faut-il pas laisser à l'historien la purgation des passions refoulées et laisser à un peuple la mémoire de sa fondation, fût-elle parfois nimbée de merveilleux ? Par exemple, l'enseignement de la seconde guerre mondiale ne doit-il pas privilégier la geste héroïque de la Résistance plutôt que le marigot de la Collaboration ? De la même manière, si l'Holodomor est devenu un souvenir fondateur pour les Ukrainiens, les Russes, eux, l'ont refoulé. N'est-ce pas là le fond du problème ?
Il est difficile de séparer la mémoire et l'histoire, la seule question des programmes scolaires suffit par exemple à le montrer. On ne peut donc séparer aussi schématiquement la catharsis du mythe. En outre, il faut faire son deuil du retour à la parole archaïque ou à la grandeur de l'État nation telle que le Lavisse l'a par exemple magnifiée. Nous sommes entrés dans l'ère du soupçon, de la distance, de la critique, du conflit, de la polysémie herméneutique. C'est là qu'est la véritable richesse de la transmission historique ! Des repères collectifs sont certes nécessaires mais ils doivent être mis en relation entre eux et avec de nombreux autres. Je ne nie pas ce que Paul Ricoeur appelait les « événements sur-signifiés » tels que le Mayflower ou la Révolution de 1789 mais outre que cette identité ne peut qu'être aujourd'hui pensée qu'en terme d'ouverture, il faut se garder, relativement à ce que disait Thomas Ferenczi sur les manuels d'histoire européens, de substituer une téléologie européenne à la téléologie nationale. Paul Ricoeur savait combien il est difficile d'accepter que l'autre raconte notre propre histoire, mais il considérait aussi que c'était une chance. Dès lors, il est possible de prendre en compte des instants mémoriels identitaires mais au sein d'une pluralité de perspectives. Par exemple, Le Tres de Mayo de Goya ne donne pas de la France une image flatteuse mais c'est cette confrontation qui enrichit l'histoire, non la prescription de mythes fondateurs à transmettre.
Enfin, en tant qu'intervenant en Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), je constate combien les jeunes agrégés ou « capétiens » en histoire sont enthousiastes à l'endroit de leur discipline telle qu'elle leur a été transmise.
Je considère quant à moi que les programmes doivent respecter la « vérité historique »…
…ainsi que le pluralisme des interprétations. Lors de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, il m'a paru tout à fait légitime que l'État mette l'accent sur les valeurs positives de liberté, d'égalité et de fraternité, ce qui n'a pas par ailleurs empêché l'organisation de colloques scientifiques pour mettre en évidence d'autres versants de ce grand mouvement. Le défilé de Jean-Paul Goude, également, tendait davantage à faire la fête qu'à célébrer la guillotine.

La sphère qui est dans la Cour d'honneur de l'Assemblée nationale et qui a été réalisée à cette occasion symbolise éloquemment, quant à elle, l'universalité des droits de l'homme. C'est donc un choix politique fondamental qui a été opéré.

Je répète : c'est le pouvoir qui a écrit l'histoire, en particulier, en URSS, Monsieur Gremetz, où la vérité officielle était en quelque sorte exemplairement celle du pouvoir politique.

Il est dommage que M. Gremetz n'ait pas vécu en URSS pour se rendre compte de ce qu'était cette vérité-là.
Dans cette optique, l'école et le manuel scolaire constituent des outils précieux - que l'on songe par exemple au Mallet-Isaac. Aujourd'hui, s'il n'est plus de vérité officielle émanant du pouvoir politique, il existe en revanche des vérités issues de groupes politiques ou communautaires que véhicule cet élément extraordinaire et ravageur qu'est le média. Vue à la télé, entendue à la radio, lue dans la presse : la vérité est d'abord médiatique. Or, les médias n'ont pas toujours le temps, dans le flux des informations, d'opérer les tris qui s'imposent et de favoriser des débats équilibrés. Dès lors, comment expliquer, par exemple, que nous ne portons pas aujourd'hui le même regard sur l'enfance qu'au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle ? Comment former un jugement aussi pertinent que possible sur le passé ?
La loi Gayssot, quant à elle, n'est-elle pas emblématique d'une crainte d'autant plus incompréhensible à l'égard des discussions historiques que le fait historique qu'elle est censé protéger n'en a nul besoin compte tenu de son évidence ? Cette loi n'a-t-elle pas abouti, dans un autre contexte, à ce que M. Pétré-Grenouilleau soit poursuivi devant les tribunaux ? Cela devrait suffire à démontrer que notre démocratie n'en est plus tout à fait une. Dieu merci, les médias ont en l'occurrence permis une réaction salutaire ! La question essentielle est de savoir si nous sommes oui ou non capables de débattre de tout et de contester l'incontestable sans risquer des ukases ?
Enfin, Mai-68 est en effet l'archétypique de la célébration médiatique à tel point que les jeunes s'interrogent sur sa raison d'être et regardent les anciens de 68 comme ces derniers regardaient les anciens combattants.
Je ne peux accepter que l'on dresse journalistes et historiens les uns contre les autres et que l'on considère la pratique médiatique comme infâmante.

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comment le simple fait de souligner la complexité du rôle des médias peut-il être jugé infâmant ?

Ce n'est pas péjoratif. C'est un élément ravageur au sens où il est pris lui-même dans le tourbillon des flux informationnels.
En tant qu'historien, je trouve que le travail des médias est extraordinaire. Je suis plutôt admiratif, par exemple, d'une émission comme « La Fabrique de l'histoire ».
L'événement, loin d'être figé et fixé, « est ce qu'il devient », affirmait Michel de Certeau. Sa factualité est évidemment bien présente mais elle s'inscrit dans une conscience collective qui interdit toute clôture. François Furet, en 1978, disait que la Révolution française était terminée. Non ! Elle demeure au centre d'enjeux politiques et sociaux, elle est toujours source d'identité. Le défilé de Jean-Paul Goude n'était pas seulement festif : il illustrait l'universalisme de 1789. C'est ainsi que le sens se construit perpétuellement et que tous y participent : parlementaires, médias, historiens. Tout ce qui relève de la prescription est en revanche contre-productif et je suis sur ce point-là d'accord avec vous s'agissant de la loi Gayssot. Avant Pierre Nora, qui a parlé avec raison de l'« effet funeste » de la « gayssotisation », deux historiens avaient été particulièrement lucides en tirant le signal d'alarme : Pierre Vidal-Naquet et Madeleine Rébérioux. L'avenir leur a donné raison.
Lucien Febvre disait en 1932 que l'histoire qui sert est une histoire serve. Les historiens ne peuvent accepter l'instrumentalisation de leur discipline. Il faut respecter leur liberté ainsi que celle des enseignants. Si les pouvoirs publics ont leur mot à dire sur les programmes scolaires, les spécialistes également, de même que la société toute entière. Ce n'est donc qu'au terme de ces discussions que des compromis sont passés et que des équilibres, toujours précaires, sont trouvés.
Les médias ont évidemment un rôle éminent à jouer dans les commémorations, non pour diffuser des vérités officielles mais pour être à l'écoute de la conscience collective, d'une manière aussi pluraliste que possible. Ils ont certes leur défaut, comme ces effets d'emballement que l'on constate aujourd'hui autour de Mai-68 ou cette propension à la vulgarisation qui les amène à opter pour la facilité consistant à faire toujours appel aux mêmes historiens et aux mêmes philosophes…
…qui ne sont pas en outre les plus reconnus de leurs pairs. En même temps, la presse écrite ou audiovisuelle fait son travail en s'efforçant de donner la parole aux historiens le plus souvent possible.

Je vous remercie pour vos propos. Vous avez pu constater combien notre mission est complexe ! Nous tournons parfois un peu en rond mais vous nous avez aidé à sortir de cette compulsion de répétition !
Je suis frappée par le fait que certains collègues ne semblent pas accepter la réécriture de l'histoire en fonction des périodes puisque cette discipline implique au contraire une interrogation permanente : il n'y a pas d'histoire officielle.
J'ai par ailleurs eu l'occasion d'enseigner en IUFM et je crois qu'il faut toujours insister sur l'éducation civique et l'esprit critique. L'histoire sert à former les citoyens qui auront un esprit suffisamment critique pour savoir, le moment venu, se défaire de leurs maîtres. Ces questions passionnent les élèves.
Enfin, une ouverture en direction de l'Europe est également essentielle. J'ai eu l'occasion de réfléchir à l'élaboration des programmes européens et je me suis rendu compte combien Napoléon, par exemple, était un thème crucial, de même que Jeanne d'Arc. Nous serions sans doute bien inspirés de réfléchir au point de vue des autres pays.
Vos travaux ont-ils d'ores et déjà été finalisés ? Une nouvelle législation sera-t-elle adoptée ? L'abrogation de la loi Gayssot est-elle pensable ?

L'histoire n'est pas écrite à l'avance (Sourires) ! Les parlementaires veulent élargir leur réflexion à des questions taraudantes sur lesquelles ils tournent un peu en rond. Nous avons besoin de vous pour essayer de sortir de ce cercle infernal.

Non seulement nous n'avons pas de télos, en effet (Sourires), mais chacun vient parfois avec ses propres préoccupations.

Ce qui n'est pas inutile.
Je vous remercie, Messieurs, pour votre participation à nos travaux.