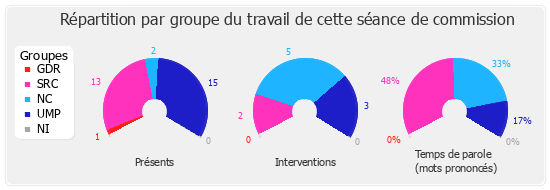Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Séance du 7 octobre 2008 à 18h15
La séance

Mes chers collègues, nous accueillons M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, et M. Michel Prada, président de l'Autorité des marchés financiers, un an après la réunion au cours de laquelle avions évoqué le début, aux États-Unis, de la crise financière due aux subprimes.
Cette crise s'est depuis très sensiblement aggravée et s'est propagée, par le biais notamment de la titrisation, à l'ensemble des marchés, aboutissant aujourd'hui à une crise de confiance généralisée.
Nous souhaitons que vous vous exprimiez de la façon la plus directe sur la situation du système bancaire en Europe et en France, notamment en ce qui concerne la présence d'actifs « toxiques » dans le bilan des banques françaises, l'état des échanges interbancaires, les risques de resserrement du crédit et les menaces d'aggravation de la crise du fait des ventes à découvert et des CDS. Peut-être, Monsieur le gouverneur, nous indiquerez-vous également des pistes pour endiguer, voire prévenir ce type de crise.
Pour comprendre cette crise, il faut s'arrêter un moment sur la situation américaine.
Aux États-Unis, la crise y a connu un tournant décisif avec la faillite de Lehman Brothers, qui a provoqué une crise de confiance généralisée asséchant le marché interbancaire : les gestionnaires de fonds réduisant leurs achats de papier bancaire ou raccourcissant la durée de leurs dépôts auprès des banques, celles-ci hésitent à se prêter les unes aux autres. D'autres épisodes ont suivi, tels que le sauvetage d'AIG, compagnie d'assurance dont l'engagement dans des activités financières très exposées constituait aux yeux des autorités américaines un risque systémique. Ces inquiétudes se sont étendues aux fonds monétaires, qui ont connu aux États-Unis une baisse de leur valeur liquidative et des mouvements de retrait.
C'est cette situation qui a justifié l'adoption du plan Paulson, par lequel les autorités américaines achètent des titres supposés illiquides afin d'éliminer l'incertitude pesant sur la valeur des actifs bancaires comptabilisés selon la méthode du mark to market, et donc sur les institutions bancaires elles-mêmes. Même si ce plan est globalement positif, puisqu'il tend à stabiliser le système financier, ses modalités d'application sont aujourd'hui encore imprécises, notamment en ce qui concerne un élément aussi important que le prix d'achat de ces actifs.
En Europe, la situation est très différente, le secteur bancaire n'y étant pas surchargé d'actifs de mauvaise qualité comme aux États-Unis ; c'est principalement via leurs activités américaines que les banques européennes ont été touchées. Cependant, le fonctionnement du marché interbancaire souffre de problèmes de liquidités du même type, même s'ils sont moins graves. Malgré l'intervention des banques centrales, le secteur bancaire connaît une crispation telle qu'on en arrive à des situations absurdes : on a vu ces derniers jours des banques emprunter auprès de l'Eurosystème des facilités marginales de plusieurs dizaines de milliards d'euros pendant que d'autres banques y déposaient des excédents de liquidités deux fois plus importants. Cet exemple traduit le degré de paralysie du système bancaire.
Face à cette situation, la France et ses partenaires européens ont déclaré, à l'issue du Sommet qui s'est tenue hier à l'Élysée, qu'ils remédieront à toute défaillance du système bancaire. Tous les dépôts seront de facto garantis puisque les institutions financières seront elles-mêmes protégées, dans le respect des intérêts des contribuables. Cette solution, proposée par la présidence française et discutée aujourd'hui même par le conseil Ecofin de Luxembourg, semble gagner du terrain ; elle a déjà été appliquée par certains États, à certaines institutions bancaires, soit individuellement, soit collectivement.
La solution d'une recapitalisation via un fonds européen, sur le modèle retenu par le plan américain, a été à juste titre écartée, et ce pour trois raisons : premièrement, rassembler des crédits aussi considérables, bien supérieurs a priori aux besoins du système bancaire européen, aurait suscité des craintes inutiles ; deuxièmement, le pouvoir budgétaire relève dans notre organisation actuelle de l'État national ; troisièmement, le sauvetage de Dexia ou celui de Fortis ont prouvé que les État étaient capables d'agir rapidement et conjointement dès lors qu'il y a identité de doctrine.
Nos banques sont également exposées directement, notamment à travers les monolines, dont les risques n'étaient pas avérés il y a un an. La situation a beaucoup changé depuis, la dégradation de ces assureurs d'un type particulier entraînant des dépréciations d'actifs parfois substantielles.
En tant que président de la Commission bancaire, je conserve cependant une opinion très positive sur les banques françaises : elles sont solides et profitables, et je voudrais à ce propos rappeler quelques vérités d'évidence.
D'abord, le niveau des fonds propres « durs » détenus par nos banques est supérieur à 8 %, ce qui est extrêmement confortable.
Ensuite, elles ont continué à faire des bénéfices jusqu'à cet été, et je n'ai pas de raison de penser que cela ait fondamentalement changé depuis. Certes, avec 7 milliards d'euros, les sept premières banques ont réalisé durant le premier semestre un bénéfice moitié moindre qu'au cours du premier semestre de l'année précédente, mais ce montant traduit leur capacité à faire face à des dépréciations importantes.
En outre, nos banques sont des banques universelles, dont l'activité est répartie entre plusieurs métiers, de sorte que les pertes subies par l'activité d'investissement, par ailleurs très utile à l'économie réelle, peuvent être compensées par les autres métiers de la banque. À l'inverse, le modèle de la banque spécialisée dans l'investissement, si caractéristique des États-Unis, a volé en éclats, les banques américaines se convertissant toutes en banques universelles, soumises à la réglementation beaucoup plus stricte de la FED.
Enfin, sous l'effet de la pression que nous avons exercée sur elles ces dernières années dans la perspective de Bâle II, nos banques ont réalisé des progrès considérables en matière de contrôle des risques.
En ce qui concerne l'évolution du crédit, le diagnostic doit être équilibré. Jusqu'en août, le crédit, bien qu'un peu ralenti, restait dynamique, avec une progression supérieure à 10 % pour les entreprises et de 9 % pour les ménages. Ainsi, l'endettement net des entreprises continuait à progresser, en dépit d'une baisse très significative du nombre des titres qu'elles émettaient. Si les conditions s'étaient effectivement resserrées, on ne pouvait pas parler d'une restriction du crédit, mais plutôt d'un retour à la normale après quelques années où elles ont été extrêmement accommodantes.
À partir de septembre, en revanche, on assiste à un indéniable durcissement, même si nous ne pouvons pas encore le mesurer précisément, des conditions du crédit, tant en ce qui concerne les garanties demandées que les montants octroyés, dû en grande partie aux incertitudes des banques quant à leur refinancement. Si l'on ne peut pas parler aujourd'hui de tarissement du crédit, la situation est beaucoup plus tendue depuis la faillite de Lehman Brothers et réclame la plus grande vigilance de notre part. De ce point de vue, les mesures arrêtées par les pouvoirs publics en faveur du financement des PME me semblent extrêmement importantes.
Quant aux pistes d'avenir, j'en citerai deux.
Il conviendrait d'abord d'organiser le marché des dérivés de crédit. Certes, ce maillon important du système a jusqu'à présent assez bien résisté, l'organisation par la profession d'enchères collectives permettant de dénouer sans drame les positions ; il n'en reste pas moins que ce marché, entièrement de gré à gré, présente un risque important.
Plus généralement, et conformément aux préconisations formulées samedi dernier par les chefs d'État et de gouvernement européens, il conviendrait de repenser sans tabou l'ensemble de notre réglementation financière : le système des agences de notation, la gestion des risques, l'organisation des marchés, la question des rémunérations, celles-ci ne devant plus inciter au « court-termisme » et à la prise de risques excessifs. On pourrait par exemple envisager un code de bonne conduite des banques, dont la violation serait sanctionnée par des exigences plus sévères en termes de fonds propres.
J'ajouterai à l'exposé de Christian Noyer le point de vue d'un régulateur de marchés, dont la capacité d'action est relativement limitée dans cette circonstance.
Cette crise, née dans des marchés non régulés des excès de la « sécuritisation », est en effet devenue une crise bancaire et, si les autorités bancaires et gouvernementales sont désormais « à la manoeuvre », les marchés continuent à obéir à leur logique propre.
Le régulateur français s'est focalisé sur deux types de sujets. Il s'est d'abord penché sur le fonctionnement à court terme du marché, dont la surveillance relève de sa mission. Nous n'avons pas dans ce domaine découvert de réels dysfonctionnements.
Le 19 septembre, nous avons certes durci les conditions de la vente à découvert de titres des sociétés financières après que nos amis britanniques eurent, le 18 septembre, décrété sans concertation l'interdiction totale des ventes à découvert. Mais ce système est encadré depuis longtemps en France, et n'a jamais connu chez nous les débordements auxquels il a donné lieu aux États-Unis, notamment avec le recours massif au naked short selling – ventes à découvert sans possession de titres, qui ne sont pas autorisées dans notre pays. Par la suite, nos collègues de la zone euro se sont alignés sur notre dispositif. Mais, quelles que soient les différences de réglementation, le résultat a été à peu près identique, les banques britanniques ayant même été davantage malmenées par l'évolution des marchés.
Ce dispositif a été assorti chez nous de l'obligation de rendre publiques les positions nettes lorsqu'elles dépassent 0,25 % du capital des sociétés concernées et d'une ferme recommandation aux établissements financiers de ne pas se livrer à des prêts de titres visant à nourrir la spéculation. À ce jour, si les Britanniques ont maintenu leur décision, les Américains, qui avaient également décidé d'interdire les ventes à découvert, viennent d'annoncer que cette interdiction serait levée dans les prochains jours.
Le phénomène des ventes à découvert ne semble donc pas l'explication véritable de l'évolution des marchés, qui est restée chaotique.
Nous avons ensuite analysé la situation de la gestion collective destinée au grand public. Sur 7 000 à 8 000 fonds, seuls quatre ou cinq posent problème, conséquence, directe ou indirecte, de la faillite de Lehman Brothers, et ces difficultés sont sous notre contrôle. Nous avons examiné également la question des hedge funds, qui risquaient d'être entraînés dans la crise par la défaillance de leur prime broker. Nous avons élargi notre dispositif réglementaire afin d'étendre notre capacité d'intervention, notamment en prévoyant la possibilité de cantonner les actifs en difficulté, et nous sommes en train, avec le ministère des finances, de mettre en place des fenêtres de rachat, ou gates. Cette surveillance de la gestion collective se fait en concertation très étroite avec la profession et avec la Banque de France.
Quant à la régulation dans la durée, elle ne peut s'inscrire que dans un cadre international. Les principaux problèmes concernent le rôle des agences de notation dans la chaîne de titrisation, les normes comptables et les modalités de valorisation des actifs dans des marchés illiquides, ou encore la transparence de l'information. Nous avons, avec la Banque de France, été à l'origine de l'initiative visant, dans le cadre du Forum de stabilité financière, à encadrer la communication des banques cotées. Du point de vue de la qualité de l'information financière dispensée depuis le printemps dernier, les banques françaises se placent au premier rang.
La question de la transparence des marchés financiers est autrement plus délicate et s'inscrit dans la problématique plus large de la confiance, domaine dans lequel les banques centrales et les gouvernements jouent un rôle éminemment stratégique. Il s'agit de tout faire pour éviter que le « recalage » de l'économie financière n'ait des conséquences trop graves sur l'économie réelle via le resserrement du crédit aux entreprises.
Si les outils de régulation des marchés sont inefficaces s'agissant d'une problématique macroéconomique, la crise est cependant née du développement de la titrisation hors du champ de la régulation. Elle nous enseigne donc qu'il faut organiser, sinon la réglementation, du moins la surveillance des marchés non régulés, qui représentent de sept à neuf fois les volumes des marchés réglementés.
Ma dernière remarque sera pour déplorer l'absence de l'Europe en matière de régulation des marchés dans cette phase critique, du fait de l'extrême prudence des autorités européennes dans l'édification d'un système communautaire de régulation. Après le lancement du plan d'action des services financiers par Mario Monti et son déploiement par Frits Bolkestein, la dynamique s'est ralentie. Nous avons aujourd'hui la démonstration qu'il est nécessaire de muscler le dispositif européen de régulation, non pas en mettant en place un régulateur européen de marchés, mais en donnant au Comité européen des régulateurs des marchés des responsabilités plus étendues, une assise juridique plus forte et une capacité de coordination et d'animation plus grande.

Que peuvent faire les banques centrales pour rétablir le crédit interbancaire ?
A-t-on aujourd'hui une vision claire du niveau de provisions bancaires pour dépréciation d'actifs financiers ?
Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le financement des PME via des instruments tels qu'OSEO, la Caisse des dépôts, ou la mise à la disposition des banques des livrets de développement durable ? Enfin, comment enfin éviter que les assurances répétées des autorités publiques concernant la garantie des dépôts ne finissent par alimenter l'anxiété ?
Quant au crédit interbancaire, il est menacé par la crainte des banques de manquer de liquidités. Les banques doivent donc pouvoir se refinancer auprès des banques centrales, notamment via la mobilisation de garanties collatérales. Depuis l'origine, l'Eurosystème, qui s'est construit par l'agrégation des politiques des différentes banques centrales nationales, accepte un collatéral très large. Nous disposons également d'un dispositif d'opérations de refinancement à terme, héritage du système allemand. La FED, la banque d'Angleterre et beaucoup d'autres banques centrales se sont progressivement rapprochées du modèle européen en la matière.
Si le volume des liquidités que nous avons injectées dans le système bancaire ne s'est pas sensiblement accru depuis un an, variant de 400 à 600 milliards d'euros, nous en avons complètement modifié la répartition : alors qu'elle était avant la crise d'un tiers pour les opérations à long terme et de deux tiers pour les opérations à une semaine, plus des deux tiers reviennent aujourd'hui aux opérations à terme, qui ont en outre été diversifiées puisqu'elles comptent désormais des opérations à un mois et à six mois. De plus, nous continuons d'octroyer aux banques des facilités marginales d'emprunt.
Face à la dégradation du système bancaire, nous examinons la possibilité d'élargir encore le collatéral – ce qui pose de complexes problèmes juridiques – et, plus largement, celle de donner aux banques une plus grande assurance.
À votre question concernant le niveau de provisions, je réponds par l'affirmative. Ayant procédé à toutes les vérifications et inspections, nous connaissons tous les actifs des grands groupes bancaires français, la réalité de leurs créances et le niveau de leurs provisions : celles-ci couvrent bien les dépréciations d'actifs. Le caractère progressif de certaines dépréciations est dû à l'application de modèles comptables qui s'appuient sur des valeurs de marché de plus en plus affectées.
Les sept grandes banques françaises ont inscrit 18,4 milliards d'euros de dépréciations, soit 11 % des fonds propres de base, qui ont été absorbés par une partie des bénéfices. Ce chiffre est à comparer aux 150 milliards d'euros inscrits par les dix premières banques américaines, soit 44 % de leurs fonds propres de base, aux 40 milliards d'euros inscrits par les cinq principales banques du Royaume-Uni, soit 19 % de leurs fonds propres de base, aux 37 milliards d'euros inscrits par les deux premières banques suisses, soit 44 % de leurs fonds propres de base et, enfin, aux 32 milliards d'euros de dépréciations inscrits par les cinq premières banques allemandes, soit 46 % de leurs fonds propres de base.
En ce qui concerne le financement des PME, les banques ont envie de financer ces clients fidèles et seule la peur de ne pas pouvoir se refinancer peut les en dissuader. C'est pourquoi la solution du Gouvernement est excellente : elles ont tout intérêt à respecter la demande qui leur est faite de prêter aux PME les dépôts auxquels elles auront ainsi accès. L'intervention d'OSEO présente en outre l'avantage de réduire les risques encourus par les banques, notamment en matière de financement des PME innovantes.
Sur le plan de la communication de crise, je pense que la garantie des dépôts bancaires est anxiogène en ce qu'elle insinue dans l'esprit du public l'idée de la faillite. Se pose également la question du niveau de la garantie et de ce qu'elle recouvre, d'où une angoisse supplémentaire. L'État irlandais s'est engagé à garantir tous les dépôts, ce qui revient à garantir plus de deux fois le PIB irlandais : on peut s'interroger sur la crédibilité d'une telle promesse, qui peut être génératrice de nouvelles inquiétudes. Par ailleurs, les banques des autres pays européens pourraient en souffrir. Mais garantir tout le passif de toutes les banques risquerait de créer une prime à la mauvaise gestion.
Voilà pourquoi la proposition du Président de la République, à laquelle les autres pays européens semblent devoir se rallier, quand ils ne l'appliquent pas déjà, est à mes yeux la seule solution : il s'agit d'affirmer qu'on ne laissera pas tomber les banques en cas de problèmes, et que la mise en oeuvre de cette garantie supposera une pénalisation des actionnaires, un changement des équipes de direction, voire une restructuration de l'établissement.
En tant que Gouverneur de la Banque de France, je peux affirmer la bonne santé des banques françaises et la pertinence de la solution gouvernementale dans l'hypothèse, invraisemblable, où il se passerait quelque chose. Je reconnais cependant que l'équilibre entre le trop et le pas assez est très difficile à trouver : si l'on n'en dit pas assez, on ne répond pas à l'inquiétude, et si l'on en dit trop, on entretient l'inquiétude.

Je me réjouis de la qualité de cette audition, qui contribuera sans doute à rétablir la confiance.
Il y a une dizaine d'années, monsieur le gouverneur, l'AFB proposait aux membres de la commission des finances de bénéficier de formations dispensées par des professionnels. J'ai fait partie des premiers et vous des seconds. Je vous avais demandé à l'époque si la configuration du secteur bancaire en France vous paraissait adaptée aux besoins du pays. Vous estimiez que oui, tout en redoutant une concentration à laquelle la crise actuelle risque pourtant de conduire, comme on le voit avec la BNP et Fortis ou la Caisse d'épargne et la Banque populaire. Si vous persistez à penser que cette concentration est préjudiciable au financement de notre économie, que pouvez-vous faire pour l'éviter ?
Les trois arguments que vous avez développés contre la création d'un fonds européen sont très convaincants. Il me semble toutefois que certains responsables gouvernementaux avaient émis cette hypothèse. Savez-vous ce qui a pu les convaincre d'avancer cette proposition, qui a heureusement été rejetée ?
La Banque postale aurait vu affluer ces derniers jours – en raison, pour certains, de son statut de banque publique bénéficiant de la garantie d'État – nombre de capitaux. Pouvez-vous nous confirmer que des mouvements importants ont eu lieu au profit de cet établissement ?
Je « vole » la question suivante à Jean-Pierre Balligand : avez-vous les moyens de vérifier que le produit des livrets de développement durable, qui bénéficient de mesures de défiscalisation, va bien à l'aide au crédit aux PME ? Selon les chiffres que M. Balligand a obtenus de la ministre de l'économie, 52 % seulement seraient utilisés conformément à leur destination. Confirmez-vous ce chiffre ? Avez-vous les moyens de contraindre les établissements bancaires à affecter cette épargne à ce pour quoi elle est collectée ?
En ce qui concerne la concentration du secteur bancaire, je continue à penser qu'il faut une concurrence forte, mais celle-ci se fait désormais à l'échelle de la zone euro. La capacité à s'appuyer sur plusieurs marchés nationaux et à « croiser » différents métiers et différents types de clientèle sont des facteurs de résistance.
Vous avez évoqué le rachat d'une partie des activités de Fortis par le groupe BNP Paribas. Avoir une activité de banque de détail non seulement en France, mais aussi en Italie, en Belgique et au Luxembourg, est un facteur de solidité. Avoir une activité de prêt aux entreprises non seulement en France, mais aussi en Italie, en Belgique et dans les pays de l'Est, est également un facteur de solidité. Il en va de même pour le projet de rapprochement entre le réseau des caisses d'épargne et celui des banques populaires. Je n'en dirais bien sûr pas autant d'un projet de fusion entre les quatre premiers groupes bancaires français ! Il est en effet très important pour les chefs d'entreprise d'avoir plusieurs interlocuteurs capables de les accompagner sur des opérations importantes. Tout est question d'équilibre. Quoi qu'il en soit, la recomposition du secteur bancaire est en marche, et il est très rassurant que des groupes français figurent parmi ceux qui sont à la manoeuvre.
L'idée du fonds européen est venue, je crois, du gouvernement néerlandais. Il s'agissait, dans la mesure où l'on s'orientait vers une intervention des États pour soutenir les banques, que chaque État crée un fonds où il s'engage à mettre un certain pourcentage de son PIB, ce qui rendrait possible des interventions conjointes – bref, un plan européen. L'inconvénient majeur est de laisser penser qu'il existe des problèmes considérables qui ne sont pas révélés. Les rumeurs avaient fait état de 3 % du PIB et de 300 milliards d'euros : il n'en fallait pas plus pour que l'on évoque 300 milliards de pertes ! L'idée étant anxiogène, le Président de la République a proposé à ses partenaires de l'écarter.
La Banque postale n'a pas d'activité internationale et reste une banque de dépôt classique. Son statut public a peut-être une image rassurante. Mais les mouvements de capitaux que vous avez évoqués s'expliquent surtout par l'afflux de fonds sur le livret A, dont la rémunération est devenue très attractive par rapport aux autres produits. Le Codevi et les autres livrets d'épargne ont d'ailleurs eux aussi bénéficié de cet engouement. Les liquidités très abondantes de la Caisse des dépôts ont permis de diminuer le taux de centralisation du LDD et du Codevi.
J'en viens à la dévolution des fonds du LDD aux PME. D'une façon générale et sous réserve de vérification, le financement des PME par les banques est supérieur au montant collecté sur le LDD après la réduction du taux de centralisation. Cet argent est donc bien consacré au crédit aux PME. Le ministère des finances s'assure par sondages que les banques respectent bien les critères fixés. Nous pourrions le faire aussi, mais sans doute pas en ce moment. Cela étant, je ne suis pas inquiet. Il est important que la vérification soit faite, mais je m'étonne un peu du chiffre de 52 %. Il faudrait savoir comment il a été calculé.
Il a dû être calculé par l'Inspection générale des finances, mais il me faudrait des éléments plus précis pour répondre à votre question.

Disposez-vous de moyens de contrainte pour garantir, le cas échéant, que ces fonds servent bien aux PME ?
Le ministère des finances dispose en effet de tels moyens. Si la période était plus calme, nous pourrions nous aussi procéder à cette vérification.

La Banque centrale peut-elle percevoir, à travers ses opérations de refinancement, que l'on risque de passer d'une crise de liquidités à une crise de solvabilité ?
Ma deuxième question porte sur la séparation entre banque de dépôt et banque d'investissement. Je connais l'argument selon lequel nos banques, parce qu'elles sont universelles, sont plus prudentes que celles qui se cantonnent à des activités d'investissement. La séparation qui prévalait aux États-Unis avait cependant sa cohérence : l'État se devait de garantir une banque de dépôt, qui remplit une mission de service public, mais pouvait accepter la faillite d'une banque d'investissement, qui est une entreprise comme une autre. Certes, une telle séparation n'est pas envisageable en Europe. Mais ne faut-il pas traiter différemment les banques qui sont principalement des banques de dépôt et celles qui prennent un peu plus de risques ?
La crise actuelle est venue pour une bonne part de la titrisation – celui qui accorde le crédit s'en défausse assez rapidement en émettant des titres, le risque étant alors disséminé. Peut-on faire en sorte, dans un monde globalisé, que celui qui accorde le crédit initial supporte l'essentiel du risque ?
Les accords de Bâle II n'ont pas été complètement mis en oeuvre. S'ils l'avaient été, ce qui aurait notamment conduit à réintégrer la titrisation dans le bilan des banques, les comportements auraient-ils significativement changé ?
Peut-on étendre la régulation bancaire aux institutions non bancaires émettant des crédits – je pense aux hedge funds, mais aussi à beaucoup d'autres ? Ce sont en effet le plus souvent les institutions non bancaires qui sont à l'origine des crises.
Si la crise de liquidités ne trouve pas de réponse, l'incident survient, et c'est alors que l'on passe à une crise de solvabilité. Mais, s'il y a une leçon que je tire de la crise, c'est qu'il est essentiel que la mission de supervision bancaire soit confiée à la Banque centrale, fût-elle appuyée sur une commission où l'État est présent, comme c'est le cas en France. Nous sommes ainsi à même, à tout moment, de « croiser » les informations avec la certitude que nous les avons toutes. Des drames et des faillites se sont produits dans des pays voisins parce que les informations n'avaient pu être « croisées » à temps et que la banque centrale n'en disposait pas. Aux États-Unis, les responsabilités de supervision bancaire tendent à repasser plus largement à la FED depuis la crise. Le croisement des informations sur la liquidité et sur la solvabilité est en effet le meilleur antidote aux drames.
La séparation entre banques commerciales et banques d'investissement ne fonctionne plus, comme l'a démontré le cas de Lehman Brothers, banque d'investissement qui n'était pas soumise aux mêmes réglementations que les banques de dépôt et qui échappait à la surveillance de la FED. Depuis, les banques d'investissement se sont toutes transformées en holding companies et sont passées sous la supervision de la FED. Quant aux banques commerciales, elles semblent plus solides dans la mesure où elles sont largement financées par les dépôts. Ma conviction est donc qu'une banque universelle est plus solide.
Peut-on faire porter l'essentiel du risque sur le prêteur de départ ? Cette question est en cours d'examen sur le plan du principe, mais y répondre n'est pas facile car le risque peut être neutralisé par l'assurance ou la garantie, ce qui peut donner l'illusion qu'on a maintenu une partie du risque sur lui.
À l'avenir, la titrisation sera de toute façon différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent : elle se fera sur des produits plus simples, plus homogènes et plus transparents. C'est en effet parce qu'on a élaboré des produits très complexes et très opaques que la crise de confiance est survenue. Je pense que le marché va discipliner tout cela.
Mais la vraie réponse, vous l'avez dit, se trouve sans doute dans l'extension de la réglementation à toutes les institutions faisant du crédit – en mettant à part les hedge funds, puisqu'il ne s'agit pas là d'opérations de crédit, mais de marché. Le drame des subprimes s'est noué parce que le modèle de réglementation bancaire américain était moins bon que le modèle européen. Qu'est-ce en effet que les subprimes, sinon du crédit distribué par des courtiers en dehors de toute réglementation et de toute surveillance, puis mis en place par des banques d'investissement échappant à la réglementation bancaire et employant des conduits, c'est-à-dire des instruments de type OPCVM, non réglementés et non surveillés ? Cette crise n'aurait pas pu arriver en France, où tous ceux qui font du crédit sont soumis à la réglementation bancaire européenne. L'Europe peut être fière de son modèle de réglementation bancaire ; elle pourrait le proposer au reste du monde, en particulier aux États-Unis.
Vous avez évoqué Bâle II et la comptabilité. Oui, il y a une différence entre les normes comptables appliquées en Europe et celles appliquées aux États-Unis. En Europe, les entités de type conduit qui sont « sponsorisées » par une banque doivent en principe être consolidées dans les comptes consolidés. Le risque pris est donc intégré. Dans les comptes « à l'américaine », ils ne sont pas consolidés en l'absence de participation au capital. Il faudra harmoniser tout cela. Les accords de Bâle II permettent par ailleurs de prendre en compte une garantie de fait. Leur mise en oeuvre aurait donc réduit les risques de la crise actuelle.

Nous avons un peu vécu, durant toutes ces années, sous la dictature des agences de notation américaines. Or elles n'ont pas vu venir la crise des subprimes ! Qui nous dit que cet outil, sur lequel on devrait pouvoir compter pour alerter sur la mauvaise qualité d'une institution de crédit, ne faillira pas à nouveau ? Ne doit-il pas se réformer ?
Pour briser le monopole des agences américaines, on avait un temps évoqué la création d'une agence de notation européenne. Serait-ce utile pour prévenir les crises ?
On ne peut répondre hic et nunc à cette question. Entre 1995 et 2000, nous avons voulu initier un processus de surveillance des agences de notation. Nos amis américains ne se sont pas prêtés à cette démarche. Après les affaires Enron et WorldCom, notre organisation mondiale, l'OICV, s'est enfin penchée sur le sujet. Elle a conçu un premier code de conduite, qui ne portait que sur la fonction classique des agences, la notation des émissions obligataires des grands émetteurs. On n'a pas vu assez tôt que les agences avaient développé à partir de 2003-2004, dans des conditions critiquables, une nouvelle activité, la notation des produits structurés, ceux-là mêmes qui sont à l'origine des difficultés actuelles. L'AMF a été la première institution à poser le problème en 2005. Elle y a d'ailleurs consacré son rapport 2006 sur les agences de notation.
Le code de conduite de 2004 a été complété en mai dernier pour traiter spécifiquement de la problématique des produits structurés. Cela ne résout cependant pas tous les problèmes. Il n'existe toujours pas de véritable surveillance des agences de notation, qui entretiennent une relation ambiguë avec leurs opérateurs.
Deux pistes sont aujourd'hui explorées : la première consiste à constituer un dispositif de surveillance mondial en s'appuyant sur le code de conduite, la seconde à faire de même au niveau européen. Des discussions ont été ouvertes à cet effet à l'initiative de la Commission européenne. Je pense pour ma part que les agences devraient être surveillées de manière globale par le Comité européen des régulateurs de marché, en coopération avec le Comité des régulateurs bancaires et peut-être celui des régulateurs d'assurances, la surveillance au quotidien relevant des régulateurs nationaux.
Il existe trois grandes agences, dont l'une, je le rappelle, a des capitaux européens même si son siège est aux États-Unis. Il y en a désormais ailleurs qu'aux États-Unis – au Canada, au Japon –, mais nous restons en présence d'un oligopole. La difficulté est que la profession n'est pas organisée. Il faudrait qu'elle le soit pour pouvoir construire un vrai dialogue avec les régulateurs. Cela prendra du temps, mais c'est désormais une hypothèse crédible.

Vous avez évoqué le rôle objectif des provisions dans le déroulement de la crise, monsieur le gouverneur. Y a-t-il des conclusions à en tirer pour les normes comptables ?
Il ne faut pas récuser le principe de la valeur de marché, mais c'est de la folie de le pousser à l'extrême. L'AMF et la Banque de France ont mené ce combat, avec beaucoup de leurs partenaires européens, contre les « ayatollahs » des normes comptables dites fair value, qui rêvent de les étendre, y compris aux capitaux propres. Cela aurait par exemple pour conséquence que, lorsque le prix de vos obligations baisse et que leur taux augmente parce que vous êtes en difficulté, votre passif baisse et vous dégagez un profit… jusqu'au moment de la faillite ! Bref, on arriverait à un résultat absurde. Nous avons donc résisté à ce mouvement qui avait gagné l'IASB. La Commission européenne avait malheureusement commencé par se plier à ses décisions. Nous n'avons cependant pas été jusqu'au bout.
La crise a ensuite montré que la valorisation à la valeur de marché ne fonctionne que lorsqu'il y a un marché. Quand celui-ci disparaît, on ne peut valoriser que sur la base de valeurs de référence qui sont difficiles à fixer s'il n'y a que des « ventes à la casse ». L'une des pistes qui pourrait être mise en oeuvre d'ici à la fin du mois consiste à autoriser les banques à opérer des transferts de portefeuilles. Puisqu'elles garderont jusqu'au bout des actifs aujourd'hui considérés comme invendables et qui sont valorisés à la valeur de marché, il faut leur permettre de les transférer dans des portefeuilles où ils ne seront plus valorisés en valeur de marché. À l'avenir, nous devrons être beaucoup plus restrictifs sur le contenu des portefeuilles valorisés en valeur de marché, très prisés jusqu'alors puisque cette valeur montait.
Le monde est en train de changer. Nous avons connu une période où le dialogue était très difficile, la thèse selon laquelle il fallait être plus modéré dans l'utilisation de la théorie de la full fair value étant combattue par des acteurs très importants – les banques d'investissement, mais aussi les régulateurs américain et britannique. La crise les a conduits à changer de position. La SEC a ainsi publié il y a quelques jours une interprétation des règles du FASB conforme à ce que nous souhaitions depuis longtemps et sur laquelle l'IASB vient de s'aligner. C'est donc une approche plus raisonnable qui devrait désormais prévaloir, la valeur de marché restant tout de même la référence la plus pertinente dans une économie de marché, pourvu qu'il y ait un marché.

On parle beaucoup des banques, monsieur le gouverneur, mais peu des assurances. Or beaucoup de sociétés d'assurances ont investi leurs réserves en valeurs mobilières ou immobilières. Une partie d'entre elles ne respectent donc plus leurs ratios aujourd'hui. Quelle est votre analyse à cet égard ?
N'étant pas le régulateur, je ne peux vous répondre complètement. Il me semble néanmoins que la structure des risques n'est pas identique : pour l'assurance, le principal risque est au passif ; pour la banque, c'est un risque de crédit, qui est à l'actif. On retrouve cependant la question de la valorisation, qui devrait encore plus, en matière d'assurance, être cohérente avec l'horizon de placement : si les méthodes de valorisation des fonds qui doivent être investis à long terme créent une volatilité comparable à celle d'un fonds investi à court terme, on donne une image fausse.
Ces débats complexes seront tranchés dans le cadre de la directive Solvency II. En tant que régulateur de marché, nous redoutons les conséquences d'une comptabilisation conduisant à une vision « court termiste », à savoir une réduction des emplois des compagnies d'assurances dans les placements longs. Or l'un des enjeux aujourd'hui est d'arriver à allonger le terme des placements et à reconstituer un marché d'actions plus significatif.

Je pense que les assurances vont rencontrer le même problème de solvabilité que les banques. Je connais déjà beaucoup de petites mutuelles qui n'arrivent plus à respecter leurs normes.
Ma deuxième question s'adresse plutôt au président de l'AMF : ne faudrait-il pas prendre des mesures temporaires pour briser la spéculation ? Après les spéculateurs à la hausse, nous avons aujourd'hui les spéculateurs à la baisse. Faut-il vraiment continuer à autoriser la spéculation à découvert à 100 % ?
Nous sommes peu favorables à l'idée d'intervenir dans le fonctionnement normal du marché. J'ai évoqué tout à l'heure la position que nous avons prise sur les ventes à découvert. Nous avons considéré que c'était la vente à découvert à nu – on passe un ordre à terme sans posséder le titre – qui était dangereuse, dans la mesure où elle peut conduire à négocier un volume de titres supérieur au montant des titres émis. Nous avons donc estimé que les ventes à découvert devaient être sécurisées ab initio par l'emprunt, et à 100 %, règle différente de celle qui prévalait aux États-Unis. Dès lors, la vente à découvert présente un certain nombre d'avantages et peu de risques. L'expérience montre que les interventions du régulateur pour arrêter le marché sont en général dommageables.
Là, vous êtes à 100 % : vous devez avoir le titre lorsque vous passez l'ordre à découvert.
Je parle ici de la vente à découvert sur les titres. Je constate que les différences de réglementation entre pays n'ont pas conduit à modifier les mouvements des marchés. Ce sont les fondamentaux qui créent les marchés. Le régulateur de marché ne peut pas intervenir sur les anticipations des agents économiques, si ce n'est pour s'assurer que l'information est correcte.
Les marchés des matières premières sont un peu différents, monsieur de Courson. Nous intervenons cependant peu, car ils sont pour l'essentiel aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais il est vrai que se pose la question de la bonne constitution des garanties données par les opérateurs.

Un marché ne peut fonctionner sans un minimum de transparence. Or les produits ne font l'objet d'aucune classification selon ce critère. Ne faudrait-il pas que les autorités de régulation des marchés donnent des notes de transparence aux produits comme les Sicav de Sicav ?
Je ne retiendrai pas cette distinction. Il y a, d'une part, les produits qui sont régulés sur des marchés organisés ou réglementés et, d'autre part, les produits de nature contractuelle, qui s'échangent sur des marchés de gré à gré. Le procès que vous faites doit être fait aux marchés de gré à gré : il n'y a pas de défaut de transparence sur les autres. Le problème s'est posé sur les produits de taux et de dérivés, dont la masse s'est développée en dehors des marchés réglementés et organisés.
Il y a eu deux écoles dans le débat sur la transparence : la nôtre défendait au moins une transparence post-marché sur les marchés de gré à gré, mais d'autres estimaient qu'il s'agissait de marchés entre professionnels auxquels la transparence n'était pas nécessaire. La crise a démontré que notre thèse était la bonne, et elle est en train de gagner.
Dans le cas d'un fonds agissant en direct, Sicav ou FCP, la notice décrit assez bien les investissements possibles, même si des gérants ont pu se tromper. En ce qui concerne les fonds de fonds – ou fonds au carré, les fonds au cube étant interdits – nous avons autorisé, avec parcimonie, des fonds de hedge funds, sous certaines conditions et selon certains critères, qui figurent dans la notice. La transparence est donc assez bonne. Nous exigeons un panachage de différents styles de gestion. le problème le plus sérieux que nous ayons rencontré est celui des produits se présentant comme des sortes d'obligations alors qu'ils sont très complexes, et donc fragiles.
Ces produits ont perdu leur identité de produits longs par le jeu de la titrisation. Ils ont été refinancés à court terme par des banques non régulées, qui n'en faisaient pas moins de la transformation. Ces conduits, dans lesquels on a logé les produits titrisés, sont allés ensuite sur le marché lever du papier commercial à court terme. Nous devons donc reprendre les choses en main, mais il est vrai que tout cela s'est fait essentiellement aux États-Unis.

Personne n'ose poser cette question : à quoi servent les agences de notation ? Personnellement, je ne vois pas ! Je les ai vues pratiquer : ce n'est pas en venant déjeuner avec vous et en vous faisant payer qu'elles peuvent apprécier la réalité du risque ! Je trouve donc leur activité perverse : elles donnent à penser qu'il y a une sécurité là où il n'y en a pas. Si l'on maintient ces agences, il faut poser la question de leur responsabilité. N'ont-elles pas donné des triples A à des structures défaillantes ?
Je ne vous suis pas complètement. L'agence de notation est à l'origine une entité qui exprime librement une opinion à la demande d'un émetteur.
Certes, mais ce n'est pas interdit ! Les agences ont longtemps rempli correctement leur mission sur les émissions classiques : leurs jugements se sont révélés assez justes sur le positionnement relatif des dettes. Il a fallu de grands scandales, provoqués par des fraudes, ou des changements de paradigme pour qu'elles soient prises en défaut.
Elles ont ensuite fait un deuxième métier, consistant à donner des notes à des produits complexes alors qu'elles étaient impliquées dans leur process de fabrication, et dans des conditions qui ne permettaient aucun contrôle public – ce qui n'est pas le cas lorsqu'on note une obligation émise, par exemple, par une grande entreprise automobile ou pétrolière.
Les agences se défendent en disant qu'elles n'ont pas noté la liquidité des produits complexes, mais la probabilité de défaut à l'échéance. Le paradoxe est que pour un certain nombre de produits dont la valeur s'est effondrée, le coupon continue d'être payé !
La responsabilité des agences est donc la même que celle d'un journaliste qui donne un conseil.
Les agences sont des émetteurs d'opinion, mais leur responsabilité « civile » est en effet très faible. C'est d'ailleurs leur thèse. Leur responsabilité est donc quasiment impossible à mettre en cause, à moins de démontrer une intention de nuire. Nous avions publié il y a un an et demi une étude démontrant que la moitié du chiffre d'affaires de certaines agences provenait soudain des produits structurés sur lesquels elles ne faisaient aucun chiffre d'affaires il y a quelques années.
Pour pouvoir mettre les agences en cause, il faudrait qu'elles aient une mission qui les rende acteurs du marché régulé, et donc responsables. Or cela n'a pas encore été fait.
Nous ne pouvons pas nous isoler ainsi !

Monsieur le gouverneur, ma question concerne les CDS.
Selon la BRI, l'encours de ces contrats financiers, équivalant à des contrats d'assurance contre la défaillance d'une entreprise, s'élèverait à 62 000 milliards de dollars. Les banques françaises ont-elles acheté ce type de protection ? Dans l'affirmative, à quel niveau estimez-vous l'encours ?
La note que vous nous avez remise se conclut ainsi : « Pour l'instant, les intervenants tentent tant bien que mal de retrouver leurs fonds et de se re-protéger, mais il faudra cependant encore plusieurs semaines pour tirer le bilan des dénouements en cours. » Est-ce à dire qu'il y aura une deuxième vague de difficultés ?

Voulez-vous en effet préciser votre appréciation de cette situation.
Vous dites que l'encours des CDS dépasse celui du marché des dérivés actions, mais qu'il reste inférieur à celui des dérivés de taux d'intérêt. Peut-on avoir une idée de ces différents encours ? Quelle est la vulnérabilité de ces marchés ?
Ne nous faisons pas peur ! Le total notionnel des dérivés de toute nature s'élève à 600 trillions, mais on additionne là des opérations qui se compensent largement les unes les autres.
Les mécanismes d'assurance et de couverture sont légitimes. Leur fonctionnement est encadré par des conventions élaborées par les professionnels. Si les opérateurs ont bien géré ces produits, il n'y aucune raison que cela ne fonctionne pas normalement. Ce qui est en cause, c'est en fait l'impact des produits toxiques de base qui ont pollué le produit final par le jeu des transformations successives. À ce stade, il me semble que ce qui se passe depuis un an devrait avoir en partie purgé le système. J'observe au passage que les 700 milliards du plan Paulson sont revolving : si ces produits sont achetés et revendus, l'effet de levier sera encore plus important.
En ce qui concerne les CDS, la note indique simplement que les événements récents ont créé une situation dans laquelle beaucoup de choses ont dû être dénouées. Cela semble se passer assez bien. Il ne s'agit pas d'une alerte !
Le marché des CDS est un cas typique de l'absence préjudiciable de transparence post marché. Même s'ils ont sans doute été trop utilisés, les CDS ne sont pas un mauvais instrument. Mais ne pas voir les risques finaux qui sont couverts pose indéniablement problème. Les régulateurs et le secteur privé sont maintenant d'accord pour faire des efforts de transparence, et j'ai bon espoir qu'ils puissent aboutir en 2009.
Autre raison d'être optimiste : chaque grande banque française a expliqué en détail – c'est disponible sur Internet – les provisions qu'elle a à passer sur ses achats et sur ses ventes de protections. Le socle est donc solide. La véritable interrogation porte sur le « netting », la compensation que personne n'est capable de calculer : autrement dit, personne ne sait où sont ces trillions ni comment ils se compensent. Mais nous considérons que c'est assez bien piloté ex post.

Monsieur le gouverneur, Monsieur le président, Monsieur le secrétaire général, je vous remercie pour cette passionnante audition.